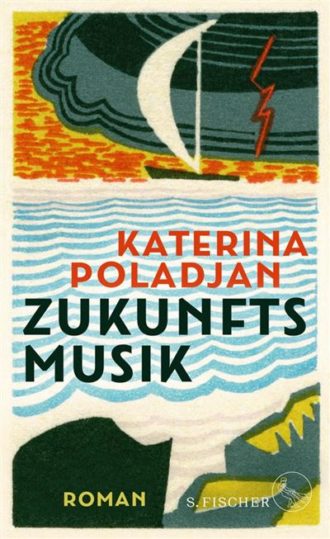Musique du futur
Jusqu'à samedi, nous publions chaque jour en avant-première des extraits des cinq romans finalistes du Prix Grand Continent, qui sera remis le dimanche 18 décembre à 3466, au cœur du massif du Mont Blanc. Aujourd'hui, pour la première fois en français, nous vous offrons de longs extraits du roman de Katerina Poladjan, Zukunftsmusik, qui nous plonge dans l'atmosphère insolite d'une Russie entre deux époques. La musique du futur est déjà dans l’air, mais la vie continue comme dans un interrègne — tantôt comique, tantôt tragique.
p. 9-26
1
À des milliers de verstes ou miles ou kilomètres à l’est de Moscou, l’ossature d’une station radar s’élevait dans le ciel nocturne, faiblement éclairée par les lampes d’une usine d’ampoules allumées constamment. Il faisait doux en ce mois de mars, la température était juste en dessous de zéro et le sol sablonneux de la friche recouvrait la neige sale. La neige brillait aussi sur la berge, où la rive tombait à pic ; derrière, les étoiles projetaient leur faible lueur à l’horizon circulaire, c’était joli, et plus bas, Ianka le savait bien, le courant paresseux et noir comme le goudron emportait tout avec lui, même le temps. Ianka s’assit sur un tronc d’arbre, remonta la fermeture de sa parka et s’alluma une cigarette. Sa main sentait l’aigreur du métal.
Au beau milieu du service de nuit, le contremaître était venu voir le personnel, il avait brandi un transistor qui entonnait la marche funèbre de Chopin. Vous savez ce que cela signifie, avait-il dit avant d’ajouter que ce n’était pas une raison pour se laisser abattre, l’Union soviétique avait plus que jamais besoin de lumière.
Plus que deux heures avant le lever du soleil. Ianka jeta sa cigarette et la regarda se consumer dans le sable froid.
2
Matveï Alexandrovitch fut tiré de son sommeil par un vacarme et le bruit des pieds qui traînent dans le couloir. Il tâtonna sur la table de nuit à la recherche de sa montre-bracelet, et Gagarine glissa de sa poitrine. Il n’était même pas cinq heures et demie, et Matveï espérait que Ianka ne réveillerait pas tout de suite son enfant, comme elle avait l’habitude de faire après le service de nuit, l’enfant pleurnicherait et dérangerait sensiblement sa routine matinale. Il écouta et gratta Gagarine à l’arrière des oreilles. L’an passé, le poil du vieux matou avait blanchi, et Matveï avait tout de suite craint la mort de Gagarine, mais il n’y pensait pas.
Matveï Alexandrovitch se leva et alluma la radio. Ils passaient le troisième mouvement de la sonate pour piano no2 de Chopin, la marche funèbre. Il baissa le son, se positionna à côté du lit en sous-vêtements, se grandit sur la pointe des pieds, ce qui sonnait le début de sa gymnastique quotidienne, quand la petite Krochka se mit à piailler. Matveï se laissa retomber sur les chevilles et tendit l’oreille. L’enfant se tut. Ce qui laissait encore entrevoir la possibilité que tous ne fussent pas réveillés et n’apparaissent pas sous peu dans la cuisine communautaire. Matveï Alexandrovitch enfila peignoir et pantoufles, traversa sa chambre en deux pas et se faufila en face. Il s’arrêta brièvement dans le couloir, il y avait du bruit dans la chambre du professeur, comme si quelqu’un toussait dans le pavillon d’un tuba.
Il y avait une grande casserole de riz avec des morceaux de viande sur la cuisinière des Karisen. Sans allumer, il prit une cuillère et mangea directement dans la casserole. La viande avait un léger goût de dinde. Ou bien était-ce du serpent ? Où les Karisen trouvaient-ils du serpent comestible ? Dans le jardin public de la ville, il n’y avait que des orvets sans défense, même en été. Il mangea encore quelques cuillérées, s’essuya la bouche sur un torchon effiloché et scruta la cuisine qui, à la lueur mate d’un lampadaire, laissait entrevoir ses lointaines origines aristocratiques.
Six parties locatives vivaient sous les vieilles moulures effritées des années de fondation et s’évitaient — autant que faire se pouvait. Matveï croisait rarement les habitants des chambres au bout du couloir, les Karisen par exemple ou le vieux professeur, qui menait une existence tellement insignifiante que Matveï oubliait sans cesse son nom. Au milieu du couloir officiait la Liebermann, à côté — dans la plus grande de toutes les chambres — habitaient les Kosolapij. Matveï échangeait surtout avec les dames dans la partie avant de l’appartement, leur chambre étant en face de la sienne.
Matveï Alexandrovitch posa la cuillère dans un baquet de couverts et de vaisselle sales. Le manque d’hygiène était un thème récurrent et fatigant dans la kommunalka, mais les Karisen finissaient toujours par ranger. Quand, personne ne le savait, on ne les avait jamais vu faire, mais parfois, au beau milieu de la nuit, Matveï Alexandrovitch avait l’impression d’entendre les Karisen s’activer avec pelle, balai et serpillère.
À côté, Ianka se faisait couler un bain, ce qui repoussait son rasage à un horaire indéterminé.
Un arc électrique sur la ligne de tension du bus dix-sept, qui passait devant l’immeuble, éclaira le visage de Mikhail Potapitch Toptygin, la tirelire qui trônait sur la grande étagère. Les habitants de la kommunalka étaient priés de glisser chaque semaine quelques pièces entre les yeux de l’ours pour les achats communautaires de savon ou de papier toilette. Mikhail Potapitch Toptygin avait constamment le ventre vide, en revanche les réserves étaient renflouées comme par magie dès que nécessaire. Là encore, il faudrait revoir le système.
Matveï Alexandrovitch regarda dehors. Une seule fenêtre était éclairée dans la rue, les gens dormaient comme des loirs. Mais à la lueur d’une lampe de chambre, deux êtres étaient enlacés sur le canapé en pleine parade amoureuse, débordants de santé, échangeant bourrades et baisers jusqu’au lever du soleil. Matveï Alexandrovitch soupira et sursauta en entendant son soupir résonner aussi bizarrement dans la cuisine. Il soupira à nouveau, cette fois plus doucement. Il bourdonna un peu, grogna, fredonna, fredonna plus fort, puis se mit à chanter :
Vous êtes tombés pour tous ceux qui ont faim,
Tous ceux qu’on méprise et opprime,
De votre pitié pour vos frères humains,
Martyrs et victimes sublimes.
Je peux savoir où se cachent les martyrs dans notre cuisine, cher Matveï Alexandrovitch ?
Il fit volte-face. Face à lui, Maria Nikolaïevna en robe de chambre rose poudre, et étaient-ce l’effet de surprise ou les boucles blondes qui tombaient sur les épaules de Maria Nikolaïevna, des boucles blondes constamment remontées en un chignon strict la journée, ou bien était-ce le col de sa chemise de nuit qui pointait sous le revers de sa robe de chambre, il ne savait plus bien, toujours est-il qu’il se laissa emporter et saisit Maria Nikolaïevna par les épaules et lui entonna la strophe suivante du chant comme s’il n’y avait plus de lendemain.
Pour prix de vos peines, la peine de mort,
Ou bien la prison pour la vie,
Du bruit de vos chaînes sont pleines encore
Les plaines de Sibérie.
Matveï, calmez-vous. Je nous fais du thé. Il y a aussi des chocolats, que je conservais spécialement pour l’anniversaire de ma mère, mais vous avez l’air d’en avoir plus besoin.
Si j’avais su qu’un chant patriotique me permettrait de savourer votre présence et des chocolats, j’aurais pris cette mesure bien plus tôt.
Maria Nikolaïevna alluma et s’affaira à sa cuisinière. Matveï Alexandrovitch contempla ses attaches, qui laissaient entrevoir une fine bande nue entre l’ourlet de sa robe de chambre et les revers de ses pantoufles fourrées. Il se laissa tomber sur une chaise. Aucune constellation, aucun soleil ne pouvait pénétrer aussi loin dans l’orbite de l’autre au point de provoquer d’imprévisibles conséquences, qui se formalisaient désormais dans le tumulte de ses pensées.
Vous savez, Maria Nikolaïevna, chaque être humain vit dans son propre monde, c’est une loi suprême qui me paraît honnête et juste. Mais votre fille Ianka vit dans un cosmos particulièrement étranger et très éloigné, et doit-elle pour cela, quand elle rentre de son service de nuit de bon matin, faire preuve d’autant d’égoïsme en réveillant immédiatement son enfant qui, en babillant et en braillant, tire alors toute la kommunalka de son sommeil ?
Vie de merde que la nôtre, dit Maria Nikolaïevna. Elle tendit une tasse de thé à Matveï, s’assit à la table avec lui et se pencha sur la boîte de chocolats. Au même moment, elle se rendit évidemment compte que cette phrase, qu’elle aimait à prononcer souvent, n’était pas adaptée à la situation. Elle ajouta donc rapidement : Mais plus pour très longtemps, car le printemps sera bientôt là et les bouleaux se pareront de petites feuilles vertes.
À propos des arbres, je dois vous dire que vous entendre parler de la texture de l’écorce d’un sorbier, d’un aulne ou même de la couleur du feuillage d’un bouleau me touche, comme si votre allocution m’était consacrée plutôt qu’aux arbres. Je suis flatté par la délicatesse de vos mots sur les arbres, qui mènent une existence tellement silencieuse et solennelle. J’aimerais ajouter une chose, mais promettez-moi de ne pas rire : le jeune moi d’il y a trente ans n’aurait pu s’imaginer sombrer un jour dans la mélancolie en pensant aux arbres.
Maria Nikolaïevna bâilla bruyamment, largement et joliment, se redressa, ôta la bouilloire du feu, écarta les vêtements suspendus aux multiples fils tendus à travers la cuisine, et finit par demander, perdue dans ses pensées : Des arbres, dites-vous ? Vous lisez trop Tourgueniev.
On alluma une radio dans la partie arrière de l’appartement, les dernières mesures de la marche funèbre de Chopin, puis un chœur entonna : Vous êtes tombés pour tous ceux qui ont faim. On éteignit de nouveau la radio.
Mais si, les arbres, dit Matveï Alexandrovitch, qui ressentit soudain une grosse fatigue, si vous le souhaitez, nous irons nous promener au jardin public dimanche prochain et je vous les montrerai.
Mais non, Matveï, rien ne vous y oblige, et puis qui sait si les arbres ne sont pas également endeuillés ces jours-ci et ne renvoient pas une image misérable.
Que voulez-vous dire, chère Maria Nikolaïevna ?
On ne peut nier le fait que Moscou pleure un autre mort. Et d’ailleurs, avez-vous le temps ?
Le temps ?
Quelle heure est-il ?
Bientôt six heures et demie. Je ne crois pas que les arbres pleurent, à l’exception des saules, évidemment. Les ormes et les bouleaux sont fondamentalement de nature joyeuse, légère. Les chênes sont parfois un peu sérieux, mais pleurer ? On a pleuré Staline, on a pleuré Brejnev, et aujourd’hui ?
Maria Nikolaïevna fixa longuement Matveï Alexandrovitch, sans rien dire. Puis elle jeta quatre morceaux de sucre dans une autre tasse et remua soigneusement.
Ton thé, Maman.
Varvara Mikhaïlovna fit son entrée, saisit la tasse, regarda sa fille et dit : Je vais bientôt mourir.
Bonjour, chère Varvara Mikhaïlovna, dit Matveï Alexandrovitch.
Varvara Mikhaïlovna grommela en retour et se tourna à nouveau vers sa fille. Où est Ianka ?
Dans son bain.
Évidemment. Suis-je bête. Soit elle est dans son bain, soit elle crie.
Elle ne crie pas, elle chante.
Et qui est mort ? Ils passent Chopin.
Ce cher Matveï Alexandrovitch pense –
Tant que rien n’est officiel, je ne pense rien du tout ! s’écria Matveï Alexandrovitch avec une véhémence inhabituelle.
Qui que ce soit le défunt, posa Maria Nikolaïevna, il faut que je me prépare. À plus tard.
Méfie-toi des Karisen, dit Varvara Mikhaïlovna.
Méfie-toi de toi-même.
Avant que vous n’y alliez, chère Maria Nikolaïevna, la salle de bains est toujours occupée par votre fille. Il faut faire quelque chose.
Et que faut-il faire, Matveï ? Que proposez-vous ?
La petite Krochka arriva à la porte pieds nus, Varvara Mikhaïlovna la prit sur ses genoux et fit apparaître comme par magie une paire de chaussettes de sa robe de chambre. Tu vas prendre froid, petite ! Mais ça ne dérange personne ici, pauvre petit ange.
Il faut qu’un homme lui parle. Pour faire acte d’autorité, vous comprenez ?
Oui, je comprends, Matveï Alexandrovitch, mais vous ne serez pas cet homme-là. Maria Nikolaïevna passa devant lui en sortant de la cuisine et frappa énergiquement à la porte de la salle de bains. Ianka, il faut sortir maintenant. Elle essaya de prendre un ton autoritaire. On entendit Ianka chanter encore quelques mesures, puis jurer.
Vous voyez, il n’y rien à faire, dit Maria Nikolaïevna par-dessus son épaule.
Remis au cœur du massif du Mont Blanc, à 3466 mètres d’altitude, le Prix Grand Continent est le premier prix littéraire qui reconnaît chaque année un grand récit européen.
3
Ianka leva la jambe gauche de son bain tiède et contempla son pied en faisant de petits cercles — un pied solide. Elle ferma les yeux ; allez, encore cinq minutes dans la baignoire. Ses membres étaient lourds. Le service avait été particulièrement long sous la lumière criarde de milliers d’ampoules. Visser, vérifier, visser, trier. Ces services de nuit éveillaient sa conscience d’une étrange manière, et Ianka développait un sens des choses sans importance. Elle revoyait ses collègues bavarder pendant la pause et, quand elle était arrivée pour fumer une cigarette à son tour, elles avaient fait les gros yeux avant de changer de sujet. Pourquoi ? C’était sans importance. Elle se fichait de ses collègues. Elle se fichait de l’usine. Elle pouvait être en apesanteur et elle pouvait être triste, elle pouvait être stupide et heureuse. Ou elle pouvait cesser — enfin cesser — de se demander comment elle pouvait ou comment elle voulait être, ou comment le monde voulait qu’elle soit. Était-elle utile, ou le monde s’en sortait aussi bien sans elle ? Sa main descendit jusqu’à son ventre, ses hanches, de petites bulles d’air remontèrent pour éclater à la surface. Elle s’immergea et nagea jusqu’à la rive, remonta à la surface. Ils étaient tous là, Pavel, Olga, Emi, Kostia et Andreï. Emi et Kostia étaient enlacés sur une couverture et se dévoraient l’un l’autre. Olga balbutiait des vers de Pasternak, Andreï surveillait le chachlik sur les braises, et Pavel la scrutait depuis la rive.
Vous pouvez m’envoyer une serviette, bande de cons, dit-elle en sortant de l’eau gelée, tellement gelée que les poissons avaient migré vers l’Afrique. Pavel ôta chemise et pantalon, courut vers elle la nouille au vent et la serra fort dans ses bras. D’accord, c’est toi ma serviette, murmura-t-elle dans la chaleur du creux de son épaule. Oui, c’est moi.
Andreï paradait athlétiquement avec la pince à barbecue et s’enfila un énorme morceau de pain blanc dans la bouche. Autour d’eux des bouleaux resplendissants, une eau étincelante et dans l’air cette impression lumineuse que l’été ne tiendrait pas sa promesse d’éternité. Le corps nu de Pavel collé à elle, Ianka essaya d’avancer, de glisser sur l’herbe comme avec des skis sur la neige, une jambe après l’autre. Tu me les brises. Elle lui pinça les bourses, il la libéra enfin et tomba par terre comme mort. Andreï envoya sa chemise à Ianka en ricanant.
Quoi ?
On chanterait pas quelque chose, Ianka ?
Pour qui ?
Pour nous.
Tu veux chanter quoi ?
Au lieu de lui répondre, il lui tendit une brochette avec des oignons brûlés et de la viande grasse, l’observa en train de mâcher. Il mangea les morceaux de gras qu’elle avait laissés de côté. C’est le meilleur et toi tu les recraches.
Ianka ajouta encore un peu d’eau chaude. Qu’est-ce qu’on était bien dans le ventre de la baignoire. J’ai encore la vie devant moi, mon Dieu, faites que j’embrasse encore beaucoup de lèvres, faites qu’on écoute mes chansons.
Ce soir, elle donnerait un concert dans sa cuisine, un kvartirnik, seule avec sa guitare, devant dix, peut-être vingt personnes. Si tout ce monde venait, ils seraient à l’étroit, et puis elle n’avait toujours pas d’instrument digne de ce nom. Il y a quelques jours, Andreï avait trébuché ivre sur sa guitare, et si la caisse avait résisté au coup de pied, la jonction entre la table d’harmonie et l’éclisse avait sauté à un endroit et le chevalet menaçait de se décoller à tout moment. Andreï avait surjoué sa gêne en ricanant, tu devrais me dire merci, Ianka, ça sonnera vraiment punk maintenant. Pavel était à deux doigts de se jeter sur Andreï, Ianka s’était interposée, Andreï s’était cassé. Pavel avait promis de trouver une nouvelle guitare, mais lui servait tout un tas d’excuses à chaque fois : Difficile à avoir, trop chère, pas la bonne pour toi, et pourquoi pas la guitare d’Andreï ? Il l’a refourguée. Et Olga, elle en a pas une ? Olga joue du violon. Ianka, je te promets que tu auras une nouvelle guitare pour ton concert. Pavel avait même dit que le célèbre B. G. était arrivé de Leningrad et qu’il voulait assister à son concert. Andreï n’aimait pas B. G., il le taxait de commercial et de traître à cause de sa copine occidentale qui faisait soi-disant passer ses enregistrements en Amérique et lui aurait ramené une Stratocaster rouge de là-bas. Avec elle, il avait pu se produire au Rock Club de Leningrad — sous l’œil du KGB, mais devant un public et sur une vraie scène. Mais peut-être que tout ça, c’étaient des mensonges.
Andreï lui avait aussi parlé d’une chanteuse appelée Diaguileva qui faisait de la musique pour elle uniquement, qui se foutait qu’on aime ou pas ses chansons. Mais cette Diaguileva était probablement une élue, traversait le pays sans crainte et l’âme brûlante, se faisait arrêter, vivait des aventures amoureuses avec d’autres élus. L’âme de Ianka aussi voulait brûler, brûler d’amour, être aimée d’un amour brûlant. Fallait-il pour cela qu’elle fasse saigner ses doigts sur la guitare comme Andreï ? Fallait-il qu’elle se fasse arrêter par la milice pour trouble à l’ordre public comme cette Diaguileva ? Ianka allait tranquillement au travail, parfois même volontiers, car contrôler les ampoules lui permettait d’oublier le monde et de composer ses chansons au rythme de la machine. Elle écrirait un titre inoubliable avant ses vingt-et-un ans.
L’eau refroidissait doucement. Elle entendait Krochka babiller joyeusement. Krochka, hier encore pendue à son sein, et elle qui s’était étonnée de voir autant de lait sortir de seins aussi petits. Une fois, Ianka s’était réveillée en pleine nuit avec le sentiment que Krochka ne respirait plus à côté d’elle, qu’elle avait perdu son souffle, que leur vie commune était terminée avant même d’avoir commencé. Elle avait visualisé le poumon vide et crié si fort qu’elle ne s’en rendait même pas compte. Ce n’est que quand sa mère et sa grand-mère se réveillèrent en sursaut et que Krochka se mit à crier à son tour de sa toute petite voix, que Ianka était revenue à la raison et avait reposé la tête sur l’oreiller. Espèce de dinde, elle dormait, c’est tout.
Si Ianka restait plus longtemps dans la baignoire, elle n’aurait pas le temps de préparer Krochka pour le jardin d’enfants et de passer quelques minutes avec elle. Elle voyait à peine l’enfant. Il arrivait que Krochka la fixe avec de grands yeux, comme surprise, comme s’il y avait un malentendu entre l’enfant et Ianka. Excusez-moi, on se connaît ? On s’est déjà croisé quelque part ? Et quand Ianka demandait à Krochka de faire quelque chose, cela paraissait faux et maladroit, il lui semblait même percevoir une étincelle de raillerie dans le regard de l’enfant. Était-ce vraiment de la raillerie, elle ne savait pas. Peut-être avait-elle simplement peur de n’avoir rien à offrir à sa fille. Et puis il y avait les remords, de laisser à sa mère le soin de s’occuper de sa fille, de dormir quand sa mère emmenait Krochka au jardin d’enfants. Maria ne disait jamais rien, ne disait jamais non, ne montrait aucun geste d’agressivité. Parfois, Ianka constatait avec effroi que sa jeune mère commençait à vieillir, elle lisait la ressemblance avec sa grand-mère sur son visage, les yeux légèrement fermés, le tressaillement au coin de la bouche.
Ianka sortit de la baignoire, se sécha et essuya le miroir embué avec sa serviette. Elle rit et observa l’effet du rire sur son visage. Brille, mon étoile, brille.

* * *
p. 178-186
21
Elle pourrait disparaître dans les montagnes où elle allait camper avec son père. Ils descendaient de voiture dans une clairière, regardaient tout autour pour constater qu’il n’y avait pas âme-qui-vive. Rien que la forêt, une mare, le ciel qui se reflétait ponctuellement dans l’eau. Le père montait la tente en silence, elle allait chercher l’eau à l’étang, attendait que son père allume le feu qu’elle puisse faire à manger. Elle savait qu’elle avait son père rien que pour elle pendant quelques jours. Ils iraient pêcher et se balader en forêt, et son père lui raconterait des histoires qu’elle écouterait sérieusement en essayant de ne pas poser de questions bêtes. La nuit, ils sont blottis l’un contre l’autre dans la tente et écoutent attentivement les bruits de la forêt, il n’est pas exclu que même des ours et des lynx errent. Ceux qui font les bruits les plus bizarres, ce sont les hérissons. Comme si une horde de bandits haletants guettaient devant la tente, armés de couteaux aiguisés. Mais elle n’a pas peur, elle se sent en sécurité avec son père. Ce sont des moments de béatitude. Quand le père dort, elle reste allongée à imaginer l’avenir. Elle aimerait s’entourer de jolies choses, et elle aimerait qu’on la laisse tranquille, qu’on lui adresse rarement la parole et qu’on lui en demande peu. Elle aimerait avoir le temps de réfléchir au pourquoi de son existence. Quand elle partage ses réflexions avec son père, il rit. Je souhaite que tes rêves se réalisent.
Un grand étui à guitare à la main, Pavel entra dans la chambre, scruta la pièce, referma la porte derrière lui, posa l’étui à guitare et s’assit à côté de Ianka sur le lit. Il était un peu pâle, seules ses lèvres étaient d’un rouge éclatant, comme s’il avait mangé des cerises.
Te voilà.
Ce n’était pas une partie de plaisir, un sacré remue-ménage. Vois-tu, Ianka, sans toucher à d’autres points, je dois dire que le sort se comporte envers moi sans pitié, comme fait la tempête avec un petit bateau en mer, une eau déchaînée, ce va-et-vient, horrible.
Tu t’es trompé de pièce, Pavel. Tu veux peut-être ajouter que ce matin il y avait une araignée d’une énorme grosseur sur ta poitrine, pour ensuite me dire qu’il n’y avait pas d’araignée du tout ?
Et tu pourrais répondre : Dans six jours, je serai à nouveau à Paris. Demain, nous montons dans l’express et disparaissons comme si nous n’avions jamais été ici.
Il serait peut-être plus adapté de dire : Mon âme et la vôtre n’ont aucun point de contact. Je vous aime, je suis si tourmenté que je ne peux pas rester chez moi ; chaque jour je fais six verstes à pied jusqu’ici, et six pour rentrer, et je ne rencontre qu’indifférence de votre part.
Qui dit ça ?
Semion Semionovitch Medvedenko à Macha. Tu es allé dans la cuisine, Pavel ?
Tout le monde t’attend. Toute la kommunalka. Ta mère, ta grand-mère et ta fille. Des amis d’Andreï et B. G. Andreï vient d’arrêter de chanter, ils sont tous assis en silence à attendre ton entrée en scène.
En silence, tu dis ?
Même cet affreux matou attend là, les oreilles dressées. Tu ne regardes pas ta guitare ?
Ianka regarde l’étui. Si, bien sûr, dit-elle, sans ouvrir l’étui pour autant. Tu parles d’un silence, écoute un peu. C’est quoi ce bruit ?
Le bâtiment va être démoli.
Non, c’est un autre bruit. Un bruit de fête. Comme si les gens s’amusaient, buvaient ensemble, discutaient et faisaient des tours d’adresse.
C’est trompeur, Ianka.
Tu te rappelles comment nous nous sommes rencontrés ? Nous avions dix ans. Tu es venu me chercher à l’école, et nous avons parlé de vers de terre.
Tu avais un écart énorme entre les incisives.
Nous avons cherché mon père. Tu voulais connaître tous les détails de sa disparition, moi je savais uniquement ce que ma mère m’avait dit : Il s’est cassé dans la taïga ! Nous avons fouillé chaque arbuste et chaque buisson du jardin public, et fatigués, nous nous sommes assis dans la grande pelouse et tu m’as fait une longue tresse dans les cheveux. Plus tard, au camp d’été, je restais éveillée la nuit et je rêvais de toi.
Dans l’étui, il y a la guitare que tu voulais.
Merci. Peut-être que je me suis trompée, à l’époque, peut-être qu’il n’existe pas ce droit à l’amour réciproque. Ianka tendit la main vers Pavel, sans parvenir à le toucher.
Si tu ne vas pas tout de suite dans la cuisine, —
Qu’est-ce qui peut m’arriver ?
Tu chantes tellement mal que tout le monde s’en va. Tu chantes tellement bien que B. G. vous emmène toi et Krochka à Leningrad — directement sur la grande scène. Il se peut aussi que tu chantes très bien, mais que personne ne comprenne ton art, personne ne l’apprécie à sa juste valeur, tout le monde bâille. Ou tu chantes mal et tout le monde est content, mais toi tu as tellement honte que tu préfères aller te cacher.
Voilà mes possibilités ?
Ils pourraient aussi dire que c’était bien, sans plus. Ou tout le monde est content, mais B. G. ne t’emmène quand même pas à Leningrad, et tu restes ici avec nous. Ou tout le monde est content, seul B. G. trouve ça moyen et provincial. Ou ta grand-mère pleure d’émotion et Matveï Alexandrovitch, votre gentil petit communiste, le signale et nous finissons tous en prison.
J’arrive. Vas-y en premier. J’ai encore besoin d’un instant.
Ianka ?
Pavel ?
Si vous retournez à Paris, faites-moi la grâce de me prendre avec vous. Vous le voyez vous-même : le pays est sauvage, les gens sont dépravés, et avec ça, quel ennui ! À la cuisine, on nous nourrit très mal. Emmenez-moi avec vous ; ayez cette bonté !
Ianka acquiesça. Pavel ouvrit la fenêtre et s’envola.
Ianka sortit la guitare de l’étui. Le vernis étincelait. Elle reposa la guitare et alla dans le couloir. À gauche, entre la cuisine et la porte d’entrée c’était le branle-bas de combat, toutes les portes étaient ouvertes, les gens faisaient des allers-retours tout excités, emportaient bagages, livres, caisses, casseroles. Personne ne lui prêtait attention, quelqu’un dit : Bon, messieurs dames, il est temps d’y aller ! Un autre cherchait son manteau, quelqu’un toussa fort et jura, j’ai bu de l’eau et avalé de travers. Quel nigaud ! En route. On ne laisse personne ici. Nous n’avons oublié personne ? Il faut bien fermer partout ! Dans l’agitation, Ianka entendit Kosolapij dire : Mes amis, mes chers et fidèles amis, la tristesse me gagne au moment de quitter notre vieille maison, notre appartement, vous voyez bien, ces murs, on dirait qu’eux aussi nous disent adieu. N’exagérez pas, cher Ipolit Ivanovitch ! Puis la voix de la grand-mère : Matveï, avez-vous vu mon nouveau foulard en soie ? Je vais le chercher, Varvara Mikhaïlovna, vous en aurez besoin, il fait froid dehors, une tempête de neige fait rage. La voilà, notre Ianka ! Où étais-tu passée, nous t’attendions !
Matveï Alexandrovitch, dites-moi, que se passe-t-il ?
Ce qu’il se passe ? demanda Matveï Alexandrovitch à son tour avant de disparaître à nouveau dans la foule. Ianka attrapa Kosolapij par la manche, attendez une minute, où est-ce qu’ils s’en vont tous ?
Le bâtiment va être démoli, il faut te dépêcher, s’écria Kosolapij avant de filer.
Démoli ?
Ou transformé, personne ne sait vraiment. Dis-moi plutôt où sont mes sabots en caoutchouc. Je dois aller à Moscou pour régler des affaires importantes, susurra la Liebermann dans l’agitation. Allez-y, allez-y ! Mais la tempête de neige ? Vous vous en sortirez. Là, Maman, je suis là, donne-moi ta valise, mais elle est toute légère, Matveï, la valise de ma mère est toute légère ! D’autant mieux, chère Maria Nikolaïevna, donnez-moi la valise. Allez c’est parti, venez maintenant ! Et les Karisen ? C’est vrai, quelqu’un a prévenu les Karisen ? Ça a sûrement été fait. Mais peut-on compter là-dessus ? Vous en posez des questions, a-t-on vraiment le choix. Il ne faut pas oublier les jeunes ! Qui a dit ça, c’est vous, Varvara Mikhaïlovna ? Non, Matveï, c’est sûrement vous. Et l’enfant, où est l’enfant ? Passez-moi le champagne et trinquons à la santé de ceux qui restent ! Beurk, ce n’est même pas du vrai champagne ! Matveï, reparlez-nous des planètes, vous voulez bien ? Plus tard ! Laissez-moi encore une minute ici, vous voyez bien combien les murs sont mornes. Cela ne vous a encore jamais sauté aux yeux ? Non, cela ne m’a jamais sauté aux yeux. Vous voyez, il n’y a pas mort d’homme. On y va maintenant, il y a encore des bottes ici, le dernier éteint la lumière en sortant.
Tout le monde se précipita dehors. Retour au calme.
Vous m’avez oubliée, se dit Ianka à voix basse.
Elle parcourut le couloir. Par terre, il y avait des tas de coton çà et là, dans l’un d’eux un panneau avec l’inscription Neige russe des premiers mois d’hiver, dans un autre un panneau avec l’inscription Neige russe à la fin de l’hiver. Ianka avança, passa la chambre du professeur et la chambre des Karisen, poursuivit jusqu’au bout du couloir, et là où elle n’était encore jamais allée, il y avait une autre porte.
Derrière s’ouvrait un paysage : le soleil était bas sur l’eau noire de la rivière, de l’autre côté l’usine brillait auréolée d’une lueur électrique, la rive abrupte juste devant. Il faisait aussi chaud qu’un soir d’été, et pourtant de la neige subsistait sur l’herbe entre les collines. À l’est, le petit bois, une silhouette sombre, et de petits cerisiers insolites fleurissaient dans toute leur splendeur sous un ciel sans nuages.
Ianka resta longtemps là à observer, aussi heureuse qu’une patiente qui retourne dehors pour la première fois après une longue maladie et sent la brise fraîche sur sa peau. Elle fit signe aux Karisen qui filaient à travers collines, et s’inclina bien bas.