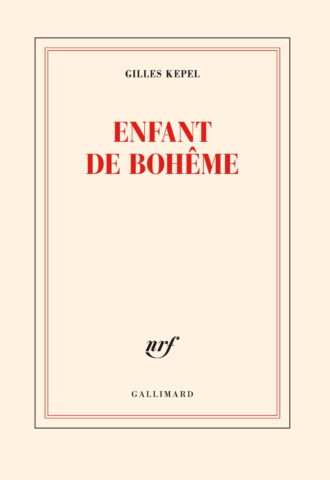« Le style est une exigence de chaque phrase », une conversation avec Gilles Kepel
Quelques jours avant la sortie de son épopée tchèque, Florian Louis a rencontré Gilles Kepel pour évoquer la lente maturation de cette première œuvre littéraire : une enquête familiale nouée autour de la lettre K. — celle du père — où l'on croise entre Prague et Paris des personnages historiques et des destins hors normes nourris de multiples coïncidences.
Enfant de Bohême est un ouvrage qui, par sa thématique, marque une inflexion dans votre œuvre. Il n’y est en effet pas question du monde arabe et de l’islamisme auxquels vous avez consacré votre vie de chercheur, mais de vos racines tchèques. Sur la forme toutefois, le ton personnel que vous y déployez avait commencé à se faire jour dans vos essais les plus récents, notamment Passion Arabe et Passion Française. C’est donc un livre qui peut tout à la fois apparaître comme étant en rupture et en continuité avec le reste de votre œuvre ?
Il s’inscrit dans la continuité de ce que j’ai publié depuis une quarantaine d’années, et dans mon esprit il n’existe nul hiatus entre les ouvrages professionnels que j’ai consacrés à l’islamisme sous ses diverses formes et Enfant de Bohême, qui est un texte littéraire par lequel je tente d’explorer « comment j’ai écrit certains de mes livres » — pour paraphraser Raymond Roussel… en allant à la découverte de ce qui m’a constitué comme arabisant. Je ne suis pas exclusivement fait d’encre et de papier, mais de chair et de sang. En juin 2016, le tueur de Magnanville, Laroussi Abdallah, m’a condamné à mort après avoir assassiné le policier Jean-Baptiste Salvaing et sa compagne, dans des circonstances atroces, au nom du jihad. Il ne s’agissait pas dans son esprit de faire un simple autodafé de mes publications, mais de me tuer en tant qu’être humain. J’ai passé près de deux ans sous protection policière, perclus de sciatique. J’en ai tiré dans l’immédiat un texte intitulé Sortir du Chaos – dont le titre était peut-être plus subjectif que le contenu… mais j’ai surtout eu le temps de réfléchir sur ce qu’était la vie qu’un jihadiste avait incité ses coreligionnaires à m’ôter. D’autant que, si j’en avais « plein le dos » – comme on dit – et les nerfs en capilotade, mon ouïe était restée intacte : je n’ai pas eu le tympan déchiré par les hurlements de douleur de mes collègues, ni par leurs cris de protestation ! Je me suis donc distancié de cet autre « corps », l’Université, auquel j’avais appartenu toute ma vie, mais pour lequel je n’étais plus qu’un mort en sursis, et me suis consacré bien davantage à poursuivre des recherches plus personnelles, me permettant de comprendre comment j’en étais arrivé là. D’autant que mon père vivait en même temps cette longue agonie de notre temps qu’est la maladie d’Alzheimer. La seule mémoire qui lui restât était celle des temps anciens et de la figure de son propre père… venu de Prague en 1908 à Paris pour traduire en tchèque Apollinaire. J’avais commencé à me plonger dans ce passé auquel je ne connaissais rien, mais les circonstances que je traversais ont accéléré le mouvement, et je me suis immergé beaucoup plus profondément dans ce qui deviendrait Enfant de Bohême, auquel j’aurai consacré une décennie de recherches comme d’écriture.
Vous éprouvez une forme de regret de ne pas vous être consacré plus tôt à la littérature ?
Non, parce que ce que j’ai fait de ma vie précédente m’a beaucoup plu et, je l’espère, enrichi, et puis on ne peut pas être et avoir été. J’ai 67 ans, j’ai formé des cohortes d’étudiants, et j’ai le bonheur d’être entouré à l’École normale supérieure d’une jeune génération parfaitement apte à prendre le relais, en laquelle j’ai toute confiance. C’est ce matériau d’une existence qui a multiplié des expériences de passage à la limite dans le magma en fusion de l’islamisme contemporain – outre ma passion pour la lecture depuis un très jeune âge – qui m’a fourni cette substance littéraire dont je vis le façonnement comme un épanouissement.
Il n’existe nul hiatus entre les ouvrages professionnels que j’ai consacrés à l’islamisme sous ses diverses formes et Enfant de Bohême, qui est un texte littéraire par lequel je tente d’explorer « comment j’ai écrit certains de mes livres » — pour paraphraser Raymond Roussel… en allant à la découverte de ce qui m’a constitué comme arabisant.
Gilles Kepel
Quel a été le déclic qui vous a permis ce passage à la littérature ?
Probablement la maladie de mon père. Notre seule conversation possible tournait autour de ses origines, mais j’en ignorais le contexte global. Je ne m’étais jamais vraiment intéressé à notre histoire familiale, ayant consacré ma vie à investiguer le présent pour réfléchir au futur. Afin de demeurer avec lui, de l’accompagner jusqu’au bout, j’ai entrepris d’exhumer tout cela. J’ai appris beaucoup de choses sur moi-même, mais aussi ressuscité une histoire de l’Europe qui est à peu près complètement oubliée. Je reviens de Prague où j’ai donné une conférence préalable à la sortie de ce livre, et quasiment plus personne aujourd’hui, ne parlons pas des gens plus jeunes que moi, mais même ceux de ma génération, ne s’y rappelle ce qu’a été cette harmonie intellectuelle et sensible entre la France et la Tchécoslovaquie, l’une des passions de l’Europe de l’entre-deux-guerres, s’achevant dans un drame calamiteux, les accords de Munich de 1938, qui signent la fin de cet amour fou. La saga familiale fournit ainsi le prisme auquel relire cette histoire engloutie, ce que l’on peut qualifier de récit « émique », ou d’égo-histoire.

Une anecdote du livre pour vous l’illustrer : Milan K., le personnage qui tient le rôle de mon père, arrivant de Bohême, est scolarisé à Paris au lycée Montaigne (où je serai aussi élève, ainsi que mon fils cadet) à la rentrée 1938, juste après les accords de Munich, il est âgé de dix ans. Au premier cours, le professeur de lettres demande aux élèves de composer des phrases en utilisant un certain vocabulaire. Parmi ces mots imposés figure l’adjectif « inévitable ». Incertain de son français, il demande conseil à Rodolphe K., son propre père qui lui suggère : » On dit que la guerre est inévitable ». Tout fier, il lève le lendemain le doigt en classe et à peine s’est-il exprimé que ses camarades imprégnés d’esprit munichois l’agressent : « Espèce de sale Tchèque, c’est à cause de toi qu’on va avoir la guerre ! ». À la récré, ils viennent le tabasser. Mais comme il avait passé l’année précédente dans les forêts de Bohême à couper du bois, il s’est fait des “biceps de bûcheron”, et leur « casse la gueule ». Il écope d’une colle, mais il a résisté aux « franchouillards capitulards » …
S’il faut toutefois que je définisse le « genre » d’Enfant de Bohême, alors appelons-le une épopée… dont Rodolphe K. serait le paladin, et son fils Milan K. l’aède !
Gilles Kepel
À quel genre appartient cet ouvrage que l’on a un peu de mal à situer, ce qui est au demeurant peut-être, volontaire. Est-ce un essai ? Un roman ? Des mémoires ?
En exergue, après les vers d’Apollinaire dans « Zone » qui constituent ma feuille de route :« Et tu retournes aussi dans ta vie lentement / En montant au Hradchin [le château de Prague] et le soir en écoutant/ Dans les tavernes chanter des chansons tchèques », j’ai rappelé cette citation des Goncourt : « L’Histoire est un roman qui a été, le roman est de l’histoire qui aurait pu être ». Robert Kopp, qui vient de republier, dans la collection « Bouquins » qu’il dirige, les romans des Goncourt, explique dans une éblouissante préface comment ils consignaient minutieusement le matériau de l’histoire en train de se faire, dans leur journal, pour ensuite le transcender par la littérature. À ma manière, je m’efforce de parcourir cette même ligne de crête, à cela près que mon matériau n’est pas contemporain, mais consiste principalement en les centaines de lettres dont le personnage de Rodolphe K. a été l’expéditeur ou le destinataire. La matière en provient de la masse de correspondance privée que j’ai retrouvée inopinément, puis prolongée par des recherches systématiques dans les archives pragoises. Paradoxalement, le prix littéraire remis au nom des Goncourt, arbitre des élégances et du cash-flow de l’édition française où les commerciaux font la loi, semble avoir oublié l’esprit même de ses éponymes pour n’en retenir que la lettre, en primant des œuvres appartenant exclusivement à un « genre », celui du roman corseté par des critères me paraissant aussi étroits que datés. Cette forme littéraire a fleuri avec la bourgeoisie industrielle du XIXème siècle à laquelle elle tendait un miroir, même si on se réfère par anachronisme aux « romans grecs et latins » ou au Roman de la Rose. Je ne suis pas convaincu que ce genre soit éternel, ni, surtout, ne corresponde adéquatement aux questions qui taraudent le présent. Il me semble au contraire que notre XXIème siècle requiert de trouver des modes de construction du récit mieux en phase avec nos préoccupations et les outils de connaissance dont nous disposons, à travers le monde virtuel notamment. S’il faut toutefois que je définisse le « genre » d’Enfant de Bohême, alors appelons-le une épopée… dont Rodolphe K. serait le paladin, et son fils Milan K. l’aède ! Mais pour complaire à l’esprit de notre temps, je me satisferai parfaitement que vous qualifiiez ce livre de… « transgenre » !

Est-ce que ce passage à la littérature, le « changement de genre » et de style, a été difficile voire douloureux pour vous ?
Pas du tout. Au contraire, cela m’a procuré un immense plaisir. Pour filer votre métaphore, appelons donc ce « changement de genre » un coming out ! Mais je n’ai pas le sentiment du tout d’avoir changé de style, « car le style, c’est l’homme même », tel que le définit Buffon, notre grand classificateur des espèces… Pour l’espèce, ou la race si vous préférez, des métèques, à laquelle j’appartiens par cette moitié de mon ascendance qui est slave, le style est à la fois un enjeu essentiel, une exigence de chaque phrase et l’objet de la plus grande délectation lorsque l’on parvient à approcher enfin l’adéquation entre le mot et la chose. Car nous autres métèques sommes particulièrement sensibles au fait qu’il n’existe pas a priori de « langue naturelle », il nous faut perpétuellement la découvrir, inventer son trésor. J’en ai eu, dans ma carrière professionnelle, l’expérience comme arabisant, apprenant incessamment cet idiome dans l’émerveillement constant d’une exploration sans fin. Or il en va ainsi plus encore pour le français, qui m’est certes familier bien davantage, mais l’exigence est d’un autre ordre car il s’agit de la langue dans laquelle j’écris — si j’adore parler arabe, je n’ai pas vocation à y devenir auteur. Je me sens tout à fait en phase lorsque Proust note que « les plus beaux livres sont écrits dans une sorte de langue étrangère ». Je me suis efforcé dans cette « épopée slave » (c’est le titre d’une série de tableaux de Mucha) d’Enfant de Bohême de recréer le style de Rodolphe K. quand il écrivait en français. Je ne disposais que d’un seul modèle, car les centaines de lettres et son journal sont exclusivement rédigés en tchèque — dont je ne connais que quelques mots de base tels pivo (bière), ou dekuje (merci) — et j’ai donc tout fait traduire, ce qui a pris des années. Cette unique exception française est la lettre qu’il adresse à Apollinaire en septembre 1911 depuis la maison de campagne de son père en Bohême. Il vient tout juste de publier sa traduction de deux nouvelles du recueil l’Hérésiarque & Cie. Guillaume est incarcéré à la prison de la Santé, soupçonné d’être mêlé au vol de La Joconde où est impliqué l’un de ses amis interlopes. J’ai reproduit quelques extraits de cette lettre dont le style m’a fasciné, on y perçoit le plaisir sensuel, presque charnel, que Rodolphe K. ressent à trouver les mots dont il use — y compris dans une petite faute, involontairement poétique, qui souligne justement cette jouissance, jusque dans l’excès, du mot le plus adéquat. Francophile passionné, il avait constitué pour l’édification de son fils Milan K. une sorte d’encyclopédie par livraison à travers des cartes postales envoyées à un rythme soutenu, comportant au recto des paysages remarquables — des Falaises d’Étretat à la cathédrale de Chartres… Au verso, il les commentait en tchèque afin de lui inculquer le goût de la France « cœur et conscience du monde ».
[Si vous trouvez notre travail utile et souhaitez contribuer à ce que le Grand Continent reste une publication ouverte, vous pouvez vous abonner par ici.]
L’écriture de ce texte a nécessité un important travail documentaire, d’autant plus compliqué que vous ne parlez pas le tchèque. Ce travail préparatoire était-il si différent de celui qui fut nécessaire à la rédaction de vos ouvrages précédents ?
Non, car j’en avais acquis la méthode — explorer les sources, réaliser des entretiens, c’était mon métier. Je l’ai transposé sans trop de difficultés, mais j’ai commencé de zéro, je ne connaissais rien au monde tchèque, il m’a fallu une décennie d’initiation — alors que mes livres « professionnels » m’occupaient entre un et trois ans… J’ai du reste rédigé les trois derniers pendant que je menais en parallèle les recherches pour Enfant de Bohême… Malgré la similarité de l’investigation, l’objet est différent : c’est un aller-retour perpétuel entre la subjectivité et l’élucidation d’un monde où celle-ci se déploie comme telle. Le livre est écrit à la deuxième personne, je m’adresse à mon père, qui n’a pas compris (et jamais vraiment accepté) que le fils d’un Tchèque soit devenu arabisant… Je me suis rendu compte que j’avais hérité d’un ensemble de poteries kabyles, rapportées d’un voyage en Algérie de Rodolphe K. en 1924. Moment-charnière dans sa vie : il a désormais décidé de demeurer à Paris, car il s’est fâché avec Édouard Bénès, l’un des fondateurs de la Tchécoslovaquie, alors que lui-même avait joué un rôle important parmi les nationalistes, il dirigeait la première revue indépendantiste, en langue française, La Nation tchèque, depuis son appartement de la rue Boissonade, à Montparnasse. Il choisit donc de faire prévaloir la Bohème (accent grave) sur la Bohême (circonflexe). Ces poteries, qui m’accompagnent jusqu’à aujourd’hui, elles sont au sommet de ma bibliothèque, comme des dieux lares, avaient-elles créé ma familiarité inconsciente avec l’aire culturelle à laquelle j’ai consacré ma carrière ? Je n’ai pu me poser la question qu’en rédigeant ce livre… Dans son appartement, où j’ai vécu mon enfance lorsque nous l’avons occupé avec mes parents après son décès, j’avais vue, de la fenêtre de ma chambrette, sur un arbre immense à la ramure bleutée : je l’identifierai plus tard comme le cèdre rapporté par Chateaubriand du Liban. Puis je suis venu moi-même au monde à l’été 1955 en urgence absolue, car mon père, naturalisé français en automne 1954, aurait été immédiatement envoyé à la guerre en Algérie s’il n’avait pas été soutien de famille — pour tuer des Arabes ou se faire tuer par eux. Peut-être ai-je ainsi explicité, en devenant arabisant, cette inflexion de notre destin d’étrangers assimilés, ai-je rendu les comptes — ou rendu compte ? Après tout je n’en sais rien, et ces hypothèses constituent justement le « pacte fictionnel » de l’épopée…

Vous dévoilez surtout la partie masculine de votre ascendance avec votre père et votre grand-père. Pourquoi est-ce que la branche féminine occupe moins de place dans cet ouvrage ? Peut-être réservez-vous cela pour un prochain livre ?
Le texte d’origine était plus long d’un tiers, mais je me suis convaincu, en échangeant avec ma lectrice Laurence Brisset, de creuser principalement ce sillon. Le matériau féminin, qui demande de longues recherches dans le village d’origine maternel dans l’arrière-pays mentonnais, auquel je fais allusion simplement dans le dernier chapitre, sera pour un texte ultérieur, qui composera un diptyque avec celui-ci insh’ Allah !
Le livre est écrit à la deuxième personne, je m’adresse à mon père, qui n’a pas compris (et jamais vraiment accepté) que le fils d’un Tchèque soit devenu arabisant…
Gilles Kepel
C’est donc un livre qui nous emmène en République Tchèque, mais aussi dans de nombreux autres lieux, au point de prendre la forme d’un récit européen.
Le titre est polysémique. Le syntagme Enfant de Bohême, quand on l’entend sans le lire, évoque d’emblée le vers que chante la cigarière Carmen dans l’opérette homonyme de Bizet : « L’amour est enfant de Bohème », mais celle-ci porte l’accent grave, elle connote Henry Murger, Puccini, Montparnasse … Or j’emploie l’accent circonflexe, qui réfère au pays tchèque d’où nous venons : et nous nous situons, la lignée des K., dans un aller-retour perpétuel entre ces accents … en passant par l’accent-hirondelle (le caron des langues slaves), que vous pouvez découvrir dans le texte… Ce diacritique que l’on lit mais n’entend pas représente l’espace qu’ouvre le livre, entre projection de soi et question des origines.
On y parcourt de ce fait des itinéraires européens car notre histoire de déplacés est issue d’une vie exilique et circulaire, à travers le ressac des haines et des passions du Vieux Continent. On voyage en Italie et au Maghreb, à Genève où Rodolphe K. dirigeait le bureau de l’Agence de Presse tchécoslovaque à la Société des Nations, en Angleterre, tant à Londres sous le blitz nazi qu’au lycée français délocalisé en Cumbria en Cumbria où Milan K. étudie …

Cette lettre K fait immédiatement penser à Kafka. On songe en premier lieu à sa Lettre au père à laquelle votre livre n’est pas sans faire écho. Quel rapport entretenez-vous avec l’œuvre de ce totem pragois ?
Kafka est un enfant de Bohême lui aussi, mais il y a dans son rapport à la littérature une dimension juive qui chez moi, contrairement à ce que j’ai lu dans la presse arabe tout au long de ma carrière… est absente. Effectivement, j’utilise dans le livre ce glyphe du K comme une sorte de blason de notre lignage improbable, fiction littéraire qui constitue ma famille épique, et non ma famille réelle. Il se trouve que l’ancêtre le plus ancien que j’ai pu identifier, le bisaïeul, capitaine des chasses (titre que portait aussi La Fontaine) du comté de Nadejkov, se nomme Joseph K. Cela évoque Le Procès, sans doute, et j’ai découvert ultérieurement que Hermann Kafka, le « père » à qui Franz écrit la lettre, avait commencé sa vie comme brocanteur dans la bourgade de Pisek, en Bohême du sud. C’est précisément là que Rodolphe K., quand il décroche sa maturitas (son bac) au lycée de Tabor, s’est fait tirer le portrait. Ce sont les premières photos de lui sur lesquelles je suis tombé, quand il partit à Prague, âgé de 19 ans, pour étudier le français à l’Université Charles. Le récit est nourri de multiples coïncidences de cette sorte. Sa parution le 6 octobre 2022, le jour où se tient à Prague le sommet des chefs d’État et de gouvernement de l’Union européenne, sous présidence tchèque durant ce semestre renforce ma foi de providentialiste athée…
L’un des mérites de votre ouvrage est de faire redécouvrir l’ampleur des liens entre la France et la République Tchèque dont on a oublié à quel point elles furent un temps de véritables « républiques sœurs ». Qu’est-il advenu de ces liens ?
Hier, ces liens étaient très resserrés. La Tchécoslovaquie fut la petite sœur de la France. Du reste elle voit le jour à Darney, dans les Vosges. C’est là où Raymond Poincaré, président de la République, remet le 30 juin 1918 — je suis aussi né un 30 juin… — le drapeau du 22ème régiment de chasseurs tchécoslovaques, dirigé par un état-major français, dont les officiers, tel le peintre František Kupka, étaient bilingues. Rodolphe K. y avait le grade d’aspirant. À partir de la grande exposition Rodin à Prague de 1902, les élites intellectuelles tchèques ont regardé vers Paris pour contrer Vienne. S’est noué un dialogue intime entre la peinture de Bohême depuis la fin du XIXe siècle et le symbolisme, puis le cubisme, les fauves, l’orphisme – que proclame Apollinaire au Salon d’or en 1911 devant deux tableaux de Kupka – jusqu’au surréalisme dont l’exposition Toyen au Musée d’art Moderne, vient de nous rappeler l’intensité. Soupault puis Breton allèrent à Prague, érigée par eux en ville tellurique. La galerie nationale recèle des collections sublimes de ces oeuvres, mais est très peu fréquentée, les touristes qui déferlent sur le pont de Pierre ignorent son existence car elle ne correspond pas aux clichés vendus par les tour-operators. Y est aussi exposé un tableau représentant la jeune épouse de Rodolphe K., par le peintre Coubine, un « Nu Assis » sur lequel l’enfant de Bohême s’interroge longuement…
[Si vous trouvez notre travail utile et souhaitez contribuer à ce que le Grand Continent reste une publication ouverte, vous pouvez vous abonner par ici.]
Il se trouve que l’ancêtre le plus ancien que j’ai pu identifier, le bisaïeul, capitaine des chasses (titre que portait aussi La Fontaine) du comté de Nadejkov, se nomme Joseph K.
Gilles Kepel
Écrire ce livre sur soi et ses aïeux est un exercice dont on ne sort pas indemne. Cette expérience d’écriture vous a-t-elle transformé, est-ce que vous en êtes ressorti différent par rapport au moment où vous y êtes entré ?
« On ne ressort jamais du hammam comme on y est entré » — pour faire référence à ma carrière universitaire… J’aurais eu un sentiment d’incomplétude, eu égard à celle-ci, si je n’avais pas connu cette mue littéraire.
Est-ce que vous regrettez que votre père ne soit plus là pour lire votre livre ?
J’ai essayé de le mettre à sa portée, encore en cours d’écriture, avant sa disparition. Je lui ai montré quelques-unes des cartes postales que Rodolphe K. lui avait envoyées quand il était encore un enfançon mais qu’il n’aurait pu déchiffrer seul. Peut-être sa mère les lui a-t-elle lues, mais il ne pouvait les comprendre. Je ne suis pas sûr qu’il eût pris connaissance de cette correspondance par la suite. À nouveau, désormais nonagénaire, il a été incapable d’en décrypter l’écriture. Sans doute le tchèque s’était-il effondré par pans entiers dans sa mémoire ravagée par la maladie. Il avait créé une sorte d’idiolecte, en mélangeant les vocabulaires français, tchèque et anglais… à l’effarement des aides-soignantes de sa maison de retraite qui ne comprenaient plus ce qu’il disait. Un jour nous avions essayé de jouer au Scrabble, il formait dans cette langue intérieure, subjective, des mots qui n’avaient plus de sens que pour lui, et qui pour les autres constituaient un signifiant énigmatique qu’Enfant de Bohême a tenté d’élucider — ensemble avec le monde d’hier qui fut le sien.
Gilles Kepel présentera Enfant de Bohême à l’Institut du monde arabe le 11 octobre à 19h.