Les perversions de la fin du monde
Le concept de « talent » est rarement utilisé, ou avec une certaine gêne, car il est imprécis et difficile à quantifier. Et pourtant, Małgorzata Żarów est un des talents les plus intéressants que la prose polonaise a connus ces dernières années. Un talent désordonné, dispendieux, bavard, récalcitrant à la discipline mais un talent indéniable.
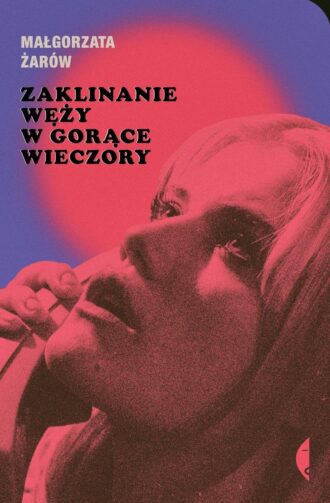
Le concept de « talent » est rarement utilisé, ou avec une certaine gêne, car il est imprécis et difficile à quantifier. Et pourtant, Małgorzata Żarów est un des talents les plus intéressants que la prose polonaise a connus ces dernières années. Un talent désordonné, dispendieux, bavard, récalcitrant à la discipline mais un talent indéniable.
Que signifie le terme « talent » lorsqu’il s’agit de littérature ? Il est facile de le remplacer par des concepts plus concrets. Parmi ceux qui viennent à l’esprit : aptitude, capacité, prédisposition, esprit, vivacité… Żarów possède tout cela : c’est une fine observatrice, son esprit est vif, elle a le don d’une pointe pertinente, elle sait brillamment construire des scènes.
Pour ne pas parler dans le vide, voici quelques exemples :
Dans le tramway, juillet est dégueulasse et collant, il suffit de plier le coude de juillet, fermer les cuisses de juillet : intérieur obscur. (p. 9)
Toutes les perversions ne sont pas bossues, borgnes et vivant dans la vase. (p. 100)
… les sourcils [de la vieille dame], peints d’un trait noir dans l’entre-deux-guerres, sont restés tels quels jusqu’aujourd’hui. (p. 103)
[Au sujet d’un homme riche et beau :] Il a tous les atouts en mains, les as dans la manche, le privilège dans la jambe du pantalon. (p. 145)
[La maison] est très grande et luxueuse, ce qui est visible au premier coup d’œil, même dans le noir, toutes les lignes des murs et de la toiture sont agencées en forme d’argent. (p. 164)
Un penchant pour le paradoxe, une imagination ouverte à l’absurde, une pointe de cruauté dans les commentaires ironiques sur les gens : ce sont les caractéristiques prépondérantes du style de Żarów dans son sens de l’observation et de la description. Sur l’exemple de ces quelques citations, nous percevons aussi une tendance à voir le monde à travers le prisme du corps. Soma est une référence stable, un moyen de contrôle, car le corps est comme un système d’alarme : la narratrice-héroïne vérifie le monde par le corps – goûts, apparences, odeurs, toucher (de façon intéressante, l’ouïe semble secondaire).
Seulement ce qui a été « vérifié avec le corps » ou « pressenti par le corps » peut être accepté dans un contact direct.
C’est d’autant plus important que la narratrice-héroïne travaille avec le corps, c’est une cam girl, c’est-à-dire une fille qui réalise devant la caméra des fantasmes des hommes. Les fantasmes n’ont pas d’autres barrières que l’imagination du client et les capacités à les réaliser par la cam girl. L’un d’eux dépose d’habitude une commande simple – « montre tes nichons » –, un autre scénarise minutieusement les séquences, un autre encore demande que la fille suce un concombre (littéralement). Nous lisons des descriptions détaillées, semblables à des scripts, de rencontres avec les clients dans neuf brefs chapitres intitulés « Viola Love est désormais on-line », entrecoupés par la trame principale. La spécificité du travail de Viola et la brutalité des descriptions évoquent le premier roman de Virginie Despentes, Baise-moi (1993) qui, de même qu’Enchanter les serpents…, montrait différentes stratégies féminines dans un monde dominé par le désir des hommes, par leur supériorité financière et, toujours prête à agir, leur force physique.
Le roman de Żarów n’est pas pour autant misandre. Les hommes dans ce livre sont parfois comme des garçons, parfois minables, mais surtout perdus dans leurs propres corps. Ils ne savent pas ce qu’ils veulent, alors ils amplifient leurs désirs, incapables de se comprendre et de s’accepter ; le plus souvent, ils abandonnent assez rapidement les services de Viola et partent. Ils ont peur qu’elle puisse les connaître mieux qu’eux-mêmes ne se connaissent, et même dans un monde virtuel ils se comportent comme des mecs classiques. Ils s’enfuient dès qu’ils perdent leur domination.
Dans tout cela, Viola ne se plaint pas et ne soutient pas qu’elle ait été obligée de faire du sex work à cause d’une situation matérielle difficile ou une famille amorale. Elle aime son corps et aime le plaisir : c’est pour cette raison qu’elle a investi le marché du sexe. De plus, elle tient à garder son indépendance, ce qui introduit des tensions avec ses clients on-line et dans son rapport au monde. Viola veut décider elle-même quand s’ouvrir au contact avec un autre homme, de même que se laisser toucher dans le monde réel. Elle veut garder la souveraineté de son propre corps, et devient alors experte dans la domination des « serpents » masculins.
Je mets l’accent sur cette question car l’opposition entre la sexualité et l’autonomie de la femme depuis des nombreuses années joue un rôle capital dans la littérature polonaise. Dans le roman effréné de Patrycja Pustkowiak, Animaux nocturnes (Nocne zwierzęta, 2013), la protagoniste est violée en représailles pour avoir voulu décider elle-même de son corps (sexuellement attractif). Dans la quasi-autobiographie, provocatrice et très remarquée, de Joanna Jędrusik, 50 visages de Tinder (50 twarzy Tindera, 2019), la protagoniste (autrice ?) après avoir testé ses préférences sexuelles durant plusieurs années (rencards pris sur Tinder), choisit la solitude, laissant ainsi entendre que dans le conflit entre l’autonomie et le plaisir sexuel, c’est le désir de l’indépendance qui a eu le dernier mot. Dans un autre roman encore, délibérément vulgaire et plein de colère, dans la veine d’une poétique trash, intitulé Heksy (Sorcières, 2021), Agnieszka Szpila compare les anciennes persécutions des sorcières avec les moyens modernes de contrôle du corps féminin, et propose un monde de « plaisir sans bite ». Elle réinterprète d’anciens mythes, présente les mouvements actuels éco-féministes et propose une sexualité féminine qui se passerait de « tout ce qui est saillant ».
Dans le roman de Żarów, l’opposition entre le plaisir et l’autonomie est nette mais il semblerait que Viola ne soit ni du côté de la soumission, ni de l’indépendance solitaire. Elle cherche la possibilité de concilier son indépendance avec le sexe. La crise arrive de manière tout à fait inattendue et dans des conditions singulières. Toute cette histoire est racontée, comme dans un polar, dans un ordre a-chronologique : un jour, Viola reçoit la proposition de jouer dans un film porno, donc de passer du virtuel au réel. Elle accepte la proposition, non sans certaines réserves et, puisque nous découvrons les événements par leur fin, nous nous attendons à ce que la situation lui échappe et que le film X ordinaire se transforme en film hard ou gore, que quelqu’un la viole ou la batte… Le suspense est cependant résolu autrement : au petit matin, après une nuit de tournage, lorsque les acteurs de cet exploit sont fatigués et couchés dans l’herbe, le ciel est parcouru par un objet bizarre – une comète ? un avion ? – qui s’écrase avec fracas contre le sol, non loin de la maison. Tout le monde est saisi de panique, Viola de même, et court dans tous les sens (c’est par là que débute la narration, le récit de Viola, très lentement et non sans digressions récurrentes, arrive aux événements du plan cinématographique).
Qu’est-ce qui est tombé sur la terre ? Selon toute vraisemblance, il s’agit d’un avion, mais en ville les gens se transmettent des versions de plus en plus improbables (catastrophe ferroviaire, explosion de gaz, irruption volcanique !…). Jusqu’à la fin du roman, nous n’aurons pas découvert la vérité. Et il semblerait que l’auteur tenait précisément à cette incertitude. Grâce à elle, elle a pu mettre en scène une société qui ne fait confiance à personne et ne croit en rien. En rien, hormis une mort commune :
– Oh putain, dit [un homme rencontré par hasard]. Ce ne sera que pire.
– Quoi donc ?
– Des catastrophes, des attentats, bientôt tout va cramer. On n’aura pas le temps d’éteindre. Nous sommes trop nombreux et ne faisons que du bordel. Ça, il montre le ciel, nous l’avons fait aussi. (p. 51)
[Un homme rencontré par hasard sur un arrêt de bus] : Tout le monde va brûler dans la catastrophe. Même si on nous identifie, ça ne servira à rien, il n’y aura pas de preuves. Ils vont tout enterrer. (p. 60)
[Viola :] Lorsqu’il n’y aura plus de quoi respirer, nous allons vivre sous l’eau dans les scaphandres en plastique. […] Mais en dehors de ça, tout sera pareil. (p. 111)
De manière inattendue, le roman sur l’industrie du sexe se transforme en diagnostic de l’état de la communication sociale. La communauté, présentée dans le roman, donne l’impression d’avoir passé – ou il faudrait plutôt dire : d’avoir sauté – d’un catastrophisme conditionnel à un catastrophisme accidentel. Dans le premier cas, les gens considéraient qu’une catastrophe est provoquée par une série d’éléments et qu’il est malgré tout possible de l’éviter, qu’au dernier moment il sera possible, grâce à une action héroïque ou aux inventions scientifiques, d’arrêter la catastrophe ; dans l’autre modèle, les personnes rencontrées soutiennent que n’importe quel événement peut déclencher l’effet domino qui conduira vers une fin inévitable. Dans la première variante, il y avait encore un espoir timide, dans la deuxième, juste un sentiment de culpabilité et de fatalité. Les liens sociaux se tissent dans l’espace de la catastrophe.
D’où viennent des angoisses des personnages de Żarów ? De partout. D’un potin, entendu dans une boutique, d’une conversation dans le tramway, d’un échange à l’arrêt de bus ; de la radio ou de la télévision, d’un sms ou d’une conversation téléphonique. Ce qui signifie que les gens se meuvent dans une réalité indirecte. Dans ce domaine donc – la symétrie romanesque est ici ironique – tout le monde communique de la même façon que Viola : tous vont à l’instant allumer un écran sur lequel quelqu’un joue pour eux une scénette de soumission ou sur lequel ils posent eux-mêmes. Tous regardent en douce ou s’exhibent. Tous sont voyeuristes ou exhibitionnistes.
En même temps, la participation à cette communication indirecte s’accompagne sans cesse d’un désir de vérité : désir de voir, d’avoir un contact direct, de toucher le monde de manière sensorielle. C’est pourquoi, dans la dernière scène du roman, Viola monte sur une digue qui cachait le lieu de la catastrophe et prononce deux phrases, simples et en même temps mystérieuses :
Je suis tout en haut. Et je vois. (p. 278)
Cela signifie-t-il qu’il est possible de dépasser les limites des apparences, même si toucher le monde implique de s’ouvrir à la blessure ? Que la vérité soit ce qui fait mal ? Je ne pense pas. Je crois que ce « je vois » final, après une narration pleine de descriptions répétées et d’un trop plein de digressions, nous amène à une autre conclusion. « Voir » ne veut pas dire ‘voir enfin la vérité’ mais ‘éprouver du plaisir’. Un plaisir différent de celui ‘d’être vu’. Un plaisir plus fort, car ‘voir’ c’est ‘dominer ce que l’on regarde’. Voir c’est ressentir le monde qui a composé pour nous une scénette en dévoilant sa propre propension à être détruit.
Tant que le monde se laisse regarder, la vie peut être source de plaisir. Même au moment d’une catastrophe.

