La politique de l’urgence, une conversation avec Jonathan White
Du sauvetage de la zone euro à l'adoption du plan de relance, la gestion de crise domine la politique européenne depuis deux décennies et transforme profondément l’Union. Dans son livre, Politics of last Resort, Jonathan White jette un regard critique sur « la politique de l’urgence » et ses conséquences au niveau européen. L’importance prise par les mesures d’urgence ne traduit-elle pas une faiblesse persistante de la gouvernance européenne ? Une telle politique n’est-elle pas porteuse de risques pour la démocratie ? Ne nourrit-elle pas le populisme ? Dans ce long entretien, il apporte un éclairage nouveau sur l’intégration européenne et sur les défis auxquels l’Union est aujourd’hui confrontée. Un texte sur l'urgence qu'il faut prendre le temps de découvrir.
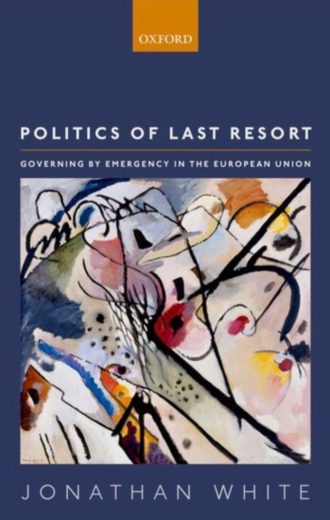
Dans votre livre, Politics of Last Resort (Oxford University Press), vous critiquez la place croissante de la « politique de l’urgence » au niveau de l’Union européenne. Pouvez-vous nous dire d’abord ce que vous entendez par là et, ensuite, pourquoi une telle politique est-elle problématique selon vous ?
La politique de l’urgence repose sur l’idée que des temps exceptionnels exigent des mesures exceptionnelles. Il s’agit pour les autorités d’outrepasser les contraintes habituelles au nom de la résolution des crises – en étouffant le débat parlementaire pour accélérer la prise de décision, par exemple, ou en restreignant les droits des personnes pour renforcer le contrôle social. Traditionnellement, ces actions sont associées à la sphère de la politique nationale – les « états d’exception », lors desquels un gouvernement revendique ou se voit accorder des pouvoirs supplémentaires pour faire face à un défi extrême (guerre, terrorisme, etc.). Ce qui est intéressant aujourd’hui, c’est de constater que la politique de l’urgence a pris une dimension transnationale, impliquant de nouveaux types d’autorité et de nouveaux types de menaces.
Au sein de l’Union européenne, la politique de l’urgence prend diverses formes. Parfois, il s’agit de renforcer le pouvoir des autorités supranationales. Dans les années 2010, l’exemple le plus marquant a été celui de la Troïka, grâce à laquelle la Commission et la Banque centrale européenne (BCE) ont pu, dans une certaine mesure, s’affranchir des droits souverains des États dans les affaires économiques et fiscales. Un autre type de politique de l’urgence est multilatéral : les États membres de l’Union étendent collectivement leur pouvoir discrétionnaire en créant de nouvelles structures en dehors de celle-ci. On pense par exemple aux mécanismes de prêt ad hoc créés pendant la crise de la zone euro (le Fonds européen de stabilité financière [FESF], le Mécanisme européen de stabilité [MES]), afin d’éviter les contraintes posées par les traités. Le recours à une forme de gouvernance informelle participe de cette même logique de contournement des procédures européennes, comme on a pu le voir avec l’Eurogroupe, par exemple, dans les années 2010.
Ce qui est intéressant aujourd’hui, c’est de constater que la politique de l’urgence a pris une dimension transnationale, impliquant de nouveaux types d’autorité et de nouveaux types de menaces.
Jonathan White
La politique de l’urgence, sous ses diverses formes, pose une série de problèmes. Tout d’abord, les mesures d’urgence ont tendance à être adoptées rapidement pour répondre à une menace imminente, souvent dans des contextes confidentiels ou informels. Elles offrent généralement peu de possibilités de délibération publique et de participation démocratique. Les choix de société que ces mesures impliquent – portant sur ce qui doit être protégé dans l’adversité – ont tendance à être négligés.
Deuxièmement, le pouvoir se concentre sur les institutions exécutives, en particulier leurs dirigeants, au détriment des autres acteurs et institutions de la sphère publique tels que les parlements. Même lorsque ces décisions ne conduisent pas nécessairement à un renforcement des agents exécutifs, elles affaiblissent la transparence en raison de leur caractère improvisé et opaque. Il devient en effet difficile de discerner qui est aux commandes et sur quels critères les décisions sont prises, rendant du coup ces dernières difficiles à contester.
Troisièmement, l’autorité et la cohérence du droit – national et européen – sont affaiblies. Avec l’apparition de modes de gouvernement informels et ad hoc, un décalage se crée entre le fonctionnement officiel de l’« État » et son fonctionnement pratique. Le droit ne correspond plus à la façon dont les choses se passent sur le terrain.
Enfin, bien qu’elles soient généralement présentées comme des mesures temporaires et exceptionnelles, ces actions ont des conséquences durables et il est généralement difficile de les annuler ensuite. Les politiques et les pratiques de l’état d’urgence ont tendance à se figer, y compris pour certaines d’entre elles qui sont particulièrement régressives.
Vous proposez un concept particulièrement important dans votre livre : la politique du singulier. De quoi s’agit-il ?
Ce que j’entends par la politique du singulier, c’est l’idée d’une situation qui résiste aux comparaisons et aux normes courantes, d’une situation très rare, voire unique, qui impose d’aborder les défis politiques du moment comme étant sans précédent. Cette approche présente d’importants inconvénients. Lorsque la politique commence à ressembler à une série d’épisodes uniques, notre compréhension de ces derniers s’en trouve diminuée. Il devient plus difficile de les évaluer de manière normative et critique. L’accent mis sur la singularité du moment détache les problèmes actuels des facteurs de causalité à long terme qui les sous-tendent – pour cela, il faudrait avoir le sens des continuités et des équivalences. Les grandes questions en jeu sont reléguées au second plan et les préoccupations fonctionnelles tendent à dominer le débat, avec une focalisation sur un ensemble étroit d’indicateurs pour mesurer la réussite des politiques menées. Cette mentalité était palpable dans le dernier discours sur l’État de l’Union d’Ursula von der Leyen, lors duquel elle a énuméré une liste de réussites spécifiquement liées à la crise, sans les contextualiser dans le temps long de la politique européenne. Les défis socio-économiques et politiques auxquels l’Europe est confrontée sont endémiques, interconnectés et permanents. Ils sont le fruit d’une longue évolution qui n’est en aucun cas réductible à une rupture soudaine avec les tendances préexistantes, comme le suggèrent les termes « urgence » et « exception ».
Lorsque la politique commence à ressembler à une série d’épisodes uniques, notre compréhension de ces derniers s’en trouve diminuée. Il devient plus difficile de les évaluer de manière normative et critique.
Jonathan White
Ne peut-on pas dire que la politique de crise est, de fait, un élément essentiel de la gouvernance au niveau supranational et que celle-ci engendre, en outre, une dynamique parfois propice à une plus grande intégration ? Prenons l’exemple de la crise du Covid-19 : n’a-t-elle pas permis la création de nouveaux instruments comme Next Generation EU ou l’Autorité européenne de préparation et de réaction en cas d’urgence sanitaire (HERA), alors que ceux-ci étaient restés jusque là seulement à l’état de projet ?
Il est tentant de dire : jugeons la politique de l’urgence à ses résultats. Elle est peut-être un peu anarchique et peu transparente, mais si elle fait avancer les choses, cela en vaut la peine. Si elle sert la cause d’une plus grande « intégration » et permet de prendre des mesures qui, autrement, échoueraient, alors la prise de décision en situation de crise est une chose à laquelle il faut souscrire.
Il y a cependant deux problèmes avec cette approche. Tout d’abord, l’une des raisons pour lesquelles la transparence et la responsabilité politique sont importantes est de permettre à un public plus large de déterminer quels résultats sont considérés comme valant la peine d’être atteints. Il y a toujours des choix de société à faire, même en temps de crise. Qu’est-ce qui compte le plus – l’intégrité du marché commun ou la qualité des services publics ? Le maintien du régime de la dette ou la redistribution des richesses ? Décider de manière informelle revient à laisser ces questions à la discrétion de quelques-uns, qui sont à leur tour plus vulnérables face à la pression des intérêts privés. Deuxièmement, embrasser la politique de l’urgence est généralement une mauvaise stratégie. Il y a un risque de retour de bâton, car ceux qui s’opposent aux moyens – pouvoir exécutif concentré, méthodes irrégulières, refus de choix – finissent par s’opposer également aux fins poursuivies et à la politique en tant que telle.
Je dirais enfin que « plus d’intégration » n’est pas intrinsèquement souhaitable ; ce qui compte, c’est le type d’intégration et la capacité à l’influencer.
La politique de l’urgence est-elle donc une expression de faiblesse plutôt que de force ?
Les modes de gouvernement d’urgence, bien qu’ils soient souvent associés à des démonstrations de pouvoir spectaculaires, ont en effet tendance à découler d’une certaine forme de faiblesse. Dans la crise de l’euro du début des années 2010, il s’agissait de la faiblesse des acteurs exécutifs face aux marchés financiers, ainsi que de la faiblesse structurelle posée par les dimensions transnationales de la situation – la nécessité de convaincre d’autres gouvernements et autorités de coopérer dans un contexte où aucun n’est souverain. De même, lors de la crise migratoire de 2015/17, on a vu la faiblesse des gouvernements devant les mouvements d’extrême droite, qui ont réussi à politiser l’afflux soudain et massif dans l’Union de personnes venant d’Afrique et du Moyen-Orient. Dans la crise de Covid-19, la faiblesse découle de la dé-priorisation de secteurs comme la santé publique. Il s’agissait de la faiblesse de l’État – avec des systèmes de santé sous-financés, partiellement privatisés et insuffisamment préparés – et des administrations où les voix des économistes néolibéraux sont encore majoritaires. D’une manière générale, plus les institutions et les responsables sont faibles, plus la réponse aux temps difficiles est extrême. Pour maintenir l’ordre, les dirigeants faibles se voient contraints de prendre des mesures radicales – confinement, fermeture des frontières, etc.
Il existe également une faiblesse politique plus générale, liée aux liens de représentation. Les dirigeants qui bénéficient d’un faible soutien de l’opinion publique peuvent considérer les situations d’urgence comme des occasions de montrer leur valeur à un public dubitatif. Les situations d’urgence permettent aux dirigeants d’agir de manière énergique et décisive. Dans la mesure où ils rompent avec les normes politiques et juridiques, cela peut être présenté comme un signe d’engagement et de détermination. Ces dirigeants peuvent alors également faire passer des politiques qui, autrement, susciteraient une plus grande résistance – je pense aux mesures austéritaires, par exemple. Ainsi, laisser une crise se déclencher et invoquer des pouvoirs d’urgence pour y répondre permet à ceux dont l’autorité s’estompe de renforcer leurs arguments et de gouverner. C’est une autre façon de définir une « politique du dernier recours ».
La politique de l’urgence repose sur ce que vous appelez le principe de nécessité et de rapidité. Pouvez-vous développer ce point et dire en quoi vous pensez que cela contribue à consolider l’image de l’Union comme une négation de la représentation politique ?
La politique de l’urgence est menée comme une politique de nécessité, en réaction aux événements à mesure qu’ils se produisent. Les autorités adoptent des mesures de grande envergure, non pas tant parce qu’elles sont intrinsèquement souhaitables que parce qu’elles permettent d’écarter une menace. Lorsque la BCE adopte une nouvelle mesure d’urgence – le programme d’achat d’urgence en cas de pandémie (PEPP), par exemple – elle ne la présente pas comme faisant partie d’une vision économique, ni comme une politique ayant des mérites particuliers, mais comme une simple étape nécessaire pour stabiliser la zone euro. Si l’état d’urgence implique une prise de décision frénétique, ces décisions sont rationalisées comme étant inéluctables sur le fond et dans le temps – une variation de la logique « TINA » (there-is-no-alternative). On assiste à une intensification de l’activité exécutive – ce que l’on pourrait appeler l’action – associée à un désaveu aigu de la représentation, c’est-à-dire de la capacité à choisir librement entre plusieurs options. Plus les autorités européennes ont recours à la justification des politiques en tant que mesures d’urgence, plus l’Union est associée à des politiques qui n’ont pas été librement choisies mais simplement considérées comme inévitables.
Cela signifie également que les choix qui sont faits sont plus difficiles à évaluer par le public. La logique de l’urgence est insaisissable, non seulement parce que beaucoup de choses dépendent du pouvoir discrétionnaire des dirigeants, mais aussi parce qu’ils obtiennent la permission d’être imprécis dans la manière dont ils prévoient d’utiliser ce pouvoir. Lorsque la gouvernance est envisagée comme une réponse à la nécessité, les décideurs acquièrent une grande flexibilité, car qui peut savoir à l’avance ce que la nécessité exigera ? Un tel raisonnement permet de maintenir une politique indéfiniment ou avec des extensions en série (comme dans le cas du PEPP), tout en préparant également la possibilité de son arrêt lorsque la normalité est censée être rétablie, lorsque la « reprise » est complète1.
Les mesures d’urgence ont donc ce statut équivoque. La logique de l’urgence peut être utilisée pour rendre temporaires des mesures potentiellement souhaitables (par exemple, la suspension des règles relatives aux aides d’État), étant entendu qu’elles ne sont adaptées qu’à des périodes exceptionnelles. Elle peut également être utilisée pour rendre permanentes certaines mesures controversées (par exemple, les mesures introduites par le MES, qui ont d’abord été testées en tant que dispositifs autonomes et temporaires, puis le « rapport des 5 présidents » de 2015 a envisagé d’intégrer le MES dans les traités), étant entendu qu’elles empêchent une rechute. Les mesures d’urgence visent à résoudre des problèmes spécifiques : leur lien avec les principes généraux n’est jamais clair. Elles peuvent être suspendues aussi soudainement qu’elles ont été introduites, puis réintroduites si la nécessité l’exige. Structurellement, cela peut facilement devenir une justification pour minimiser les contrôles démocratiques, y compris l’influence des parlements.
Plus les autorités européennes ont recours à la justification des politiques en tant que mesures d’urgence, plus l’Union est associée à des politiques qui n’ont pas été librement choisies mais simplement considérées comme inévitables.
Jonathan White
Vous soutenez que les exécutifs supranationaux, transnationaux et nationaux s’imbriquent dans le cadre de la politique de l’urgence. Dans votre livre, vous fondez votre argumentation sur la crise de l’euro en prenant l’exemple de la Troïka. Comment voyez-vous cette dynamique se déployer aujourd’hui et comment évaluez-vous la séquence Covid-19 à la lumière de ces considérations ?
D’une certaine manière, l’Union a géré la crise du Covid-19 différemment. Le pouvoir exécutif transnational n’a pas été canalisé par des organes de novo. Il n’y a pas eu d’équivalent de la Troïka. Les principales institutions de l’Union ont joué un rôle plus important qu’à certains moments dans les années 2010. Le Covid-19 a été abordé comme un choc universel, pour lequel les États individuels ne sont pas à incriminer. Une fois les questions de responsabilité et d’aléa moral écartées, il devient plus facile de gouverner à partir du cadre général.
Ce qui est resté inchangé, cependant, c’est l’adoption de modes de gouvernance non-codifiés. Les réunions au sommet et les forums informels comme l’Eurogroupe ont offert de nombreuses occasions de contourner les principales institutions. Comme dans le cas de la crise de l’euro, le caractère informel de l’Eurogroupe a permis d’exercer un pouvoir discrétionnaire en limitant les contraintes et la visibilité – par exemple, au printemps 2020, lors de l’élaboration de la réponse à la pandémie. Ces mesures sont souvent soutenues par des méthodes de prise de décision anormales au sein des institutions concernées – par exemple, la concentration du pouvoir au sommet de la BCE et de la Commission. Les proches de Mario Draghi ont toujours observé qu’il opérait de manière très centralisée, en gérant les affaires en tout petit comité [kitchen cabinet]. De même, depuis son accession à la tête de la Commission, Ursula von der Leyen a été critiquée pour sa « réticence à communiquer au-delà d’un groupe restreint de collaborateurs ». Christine Lagarde et Jean-Claude Juncker ont également eu tendance à prendre des décisions avec une petite équipe de confidents.
La politique de l’urgence reflète la prédominance du pouvoir exécutif, mais aussi la manière dont cette prédominance est consolidée et rationalisée. Les tendances à la présidentialisation s’accélèrent dans les contextes d’urgence à tous les niveaux, des gouvernements nationaux aux autorités supranationales. Le pouvoir se concentre au sommet, au nom de la nécessité d’éviter la lourdeur des procédures, d’accélérer la prise de décision, d’instaurer la confiance et de maintenir la discrétion nécessaire pour ne pas enflammer la situation.
Et il ne fait aucun doute que cela pose un problème démocratique. C’est en partie une question de transparence et de responsabilité politique – s’assurer que tout ne dépend pas du pouvoir discrétionnaire de quelques individus. Il s’agit également de la capacité à contester l’orientation de la politique. La concentration du pouvoir est associée à un phénomène de personnalisation, et un pouvoir personnalisé a tendance à être jugé principalement sur des questions de compétence et de charisme, plutôt que sur les fins auxquelles il est destiné. On le voit même dans le cas d’institutions supranationales technocratiques comme la Commission et la BCE, la vénération de Mario Draghi comme « l’homme qui a sauvé la zone euro » en est un parfait exemple. C’est une description exaltante, mais qui transforme une situation politique en drame personnel. Elle ne nous aide pas à nous interroger sur ce qui a été sauvé, ce qui a été sacrifié, si les objectifs étaient les bons, comment ce pouvoir discrétionnaire peut être démocratisé ? Pour aborder de telles questions, il faut faire abstraction des qualités individuelles des dirigeants, et s’intéresser aux idées sous-jacentes qui président à leurs actions.
La concentration du pouvoir est associée à un phénomène de personnalisation, et un pouvoir personnalisé a tendance à être jugé principalement sur des questions de compétence et de charisme, plutôt que sur les fins auxquelles il est destiné.
Jonathan White
Vous soutenez que le fait d’appréhender la réalité politique comme une série ininterrompue de situations exceptionnelles est une façon de la dépolitiser. Cela empêche d’établir des liens, de les relier à des modèles historiques plus larges et d’appliquer des principes plus généraux. N’avons-nous pas vu, au contraire, que la politique de l’urgence a entraîné une politisation beaucoup plus dynamique de la politique transnationale lors de la crise de Covid-19, les joutes transnationales donnant lieu à la constitution d’une véritable dynamique qui existait déjà de façon embryonnaire lors de la crise de la zone euro et qui s’apparente à la constitution progressive d’un espace politique européen ?
On pourrait sans aucun doute avancer l’argument d’une ruse de la raison selon laquelle « la politique de l’urgence permet, dans une certaine mesure, l’émergence d’une sphère publique européenne ». Je pense qu’il y a là une part de vérité. Mais cette opinion critique transnationale qui naît dans les crises est très spécifique à un sujet, très épisodique. Elle se soulève, par exemple, contre la Troïka mais se dissipe par la suite – elle se soulève avec Syriza et meurt avec Syriza. Elle est aussi obligée de s’exprimer principalement par le biais des institutions nationales.
La réaction critique est une réaction d’indignation à l’égard de décisions ou de politiques spécifiques, qu’il s’agisse de la Troïka ou de déclarations faites par le ministre des Finances néerlandais sur le manque de discipline budgétaire des Italiens en pleine pandémie. Une opinion critique à l’échelle européenne se développe sur ces questions continentales, mais elle se dissipe ensuite très rapidement. Une fois que le problème qui était le point focal du mécontentement est résolu, l’épisode est clos et l’opinion critique européenne disparaît. D’un certain point de vue, la politique de l’urgence crée une réponse critique à l’échelle continentale, mais la nature épisodique de ces moments de formation de la sphère publique ne permet pas vraiment de créer un phénomène cohérent et durable, de la même manière que la démocratie le permet dans le contexte national.
Il y a effectivement une sorte de devoir de justification qui commence à naître de ce processus de politique de l’urgence, par lequel les dirigeants ressentent le besoin d’organiser des briefings et des conférences de presse et d’écrire des articles de journaux dans la presse étrangère pour renforcer la légitimité de leurs actions, mais je ne vois pas cela comme un remplacement de processus politiques plus fondamentaux.
D’un certain point de vue, la politique de l’urgence crée une réponse critique à l’échelle continentale, mais la nature épisodique de ces moments de formation de la sphère publique ne permet pas vraiment de créer un phénomène cohérent et durable, de la même manière que la démocratie le permet dans le contexte national.
Jonathan White
Dans votre livre, lorsque vous évoquez les fondements conceptuels qui président aux mesures d’urgence, vous fondez votre réflexion sur la notion d’une politique échappant aux cadres de décision habituels. Pouvez-vous revenir sur ce point et les problèmes associés au caractère informel de la politique de l’urgence ?
Sur les problèmes associés au caractère informel de la politique de l’urgence, je pense que le politologue allemand Ernst Fraenkel est particulièrement intéressant. Dans son étude du régime autoritaire, il a observé comment les règles formelles et les méthodes informelles peuvent exister en parallèle. Un « État normatif », façonné autour de lois et de procédures et destiné à être évalué par le public, peut cohabiter avec un « État prérogatif », indifférent à ces règles et désireux de les contourner. Son terme pour décrire cette situation était « l’État dual ». Ce concept est particulièrement utile pour penser l’Union à la lumière de sa politique de l’urgence. D’une part, l’Union conserve les caractéristiques d’un système codifié et peut fonctionner de manière constante dans un certain nombre de domaines pendant de longues périodes. Les décideurs peuvent se limiter à des pratiques largement conformes à la division des pouvoirs de l’Union et à ses principes de démocratie et de contrôle. Dans le même temps, le potentiel de substitution des structures formelles par des méthodes informelles et ad hoc est conservé. Il y a toujours les germes de quelque chose de plus arbitraire – une « double union », si vous voulez.
Vous semblez affirmer que l’un des problèmes structurels du modèle actuel d’intégration européenne réside dans son approche fragmentée de l’élaboration des politiques. Vous affirmez que la création d’institutions dont la raison d’être est de promouvoir certains objectifs politiques bien déterminés met en relief l’importance de ces engagements substantifs par rapport aux questions procédurales. En conséquence, plutôt que d’être des entités autonomes pouvant être utilisées à différentes fins politiques comme c’est le cas des structures de l’État moderne, les institutions européennes évoluent en fonction des buts qui leur sont attribués et sont donc susceptibles d’être court-circuitées si elles ne les servent pas. Pouvez-vous développer ce point à la lumière des actions et de l’ambition géopolitique de l’Union ?
Dans l’Union, on ne considère pas la primauté des structures (comme dans l’État, où les dispositions constitutionnelles déterminent largement ce qui est fait), mais la primauté des objectifs politiques, notamment ceux associés à l’intégration du marché. Ainsi, par exemple, dans les années 1970, lorsque l’intégration du marché semble marquer le pas, la méthode communautaire commence à être supplantée par des sommets entre chefs d’État et de gouvernement. Les pratiques de gouvernance s’adaptent aux objectifs. Ou bien, plus récemment, pensez à la façon dont le rôle de la Commission est passé de l’initiative législative à l’application de la conformité par le biais d’une surveillance spécifique des pays, de recommandations et de sanctions ciblées (la Troïka, le Semestre européen, etc.). Le rôle de l’institution a été redéfini pour permettre aux objectifs, notamment ceux relatifs à la libéralisation économique, d’être poursuivis avec plus d’insistance dans des conditions de crise qui semblent les mettre en péril. On peut faire des observations similaires à propos de la BCE, qui réinterprète son mandat en passant de la stabilité des prix à la stabilité plus générale de la zone euro. Je pense que l’on peut discerner un schéma similaire avec l’exemple de la politique migratoire. Ces dernières années, nous avons vu des États sortir du cadre de l’Union pour tenter de limiter les migrations et inciter d’autres pays (par exemple la Turquie) à les aider. Cette méthode est utilisée comme un véhicule d’exceptionnalisme, un moyen d’échapper aux normes juridiques et politiques de l’Union.
Si la protection de la libre circulation intra-européenne et la lutte contre l’extrême droite semblent exiger que l’on garde les migrants à distance, les dirigeants choisiront l’arrangement qui leur semble le mieux à même de garantir cet objectif, quelles que soient les conséquences que cela pourrait avoir sur l’intégrité des institutions et des valeurs de l’Union. Étant donné que les préoccupations géopolitiques occupent aujourd’hui une place de plus en plus importante dans l’agenda politique (par exemple, en ce qui concerne la Chine et la Russie), on peut s’attendre à ce que l’on s’appuie davantage, non seulement sur le Conseil européen (lui-même une entité para-communautaire pendant la majeure partie de son existence), mais aussi sur des canaux ad hoc, extracommunautaires (sommets, coalitions de volontaires, etc.).
Dans l’Union, on ne considère pas la primauté des structures (comme dans l’État, où les dispositions constitutionnelles déterminent largement ce qui est fait), mais la primauté des objectifs politiques, notamment ceux associés à l’intégration du marché.
Jonathan White
Une fois qu’ils se sont engagés dans un régime d’exception, les agents exécutifs sont confrontés à la question de savoir si, quand et comment ils vont y mettre fin. Il s’agit d’une tâche que vous qualifiez d’ambiguë et difficile. Comment revenir à la normalité politique après une séquence non-conventionnelle ? Comment prendre du recul par rapport au pouvoir discrétionnaire ?
Il existe plusieurs façons d’y parvenir, bien qu’aucune ne soit facile dans le cas de l’Union. L’une d’entre elles consiste tout simplement à considérer le statu quo comme une « nouvelle normalité » et à prétendre qu’il peut être maintenu sans autre bouleversement parce que le système est désormais plus résilient. C’est ce que l’on peut entendre à propos du Fonds de relance – que de meilleures politiques sont désormais en place, et que l’Union n’aura plus à s’engager dans la gestion de crise. Même si le dispositif est encore temporaire, l’argument invoqué est le suivant : « Si nous pouvons nous appuyer sur ce dispositif et l’améliorer, l’Union sera beaucoup plus résiliente et nous laisserons les années de crise derrière nous ».
Cependant, il s’agit peut-être d’un vœu pieux : il existe des problèmes structurels dans l’économie et la société européennes qui n’ont pas disparu, ainsi que des orientations politiques qui encouragent à laisser de telles crises se produire afin de les instrumentaliser. C’est pourquoi je pense qu’il ne suffit pas de dire que l’Union est plus résiliente, il faut aussi montrer en quoi l’exercice du pouvoir va être différent, dans quelle mesure les décideurs vont être encadrés, ou comment la relation avec l’opinion publique et le pouvoir législatif va être différente. C’est un élément que nous n’avons pas beaucoup vu, et je ne pense pas que nous puissions partir du présupposé que la politique de l’urgence va simplement disparaître à un moment donné. Une autre approche consiste à mettre en place de nouvelles procédures qui minimiseront les incitations à l’exceptionnalisme lors de la prochaine crise – une sorte de refondation constitutionnelle qui pose toutefois de grandes questions de faisabilité…
À cet égard, vous soulignez que les recours procéduraux permettant de sortir de la politique de l’urgence dépendent de la volonté politique de ceux qui sont les plus susceptibles de les bloquer. Pourriez-vous développer ce point ?
Il existe toute une panoplie de remèdes institutionnels que l’on pourrait imaginer pour rendre le gouvernement de crise de l’Union plus équilibré et plus transparent, par exemple en modifiant les traités afin de limiter les pouvoirs de décision du Conseil et renforcer ceux du Parlement européen. Toutefois, si nous avons de bonnes raisons de nous inquiéter de l’abus de pouvoir de l’exécutif dans les situations d’urgence, nous avons également des raisons de douter de la volonté des dirigeants d’accepter tout arrangement qui leur lie les mains. Au sein de l’Union européenne, il y a tout lieu de douter que les acteurs exécutifs concernés – notamment le Conseil – soient disposés à accepter de telles contraintes, étant donné la mesure dans laquelle ils se sont historiquement appuyés sur l’exceptionnalisme pour gérer les crises, introduire de nouveaux mécanismes politiques et faire progresser l’intégration européenne. À une époque où le public est de plus en plus divisé sur les objectifs de l’intégration, ils ont tout intérêt à maintenir cette approche.
Vous affirmez que l’exceptionnalisme et la technocratie sont complémentaires. Pourquoi ?
Si l’on regarde l’histoire, il existe des affinités évidentes entre l’exceptionnalisme et la technocratie. Dans l’Europe et l’Amérique du Nord des années 1930, des mouvements prônant le renforcement de la technocratie sont apparus en réponse à la Grande Dépression. Les revendications en matière d’expertise, ainsi qu’un certain appétit du public à leur égard, étaient un composant essentiel de l’état d’urgence économique de l’époque.
Savoir ce qu’il faut faire lorsque les méthodes conventionnelles n’offrent que peu de perspectives fait partie intégrante de la culture technocratique. En effet, on pourrait dire que les véritables dimensions de l’expertise ne peuvent être révélées et réalisées que dans des moments exceptionnels tels que ceux-ci. Comme je l’ai expliqué dans mon livre, des techniciens comme Mario Draghi ou Christine Lagarde adhèrent à l’idée que les situations d’urgence exigent leur capacité personnelle de décision et de discernement.
Bien sûr, lorsque le pouvoir discrétionnaire est mis en avant, l’idée que les techniciens accomplissent des tâches définies et encadrées devient difficile à préserver. Il est essentiellement difficile de déterminer ce que l’expertise exige dans une situation inconnue : elle peut être utilisée pour rationaliser un certain nombre d’actions, allant des plus scientifiquement informées aux plus arbitraires. La frontière entre technocratie et politique devient de plus en plus floue, et le pouvoir personnel plus souple.
Un autre lien entre l’exceptionnalisme et la technocratie renvoie au problème de la responsabilité politique que j’ai évoqué plus haut. Les techniciens sont confrontés à un défi permanent : comment se légitimer auprès du grand public ? Cultiver une atmosphère d’urgence et adopter des actions décisives au nom de la sécurité sont des moyens, non seulement d’étendre les pouvoirs discrétionnaires, mais aussi d’obtenir une certaine forme d’approbation et de consentement. Les autorités transnationales ont des raisons de considérer les urgences comme des occasions de montrer leur valeur à un public sceptique, d’autant plus à l’ère de l’euroscepticisme. Des recherches récentes sur la BCE et la Commission suggèrent un comportement conforme à ce raisonnement2.
La politique de l’urgence nourrit-elle le populisme ?
Je pense que ce que l’on tend à appeler le « populisme » peut être interprété comme une sorte de politique hostile à l’urgence. Comme je l’ai évoqué plus haut, la politique de l’urgence est conçue comme une politique de la nécessité. Qu’elle soit axée sur les pandémies, les migrations ou les bouleversements économiques, les autorités adoptent des mesures non pas parce qu’elles sont intrinsèquement souhaitables, mais pour parer à une menace. Les actions d’urgence sont présentées comme étant imposées par la force des choses dans leur substance et leur temporalité. C’est contre ce mode de gouvernement réactif que de nombreux groupes politiques contestataires se définissent. Ils sont partisans d’une répudiation de la politique de la nécessité – une critique de la docilité face aux forces exogènes.
On a tendance à les qualifier de « populistes », mais ce terme est associé à une foule de considérations sur ce qui motive ces mouvements et leurs adeptes – une haine intrinsèque des élites, de tous ceux qui ne font pas partie du « peuple » authentique, etc. Je me demande si les caractéristiques typiquement identifiées comme propres au populisme ne sont pas nécessairement les véritables moteurs de leur motivation. La promesse de la capacité de décision et de la reprise de contrôle est au cœur de l’attrait populiste. C’est cela qui devient la source principale de son attrait, dans le contexte plus large d’un rejet de la représentativité par d’autres acteurs clefs de la sphère publique.
J’essaie de montrer cela dans mon livre, avec les mobilisations populistes des années 2010, et je pense que l’on voit quelque chose d’assez similaire en réponse au Covid-19. Une compréhension de l’aversion pour la nécessité et l’injonction à « agir » permet de mieux étudier les réactions à la crise par des personnalités telles que Boris Johnson, Donald Trump ou Jair Bolsonaro. Leur attitude implique une hostilité à l’égard des autorités publiques et un refus politique de se laisser « forcer la main » pour répondre à une situation d’urgence. Pour ces dirigeants, adopter un mode de politique purement réactif était une forme de capitulation, une expression de faiblesse, de peur ou de manque d’ambition. Même lorsque les gouvernements dirigés par de telles personnalités ont fini par imposer des confinements et d’autres mesures d’urgence, ils ont cherché à faire comprendre qu’ils étaient personnellement réticents ou opposés à ces mesures. Il y a là un instinct démocratique, mais poussé à l’extrême, qui se traduit par une forme de volontarisme paranoïaque et irrationnel. Mais ce prisme d’analyse permet de comprendre que, tout comme la crise de l’euro a fourni des conditions favorables à l’émergence de partis dénonçant une politique de nécessité et sans alternative, le Covid-19 fait de même.
Le seul véritable remède pour lutter contre l’exploitation de ces crises par les partis extrémistes est que les autres partis renoncent également à la politique de la nécessité et adoptent à nouveau une politique qui s’articule autour de principes clairs, en esquissant une vision de la société et d’eux-mêmes en tant qu’agents de celle-ci. Si ceux que nous appelons les populistes prospèrent parce qu’ils sont les seuls à dire « nous n’allons pas faire les choses par nécessité mais parce que nous le souhaitons », alors il faut déchiffrer pourquoi la politique de l’anti-nécessité passe au premier plan. Le Brexit, les mouvements anti-vaccins, le Front National ou les Gilets Jaunes suivent tous cette logique d’une manière pathologique et dangereuse.
Pour contrer cette dynamique ainsi que la politique de la nécessité qu’elle fustige, il faut un retour de l’idéologie transformationnelle au sein des partis plus traditionnels. Si les partis de centre-gauche et de gauche commencent à avancer des arguments, non pas fondés sur la nécessité, mais sur ce qu’ils pensent être une vision de l’avenir qui vaut la peine d’être défendue, cela pourrait être une façon de dépasser la dialectique problématique entre la politique de l’urgence et sa critique. Pour cela, il faut une politique idéologique qui porte sur ce que nous voulons en tant que société. Beaucoup de partis ne répondent pas à ces critères aujourd’hui et semblent, au contraire, dépourvus de substance idéologique. La tournure que prendra le SPD en Allemagne sera déterminante à cet égard.
Si ceux que nous appelons les populistes prospèrent parce qu’ils sont les seuls à dire « nous n’allons pas faire les choses par nécessité mais parce que nous le souhaitons », alors il faut déchiffrer pourquoi la politique de l’anti-nécessité passe au premier plan.
Jonathan White
Vous affirmez que la politique de l’urgence a considérablement façonné la manière dont les institutions et les politiques ont été élaborées au sein de l’Union ou en marge de celle-ci. En ce sens, ne pourrait-on dire, paradoxalement, que la politique de l’urgence a toujours été la norme au niveau européen ?
La politique de l’urgence a été particulièrement intense ces dernières années, mais elle a sa place dans l’histoire plus longue de l’intégration européenne. Certaines caractéristiques majeures de l’architecture de l’Union sont nées d’abord comme une solution temporaire destinée à desserrer l’emprise des procédures sur le pouvoir discrétionnaire de l’exécutif. Prenons l’exemple de l’émergence du Conseil européen au milieu des années 1970. Jean Monnet3 4, qui en était lui-même un partisan contrairement à ce que l’on pourrait intuitivement penser, l’a présenté comme un « gouvernement européen provisoire » capable de garantir et de consolider l’intégration dans des circonstances de crise comme le choc pétrolier de l’automne 1973 et une récession économique plus large. Plutôt qu’une institution permanente, il proposait un arrangement provisoire qui renforcerait le leadership des exécutifs européens, étant entendu que les structures existantes étaient trop lourdes et bureaucratiques pour faire face aux défis à relever. La création du Conseil européen a permis d’échapper aux contraintes procédurales et de concentrer l’autorité sur les chefs d’État et de gouvernement.
Avec le recul du temps, il est tentant de considérer la formation du Conseil européen comme faisant partie du développement logique des procédures de l’Union – surtout maintenant qu’il est pleinement intégré cadre de l’Union. Mais à l’époque de son introduction, il était surtout prisé pour ses qualités extra-institutionnelles – en tant qu’arrangement ad hoc, « provisoire » plutôt que permanent, et comme moyen de parer aux menaces urgentes qui pesaient sur l’intégration européenne. Tout le monde connaît le dicton de Monnet selon lequel « L’Europe se fera dans les crises et elle sera la somme des solutions apportées à ces crises », mais cette affirmation est un peu trompeuse. Ce ne sont pas les crises en tant que telles qui ont propulsé l’intégration – c’est le fait que les dirigeants ont profité de situations difficiles pour se libérer des contraintes existantes et bâtir des arrangements transnationaux qui renforcent leur pouvoir discrétionnaire.
À ce propos, vous affirmez que le mandat électoral des responsables décroît à mesure que les décisions qu’ils prennent s’éloignent des raisons pour lesquelles ils ont été élus. Pensez-vous que, lorsqu’ils agissent au nom de la gestion de crise, les dirigeants au Conseil européen prennent des décisions à long terme qui outrepassent leurs mandats ?
Inévitablement, oui. Les élections nationales n’ont pas tendance à mettre les questions européennes au premier plan, comme on peut le constater au regard de la séquence électorale allemande qui vient de s’achever. Il est donc inévitable que les décisions prises par le Conseil européen dépassent le cadre des mandats électoraux des personnes qui y sont rattachées. Le Conseil européen est peut-être composé de représentants élus, mais ils sont élus pour des raisons qui n’ont généralement aucun rapport avec les affaires du Conseil. Cette déconnexion est d’autant plus prononcée lorsque les décisions sont prises en urgence. Les gouvernements se sentent alors autorisés à dépasser ou à rompre les engagements qu’ils ont pris dans leur programme électoral – dans des circonstances considérées comme inattendues et même sans précédent, pourquoi être lié par des engagements passés ?
Vous affirmez que « là où les pratiques de contrôle sont bien établies, les pouvoirs exécutifs doivent compter avec des formes d’opposition informelles et spontanées. Là où le pouvoir de contrôle du public est faible, les revendications de nécessité peuvent être déployées avec plus de certitude, puisque la capacité à les mettre en doute dépend d’une bonne connaissance du système ». Comment cette considération bien connue se traduit-elle, selon vous, dans le système européen ?
Un moyen de contrôle sur le pouvoir politique repose sur le pouvoir judiciaire. De nombreux universitaires font confiance aux tribunaux pour limiter l’exceptionnalisme de l’exécutif. Dans le cas de l’Union, cela signifie que l’on attend de la CJUE qu’elle veille au respect des normes et des procédures européennes. Cette approche pose toutefois des problèmes : les tribunaux ont parfois tendance à faire preuve de déférence à l’égard du pouvoir exécutif dans les moments à fort enjeu, et à rendre leurs verdicts bien après que le moment politique soit passé. C’est également une approche qui, parce qu’elle attribue un grand pouvoir aux juges, soulève des problèmes d’ordre démocratique. Selon Carl Friedrich, « derrière tous ces dispositifs procéduraux, il doit y avoir un peuple vigilant, un véritable pouvoir constituant, déterminé à veiller à ce que ces limites soient effectivement posées… ». L’idée est que si les dirigeants savent qu’ils sont confrontés à un public critique, ils éviteront les tentations de l’exceptionnalisme.
Mais cela suppose un public vigilant qui connaît le système et sait comment demander des comptes aux dirigeants. Pour cela, il faut un public qui sait, par exemple, où se situe la responsabilité des décisions, qui connaît certains des choix politiques existants et qui est capable de faire entendre son point de vue dans un système structuré. Ce type de public européen critique est encore loin d’exister. Et s’il doit émerger, il aura besoin de l’aide de corps intermédiaires forts, des partis et des mouvements transnationaux qui se consacrent à rendre le système européen lisible et à faire connaître la manière de contester les décisions prises.
Comment la contestation de la politique de l’urgence peut-elle trouver sa place dans le contexte transnational ? Que recouvre ce que vous appelez la politique de désobéissance de principe ?
Dans l’état actuel des choses – une politique transnationale dominée par le pouvoir exécutif, et une opinion publique faiblement institutionnalisée – il est difficile de contester les mesures d’urgence en temps réel. Il se peut que le mieux que l’on puisse espérer soit une contestation rétrospective – des efforts pour démêler les mesures qui ne sont plus nécessaires, ou qui n’ont peut-être jamais été nécessaires, et pour décourager de nouveaux actes d’exceptionnalisme à l’avenir. C’est là qu’intervient la désobéissance de principe.
L’un des caractéristiques de la gestion de crise de l’Union est que les mesures prises dans l’urgence tendent à être associées à des efforts visant à les pérenniser par la suite (pensez aux règles budgétaires pour un exemple négatif ou au Fond de relance pour un exemple positif). Cela signifie que ceux qui souhaitent repenser l’ordre établi sont contraints de le faire par des moyens qui enfreignent les règles. Au fur et à mesure que les politiques sont intégrées, il devient plus difficile de les contester par des moyens conventionnels.
Dans le livre, j’analyse les efforts de Syriza au printemps 2015 pour contester les conditions de la Troïka, et les conditions plus larges de son appartenance à la zone euro, comme des efforts avortés de désobéissance de principe. Cela signifie briser les règles (de l’Union), ou menacer de les briser, dans le but de souligner leur injustice – un peu comme la désobéissance civile est utilisée au niveau national par ceux qui veulent dénoncer l’injustice des lois. Cela soulève une série de questions sur ce qui distingue la désobéissance de principe de la violation des règles et du sabotage dans un but intéressé. L’un des critères que je mets en avant dans mon livre est le caractère universel de la désobéissance – elle doit être convaincante pour le bien de l’ensemble, et pas seulement pour l’intérêt particulier de ceux qui la pratiquent. Je pense qu’il est juste de dire que les actions de Syriza correspondaient à cette description car il ne s’agissait pas seulement d’une résistance nationale, mais d’une opposition aux politiques menées au nom de toute l’Europe. Bien sûr, cela n’a pas nécessairement renforcé leurs chances de succès, mais cela en fait un précédent de la désobéissance de principe intéressant.
L’un des critères que je mets en avant dans mon livre est le caractère universel de la désobéissance – elle doit être convaincante pour le bien de l’ensemble, et pas seulement pour l’intérêt particulier de ceux qui la pratiquent.
Jonathan White
Vous affirmez qu’en participant aux élections nationales en tant que militants transnationaux, ceux qui critiquent le pouvoir discrétionnaire de l’exécutif de l’Union sous couvert de l’urgence peuvent prendre des mesures visant à le contraindre politiquement. Qu’entendez-vous par là ?
Il me semble que des partis politiques forts sont indispensables pour façonner positivement le pouvoir exécutif dans des circonstances extrêmes. Au gouvernement, les partis sont un moyen de lier les dirigeants à une organisation de principe plus large. Lorsque les dirigeants sont responsables devant un parti, cela agit comme un frein à la concentration du pouvoir et à la confiance dans la marge de manœuvre personnelle. Dans l’opposition, les partis sont un moyen de cultiver la vigilance à l’égard des abus de pouvoir et de décourager l’exceptionnalisme, tant dans les institutions politiques que technocratiques.
Une transnationalisation plus forte des partis au sein de l’Union serait synonyme d’une plus grande limitation de l’exceptionnalisme de l’exécutif, voire d’une plus grande cohérence dans l’élaboration des politiques. Le lieu le plus naturel pour cela est le Parlement européen, mais celui-ci a encore des pouvoirs limités, il est encore trop facilement mis à l’écart.
Son renforcement contribuerait grandement à favoriser la dynamique gouvernement/opposition au niveau européen, mais le Conseil européen et d’autres acteurs s’y opposeront probablement. Les élections nationales restent le principal lieu de contestation du pouvoir. Mais il n’y a aucune raison pour que les élections nationales ne puissent pas être contestées par des partis organisés au niveau transnational (Volt en est un exemple, bien que ses positions soient trop modérées). Il s’agit d’un moyen de substitution par lequel l’opinion publique pourrait commencer à se consolider sur les questions européennes. Je pense bien sûr à long terme – il faudrait probablement que de nombreux efforts échouent avant que quelque chose de ce genre n’advienne.
Une transnationalisation plus forte des partis au sein de l’Union serait synonyme d’une plus grande limitation de l’exceptionnalisme de l’exécutif, voire d’une plus grande cohérence dans l’élaboration des politiques.
Jonathan White
Parmi les autres solutions présentées dans votre livre, vous envisagez la formation d’un exécutif européen puissant, unique et élu, capable d’effectuer des changements profonds tout en étant très encadré par le contrôle d’un public structuré sur le plan institutionnel. Comment cela se présenterait dans la pratique et n’y a-t-il pas une certaine contradiction entre cette proposition et votre dénonciation de la concentration du pouvoir ?
Un exécutif plus simple et unique et plus facilement contrôlé par le grand public correspond à une vision très éloignée de de la configuration actuelle de l’Union, j’en suis bien conscient.
L’un des problèmes actuels réside dans le nombre considérable d’acteurs exécutifs impliqués (la Commission, la BCE, le Conseil, une série d’agences exécutives, etc.) Une option consisterait à choisir l’un d’entre eux – disons la Commission – et à le rendre plus puissant, tout en démocratisant ce pouvoir. Si vous exigez que les commissaires soient des députés européens, vous commencez à intégrer l’exécutif dans le pouvoir législatif. Le droit d’initiative serait ainsi entre les mains des représentants élus, ainsi que la capacité de définir et d’appliquer la politique. Un tel arrangement maximiserait les chances que le pouvoir exécutif soit mis au service du plus grand nombre plutôt que de quelques-uns, tant dans des conditions extrêmes que dans une situation « normale ». Il est indéniable que cela politiserait l’Union européenne et certains diront que c’est contraire à l’esprit de l’équilibre institutionnel. Mais cette évolution devrait être envisagée comme une refonte fondamentale des institutions européennes. Le Conseil devrait se voir confier une fonction de contrôle plutôt que d’exécution. Les formations para-juridiques telles que l’Eurogroupe seraient idéalement dissoutes. L’essentiel est qu’il s’agisse d’une refonte qui ne soit pas dictée par une politique de l’urgence, mais qui se fasse par le recours à une sorte de moment décisionnel constituant. Il ne s’agit pas d’une refonte des institutions en réponse aux problèmes du jour, comme le suggèrent les notions de Commission politique ou géopolitique autoproclamées, mais d’une refonte structurelle globale.
Bien sûr, tout cela est à contre-courant de ce qui se dessine actuellement et cela impliquerait d’importants transferts de pouvoir. Les personnes hostiles à un modèle fédéral auraient de quoi s’opposer à cette idée. Mais contrairement à la politique de l’urgence qui traite les problèmes de façon ad hoc, les enjeux seraient clairs pour tous au moment de cette réforme. Alors que les arrangements à court terme, adoptés à un moment de grande tension, ont tendance à être introduits sans que l’on prête suffisamment attention à leurs défauts, la perspective d’un nouvel ordre constitutionnel durable est susceptible de susciter un examen critique plus que suffisant. Il ne serait approuvé que dans la mesure où ses dispositions sont acceptables en tant que caractéristiques permanentes, plutôt qu’en tant que déviations temporaires de la normalité institutionnelle, évitant ainsi certaines des ambiguïtés critiques associées à la politique de l’urgence informelle.
Une révision constitutionnelle majeure de ce type devrait bien sûr être considérée comme un exercice du pouvoir constituant, et donc un processus ascendant mené par les citoyens et imposé aux pouvoirs existants. Cela n’est pas facile à mettre en œuvre. La manière dont l’actuelle Conférence sur l’avenir de l’Europe a été neutralisée par les autorités et rendue inoffensive en veillant à ce qu’elle ne puisse pas déboucher sur une modification du traité, est une indication des difficultés à remettre en question le statu quo.
Sources
- La BCE déclare par exemple que le PEPP prendra fin lorsqu'« elle jugera que la phase de crise Covid-19 est terminée »
- Christian Rauh (2021), ‘Supranational emergency politics ? What executives’ public crisis communication may tell us’, Journal of European Public Policy.
- Monnet (Memoires), p.503
- Monnet’s memo (‘Constitution and Action of a Provisional European Government’), August 1973.

