Le roman familial d’Édouard Louis
Dans ce dernier opus en date d'une série familiale, Édouard Louis livre le portrait de sa mère, héroïne de laquelle il se sent proche en raison d'une solidarité de dominés, dans une relation nocive avec le père « Bellegueule », figure repoussante de Qui a tué mon père. Une nouvelle fois, mais de manière différente, Édouard Louis joue sur les limites entre la politique et la littérature – au risque de s'épuiser.
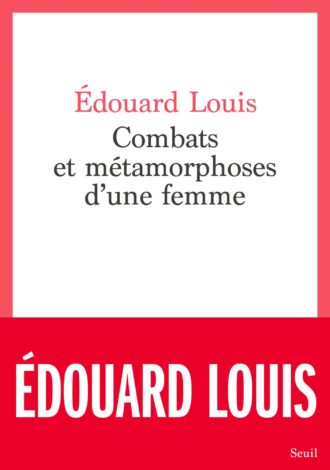
Après En finir avec Eddy Bellegueule (2014), Histoire de la violence (2016) et Qui a tué mon père (2018), Édouard Louis vient de publier aux Éditions du Seuil un quatrième livre, Combats et métamorphoses d’une femme (2021)1. Les quatre ouvrages relèvent de l’écriture autobiographique et composent un roman familial qui se précise et se corrige tous les deux ou trois ans, au rythme des parutions.
En finir avec Eddy Bellegueule racontait l’enfance du narrateur-auteur dans son petit village picard, les violences homophobes qu’il y avait subies, la pauvreté dans laquelle il avait grandi ; il y dressait un tableau effrayant de son milieu, caractérisé par la brutalité, la saleté, le machisme, l’abrutissement permanent par la télévision (il y aurait beaucoup à dire sur la manière dont la télévision est érigée de livre en livre en symbole d’aliénation et de pauvreté, en objet quasi-phobique). Au nom d’une souffrance « totalitaire », il rejetait en bloc tout le monde de son enfance et de sa prime adolescence, ses parents y compris, ne trouvant d’issue que par la fuite c’est-à-dire par son inscription dans un lycée et un internat amiénois. Le changement de nom d’Eddy Bellegueule, devenu Édouard Louis, matérialisait sur la couverture sa rupture avec son milieu prolétaire d’origine et son accession à la petite bourgeoisie intellectuelle.
Laissons de côté Histoire de la violence, qui racontait un viol subi par l’auteur et qui se trouve un peu en marge du roman familial. Dans Qui a tué mon père, Édouard Louis revenait à cette figure paternelle dont le premier opus offrait un portrait parfois véritablement repoussant. Comme pour s’excuser, il entreprenait cette fois d’explorer la genèse des violences subies par le père, qu’elles proviennent de ses propres enfants (le frère d’Eddy aurait pu le tuer au cours d’une bagarre provoquée par Eddy lui-même) ou de la société, de l’ordre capitaliste et des décideurs politiques (victime d’un grave accident de travail, le père d’Eddy a souffert physiquement pendant des années et a dû vivre des très modestes aides sociales qui lui étaient allouées). La troisième et dernière partie de ce livre accusait plusieurs et femmes politiques (Chirac, Xavier Bertrand, Sarkozy, Martin Hirsch, Valls, Hollande, El Khomri, Macron) d’avoir causé par leurs décisions la dégradation de son niveau de vie et de son état de santé. À plusieurs reprises, ce bref ouvrage thématisait la question des sentiments ambivalents, mêlant amour et haine, éprouvés par l’auteur à l’égard d’un père qui fut aussi, par certains aspects, un bourreau ; mais contraint par son ton souvent très sobre et très neutre, sans doute inspiré de l’écriture plate d’Annie Ernaux, Édouard Louis ne faisait qu’effleurer ces complexités psychologiques, récusées par le geste final d’élargissement du personnel au politique.
Désigner Valls ou Sarkozy comme les responsables du malheur de son père, c’était situer la vérité des vies singulières dans l’ordre politique – et c’était là le propos explicite, assumé, du livre –, mais c’était aussi s’acquitter soi-même de la haine et neutraliser définitivement les affects ambigus qui surgissaient. Soit ; mais on pouvait trouver frustrante cette sortie de piste finale, si contrôlée qu’elle fût. Le passage du « roman » biographique (car l’étiquette « roman » figure sur la page de garde) au tract politique paraissait une facilité.
Dans Combats et métamorphoses d’une femme, les choses sont finalement plus claires et plus apaisées car Édouard Louis n’a pas à l’égard de sa mère – qui est l’héroïne de ce court texte – des sentiments aussi ambigus qu’à l’égard de son père. Il l’aime, la défend et prend son parti, au nom d’une solidarité de dominés (lui étant gay, elle étant une femme), contre leur bourreau de mari et de père. Le livre peut se lire comme une déclaration d’amour. Le propos étant moins ambivalent que dans le livre précédent, il est aussi plus simple et moins embarrassé, plus construit et mieux tissé, et reste toujours de plain-pied avec son sujet, sans prendre la tangente à la fin ; bref, le sujet étant plus facile, le traitement est plus réussi. On voit d’ailleurs se préciser, en lisant ce quatrième opus, quelques aspects du roman familial de l’auteur. Le fait que Monique Bellegueule, elle aussi, ait changé de nom (mais l’a-t-elle fait avant ou après son fils ?) désigne rétrospectivement le nom « Bellegueule » non pas comme celui de la famille, mais comme celui d’un seul homme ; le congé éruptif et violent donné en 2014 par Édouard Louis à tout son milieu d’origine ne concerne désormais plus que son père, ou du moins concerne désormais principalement son père. La cruauté de certaines notations d’En finir avec Eddy Bellegueule et la responsabilité diffuse d’Eddy Bellegueule dans le quasi-meurtre raconté en 2018 incitaient déjà à lire le titre Qui a tué mon père, figurant sans point d’interrogation sous le nom de l’auteur (Édouard Louis), non comme une interrogative indirecte mais comme une subordonnée relative, c’est-à-dire comme l’aveu d’un parricide symbolique ; celui-ci paraît désormais consommé.
Ce quatrième livre est le premier de la série à ne pas porter, sur sa couverture ou sa page de garde, la mention « roman » : les photographies qui parsèment l’ouvrage (à la manière là encore d’Annie Ernaux) constituent une caution d’authenticité et servent à prendre congé de la fiction. Combats et métamorphoses raconte la trajectoire de Monique Bellegueule, victime du machisme des hommes et des humiliations infligées par son époux, victime de la violence de classe infligée par Eddy Bellegueule lui-même après qu’il fut devenu un transfuge, victime aussi de la misère, jusqu’à son émancipation (difficile, progressive et inachevée) qui passe par un changement de nom et de ville. La trajectoire de la mère ressemble décidément beaucoup à celle du fils – en mode mineur, sans le succès flamboyant, sans l’aisance matérielle, sans la notoriété ; hors de la fuite, du changement de nom, de l’installation à Paris, point de salut. La campagne demeure un repoussoir radical. Le portrait de la mère par le fils a donc des allures d’autoportrait – certes en un peu plus pâle, en un peu moins triomphal : cela contribue à tisser l’émouvante solidarité qui les unit, mais cela revient aussi à suggérer qu’il n’y a qu’une seule stratégie d’émancipation possible, et ainsi compris le propos devient sourdement plus pessimiste.
Le texte parvient en plusieurs endroits à susciter l’émotion et l’empathie ; son projet plus clair et mieux assumé en fait une œuvre mieux mûrie que les précédentes. Mais la matière semble s’épuiser très vite, comme en témoigne l’exiguïté de l’ouvrage (116 pages très aérées), et nous empêche d’engager un véritable compagnonnage littéraire avec l’héroïne du livre. On se demande si cela ne tient pas un peu à l’impérialisme de la grille de lecture sociologique imposée aux faits racontés ; car si l’on veut ne voir dans le parcours de Monique Bellegueule qu’une illustration exemplaire de la violence de genre et de classe, alors il est naturel que le propos s’use vite dans la redondance d’une démonstration toujours déjà faite. Et au lieu de lâcher la bride à ses capacités d’investigation psychologique (Histoire de la violence nous avait montré son talent dans cet exercice), Édouard Louis fait encore des structures sociales les vérités ultimes du réel – en témoigne sa tendance à conclure ses anecdotes par des clausules récapitulatives qui en résument et en écrasent le sens (p. 78, p. 85, p. 89 par exemple). À peine le dispositif frémit-il un peu quand le texte envisage, émerveillé, qu’un « facteur psychologique » (la dépression d’une amie de Monique) puisse « rend[re] poreuses les lois habituelles de la sociologie » (p. 62). Ajoutons que cette sociologie, si elle est efficace jusqu’à un certain point, est peut-être un peu sommaire : l’opposition binaire entre les pauvres et les « bourgeois » occulte par exemple la complexe frontière de classe qui, de l’aveu même d’Édouard Louis, passe au sein même du ménage Bellegueule, entre une mère femme au foyer mais issue de la classe ouvrière et un père ouvrier mais issu du Lumpenproletariat (p. 52). De même, la catégorie de « bourgeoisie », dont il est fait grand cas, est remarquablement nébuleuse et sous-déterminée. On ne peut s’enlever de l’idée qu’Édouard Louis, tout à sa volonté assumée d’écrire un « manifeste politique » aiguisé comme « la lame d’un couteau » (p. 19), s’est fermé quelques possibilités littérairement fécondes. Mais puisqu’il se propose d’écrire « contre la littérature » (p. 20), ce n’est peut-être pas très grave.

