Le pouvoir de la destruction créatrice : de l’intégration de la critique au dépassement du néolibéralisme ?
Les évolutions dans la théorie économique impliquent-elles simplement une réforme du néolibéralisme ou bien son dépassement ? Une note de lecture particulièrement fouillée du dernier livre de Philippe Aghion et al.
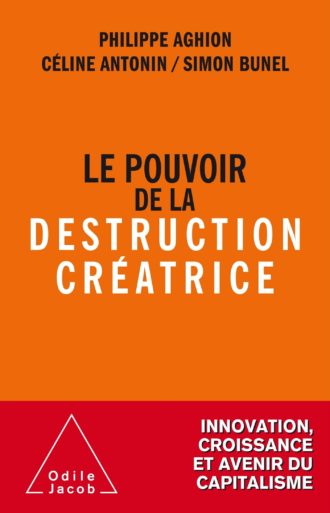
L’objectif de cette note de lecture est de discuter le livre de Philippe Aghion, Céline Antonin et Simon Bunel (ci-après désignés sous les initiales AAB), Le pouvoir de la destruction créatrice paru en 2020 (édition Odile Jacob). Après une première section de présentation du livre, les sections deux à cinq analysent certains points spécifiques de l’argumentation : intérêt de la croissance et de l’innovation, prise en compte des institutions, théorie de l’Etat et du changement institutionnel. La section 6 conclue la note en s’interrogeant sur la dynamique d’intégration de la critique du capitalisme par l’économie dominante.
1 – Présentation du livre : destruction créatrice et institutions
Il faut souligner d’emblée que le livre est bien écrit et accessible. Le texte est facile à lire et les explications sont très pédagogiques pour le profane. Les graphiques et tableaux nombreux aèrent l’ouvrage et aident grandement à la compréhension de l’argumentation. De nombreuses références récentes viennent à l’appui du propos. L’écriture est dynamique : les chapitres, sections et sous-sections sont courtes et bien articulées. Le lecteur pressé appréciera par ailleurs les conclusions synthétiques à chaque fin de chapitre. On ne peut que remercier les auteurs pour cet effort d’ensemble.
La thèse centrale du livre est présentée de la façon suivante dès le premier chapitre qui fait office d’introduction :
« La destruction créatrice est le processus par lequel de nouvelles innovations se produisent continuellement et rendent les technologies existantes obsolètes, de nouvelles entreprises viennent constamment remplacer les entreprises en place, et de nouveaux emplois et activités sont créés et viennent sans cesse remplacer les emplois et activités existants. La destruction créatrice est ce moteur du capitalisme qui assure le renouvellement permanent et la reproduction, mais qui en même temps génère du risque et des bouleversements qu’il faut savoir réguler et orienter. » (AAB, 2020, p. 11, je souligne).
Les auteurs qualifient leur approche de « paradigme schumpetérien » et prennent le soin de le distinguer de la théorie de la croissance de Robert Solow – qu’ils qualifient de néoclassique. Trois idées fortes, répétées régulièrement tout au long du livre, complètent la définition liminaire :
« 1) La croissance repose sur un processus cumulatif de progrès du savoir : chaque nouvelle innovation utilise le savoir contenu dans les innovations précédentes, chaque nouvel innovateur se fait sur les « épaules des géants » qui ont précédé ; 2) l’innovation requiert un environnement institutionnel favorable, à commencer par une bonne protection des droits de propriété ; 3) l’innovation détruit les rentes existantes, et par conséquent nécessite un environnement concurrentiel pour permettre l’entrée de nouvelles entreprises innovantes » (ibid., p. 50).
L’ensemble de l’ouvrage est consacré à la démonstration de la supériorité du paradigme schumpétérien pour expliquer la croissance, cette dernière étant conçue comme l’horizon le plus souhaitable pour l’ensemble de la société. On peut reformuler l’ambition du livre sans la dénaturer en quatre thèses articulées :
Thèse 1 : L’innovation est à l’origine de la croissance économique qui elle-même est le socle de l’amélioration du bien-être des sociétés. L’innovation est créatrice de bien-être.
Thèse 2 : L’innovation produit des effets néfastes sur certains secteurs de la société ce qui la rend difficile à accepter socialement et politiquement. L’innovation est destructrice de bienêtre.
Thèse 3 : L’État doit produire un contexte institutionnel permettant de favoriser l’innovation tout en protégeant les victimes de l’innovation pour qu’elles s’adaptent aux nouvelles conditions économiques. L’État est au cœur d’un capitalisme régulé favorisant et rendant acceptable la destruction créatrice.
Le rôle de l’Etat est central puisqu’il doit assurer un double équilibre :
- L’État doit assurer un équilibre entre protection des innovateurs par des rentes spécifiques et mise en concurrence des entreprises. Les innovateurs sont encouragés à innover par l’existence de droits de propriété leur octroyant un monopole temporaire (les brevets) et par des investissements spécifiques de l’État (éducation, secteur innovants, etc.). Mais, une fois la juste récompense de l’innovateur reçue, la concurrence doit reprendre ses droits car elle est elle-même favorable à l’innovation lorsque les nouveaux innovateurs cherchent à gagner des parts de marché. La mise en concurrence suppose par ailleurs la lutte contre des rentes illégitimes (non liée à l’innovation).
- L’État doit assurer un équilibre entre l’insécurité endogène au processus d’innovation et la stabilité pour les secteurs qui sont victimes des nouvelles vagues technologiques. L’innovation créé du chômage, de la précarité et des mauvaises conditions de santé, ce qui la rend légitimement contestable à court terme. L’État doit alors protéger les citoyens par des garanties sociales de toutes sortes (assurance chômage, formation professionnelle, système de santé, etc.).
Thèse 4 : L’Etat n’est cependant pas un acteur exempt de défauts, il est capable de collusion avec les intérêts économiques et peut de ce fait protéger des rentes illégitimes au regard de l’efficacité économique. L’enjeu est alors de favoriser une constitution démocratique et, surtout, d’opposer au marché et à l’État un troisième pôle : la société civile. Celle-ci peut par ses choix de consommation, par l’influence dans les entreprises (responsabilité sociale de l’entreprise) ou par des manifestations obliger l’Etat (et le marché) à se réformer dans le sens d’une plus grande prise en compte de l’intérêt général.
Par rapport aux ouvrages précédents auxquels Philippe Aghion a contribué, l’intérêt du livre de AAB est double. D’une part, il systématise la réflexion sur le contexte institutionnel nécessaire à l’acceptabilité et au déploiement du processus de destruction créatrice. D’autre part, il entame le débat avec les contributions les plus récentes et populaires de la théorie économique. Par exemple, le chapitre 5 discute les travaux de Thomas Piketty en précisant que toutes les inégalités ne sont pas également condamnables : les inégalités liées à l’enrichissement par l’innovation sont légitimes car elles profitent à tous, tandis que les autres sont illégitimes car elles produisent des rentes inefficaces. Autre exemple : le chapitre 11 prend en considération les travaux d’Anne Case et Angus Deaton sur les effets néfastes de la perte d’emploi sur la santé pour en déduire que l’Etat doit mettre en place des politiques sociales généreuses de protection contre la précarité endogène au processus de destruction créatrice. Nombre de thématiques récentes sur la critique du capitalisme sont ainsi passées au crible : destruction de l’emploi par l’innovation, stagnation séculaire, syndrome argentin, décroissance et écologie, Etat investisseur, mondialisation, etc. A chaque fois, l’enjeu est de mettre en évidence l’intérêt pour la croissance du processus de destruction créatrice et de discuter des institutions nécessaires pour l’encourager et/ou le rendre acceptable.
Dans la conclusion, reprenant la distinction de Daron Acemoglu, James Robinson et Thierry Verdier (Acemoglu et al., 2017), AAG contestent l’idée qu’il soit nécessaire de choisir entre un capitalisme féroce (cutthroat capitalism), et un capitalisme douillet (cuddly capitalism) ; entre un capitalisme efficace économiquement mais féroce pour les individus ou un capitalisme inefficace économiquement mais protecteur pour les individus :
Le capitalisme est un cheval fougueux : il peut facilement s’emballer, échappant à tout contrôle. Mais si on lui tient fermement les rênes, alors il va où l’on veut » (idbid., p. 395).
Le capitalisme est le meilleur système économique et politique pour l’intérêt général. Les forces du marché (innovation et concurrence) doivent cependant être tenues par un Etat puissant et une société civile soucieuse de jouer son rôle de contrepouvoir.
2 – L’intérêt de la croissance et le lien innovation / croissance
L’ouvrage de AAB présente les défauts de ses qualités. En allant au plus vite pour discuter d’une multitude de problématiques labourées par la littérature en sciences sociales, le lecteur reste très surpris par beaucoup de résultats qui sont présentés comme des évidences alors qu’ils font l’objet de débats passionnés. Chaque chapitre mériterait une discussion approfondie par des spécialistes des questions traitées, on se bornera dans cette note de lecture à quelques points principaux.
Le plus grand étonnement à la lecture du livre repose sur l’idée que la croissance économique est indubitablement un bien à poursuivre pour toutes les sociétés. Si les thématiques de la décroissance et la critique de la croissance sont évoquées, c’est pour les rejeter en peu de mots. Pourtant la recherche sur les sociétés post-croissance n’a jamais été aussi vigoureuse, le plus souvent en partant des limites écologiques à la croissance mais aussi en remettant en cause ses implications politiques et sociales (Douai et Plumecoq, 2017, Rotillon, 2020, Tordjman, 2021). Les séries longues fournies au chapitre 2, intitulé l’énigme du décollage, montrent avec éloquence que la période de croissance soutenue est très récente dans l’histoire de l’humanité mais rien n’est dit sur la capacité ou non de l’innovation à résoudre les défis de l’âge de l’anthropocène, que certains ont renommé le capitalocène. Le raisonnement présenté au chapitre 9 sur l’innovation verte et la croissance soutenable laisse le lecteur largement sur sa faim :
« Seule l’innovation peut reculer les frontières du possible. Seule l’innovation pourra éventuellement permettre d’augmenter notre qualité de vie en utilisant de moins en moins de ressources naturelles, et en émettant de moins en moins de dioxyde de carbone. Seul l’innovation permettra de découvrir de nouvelles sources d’énergies de plus en plus propres » (AAB, 2020, p. 218).
Peut-on se permettre de rejeter la discussion sur les sociétés post-croissance en deux pages (217-218) sur la base d’un pari ? L’angle adopté dans le livre porte sur la capacité de l’État et de la société civile à inciter les entreprises à innover dans les secteurs verts plutôt que sur la probabilité que ces innovations vertes soient en capacité de nourrir un processus de croissance soutenable. Peut-on s’en satisfaire pour orienter la société vers la croissance et l’innovation ? Est-il impossible que le pari soit perdu ? Ne faut-il pas prendre en compte cette hypothèse pour discuter des projets de sociétés alternatifs ?
Une autre interrogation porte sur la conception du capitalisme. Le chapitre sur le décollage industriel évoque quelques institutions favorables à la destruction créatrice (diffusion de la connaissance, droits de propriété, pratiques de financement, etc.) mais ne mentionne pas le rôle central de l’avènement du rapport social de production capitaliste dans le bouleversement perpétuel « des conditions techniques et sociales du procès de travail » (Marx, 1993[1867]). C’est parce que le rapport social de production change en concentrant le pouvoir dans les mains du capitaliste que les innovations deviennent centrales dans l’activité économique. Comme le suggère Marx, étouffé par la concurrence, le capitaliste particulier doit sa survie à l’augmentation la durée de la journée de travail (survaleur absolue) et au gains de productivité engendrés par la modification permanente de l’organisation et des moyens de travail (survaleur relative). Tout cela aurait-il été possible sans la séparation du producteur des moyens de production, sans la séparation de l’escargot de sa coquille ?
Parmi les points importants qui sont trop peu discutés figure l’absence de réponse structurelle aux critiques désormais bien établies du paradigme schumpétérien. On pourra par exemple se référer à l’ouvrage de Bruno Amable et Ivan Ledezma (2015) pour une discussion théorique et empirique. Selon ces derniers, rien ne permet d’affirmer que la libéralisation (mise en concurrence des monopoles qui seraient détenteurs de rentes illégitimes) conduise à plus d’innovation, de productivité et donc de prospérité. Le livre de AAB reconnait l’importance stratégique de la subvention par l’État de l’innovation (en discutant de l’intérêt du Defense Advanced Research Projects Agency aux États-Unis) et écarte l’idée selon laquelle seule la concurrence génère de l’innovation. L’État ne doit pas seulement organiser la concurrence mais il doit aussi subventionner des secteurs stratégiques. Cette revalorisation de l’État et de la politique industrielle répond à une partie de la critique, sans pour autant ébranler les résultats sur le monopole. Est-on certain que les monopoles sont nécessairement néfastes s’ils ne sont pas innovants ? On peut penser par exemple à la protection sociale, tiraillée entre la sécurité sociale et les complémentaires.
Une autre critique importante qui reste sans réponse porte sur l’absence de réalisme des modèles théoriques sous-jacents aux développements proposés. On pourra se référer aux travaux de Michel Husson qui s’est fait une spécialité de décoder la signification des hypothèses des modèles théories mainstream (Husson, 2017). Le lecteur aurait aimé savoir dans quelle mesure les auteurs se sentent concernés par la critique de Paul Romer, prix de la banque de Suède 2018, selon lequel la macroéconomique contemporaine est fondée sur des modèles post-réels (Romer, 2016) ?
L’absence de discussion de ces différents points manque d’autant plus que d’autres approches de l’innovation trouvent un succès important dans la littérature : capitalisme de surveillance (Zuboff, 2020), hypothèse techno-féodale (Durand, 2020), centralité de l’État dans l’innovation (Mazucato, 2020), incapacité de la technique à répondre aux problèmes sociaux (Lechevalier, 2019), etc. L’ouvrage a été écrit pendant la pandémie de Covid-19 et quelques sections portent sur ce sujet. On regrette que les effets négatifs des brevets sur les médicaments pour promouvoir l’accès aux soins n’aient pas été mentionnés (Guennif, 2021a et b). Ce cas n’invalide-t-il pas les thèses des auteurs ?
3 – Les institutions partout, l’institutionnalisme nulle part
Un des grands intérêts de l’ouvrage de AAB est de refuser une lecture purement techniciste ou économiste de la croissance. Comme le répètent les auteurs, pour libérer le plein potentiel de la destruction créatrice, il faut un bon contexte institutionnel. Cependant, à aucun moment le concept d’institution n’est défini et il semble que le seul critère d’évaluation des institutions soit leur capacité à se mettre au service de la destruction créatrice. Les institutions sont partout, l’institutionnalisme nulle part.
Ce problème théorique et méthodologique nuit à la cohérence d’ensemble du livre. En l’absence d’une définition des institutions aussi sérieuse que celle qui est donnée de la destruction créatrice, les institutions ont un statut de carte joker. Lorsque le pouvoir de la destruction créatrice est trop brutal (chômage, précarité, etc.) ou lorsqu’il est contenu (rentes illégitimes, médiocrité de l’enseignement, etc.), c’est du fait du trop peu ou du trop d’institutions. Ces dernières ne sont alors jamais analysées en tant que telles, elles le sont toujours au prisme de ce qu’elles font à l’innovation et la croissance. Rien ne permet de comprendre la rationalité des institutions : elles sont totalement instrumentales – soit obstacle à la destruction créatrice soit moteur. Tout se passe comme s’il existait une force magique et que le reste n’avait d’intérêt qu’au service de cette magie.
Le recours que l’on suggère ici à l’une ou l’autre des traditions institutionnalistes (Chavance, 2007) n’a rien d’une coquetterie. Cela éviterait plusieurs problèmes. Premièrement, cela permettrait de positionner théoriquement les concepts de destruction créatrice et d’innovation par rapport aux autres institutions. Deuxièmement, cela permettrait de se demander si des institutions jugées apriori inefficaces au regard du processus de destruction créatrice n’ont pas une autre rationalité ce qui les rendrait légitimes au regard d’autres critères. Les sociétés que nous analysons en sciences sociales sont peuplées d’institutions qui entretiennent des rapports de force mais aussi des valeurs, des normes et des conventions qui s’appuient sur d’autres critères de légitimité que la capacité à produire de la croissance économique. Par exemple, pourquoi, comme le suggère le chapitre 5, l’horizon du système scolaire ne se mesurerait qu’à sa capacité à « récupérer le maximum d’Einstein » (AAB, 2020, p. 261) ?
Une théorie des institutions un peu plus rigoureuse permettrait éventuellement d’éclaircir la conclusion des auteurs. Comme on l’a souligné dans la section 1, les auteurs contestent la nécessité de choisir entre un capitalisme féroce (type étasunien) et un capitalisme douillet (type scandinave). La politique publique doit réguler le capitalisme dans le sens de l’alliance du meilleur des deux situations spécifiques : « nous croyons fermement au ‘et’ » (AAB, 2020, p. 395). Or, l’un des résultats les plus intéressants de l’institutionnalisme est l’existence de complémentarités institutionnelles expliquant la cohérence entre les variétés du capitalisme (Hall et Soskice, 2002). Sur quelles bases peut-on s’assurer que des institutions efficaces dans un capitalisme particulier le resteront si elles sont désencastrées de la situation qui les a vu naître ? Comme en cuisine, certains aliments sont bons dans leur contexte mais les mélanger peut produire des catastrophes. C’est le cas de la pizza à l’ananas. Dans quelle mesure peut-on s’assurer que les institutions des différents capitalismes sont complémentaires ?
4 – L’État et la société civile : pouvoir et contrepouvoir ?
L’institution centrale du livre est l’État car il régule l’ensemble de l’activité économique au nom de l’intérêt général. Il a la charge de mettre en œuvre les politiques publiques permettant de favoriser l’innovation et de protéger les individus de ses effets pervers. La destruction créatrice est le moteur de la croissance et l’État est le volant qui permet d’orienter, sinon de diriger la machine.
L’un des grands intérêts du livre est de ne pas faire l’hypothèse de l’État dictateur bienveillant. De nombreux développements sont consacrés à l’ambivalence de l’Etat dont l’impartialité est souvent annihilée par sa proximité avec les groupes d’intérêts économiques. La question du lobbying traverse tout le livre. Le chapitre 15 intitulé « L’État, jusqu’où ? » propose une critique de l’État lorsqu’il fait obstacle à la destruction créatrice. Il peut en effet protéger les entreprises peu efficaces et leurs employés de la concurrence en leur octroyant les faveurs du monopole. Le chapitre propose une critique des effets d’une mauvaise constitution et rappelle l’existence de limites à l’impartialité du pouvoir judiciaire. Face aux dangers de l’État, il faut favoriser des institutions démocratiques puissantes mais aussi ce que les auteurs appellent la société civile.
Lorsque l’État est défaillant, la société civile peut prendre le relai de la défense de l’intérêt général. AAB reprennent à leur compte les développements récents de Samuel Bowles et Wendy Carlin (2020) pour lesquels il faut repenser le politique dans un monde où le capitalisme conduit à la destruction des communautés et à l’aliénation – encourageant ainsi la montée en puissance des mouvements autoritaires. Entre le marché et l’État, l’analyse économique doit penser le rôle de la société civile (Figure 1)1.

La prise en compte des défauts de l’État est bienvenue. Mais, la société civile, le non-étatique, doit-il seulement être restreint au statut de contrepouvoir ? L’État doit-il être maintenu dans le rôle d’institution d’intérêt général indépassable ?
Ces questions sont d’autant plus importantes qu’au chapitre 14 (« L’émergence de l’État investisseur, puis de l’État assureur »), les auteurs soulignent combien la naissance et le développement de l’État est lié à une activité prédatrice :
« Pendant longtemps, c’est principalement la rivalité militaire qui a incité les Etats à accroitre leur capacité à taxer et à investir dans les services publics (Tilly, 1975 ; Besley et Persson, 2011). En particulier, le développement d’un système d’écoles publiques n’a rien eu de spontané : ce sont les guerres ou les menaces de guerres qui ont contribué à le faire émerger dans les différents pays du monde » (AAB, 2020, p. 341).
Dans la même section les auteurs saluent l’impact positif du dispositif Defense Advanced Research Projects Agency aux Etats-Unis sur l’innovation. Or, comme son nom l’indique, celui-ci qui est directement lié à des considérations militaires. Que cela soit dans le cas de l’école ou de l’investissement public, si c’est la guerre qui est à l’origine du développement de l’Etat, ne peut-on pas penser que l’Etat en tant que tel est un problème ?
De façon plus surprenante, les auteurs n’explorent pas la piste du lien entre Etat providence et guerre lorsqu’ils cherchent à expliquer le développement des dispositifs sociaux au XXè siècle. Pourtant ils rappellent bien le contexte militaire à l’origine des modèles de protection sociale inventés par Otto Von Bismarck et William Beveridge. Pourquoi ne pas aller plus loin dans la critique de l’Etat en s’appuyant sur la large littérature qui démontre que l’Etat providence est né dans la préparation, la conduite et les conséquences des guerres totales (Obinger et Petersen, 2017, Vahabi et al., 2020a) ? L’intérêt de cette littérature est par ailleurs de montrer que face à une protection sociale étatique qui n’agit pas nécessairement dans l’intérêt des assurés, l’histoire donne des exemples de protection sociale auto-organisée par les citoyens eux-mêmes – ce qui est le cas de la sécurité sociale en France (Friot, 2012, Batifoulier et al., 2020). En France, dans une large mesure, la sécurité sociale est née dans la résistance à l’Etat, ce n’est que progressivement que l’Etat s’est réapproprié l’institution. Des innovations sociales comme la sécurité sociale ont vu le jour parce qu’elles ont été portées contre l’Etat et le marché. Ne faut-il pas faire un pas de plus dans la critique de l’Etat par les citoyens – notamment en prenant en compte l’existence de classes sociales ?
5 – Une théorie du changement économique sans théorie du changement institutionnel : l’absence de la prise en compte du conflit
L’opposition historique entre protection sociale dirigée par l’Etat et protection sociale dirigée par les citoyens montre en creux l’absence dans le livre de AAB d’une théorie du conflit. Comment comprendre le changement institutionnel, par exemple l’avènement d’institutions favorables aux innovateurs, sans une théorie du conflit ?
Dans leurs développements sur le rôle de la société civile, les auteurs mentionnent la théorie de Daron Acemoglu et James Robinson (2000) selon laquelle l’existence de contrepouvoirs peut prévenir des émeutes et des révolutions. AAB rappellent à partir du mouvement des gilets jaunes en France « ce qu’il en coute d’ignorer la société civile » (p. 381). Pour ne pas avoir pris en compte la menace de révolte, le pouvoir exécutif a été contraint d’augmenter les dépenses publiques et de perdre un an dans le processus de réforme. Selon les auteurs,
« […] le mouvement des gilets jaunes aura eu un effet positif : celui de faire évoluer le système politique français vers davantage de décentralisation et de déconcentration. En particulier le mouvement conduit à la mise en place en octobre 2019 de la Convention citoyenne pour le climat. Cette Convention regroupe cent cinquante citoyens tirés au sort et qui doivent formuler des propositions pour lutter contre le réchauffement climatique. Le président de la République s’est engagé à ce que toutes ces propositions législatives et règlementaires soient soumises « sans filtre » soit à un referendum soit à un vote du Parlement. A nouveau, la crainte d’une résurgence du mouvement de protestation sert d’épée de Damoclès, pour à la fois induire des changements institutionnels et garantir que ces changements sont réels et pas seulement formels » (AAB, 2020, p. 383).
Il serait malvenu de reprocher aux auteurs le fait que le président n’a pas respecté son engagement et qu’aucun mouvement d’ampleur comparable à celui des gilets jaunes n’a émergé en contestation. Nul ne peut prédire l’avenir. Cependant, on peut s’interroger sur la théorie du conflit et du changement institutionnel qui sous-tend l’analyse. D’une part, ils sous-estiment la réalité de la réponse répressive de l’État face aux demandes des citoyens. L’État en France n’a-t-il pas démontré qu’il est prêt à s’armer pour mener la guerre sociale (Godin, 2019, Rocher, 2020) ? D’autre part, ne faut-il pas prendre au sérieux dans la théorie du changement institutionnel l’impact positif du conflit ? Dans la littérature économique standard, les seuls conflits efficaces sont ceux qui ne mènent pas à un affrontement réel entre les belligérants. Pour reprendre la distinction d’Albert Hirschman, voice et exit sont des stratégies acceptables pour conduire le changement institutionnel. Mais ne faut-il pas prendre en compte la possibilité (la nécessité ?) que le changement institutionnel passe par la révolution (scream) lorsqu’aucun compromis n’est possible avec les élites politiques et économiques (Vahabi et al., 2020b) ?
La question de la révolution, ou plus modestement l’importance du conflit violent, dans le changement institutionnel n’est-elle pas d’actualité dans un monde où les élites politiques et économiques ont tendance à fusionner ? Les auteurs soulignent le rôle néfaste des conflits d’intérêt entre les politiciens et les acteurs économiques mais ne faut-il pas franchir le pas et investir la question du capitalisme politique (Kolko, 1977, Weber, 1978) ? Si on accepte l’idée d’une collusion relativement généralisée entre élites économiques et élites politiques, comment envisager le changement institutionnel par le seul usage de la voice ?
La question du capitalisme politique ne se pose pas uniquement dans les pays où l’élite politique et économique s’accorde sur des politiques d’austérité budgétaire et de marchandisation des services publics. Si les premiers jours de l’administration Biden laissent entrevoir une volonté de réinvestir dans la puissance d’Etat, ne peut-on pas également s’interroger sur la collusion entre cette administration et les intérêts économiques. Par exemple, pense-t-on que le fait que Janet Yellen a perçu en moyenne 10 000 dollars par jours de Wall Street entre 2019 et 2020 soit neutre dans les relations qu’entretiennent élites politiques et élites économiques ? Est-on certain que les changements qui se profilent aux États-Unis se fassent dans l’intérêt de la société civile ? La comparaison entre Roosevelt et Biden, entre le New Deal et le Green New Deal, mérite que l’on s’y penche en rappelant que le New Deal est aussi à l’origine de l’expansion du complexe militaro-industriel et de l’impérialisme étatsunien.
6 – Le néolibéralisme : réforme ou dépassement ?
Si avec Pierre Dardot et Christian Laval (2009) on appelle néolibéralisme la rationalité qui structure l’action des gouvernants (Etat néolibéral et entreprise néolibérale) autant que la conduite des gouvernés (les sujets néolibéraux) autour de l’impératif de mise en concurrence généralisée, alors il est possible de rattacher le livre de AAG à la doctrine néolibérale. D’une part, la concurrence est le phénomène fondamental permettant d’inciter à l’innovation et à la croissance – qui a le statut d’optimum social. D’autre part, la concurrence ne s’autorégule pas, elle produit des effets pervers, c’est pourquoi il est nécessaire que l’État mette en place de nombreuses politiques publiques afin de conduire les conduites.
En rester là serait probablement excessif. En effet, il faut souligner que les auteurs prennent en compte de nombreuses critiques adressées aux politiques néolibérales : puisque la précarité tue, il faut, écrivent-ils, des dispositifs de protection sociale généreux ; puisque la probabilité d’être innovateur est inégalement répartie dans la société, il faut un système scolaire et universitaire public généreux ; puisque dans la mondialisation certains pays sont susceptibles de dumping social ou environnemental, les barrières douanières ne sont pas à exclure ; puisque l’Etat est susceptible de céder face au lobbying, il faut donner du poids à la société civile ; puisque l’innovation verte n’est pas rentable, il faut de grands plans d’investissement public ; etc.
Bien sûr, l’aiguillon de la concurrence reste dominant et ici où là les rechutes se donnent à voir. Par exemple, les passages sur la gouvernance de l’université soulignent l’intérêt d’un financement public élevé mais avec une mise en concurrence des chercheurs. Autre exemple, le chapitre 12 sur le financement de la destruction créatrice fait l’apologie du capital-risque et des investisseurs institutionnels ce qui semble bien anachronique (malgré un encadré final sur les risques de la finance).
En tous cas, il me semble contreproductif de ne pas voir que la théorie économique dominante cherche à intégrer la critique – qu’elle soit d’origine académique ou sociale. Le succès institutionnel d’autres économistes sur des thématiques originales permet de conforter cette analyse (Daron Acemoglu, Samuel Bowles, Thomas Piketty, Thomas Philippon, etc.).
Cela conduit à une forme d’hésitation au moment de porter un jugement final sur le type de politiques publiques que peut inspirer un livre comme celui de AAB. Est-ce que ces évolutions dans la théorie économique impliquent simplement une réforme du néolibéralisme ou son dépassement ? Il est peut-être trop tôt pour répondre à cette question. Mais on ne peut que s’inquiéter de l’unanimisme grandissant sur la figure de l’État. Que l’on cherche à réformer le capitalisme ou à le dépasser, tout le monde critique l’État et appelle à une à une forme ou une autre de plus d’État. Et si l’État faisait partie du problème ?
7 – Bibliographie
- Acemoglu D. et Robinson J. (2000), « Why did the west extend the franchise ? Democracy, inequality, and growth in historical perspective », Quarterly journal of economics, 115(4), p. 1167-1199.
- Acemoglu D., Robinson J. et Verdier T. (2017), « Asymmetric growth and institutions in an interdependent word », Journal of Political Economy, 125(2), pp. 1245-1305.
- Amable A. et Ledezma L. (2015), Libéralisation, innovation et croissance. Faut-il vraiment les associer ?, Edition rue d’Ulm, Paris.
- Batifoulier P., Da Silva N. et Vahabi M. (2020), « La Sociale contre l’Etat providence. Prédation et protection sociale », Document de travail CEPN, en ligne.
- Besley T. et Persson T. (2011), Pillars of prosperity : The political economics of development clusters, Princeton University Press, Princeton.
- Bowles S. et Carlin W. (2020), « Shrinking capitalism », AEA Papers and proceedings, 110, 372-77.
- Chavance B. (2007), L’économie institutionnelle, Repères, Paris.
- Dardot P. et Laval C. (2009), La nouvelle raison du monde. Essai sur la société néolibérale, La découverte, Paris.
- Durand C. (2020), Techno-féodalisme. Critique de l’économie numérique, La découverte, Paris.
- Douai A. et Plumecocq G. (2017), L’économie écologique, La Découverte, Paris.
- Friot B. (2012), Puissances du salariat, La Dispute, Paris.
- Godin R. (2019), La guerre sociale en France : aux sources économiques de la démocratie autoritaire, La Découverte, Paris.
- Guennif S. (2021a), « Capture règlementaire en temps de pandémie. Le cas du remdesivir dans le cadre de la loi sur les médicaments orphelins », Revue de la régulation, numéro 29, en ligne.
- Guennif S. (2021b), « Brevet et santé : d’une mondialisation à l’autre, d’une controverse à l’autre sous système de production capitaliste », Revue française de socio-économie, à paraître.
- Hall P. et Soskice D. (2002), « Les variétés du capitalisme », L’année de la régulation 2002-2003, numéro 6, pp. 47-124.
- Husson M. (2017), « Monsieur Philippe Aghion bouleverse la croissance », A l’encontre, en ligne.
- Kornai, J. (2014). Dynamism, rivalry and the surplus economy. Two essays on the nature of capitalism. Oxford : Oxford University Press.
- Kolko G. (1977), The triumph of conservatism. A reinterpretation of American history. 1900-1916, The Free Press, New York.
- Lechevalier S. (2019) (ed), Innovation beyond techology. Science for society and interdisciplinary approaches, Springer.
- Marx K. (1993)[1867], Le capital. Livre 1, Presse universitaire de France, Paris.
- Mazzucato M. (2020), L’Etat entrepreneur. Pour en finir avec l’opposition public-privé, Fayard, Paris.
- Obinger H. et Petersen K. (2017), « Mass warfare and the welfare State–Causal mechanisms and effects », British Journal of Political Science, 47(1), 203-227.
- Rocher P. (2020), Gazer, mutiler, soumettre. Politique de l’arme non létale, La Fabrique, Paris.
- Romer P. (2016), « The trouble with macroeconomics », en ligne.
- Rotillon G. (2020), Le climat et la fin du mois, Edition Maia, Paris.
- Tilly C. (1975), The formation of national states in western europe, Princeton university press, Princeton.
- Tordjman H. (2021), La croissance verte contre la nature. Critique de l’écologie marchande, La découverte, Paris.
- Vahabi, M. (2009), « An introduction to destructive coordination », American Journal of Economics and Sociology, 68(2), pp. 353-386.
- Vahabi M., Batifoulier P. et Da Silva, N. (2020)a, « A theory of predatory welfare state and citizen welfare : the French case », Public Choice, 182(3), 243-271.
- Vahabi M., Batifoulier P. et Da Silva, N. (2020)b, « The Political Economy of Revolution and Institutional Change : the Elite and Mass Revolutions », Revue d’economie politique, 130(6), 855-889.
- Weber M. (1978 [1921]), Economy and society. An outline of interpretive sociology, Universisty of California Press, Berkley, Los Angeles, London.Zuboff S. (2020), L’âge du capitalisme de surveillance, Zulma, Paris.

