Guerres invisibles, une conversation avec Thomas Gomart
À l'occasion de la sortie de son dernier livre, Thomas Gomart s'est entretenu avec Florian Louis.
« J’ai conçu Guerres invisibles comme une sorte de réponse à La guerre hors limite dans laquelle je voulais montrer que si les militaires n’ont plus le monopole de la guerre, cela ne signifie nullement qu’ils perdent leur raison d’être. »
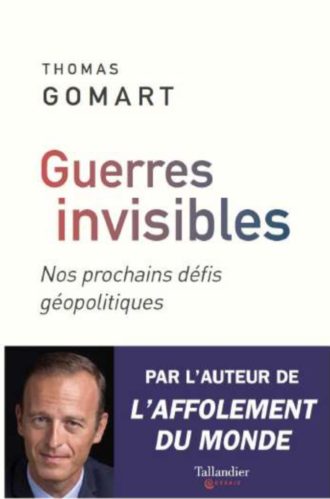
D’où vient cette idée de « guerres invisibles » qu’évoque le titre de votre dernier ouvrage ?
Au départ, il y a bien sûr le credo de « l’univers visible et invisible ». Cette dichotomie structure l’ouvrage en deux parties : le visible avec, par exemple, les inégalités et l’invisible avec, par exemple, les actions visant à dissimuler. Quant au terme de « guerre », il rappelle que la mondialisation, à rebours d’une conception largement enseignée, ce n’est pas seulement la coopération, mais aussi la compétition et la confrontation auxquelles se livrent les puissances de jour comme de nuit. Dans le travail d’analyse et de prévision que je mène à l’Ifri depuis presque vingt ans, je m’efforce de comprendre les préférences affichées et les intentions cachées des différents protagonistes en essayant « d’apprécier sainement ce que l’on voit, et deviner ce que l’on ne voit pas » pour paraphraser von Moltke le jeune. Rien à voir donc avec le complotisme : il s’agit d’un effort de dévoilement et d’explication des sous-jacents au prix d’un travail de fond conjuguant lectures et entretiens variés.
S’agit-il de guerres nouvelles ? De nouvelles manières de mener des guerres anciennes ?
Après mon service militaire, j’ai enseigné l’analyse stratégique pendant plusieurs années aux écoles de Saint-Cyr-Coëtquidan. Il s’agissait de présenter à grands traits les cultures stratégiques des principales puissances : américaine, chinoise, russe, iranienne, turque… Pour la Chine, je m’étais notamment appuyé sur La guerre hors limite de Liang Qiao et Xiangsui Wang, traduit en français en 2003. Très étudié aux États-Unis, ce livre m’avait frappé. Pendant le premier confinement, la revue française Conflits a traduit un entretien décapant d’un des deux auteurs indiquant notamment le non-sens à se prétendre puissance technologique sans être puissance manufacturière. Dès lors, j’ai conçu Guerres invisibles comme une sorte de réponse à La guerre hors limite dans laquelle je voulais montrer que si les militaires n’ont plus le monopole de la guerre, cela ne signifie nullement qu’ils perdent leur raison d’être. Liang et Xiangsui parlent d’« addition-combinaison » pour évoquer l’imbrication des formes de conflit les unes dans les autres. Les 24 types de conflits listés par ces auteurs il y a vingt ans me semblent très bien décrire la situation actuelle.
Parmi les enjeux qui sont au cœur de ces guerres invisibles, vous insistez notamment sur la centralité du numérique. Comment concevez-vous le rôle des acteurs du numérique, GAFAM et BATX notamment ? Sont-ce des belligérants à part entière ou bien des instruments au service de belligérants qui demeurent avant tout de type étatique ?
Pour répondre à cette question, commençons par revenir aux origines de l’Arpanet qui, dès la fin des années 1960, est né d’un double courant à la fois libertaire et militaire. Aujourd’hui, on se rend compte que cette ambivalence persiste : ce qui a longtemps été présenté comme un outil d’empowerment individuel s’avère aussi être un outil de surveillance très puissant. Il faut donc selon moi envisager les choses sous l’angle d’un complexe militaro-numérique. Le parcours d’un Eric Schmidt, ancien PDG de Google, est emblématique des liens étroits entre la Silicon Valley et le Pentagone. Les mécanismes du complexe militaro-numérique américain sont en partie visibles car nous sommes dans un système politique ouvert reposant sur la séparation des pouvoirs. Les mécanismes du complexe militaro-numérique chinois restent invisibles même si le parcours de Ren Zhengfei, fondateur de Huawei, est désormais bien connu. Le contrôle des nœuds névralgiques entre les espaces communs dont la maîtrise simultanée conditionne la supériorité militaire passe par le numérique. Mer, air, espace exo-atmosphérique et datasphère les constituent : les trois premiers sont des milieux physiques distincts alors que la quatrième les innerve, tout en se territorialisant à son tour.
Parmi les enjeux fondamentaux des guerres invisibles, vous accordez une place importante à la question environnementale. Celle-ci, en ce qu’elle confronte l’ensemble de l’humanité à un même défi, pourrait pourtant sembler devoir échapper à la logique conflictuelle et permettre l’émergence d’une forme de consensus planétaire entre puissances. Pourquoi n’est-ce pas le cas ?
Le fait d’envisager l’environnement uniquement comme un bien commun est un point de vue très européen. Une des thèses du livre est de dire que les États-Unis et la Chine, qui représentent à eux deux 45 % des émissions mondiales de CO2, subordonnent leur politique écologique, mais aussi numérique, à leur rivalité stratégique. L’enjeu, c’est le contrôle du thermostat mondial, ce qui devrait nous amener à nous intéresser de près aux programmes de géo-ingénierie. On ne saurait s’en tenir à une vision européenne qui voit l’environnement, comme le numérique, principalement par le biais de la régulation. Par ailleurs, je relis la crainte de « l’hiver nucléaire », qui fut l’arrière-plan de la guerre froide, à celle d’un « effondrement » qui semble être devenu l’horizon indépassable de notre époque. De manière très paradoxale, la connaissance de la dégradation environnementale doit beaucoup aux armes nucléaires. Le suivi des expériences nucléaires (plus de 2 000 tests) a abouti à la mise en place d’un réseau de capteurs qui a permis de mesurer la dégradation environnementale. Ce qui n’est pas sans alimenter le débat sur la datation du début de l’anthropocène qui pourrait être situé pour certains, plutôt qu’à la fin du XVIIIe siècle, à 1945 avec l’usage de l’arme nucléaire dont les conséquences environnementales et sanitaires sont toujours visibles.
Selon vous, la crise pandémique que nous traversons a-t-elle joué un rôle de créatrice ou de révélatrice des nouveaux équilibres internationaux ? N’a-t-elle fait que rendre visible, pour filer la métaphore du titre de votre ouvrage, des évolutions demeurées jusqu’alors invisibles ou bien a-t-elle enclenché des évolutions inédites ?
Selon moi, la crise pandémique a joué le rôle d’un catalyseur : elle a accéléré des tendances déjà présentes, entraînant une redistribution de la puissance plus rapide que prévue, notamment en faveur de la Chine. La crise n’a fait que confirmer l’évolution qui s’est produite au cours des deux dernières décennies qui ont vu la Chine ravir à l’Union européenne sa place de deuxième sur la scène internationale et convoiter désormais ouvertement la première. Elle a donc rendu encore plus saillante la rivalité stratégique sino-américaine qui constitue la grande question internationale à laquelle nous sommes confrontés. Parallèlement, la crise sanitaire a accéléré la pénétration des plateformes systémiques dans tous les secteurs économiques avec de profondes conséquences politiques et sociales.
Cette rivalité sino-états-unienne qui concentre aujourd’hui toutes les attentions est-elle comparable à la rivalité entre l’URSS et les États-Unis durant la guerre froide ? A-t-on raison comme on le fait parfois, en repliant le présent sur le passé, l’inconnu sur du connu, de la décrire sous les traits d’une nouvelle « guerre froide » ? Ou bien est-ce une rivalité d’un type totalement inédit à la compréhension de laquelle les schémas hérités du XXe siècle ne s’avèrent guère utiles ?
Les deux situations ne me semblent guère comparables. D’abord parce que pendant la guerre froide, les alliés des États-Unis étaient leurs principaux partenaires commerciaux. Par ailleurs, il faut bien voir le lien qui a existé entre la révolution reagano-thatchérienne et l’ouverture du marché chinois. Cette concomitance, au début des années 1980, est structurelle. En conséquence, le niveau d’interpénétration des économies chinoise et américaine n’a rien à voir avec ce qu’étaient les relations économiques entre l’Union Soviétique et les États-Unis. Ensuite, la guerre froide s’est surtout concentrée sur le haut du spectre stratégique et sur des enjeux idéologiques, ce qui n’est pas le cas de la rivalité sino-américaine qui se concentre sur la latéralité, sur un mélange de coopération et de rivalité, notamment dans les domaines technologique et climatique. Plus qu’à une guerre froide entre les États-Unis et la Chine, on est en présence d’une lutte multi-domaine pour la suprématie mondiale. À mon sens, le cycle stratégique dans lequel nous sommes a été ouvert par la guerre de Corée. Les autorités chinoises n’ont nullement oublié les velléités de MacArthur d’utiliser l’arme nucléaire. Cela nous oblige, nous, Européens, à un effort de décentrement.
Pour continuer à filer la métaphore de la guerre froide, peut-on envisager une forme de « coexistence pacifique » entre Pékin et Washington, ou bien chacun des deux rivaux ambitionne-t-il une suprématie sans partage ?
Aucun des deux pays n’a intérêt à la confrontation directe et il y a donc un effet de retenue inhérent à leur rivalité. Il ne faut pas tant avoir une vision clausewitzienne de cet affrontement qui ne se limite pas au seul champ militaire. De plus, les pressions des sociétés civiles et des entreprises sont d’une toute autre nature que pendant la guerre froide en raison notamment de la dissémination technologique. Cela rend plus complexe le travail d’analyse et de prévision.
Dans votre ouvrage, pour chacun des grands défis que vous étudiez, vous insistez plus particulièrement sur la position de trois acteurs : les États-Unis, la Chine et l’Union européenne. La présence de cette dernière au côté des deux premières signifie-t-elle qu’elle peut prétendre jouer dans la même cour ? Ou bien la place prééminente que vous lui accordez tient-elle au fait que vous êtes vous-mêmes européen ? Si vous aviez été un auteur chinois ou africain, pensez-vous que vous lui auriez accordé la même importance dans votre analyse ?
En raison de sa nature et de son projet, je ne considère pas l’Union européenne comme un acteur stratégique comparable à la Chine et aux États-Unis. Ni à la Russie et à la Turquie d’ailleurs. Toutefois, la place que je lui accorde me semble justifiée par son poids économique, technologique et sa prétention à agir sur les affaires mondiales. Par ailleurs, comme directeur de l’Ifri, je suis très souvent interrogé sur les positions européennes et françaises lors des échanges avec des collègues étrangers. Maintenant, il est évident que je suis marqué par ma formation européenne en français, en anglais et en russe. C’est pourquoi j’ai commencé le livre en exposant des analyses indienne, singapourienne et chinoise pour mettre en lumière la manière dont l’UE peut être perçue et comprise.
Vous terminez en rappelant la nécessité, pour la France, de se doter d’une « grande stratégie ». Celle-ci peut-elle s’inscrire hors du cadre de l’Union européenne ?
J’utilise ce concept de « grande stratégie » car il est très présent aux États-Unis, en Chine et en Russie et connaît un regain d’intérêt au Royaume-Uni. À ce stade, je l’utilise surtout pour inviter à dépasser le temps court des cycles électoraux en pensant la stratégie à l’échelle d’une ou plusieurs générations. Le grand sujet reste toujours celui de l’articulation entre la France et le projet européen pour que le grand continent reste dans l’Histoire !

