En exergue du Piano Oriental, vous citez Mahmoud Darwich : « qui suis-je ? C’est une question que les autres posent, moi je suis ma langue ». Par essence, la bande-dessinée ne cesse justement d’entremêler la langue et le dessin. Alors qui êtes-vous ? Votre dessin ou votre langue ?
Les deux ! pourquoi choisir !
Votre question me fait penser à Etel Adnan, une poétesse et peintre d’origine libanaise ayant vécu aux États-Unis et en France. Pour répondre à un journaliste qui lui demandait pourquoi elle n’avait jamais écrit en arabe, elle a eu cette très jolie réponse : « vous savez, j’écris en français mais je dessine en arabe ».
Pour ma part, si j’écris en français, je pense mes histoires dans toutes mes langues, le français, l’arabe et le dessin.
J’ai souvent la tentation de faire paraître la calligraphie arabe, non comme un signifiant, mais comme un élément sensoriel. Cela a commencé avec le Piano oriental. À la deuxième page, après une série d’onomatopées et un texte assez bref, j’insère une petite bulle dans laquelle est écrit « mon amour, ma vie » en arabe.
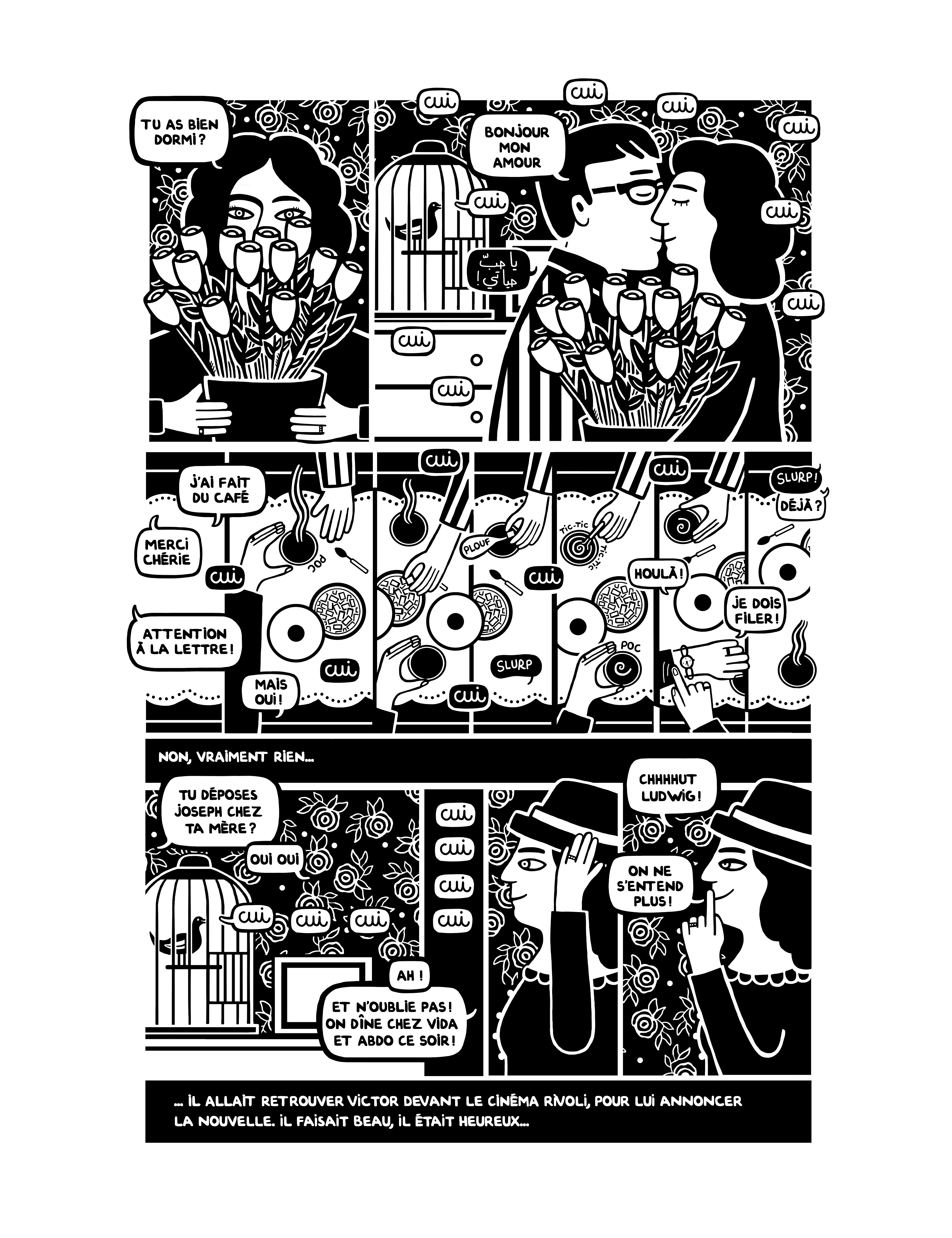
Ce n’est pas du tout indispensable à la compréhension de l’histoire, cela répond plutôt à une envie sonore, celle d’entendre cette langue dans le dessin.
C’est presque un renversement — un négatif — du dialecte libanais dans lequel des mots de français s’incrustent dans l’arabe.
Il est vrai qu’au Liban, nous avons cette souplesse de passer d’une langue à l’autre, au point où l’on oublie parfois si on a parlé en arabe ou en français.
Il en va ainsi de mes personnages. La plupart d’entre eux sont inspirés de personnes que j’ai connues. En les dessinant, je les entends, ils parlent cette langue double faite de libanais et de français, enrichie de mots venant de toute la méditerranée. C’est une langue cosmopolite, à l’image de ce qu’a été le Liban. Et de ce qu’il continue d’être envers et contre tout.
J’ai souvent la tentation de faire paraître la calligraphie arabe, non comme un signifiant, mais comme un élément sensoriel.
Zeina Abirached
J’ai souvent la tentation de retranscrire la musicalité de la langue libanaise. Dans Mourir, partir, revenir, le jeu des hirondelles ou je reconstruis un souvenir d’enfance à Beyrouth dans les années 1980, la plupart des dialogues qui me sont revenus à l’esprit au moment de l’écriture, étaient en libanais. Je les ai retranscrits en français et il me semble que mon dessin restitue quelque chose du libanais dans la musique générale de la page.
Je ne perds jamais de vue la question de la langue dans mon travail. Dans Prendre refuge, coécrit avec Mathias Enard, [paru en 2018, NDLR], nous racontons l’histoire d’une jeune Syrienne quittant Alep au moment de la destruction de la ville, et qui se retrouve à Berlin où elle apprend l’allemand. Elle y rencontre un jeune Allemand qui ne connaît rien au monde arabe. Leur langue commune est l’allemand, mais un allemand dans lequel elle « claudique » encore. Ce qui provoque un certain nombre de quiproquos et fait la part belle à la poésie.
C’était une drôle d’acrobatie à imaginer ! Un dialogue censé se dérouler en allemand, parsemé de mots d’arabe mais écrit en français !
C’était une drôle d’acrobatie à imaginer ! Un dialogue censé se dérouler en allemand, parsemé de mots d’arabe mais écrit en français !
ZEINA ABIRACHED
On retrouve toujours cette idée que l’on s’enrichit à parler la langue des uns et des autres, même imparfaitement.
C’est le propos du Piano oriental.
C’est central dans le Piano oriental. La bande-dessinée est centrée sur un piano que mon arrière-grand-père avait inventé avant la guerre : il avait modifié un piano droit pour que l’une des pédales lui permette de tout décaler d’un quart de ton, essentiel à la musique orientale. Quand j’ai découvert cette histoire, j’ai eu comme une illumination. En réalité, ce piano était bilingue.
Et qu’est devenu ce piano ? À la fin de la bande-dessinée on s’interroge sur son sort.
Il est toujours à Beyrouth. Le prototype d’usine, fabriqué chez Hofman à Vienne, est encore chez mes grands-parents. Il a survécu à tout, à la guerre comme à la reconstruction. C’est un piano des années 1950 mais il est tout neuf, car il n’a quasiment jamais été utilisé ! Il continue de faire entendre sa musique double, entre clavier tempéré et quarts de ton.
Et c’est un piano unique.
…jusqu’au moment où j’ai écrit et dessiné Le piano oriental ! Quelques mois après la sortie du livre, j’ai reçu un coup de fil du directeur du festival Les Inattendues, à Tournai, qui était complètement enthousiasmé par la bande-dessinée et qui voulait monter un concert-dessiné pour faire connaitre l’instrument, en faisant venir du Liban, le piano de mon arrière-grand-père.
C’est émouvant car Le Piano oriental raconte justement le voyage en Europe de mon arrière-grand-père parti pour convaincre une entreprise autrichienne de le fabriquer à grande échelle. L’exemplaire jusque-là unique né de cette collaboration n’a pas pu se rendre en Belgique et effectuer ainsi son retour symbolique en Europe, le directeur des Inattendues ayant jugé le voyage trop compliqué. Mais cette aventure était loin d’être terminée puisqu’il m’a dit qu’après tout, « si on ne peut pas le faire venir en Belgique, eh bien, on va le fabriquer ici ! » C’est un facteur de pianos tournaisien qui s’est chargé de reproduire le mécanisme inventé par mon arrière-grand-père 70 plus tôt.
Le piano de mon arrière-grand-père n’est plus tout à fait seul au monde, puisqu’il a aujourd’hui un presque-jumeau né dans un pays bilingue lui-aussi !
Cette folle aventure ne s’arrête pas là non plus… je raconte la suite dans la bande dessinée

Revenons à votre premier album, Beyrouth Catharsis, qui raconte très brièvement comment ce que vous pensiez être l’impasse dans laquelle vous aviez grandi s’est avérée ne pas en être une quand le mur qui la bouchait a disparu à un moment, après la guerre. Vous écrivez que la chute de ce mur a fait entrer la ville en vous. Voyez-vous cet album comme un avant-propos nécessaire au reste d’une œuvre très cathartique ?
Rétrospectivement peut-être. Lorsque j’ai écrit Beyrouth Catharsis j’obéissais surtout à un sentiment d’urgence. C’était en 2002, Beyrouth était en pleine reconstruction, je commençais à me rendre compte que la ville telle que je l’avais connue jusque-ici était en train de subir des transformations irréversibles. Je me rendais surtout compte que l’on n’avait jamais parlé de la guerre entre nous, ni dans la famille ni avec les voisins avec qui nous avions pourtant vécu en vase clos pendant toutes ces années.
Tout cela m’a poussé à écrire et à dessiner. Il fallait rendre compte de ce mode de vie très particulier que l’on avait pendant la guerre, de cette ville qui était en train de disparaître.
L’image de la ville qui entre en moi s’est imposée d’elle-même. Je voyais mon corps se superposer au plan de la ville que j’étais justement en train de découvrir. C’était une époque où je marchais beaucoup dans Beyrouth, pour tenter de me l’approprier.
L’image de la ville qui entre en moi s’est imposée d’elle-même. Je voyais mon corps se superposer au plan de la ville que j’étais justement en train de découvrir.
ZEINA ABIRACHED
Avec Beyrouth Catharsis vous témoigniez de ce moment où votre vie rencontrait l’histoire de votre ville.
Pendant les années de guerre, nous avons vécu amputés d’une partie de notre ville ; la moitié de Beyrouth nous était interdite, confisquée. Après la guerre je suis enfin allée de « l’autre côté », je me souviens que nous avons longtemps continué à rentrer la tête dans les épaules en traversant ce qui avait été la ligne de démarcation, comme si les francs-tireurs étaient toujours là. Il a fallu du temps pour s’approprier ce nouveau territoire et dépasser nos barrières psychologiques. Aujourd’hui encore, tout les Libanais ne se sentent pas en sécurité partout. J’ai des amis qui jusqu’à maintenant, ne vont pas à « l’ouest » sans appréhension.
Cela pèse peut-être moins aujourd’hui, car avec le mouvement de la contestation du 17 octobre, Les libanais se sont réappropriés l’espace public, en se retrouvant dans les lieux qui leur avaient été confisqués successivement par les miliciens pendant la guerre, puis par les politiciens au moment de la reconstruction du centre-ville vidé des classes populaires et dédié aux enseignes de luxe. À la révolution, les Libanais ont afflué vers ce centre-ville et s’y sont installés. C’était bouleversant d’observer l’investissement de cet espace public par des débats démocratiques.
D’autant que l’armée est d’abord restée l’arme au pied.
Oui, tout à fait. Cela s’est d’abord très bien passé. C’était même incroyable, toutes les régions, toutes les communautés et toutes les générations, étaient mobilisés. Ceux qui avaient connu la guerre et la jeune génération qui a grandi avec cette mémoire amputée se sont enfin retrouvés. Cet élan magnifique semblait dépasser enfin les traumatismes anciens. Et puis, poussés par les dirigeants de Amal et du Hezbollah qui voyaient leur pouvoir contesté, des jeunes de quartiers chiites qui se trouvent à quelques rues de la place de la contestation à Beyrouth, ont débarqué pour tabasser les révolutionnaires. Le réveil a été brutal.
J’étais à Paris et je n’ai pas pu m’empêcher d’aller manifester moi aussi à Beyrouth parce que je me disais qu’il y avait peut-être enfin un espoir pour que toutes ces frontières psychologiques appartenant à notre inconscient collectif tombent, pour que l’on arrive enfin à avoir un vrai dialogue politique.
Ce que vous dites résonne avec l’une des dernières scènes du Piano oriental, à la veillée de votre arrière-grand-père, où la pièce des hommes est glaçante, enfumée, en quelque sorte saturée par une conversation politique qui n’a aucune issue.
Oui. C’est sans doute un écho de ce que je perçois de la vie politique libanaise.
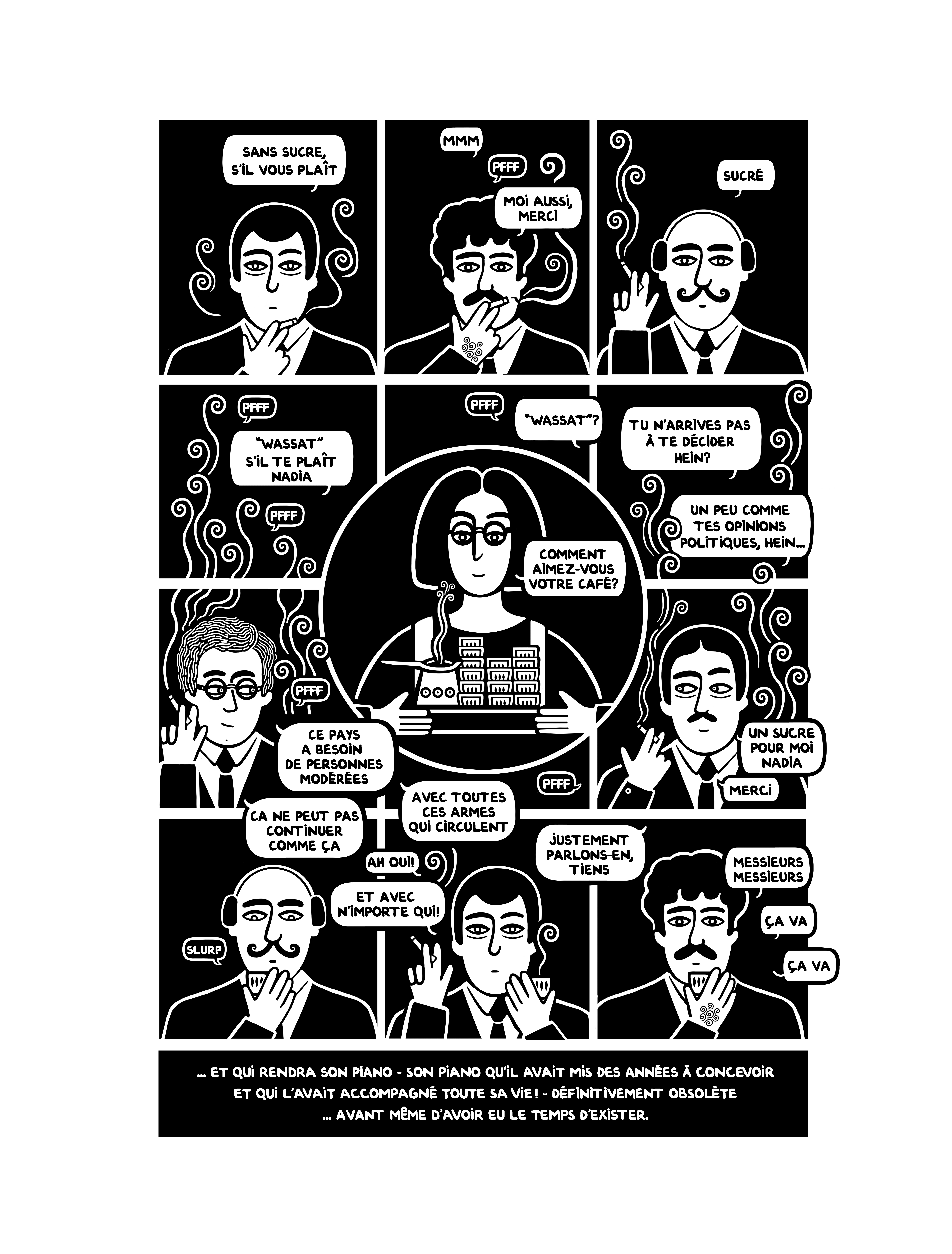
Cela m’amène à l’explosion du 4 août : pensez-vous que l’année 2020 mettra fin au mouvement de 2019 ?
J’aimerais évidement que le dénouement soit constructif, démocratique et efficace. Nous sommes dans un moment très particulier ; les Libanais sont triplement épuisés, par le choc, le traumatisme et la perspective de la reconstruction à venir. Une de plus. Mais cela ne va pas du tout arrêter le mouvement, même s’il s’essouffle ponctuellement. La scission entre l’État et la population est évidente. Il n’y a qu’à voir comment les Beyrouthins se sont mis à déblayer leurs quartiers, dès le lendemain du drame : la société civile sait depuis des années qu’elle ne peut pas compter sur l’État. Plus personne ne s’attend à ce que la réponse vienne des pouvoirs publics. Seuls les particuliers, les associations et les ONG sont sur le terrain.
La scission entre l’État et la population est évidente. Il n’y a qu’à voir comment les Beyrouthins se sont mis à déblayer leurs quartiers, dès le lendemain du drame : la société civile sait depuis des années qu’elle ne peut pas compter sur l’État.
ZEINA ABIRACHED
Et l’implication d’Emmanuel Macron est-elle une bonne ou une mauvaise chose selon vous ?
Il a été très critiqué ici [en France], mais de nombreux Libanais l’ont accueilli chaleureusement. Il est arrivé au Liban, 48 heures après la double explosion qui a ravagé le port et une grande partie de la ville, à un moment où le désespoir dominait. Cela paraissait incroyable, un chef d’État, en pleine pandémie, en bras de chemise, prenant les beyrouthins dans ses bras, alors qu’aucun politicien libanais n’avait daigné jusque-là se rendre sur les lieux du drame. Sur toutes ses photos avec Emmanuel Macron, Michel Aoun a les mains dans les poches…
C’était un moment extraordinaire, calculé ou spontané, mais qui a redonné de l’espoir à un peuple meurtri.
Il faudrait maintenant que les dirigeants libanais s’entendent entre eux pour le bien du Liban, et ce n’est pas demain la veille.
Car on touche ici au non-dit de la guerre civile, la quasi-totalité des chefs des partis qui se sont fait la guerre a instrumentalisé la reconstruction à leur profit et au détriment des Libanais.
Alors même que vous parlez beaucoup de la guerre, vous n’évoquez pas les chefs. Pourquoi ?
Aujourd’hui encore le programme d’histoire dans les livres scolaires s’arrête en 1975 et n’évoque pas les 15 années de guerre. Ce sont les intellectuels et les artistes qui transmettent le récit de cette période. J’essaie pour ma part de faire un travail de mémoire par l’écriture et le dessin, pour garder une trace de ce Beyrouth, de ses habitants, de notre quotidien pendant la guerre et de notre mode de vie si particulier, encore présent aujourd’hui. J’ai préféré me concentrer sur la vie quotidienne plutôt que sur les affrontements, car il me semblait que se trouvait là un concentré de l’identité libanaise, faite d’ingéniosité, d’autodérision, de survie et de tendresse. Tous les personnages du Jeu des Hirondelles étaient mes voisins, ils ont jalonné mon enfance de moments joyeux.
Du reste, les miliciens restent des ombres.
Ne pas dessiner la guerre était un choix délibéré. On ne la voit jamais dans mes livres, on l’entend.
Ainsi dans le Jeu des hirondelles, la guerre fait irruption dans l’appartement par le biais des sons de l’extérieur : les bombardements, les francs-tireurs… et la radio, qui est un personnage principal et omniprésent en temps de guerre.

Dans la scène à laquelle vous faites référence, qui est sans doute la plus violente du livre, je raconte l’enlèvement — et sans doute l’assassinat — du père de Chucri. Le dessin ne montre que les bras du milicien qui l’arrête à l’un des points de passage entre l’Est et l’Ouest de la ville. On ne voit pas grand-chose, on les entend parler. Jusqu’à ce petit « clic » qui suggère une fin funeste.
Ne pas dessiner la guerre était un choix délibéré. On ne la voit jamais dans mes livres, on l’entend.
ZEINA ABIRACHED
Vous verriez-vous raconter la guerre plus crûment un jour ?
Non, cela ne m’intéresse pas du tout. J’éprouve un immense plaisir à cette contrainte que je me suis imposée de ne pas représenter la guerre.
C’est aussi pour cela que je travaille en noir et blanc, cela offre des possibilités graphiques infinies pour inventer des façons nouvelles de raconter la guerre. Au début du Jeu des hirondelles par exemple, j’utilise le blanc de la page comme un élément graphique pour exprimer le vide et matérialiser la séparation entre Beyrouth-est et Beyrouth-ouest.
Dans la construction de cette série de témoignages, avez-vous lu d’autres témoignages d’enfants pris dans la guerre ou d’autres œuvres littéraires racontant Beyrouth en guerre — par exemple Beirut Nightmares de Ghada Samman — ou avez-vous plutôt voulu conserver la singularité de vos souvenirs ?
L’Histoire de Beyrouth de Samir Kassir est un incontournable. C’est un livre que j’ai énormément consulté même s’il ne traite pas de la guerre. J’ai aussi fait beaucoup de recherches (photos, documentaires, essais…) pour resituer mes souvenirs dans la chronologie de la guerre.
Et puis un soir de 2006, sur le site de l’INA qui venait de mettre ses archives en ligne, je suis tombée sur un reportage d’Antenne 2 intitulé « Beyrouth, 1984, une rue sur la ligne de démarcation ». Et soudain, sur l’écran de mon ordinateur, surgit le visage de ma grand-mère, suivi de ces quelques mots « vous savez, je pense qu’on est quand même, peut-être, plus ou moins en sécurité, ici ».
Elle qui avait toujours refusé de me parler de la guerre, me livrait, à son insu le chemin vers l’exploration de mes souvenirs.
Dans plusieurs de vos albums, vous donnez l’impression que votre dessin veut s’échapper de la case. Qu’est-ce qui a déclenché cette ouverture, ce cassage du mur de la case ? Est-ce un écho de la privation d’espace subi pendant la guerre ?
Je travaille toujours mes compositions sur l’espace de la double page. Mon envie est, au contraire, de contenir le dessin dans ce rectangle. Dans le Jeu des hirondelles, comme il s’agit justement de privation de l’espace extérieur et du rétrécissement de l’espace intérieur, il me semblait intéressant d’exprimer par la mise en page la sensation d’enfermement et de suggérer par le découpage et la composition, une sensation de lecture.
Je travaille toujours mes compositions sur l’espace de la double page. Mon envie est, au contraire, de contenir le dessin dans ce rectangle.
ZEINA ABIRACHED
Dans Prendre refuge, c’est exactement l’inverse, le paysage de Bamyan en Afghanistan et son ciel étoilé suggérant un espace beaucoup plus vaste, j’utilise très peu de cases et privilégie des pleines pages de dessin voire des pleines doubles pages !
Le jeu sur la composition et le découpage crée des sensations de lecture très différentes.

Vous citez souvent la maison d’édition L’association, et notamment David B. comme source d’inspiration, mais ce que vous dites du noir et blanc, de l’espace de la bande-dessinée ou de son découpage rappelle l’œuvre de Gotlib. Est-il une référence importante pour vous ?
C’est drôle que vous parliez de Gotlib ! Mes parents avaient toutes les Rubrique-à-brac. C’est un des premiers auteurs de bandes dessinées qui m’ait marqué, avec Hergé (quel génie !). Je me souviens que les Gotlib, Brétecher et Fred de mon père étaient rangés un peu plus haut dans la bibliothèque … et qu’il fallait se contorsionner pour les atteindre, juste au-dessus de Franquin, Goscinny et Uderzo, Morris et Hergé. Ces auteurs ont bercé mon enfance !
Justement, vous verriez-vous essayer le gag comme genre ?
Le gag n’est pas ma manière de construire une histoire, mais l’humour, la fantaisie, les personnages un peu farfelus, me sont indispensables !
Et dans ce moment particulier, y a-t-il une « école » de bande dessinée au Liban ?
J’ai plutôt été influencée par des auteurs d’ailleurs (Européens, Américains, Japonais), et il n’y a pas, à proprement parler de « style » libanais… au contraire, c’est plutôt le foisonnement des genres qui domine ! Il n’y a pas d’éditeur de bande dessinées au Liban, c’est pour cela que les auteurs libanais se font connaître à l’étranger (particulièrement en France). Longtemps la bande dessinée a été considérée comme un genre mineur au Liban, c’est un peu différent aujourd’hui, car il me semble qu’on en lit de plus en plus.
Je reviens au Piano oriental, vous faites dire – douloureusement ou ironiquement – à un de vos personnages qui revient d’Autriche, « cette bonne vieille Beyrouth ne changera jamais » …
C’est ce qu’ils pensaient ! Leur génération était convaincue de cela…

C’est d’autant plus tragique qu’en lisant Le jeu des hirondelles on se rend compte que ce personnage est mort pendant la guerre. Cet optimisme n’est-il pas un aveuglement ?
Dans l’imaginaire collectif, la génération des « années dorées » était optimiste, enthousiaste… et sans doute aussi un peu dans le déni des tensions politique (… la guerre de 1975 n’est pas venue de nulle part !)
Comme avec le mythe de la « Belle époque » qui a hanté la France de l’après-1918, le Liban est-il hanté par l’avant-1975 ?
Ma génération qui a hérite d’un pays en ruines, s’est fabriquée un pays « rêvé » à partir des récits de nos grands-parents, qui avaient connu eux, le Liban de l’âge d’or et sa douceur de vivre. Nous sommes orphelins de cette époque et elle en est devenue iconique, cristallisé dans ces quelques années. Cette nostalgie rend peut-être aussi la réalité de notre présent un peu plus supportable. Nous avons eu besoin de ce passé fantasmé pour survivre. Je pense par ailleurs que cette nostalgie commence à passer. L’explosion du 4 août nous a violemment inscrit dans le présent, d’une manière presque définitive.
Nous sommes orphelins de cette époque et elle en est devenue iconique, cristallisé dans ces quelques années. Cette nostalgie rend peut-être aussi la réalité de notre présent un peu plus supportable. Nous avons eu besoin de ce passé fantasmé pour survivre.
ZEINA ABIRACHED
Dans Le jeu des hirondelles vous décrivez longuement l’angoisse qui vous étreint lorsque vous arrivez à Beyrouth en avion — la ville vous reconnaîtra-t-elle ? Est-ce spécifique à votre arrivée à Beyrouth ou ressentez-vous quelque chose de similaire en arrivant à Paris ?
…Paris sera toujours Paris ! Beyrouth, c’est une autre affaire… je ne sais jamais vraiment comment cela va se passer entre elle et moi. Longtemps, j’ai eu peur de ne pas retrouver certaines façades emblématiques, qui constituaient mes points d’amitié avec la ville. Maintenant, à chaque fois que j’y retourne, la première balade que je fais est pour vérifier que chacune d’entre elles est encore là. C’est cela qui a été terrible après le 4 août : la promenade rituelle a servi à constater les dégâts. En 1990, mon père nous a emmené au centre-ville, qui avait été le théâtre de violents combats pendant la guerre, pour nous montrer sa ville… Je me souviens qu’il pointait du doigt « le magasin de l’oncle Émile », « la pâtisserie suisse », « la fontaine de Aintabli » avec une grande émotion dans la voix et nous racontait ses souvenirs associés à ces lieux. C’était terrible car à chaque fois il nous montrait un tas de gravats. Je me suis retrouvée à faire la même chose après le 4 août.
Ce qui est très dur après une catastrophe pareille, c’est l’horreur du présent à laquelle viennent se superposer des strates non-cicatrisées de traumatismes qui remontent à la surface. Si on avait fait un travail de mémoire au sortir de la guerre, on n’en serait sans doute pas là aujourd’hui. Mais ce récit n’est toujours pas écrit.


