La nouvelle lutte de classe
La nouvelle lutte de classe est-elle territorialisée parce qu'elle est, d'abord, une lutte pour le côntrole du centre ? Le premier compte rendu en langue française de l'ouvrage du politiste américain conservateur Michael Lind.
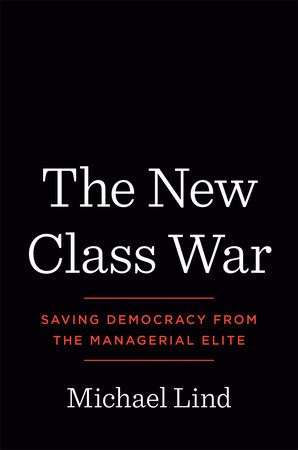
La lutte des classes est de retour, pas tant en termes marxistes et matérialistes qu’en tant qu’affrontement politique entre différents groupes, au niveau socioculturel, au sein des États-nations. C’est une thèse qui commence également à refaire surface au niveau international. Le dernier livre magistral de Michael Lind, The new class war, décrit précisément ce à quoi nous sommes confrontés et que nous refusons de voir. La thèse de Lind est simple et puissante : nous sommes entre les mains d’une élite technocratique, vivant barricadée dans ses enclaves, tandis qu’à l’extérieur il y a une classe moyenne et ouvrière (l’auteur n’a pas peur d’utiliser la classe ouvrière pour regrouper tous ceux qui sont à l’extérieur du système globalisé, vivant dans des réalités périphériques et territorialisées) de plus en plus désorientée et incisive.
La division, pour Lind, est avant tout géographique. Les technocrates, terme utilisé ici pour désigner de manière générique tous ceux qui ont de hautes compétences certifiées par un système universitaire international de plus en plus coûteux, vivent dans des hubs, les grandes zones urbaines où se concentrent la finance, les multinationales, la technologie, les médias, les services de conseil. Ils sont décrits comme « créatifs », « compétents », « élite numérique », « centres de réflexion », « entrepreneurs de la matière grise », « intelligents ».
De l’autre côté, juste à l’extérieur de la métropole ou dispersée dans les différentes Vendées du monde, il y a la classe ouvrière. Ce sont ceux qui sont ancrés dans le modèle « traditionnel » dans la terminologie des élites progressistes, qui vivent en province et en banlieue, qui croient en la famille traditionnelle, en l’immobilier, qui utilisent la voiture et qui cultivent les mythes nationaux-populaires et campagnards. Ils ne sont pas nécessairement « les pauvres », car un entrepreneur de province ou un artisan gagne souvent beaucoup plus qu’un journaliste voire même un éditorialiste, mais leur culture est différente.
De plus, la classe ouvrière nationale est obligée de se mêler aux nouveaux arrivants, les immigrés. Une dynamique sociale qui alimente les craintes des habitants, mais qui ternit aussi les ailes des nouveaux arrivants en les isolant dans les banlieues et en les poussant à travailler comme main-d’œuvre bon marché (soignants, bonnes, jardiniers, etc.). En fait, pour ceux qui sont nés en dehors de l’énclave technocratique, la route vers les centres est longue et cahoteuse, dit Lind, quoi qu’en disent les apôtres de la méritocratie. Oui, parce que la grande majorité de ceux qui font partie de la technocratie ont un avantage : être nés de parents ayant un diplôme universitaire et / ou une condition économique supérieure à la moyenne. En bref, le système récompense le mérite, mais seulement s’il existe certaines conditions de départ et si l’individu est prêt à épouser les valeurs de l’establishment, composées d’identités fades, de droits individuels, d’environnement alisme et de mobilité du travail.
Grâce à cette fermeture hermétique, l’idéologie de la classe technocratique est une synthèse hypocrite entre individualisme absolu et discipline autoritaire. L’individu doit (ne peut) pas être libéré de tous les liens familiaux, géographiques, sociaux de tradition. Les méritants doivent devenir des technocrates mondiaux, pluralistes, ouverts à la diversité des genres et des ethnies, écologistes, ouverts. Mais en même temps, les seules idées acceptables sont celles de la classe technocratique elle-même. Hors de cela, tout est populisme, fascisme, sectarisme, analphabétisme fonctionnel. L’ancien monde bourgeois où la famille, l’héritage, la communauté étaient des valeurs doit être balayé. Enterré avec ses symboles de statut comme l’immobilier, la nourriture sur-calorique et les voitures.
Lind écrit qu’il existe « une nouvelle orthodoxie de la classe dirigeante compétente, dont les membres dominent à la fois les bureaucraties, les conseils d’entreprise, les universités, les fondations et les médias du monde occidental ». Et « son modèle économique est basé sur des taxes, des réglementations, des arbitrages et un marché du travail mondiaux, qui affaiblissent à la fois la démocratie des États-nations et la majorité de la classe ouvrière nationale. Son modèle de gouvernement préféré est apolitique, non majoritaire, élitiste, technocratique ». Une élite qui, comme le décrit Joshua Goldberg dans Decline and Miracle of the West, s’attaque à des personnages anticoncurrentiels, bureaucratiques, anticommunautaires et centralisateurs. Cette élite a le désir, en substance, de tout gérer depuis le centre et de tout corriger par l’intermédiaire de l’État, des institutions supranationales et des tribunaux, s’exposant ainsi à de dangereux échecs dus à l’erreur naturelle que commettent ceux qui exigent un contrôle total de la société.
Et de là, retour à Lind, à la lutte des classes. Parce que les territorialisés, menacés par la dynamique de l’économie mondiale et de l’immigration, ont recours à la seule arme possible dans le monde occidental : le vote. Un mouvement électoral de réaction, celui qui a ébranlé les régimes démocratiques ces dix dernières années.
Les populistes entrent en jeu à ce stade. Pour Lind, le populisme est une réaction, une résistance à la victoire complète de la classe technocratique, qui a plus de ressources et de pouvoir mais est moins nombreuse que la classe périphérique. Les populistes ont changé les coordonnées de la politique. Le centrisme gagnant des années 1990, celui des Blair, Clinton, Bush, Berlusconi, était basé sur des idées économiques libérales (centre-droit) et une approche éthique ouverte (progressiste ou, au moins, non traditionaliste). Celle des populistes est exactement le contraire, c’est pourquoi le centre a disparu ; les technocrates ne veulent toujours pas le comprendre, mais il est basé sur les idées économiques de la gauche (Etat-providence) et sur les positions éthiques de la droite (traditionaliste). Dans lequel le ciment le plus fort est l’opposition à la classe technocratique et progressiste qui, entre-temps, a profité de la mondialisation économique et institutionnelle en occupant la plupart des positions de pouvoir sur le marché et dans les institutions non majoritaires. Quel est le problème du populisme ? Lind n’est pas mou : les mouvements populistes réagissent, protestent, freinent, mais ne gouvernent pas. Si et quand ils gouvernent, ils luttent pour construire leur propre élite, un contre-établissement capable de ramener la classe technocratique à la raison, de maintenir la société unie, de trouver un accord entre les deux classes.
C’est pourquoi la politique occidentale risque de s’effondrer, car personne ne peut échafauder un New Deal. Les populistes sont trop stupides, la classe technocratique est trop aveugle et effrontée. Les deux mondes ne se rejoignent pas, personne ne saisit la sophistication du jeu politique ni la necessité de concilier « bon » et « mauvais » visages. Et Lind écrit, en apportant au débat une suggestion puissante, que le risque est celui de la dérive sud-américaine dans laquelle les oligarchies oppressives provoquent des réactions populistes cycliques et destructrices. C’est le technopopulisme, un régime dans lequel les deux âmes, les deux classes, vivent ensemble au risque de s’autodétruire. Combien de temps avant que le système ne s’effondre ? Nous ne le savons pas, mais comme George Orwell l’a prévenu, il y a dans les régimes technocratiques toujours le risque d’une « société hiérarchisée, avec une aristocratie de compétence au sommet et une masse de semi-esclaves à la base ».
Où s’arrête le raisonnement de Lind ? Comment peut-on guérir d’une maladie ?
L’intellectuel américain mène à ce que l’on pourrait appeler le néo-corporativisme, et ce que Lind appelle le pluralisme démocratique. Il ne s’agit pas de rappeler le corporatisme fasciste, une expérience de la pratique de peu de succès parce qu’elle se déroule dans un cadre stataliste, autoritaire et dominé par les partis, mais d’une tradition qui part du sociologue Durkheim et s’intègre aux penseurs fédéralistes, comme Thomas Jefferson. La seule façon de trouver un pacte entre les deux classes est de fournir les instruments pour lesquels les négociations peuvent avoir lieu : relance des syndicats, re-territorialisation de la politique, domestication du capitalisme. Établir la société sur un ordre tripartite : travail, capital, politique. Ils devront revenir à la coopération dans le cadre de nouveaux ordres de chambre et de territoire.
La classe ouvrière, beaucoup plus nombreuse et répandue que les technocrates, doit utiliser ces instruments pour affirmer son pouvoir. Un contrôle accru sur la politique, les finances publiques, le commerce, l’immigration et une relation plus étroite avec le monde économico-financier sont les antidotes du techno-populisme, de l’oligarchie démagogique dans laquelle nous risquons de tomber. Dans ce processus, la maturation des mouvements nationaux-populistes est fondamentale, le passage de la réaction à la conception d’un nouvel ordre est essentiel. Mais même dans les élites technocratiques, il y a un besoin de pontifes qui peuvent promouvoir ces processus fédérateurs et pousser au renforcement du contrôle depuis la base du pouvoir. À bien des égards, ce raisonnement coïncide avec celui de Joshua Goldberg, qui part de positions plus conservatrices mais finit par nous ramener dans son livre à la nécessité de redécouvrir et de défendre l’esprit original de l’Occident. Une approche qui avait également trouvé place dans les réflexions de penseurs italiens importants, mais souvent en dehors du chœur du conformisme, comme Gianfranco Miglio et Geminello Alvi.
Le diagnostic de la maladie de notre société est désormais précis. Les anciennes et les nouvelles élites seront-elles capables de forger un nouveau pacte ? Ou sommes-nous condamnés à nous diviser entre les deux dérives désastreuses, orwellienne ou sud-américaine ?

