Nous avons appris hier soir avec une immense tristesse le décès de Samir Amin. Économiste franco-égyptien, il a été l’une des grandes figures du marxisme du XXe siècle qu’il a appliqué aux problèmes du sous-développement. Nous ne chercherons pas à retracer ici sa vie, faite d’aventures intellectuelles et politiques aux quatre coins du monde, ni son œuvre immense. Laissons lui tout simplement la parole.
Il nous avait reçus en avril dans son appartement du XIIIe arrondissement de Paris pour une longue conversation sur sa trajectoire, son œuvre et ses analyses du monde contemporain. Il se portait bien alors et, pendant qu’on apprêtait les magnétophones, trouvait déjà l’occasion de se définir comme « un nomade qui partage son temps entre Paris, le Caire et Dakar » et de nous parler de son départ imminent, à l’occasion du bicentenaire de Karl Marx, pour la Chine, où il nous assurait qu’on « discute très librement, sûrement plus librement qu’aux Etats-Unis » – comme le lecteur pourra s’en assurer, ce n’était pas la première de ses assertions surprenantes, voire provocatrices, mais elles méritent au moins le moment d’une réflexion, venant d’un homme qui connaissait le monde si bien.
Que signifie, pour vous, être marxiste ?
J’étais et je suis resté marxiste. Être marxiste, pour moi, ce n’est pas être marxologue. C’est partir de Marx et non pas le considérer comme la fin du chemin. Les grands problèmes amorcés par Marx concernent la vraie nature du capitalisme. Seul Marx a posé cette question dans tout le XIXe siècle et même au-delà. Personne d’autre n’a compris l’essentiel du capitalisme, et pas seulement le capitalisme de son temps, mais le capitalisme de manière générale. Comme je le souligne dans un chapitre de mon livre sur la Révolution d’Octobre, bien que Marx fût très conscient, en homme intelligent et cultivé, de l’adaptation du système aux circonstances de lieu et de temps, ce que le Capital nous donne à lire, ce n’est pas une histoire du capitalisme, mais une théorie du capitalisme, et c’est cette lecture-là qui a été essentielle dans ma vie.

J’ai été un lecteur attentif de Marx dans ce sens que j’ai lu tout Marx, pas seulement le Capital, les Grundrisse, etc. mais les œuvres politiques, le Dix-huit Brumaire, la Guerre civile, etc. Tout Marx. C’est amusant, je l’ai lu quatre fois dans ma vie un peu systématiquement : à vingt ans, quarante ans, soixante ans et quatre-vingts ans. Le hasard a fait correspondre ces lectures à des moments de transformation importante dans le monde. À vingt ans, c’était la fin de la Seconde guerre mondiale. À quarante, c’était Bandung et la reconquête des indépendances nationales. À soixante, c’était l’effondrement de l’URSS et la fin du maoïsme. À quatre-vingt, c’était la grande crise actuelle. Je l’ai lu à chaque fois pour m’en servir, pour voir comment il m’aiderait à comprendre mon temps. Marx n’est ni un prophète préscient, ni un génie qui aurait écrit une œuvre pour l’éternité, mais tout simplement le meilleur – et je dirais même le seul – analyste sérieux et réel du capitalisme, précisément parce qu’il n’était ni un économiste, ni un philosophe, ni un sociologue, mais tout cela en même temps.
Lorsque Marx écrit le Manifeste communiste, en 1848, il n’y avait pas que la Russie qui fût arriérée, mais aussi l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, la France du midi, etc. Le capitalisme recouvrait l’Angleterre, un quart nord-est de la France, la Belgique, et un tout petit bout de l’ouest de la Westphalie prussienne, c’était loin d’être ne serait-ce que l’Europe entière. Et c’est à partir de ces germes qu’il a vu l’essentiel, et qu’il a répondu de manière magistrale à cette question : en quoi cette société est-elle différente de toutes les autres, pas seulement des sociétés d’Asie, d’Amérique ou d’Afrique noire, mais aussi des sociétés féodales de l’Europe elle-même ? En quoi cette société est-elle qualitativement nouvelle ? Je parle à dessein de société, car il ne s’agit pas seulement du mode de production, mais aussi de la politique, de la culture et de toutes les dimensions de la vie sociale.
La réponse magistrale de Marx est de caractériser le capitalisme comme le premier système fondé sur le marché généralisé. Le travail devient une marchandise, le capital lui-même devient une marchandise sous forme financière. Il en va de même de la nature, et notamment de la terre. Le travailleur, transformé en marchandise, vend sa force de travail, mais, prisonnier de l’aliénation capitaliste, il croit vendre son travail lui-même. S’il travaille huit heures, il est formellement payé pour huit heures, mais ce salaire lui permet d’acheter des produits ou des services qui n’ont coûté à la société que quatre heures. C’est le fondement de l’exploitation.
C’est une forme nouvelle, dont l’esclavage était très différent. Si un serf travaille trois jours sur sa terre pour lui-même et trois jours pour donner le produit au seigneur, l’exploitation est visible et claire. C’est la raison pour laquelle – cela a été mon interprétation très précoce du marxisme – le rapport entre l’infrastructure économique et la superstructure politique et idéologique n’est pas de même nature dans le capitalisme que dans les systèmes antérieurs. Dans le capitalisme, non seulement elle est déterminante en dernier ressort, mais elle est dominante, c’est-à-dire qu’elle soumet les autres instances aux exigences essentielles de son déploiement.

Enfin, on ne peut parler de Marx seulement comme un philosophe ou un écrivain, fût-il de haute qualité. Il était aussi un militant, il voulait donc que ses idées deviennent, comme il l’a écrit, des forces de transformation révolutionnaire à travers des êtres humains actifs, les prolétaires. Des socialistes utopiques français, Marx a hérité du communisme comme objectif historique. Le communisme n’est pas seulement un mode de production plus efficace et plus juste, comme le considèrent souvent les marxistes, mais aussi une étape supérieure de la civilisation humaine. Marx citait Shakespeare : ‘On peut être pêcheur le matin, tourner des boulons pendant deux heures et composer le soir de la poésie.’ C’est une autre vision de l’être humain et de la société, qui prend la solidarité pour principe fondamental, solidarité entre les individus, les peuples ou les nations, au lieu de la concurrence qui commande le capitalisme, loin de la concurrence pure et parfaite des imbéciles de l’économie vulgaire, une concurrence faite de lutte et de conflit.
À partir de votre thèse de doctorat en France, vous avez également l’ambition d’apporter votre propre contribution au marxisme.
Quand j’étais étudiant en France, j’ai eu la chance de travailler avec François Perroux, qui était un homme remarquable et très ouvert d’esprit. Je lui ai expliqué que je voulais faire une thèse sur « l’accumulation à l’échelle mondiale », c’est-à-dire les spécificités du capitalisme quand on le considère, non pas comme un mode de production localisé à un endroit ou à un autre, mais à l’échelle mondiale. Il m’a dit « bravo, c’est un très beau sujet, sauf que ce n’est pas un titre académique », d’où le titre académique de ma thèse qui n’a pas grand intérêt : « les effets structurels de l’intégration des économies dites sous-développées ». Cela veut dire la même chose.
Le capitalisme, dans son expansion mondiale, a toujours été polarisant.
Samir amin
Comment définiriez-vous l’ambition de ce travail ?
Ma lecture de Marx m’a laissé sur ma faim parce que je n’y ai pas trouvé la question qui a été la mienne, celle de ma vie, depuis deux tiers de siècle maintenant : pourquoi, dans son développement mondialisé, le capitalisme n’homogénéise-t-il pas le monde ? Grosso modo, il a homogénéisé l’Occident. Avec des inégalités, mais il l’a fait en Europe occidentale et centrale, aux États-Unis, et au Japon un peu plus tard, qui sont des sociétés très semblables au niveau de développement très proche. Pourquoi ne l’a-t-il pas fait pour le reste du monde ? Il s’agit de la majorité de l’humanité, – 85 % en termes de population à l’heure actuelle, qui deviendront bientôt 90 % –, de toute l’Asie, de l’Afrique, l’Amérique du Sud, des Caraïbes. C’est un fait, le capitalisme n’a pas homogénéisé le monde, au contraire, et c’était mon idée dès 1947, alors que je n’avais même pas vingt ans. Plus tard, quand je suis devenu ami avec André Gunder Frank, il avait une formule qui rend bien ce problème : « développement et sous-développement sont l’endroit et l’envers de la même médaille ».
Comment cette polarisation a-t-elle fonctionné ?

Le capitalisme, dans son expansion mondiale, a toujours été polarisant. Les Européens de l’Atlantique ont fabriqué la périphérie américaine, et la périphérie de la périphérie : l’Afrique où l’on puisait les esclaves. Cela a été une première forme de la polarisation, dont ont été bénéficiaires principalement les Pays-bas, l’Angleterre, la France, et accessoirement, auparavant, l’Espagne. Le reste de l’Europe n’en a profité qu’indirectement. La deuxième étape de la polarisation a été le dix-neuvième siècle, la conquête de l’Inde, l’ouverture commerciale de la Chine à coups de canons, et la conquête coloniale africaine. Avec la reconquête d’une indépendance formelle par les pays arabes et africains et par les peuples de l’Amérique latine et des Caraïbes, une nouvelle forme de polarisation voit le jour et ce qui est en voie de reconstruction à l’heure actuelle, c’est une nouvelle forme de la polarisation.
C’est cette polarisation qui oppose le centre et la périphérie. Je suis assez fier de l’avoir écrit en 1954, et d’avoir ainsi publié un anti-Rostow avant le livre de Rostow, Les étapes de la croissance, qui est paru en 1960 et qui est devenu le livre de chevet de tous les étudiants. Pour moi, il n’y a pas d’étapes de la croissance. La polarisation est dans les gènes du capitalisme, c’est un produit naturel et obligatoire de son expansion mondiale.
Quelle est la forme contemporaine de cette polarisation ?
J’ai tenté de la décrire dans un écrit d’il y a quarante ou cinquante ans sur les cinq monopoles. Je disais que la Triade (Etats-Unis, Europe occidentale et Japon) bénéficie de cinq monopoles. Le premier est celui de l’accès – qui n’implique pas nécessairement la propriété – aux ressources naturelles de la planète. Ce qui est insupportable pour les gens de la Triade, c’est de ne pas avoir accès au pétrole ou à une autre ressource, ici ou là. Ensuite vient le monopole de la technologie, renforcé par les prétendus droits intellectuels. La Triade ne tolère pas que d’autres s’emparent de cette technologie, la repoduisent ou la développent par eux-mêmes. Le troisième monopole est celui de l’information, qui permet le formatage par les médias. Le quatrième monopole est financier, c’est le marché financier et monétaire mondialisé. C’est la raison pour laquelle la Chine et la Russie sont pour eux des pays insupportables, car elles ne rentrent pas dans cette mondialisation financière. Par contre, l’Inde y rentre. Quant à l’Arabie saoudite, puisqu’elle accepte cette mondialisation financière, on nous la présente presque maintenant comme la République démocratique modèle d’Arabie saoudite. Le cinquième monopole est celui des armes atomiques. Je n’aime pas l’arme atomique et les armes de destruction massive, mais la question n’est pas là. Si certains l’ont, les autres ont le droit de l’avoir. L’histoire n’a pas prouvé que les autres étaient plus criminels que les uns.
Mais ce pouvoir de la Triade n’a pas empêché le développement des pays émergents ?
Cette structure de domination a permis ce que la Banque mondiale appelle l’émergence des marchés, c’est-à-dire l’émergence de nouveaux marchés subalternisés. C’est amusant, parce que Bangalore a été donnée comme le modèle du développement induit par cette forme nouvelle de l’indépendance soumise, et il y a quelques jours j’ai lu que Bangalore est la ville la plus polluée de toute l’Inde – et Dieu sait s’il y a de la pollution en Inde. C’est devenu une ville invivable, on est obligé de mettre des rideaux devant ses fenêtres, parce qu’il y a dans l’air des résidus qui volent.
Quels sont les mécanismes économiques qui produisent le sous-développement ?
Il faut citer deux mécanismes. Le premier détermine le rapport entre le département des moyens de production et celui des moyens de consommation. Pour le comprendre, il faut se souvenir que les périphéries ont été construites par le centre, elles se sont laissées contruire par leurs classes dirigeantes, ou alors elles ont été battues dans leur résistance. Elles ont été construites sur l’articulation entre exportation et consommation de luxe. Le premier terme est l’exportation des ressources, qui concerne, pour tout le XIXe siècle et une bonne partie du XXe, les matières premières agricoles et minérales, les produits tropicaux, les arbres de Sibérie, et pour les minéraux le cuivre, le fer, l’or, le charbon, ainsi que le pétrole et le gaz qui sont plus importants aujourd’hui. Ces exportations sont contrôlées par le capital du centre, en alliance avec les classes dirigeantes des anciens systèmes locaux, sauf dans les colonies au sens le plus strict où l’administration coloniale se substituait aux classes dirigeantes locales. De la sorte, ces exportations produisent des revenus pour une minorité. Celle-ci est parfois infime, comme en Guinée équatoriale où il s’agit du Président et de sa famille, et elle a certainement longtemps représenté autour de 5 % de la population pour l’Afrique subsaharienne sortie de la colonisation. Aujourd’hui, dans des pays comme l’Inde, le Brésil, l’Amérique latine, ou une bonne partie de l’Afrique qui rattrape, ce chiffre atteint 20 %. Mais c’est seulement 20 %, et cela signifie que 80 % ne tirent aucun bénéfice de tout cela.
L’autre mécanisme, qui repose sur le rapport entre secteurs directement et non directement capitalistes, peut être représenté par un schéma. Le secteur capitaliste au nord est grand, mais il coexiste avec un secteur non capitaliste, qui comprend le travail non payé des femmes, et les paysans avant qu’ils ne soit transformés en agriculteurs capitalistes. Dans le sud, en termes d’emploi, une fraction beaucoup plus petite de la population est capitaliste. L’ensemble de ce schéma représente bien le capitalisme, mais on peut distinguer les secteurs qu’il ne gère pas directement. Les transferts de valeur se font de ces secteurs vers les secteurs directement capitalistes, et du Sud vers le Nord.
Ce secteur non capitaliste, au Sud comme au Nord, joue un rôle structurel dans le capitalisme, il est reproduit par le capitalisme, mais est-il amené à disparaître ?
Il n’est pas amené à disparaître. Il est amené à être entretenu et soumis. Au Nord, on peut dire qu’une partie du travail qui était autrefois familial est aujourd’hui remplacé, par exemple, par les produits tout faits qu’on achète dans les chaînes ou les restaurants.
Contrairement à la thèse de Weber, ce n’est pas le protestantisme qui a créé le capitalisme, c’est le capitalisme qui a conduit certains chrétiens à devenir protestants.
Samir amin
Au Sud, l’agriculture est désormais réellement intégrée, mais pas encore complètement. Il reste une autoconsommation qui n’est pas négligeable. L’agriculteur capitaliste français, qu’il fasse de la vigne, du blé, des fruits et légumes, ou du cochon en Bretagne, pratique une autoconsommation insignifiante. En Afrique subsaharienne, ce n’est pas encore insignifiant, cela représente 30 % à 50 % de la production ; le reste est vendu et acheté sur le marché.
C’est donc par le concept de capitalisme qu’il faut comprendre notre situation aujourd’hui dans l’histoire mondiale ?
L’histoire du capitalisme est une histoire très différente de l’histoire universelle des grands peuples civilisés ou des civilisations antérieures. Elle commence par une très longue incubation. Par eurocentrisme, les Européens ont réduit celle-ci aux trois siècles de mercantilisme, de 1500 à 1800, mais en réalité cette incubation commence en Chine cinq siècles plus tôt, vers l’an mille, avec des inventions géniales comme l’État laïque non religieux et une fonction publique à la place d’emplois réservés d’une manière ou d’une autre à des aristocrates. L’histoire se poursuit dans le monde musulman, au sein du califat qui était d’apparence turque, mais arabo-iranien en réalité. L’étape suivante est dans les villes italiennes. Contrairement à la thèse de Weber, ce n’est pas le protestantisme qui a créé le capitalisme, c’est le capitalisme qui a conduit certains chrétiens à devenir protestants. Venise était gérée comme une société anonyme de grands commerçants. Les vingt-quatre familles les plus riches avaient tous les pouvoirs, y compris politiques évidemment. Et allez toujours dire à un doge vénitien qu’il n’était pas catholique !

C’est seulement après tous ces épisodes qu’on en arrive à une période florissante, très courte, le XIXe siècle. C’est le moment où l’Europe s’affirme réellement, suivie par les États-Unis, puis un peu plus tard, à partir de l’ère Meiji et de la fin du siècle, par le Japon qui entre dans la danse. À cette époque, l’Europe part à la conquête du monde, ou parfois persévère dans ses conquêtes antérieures comme un Inde. Elle s’en prend ainsi à la Chine avec la guerre de l’opium, et colonise l’Afrique. Les pays d’Amérique latine sont aussi placés sous tutelle, même s’ils étaient juridiquement séparés de l’Espagne et du Portugal.
Cette période d’expansion est suivie d’un long déclin, très long. Il faut distinguer entre les « crises dans le capitalisme » et les « crises du capitalisme », comme je l’ai fait dans un texte pour le bicentenaire de Karl Marx. Les crises dans le capitalisme, ou crises cycliques, sont une chose assez banale. On peut même faire des modèles très simples si on veut s’amuser, qui montrent l’oscillation autour d’une tendance montante. Au contraire, il ne faut parler de crises du capitalisme qu’à partir du moment où il devient un système sénile, c’est-à-dire un système qui peut être et qui doit être dépassé – mais qui ne l’est pas nécessairement de fait, car il n’y a pas de lois de l’histoire, seulement des possibilités et des ouvertures. La première grande crise du capitalisme commence à la fin du XIXe siècle. Les premiers monopoles apparaissent comme réponse à cette crise du capitalisme. Ils sont analysés par les sociaux-démocrates Hilferding et Hobson, et Lénine en tire les conclusions : nous sommes entrés dans l’ère de la possibilité des révolutions socialistes. Cette sénilité du système signifie que nous sommes dans un monde, non plus de destruction créatrice à la Schumpeter, mais de destruction destructrice. L’écologie le montre, mais elle n’en est que l’un des aspects.
Cette crise court de 1914 à 1955. J’aime dire aux économistes que la réponse à cette crise, ce sont un certain nombre d’événements insignifiants dans l’histoire, comme la Première guerre mondiale, la Révolution russe, la crise de 1929, le nazisme, l’impérialisme japonais, la Deuxième guerre mondiale, et la reconquête de leur indépendance par les peuples d’Asie et d’Afrique. La voilà, la réponse à la crise. Et pas Keynes. Ce ne sont pas les économistes et les gouvernements qui auraient trouvé une quelconque bonne solution économique. Keynes n’a fait que s’insérer, en Europe occidentale, au sein de la réponse politique de la social-démocratie de l’après-Seconde guerre mondiale, une social-démocratie que je ne méprise pas du tout et qui a apporté des gains gigantesques comme le plein emploi ou la Sécurité sociale.
La deuxième crise ne commence pas en 2007 avec l’effondrement financier bien connu, elle commence en 1975. Nous n’avons été qu’une poignée à l’époque à le voir. D’abord Paul Sweezy, Harry Magdoff, et moi, rejoints quelques mois plus tard par André Gunder Frank et quelques camarades italiens de Rome. Nous avons constaté, à l’époque (cela a été publié en 1977 en anglais), que les taux de croissance étaient tombés à la moitié de leur niveau de long terme dans les pays du centre, de 5 % à 2,5 % en moyenne. Cela a des conséquences profondes, et les taux d’investissement par rapport au PIB ne se sont jamais remis depuis. Aujourd’hui, quand le taux de croissance allemand passe de 2,1 à 2,2 %, on dit que la crise est terminée, mais c’est à mourir de rire. Quelles ont alors été les réponses à cette seconde longue crise systémique ? Jusqu’à présent, c’est le chaos. L’Union soviétique en est un cas tristement exemplaire. La construction européenne est également une réponse politique inepte. Alors qu’il s’agit de dépasser le système, elle se propose de le sauver. D’où le titre provocateur d’un de mes livres récents, qui s’appelle Sortir de la crise du capitalisme ou sortir du capitalisme en crise. Le défi, c’est de sortir du capitalisme en crise, contrairement à ce que pensent les gauches électorales à 98 %.
Pourriez-vous revenir sur les causes économiques de cette seconde crise systémique ?
On peut dire que la crise débute en 1971 avec la suspension de la convertibilité du dollar. Mais l’essentiel, c’est le développement du capitalisme des monopoles. Les monopoles existaient avant, mais nous sommes arrivés à un stade – c’était l’idée principale de mon livre sur l’Implosion du système capitaliste – que j’ai appelé celui des monopoles généralisés, où les monopoles ont réduit au statut de sous-traitants de facto toutes les formes de la production qu’ils ne dirigent pas directement eux-mêmes.

Pourriez-vous revenir sur les effets politiques de cette crise ?
L’exemple par excellence, ce sont les paysans, pris en tenailles entre les monopoles de leurs fournisseurs de pesticides et d’OGM en amont, et les grands monopoles de commercialisation en aval. Mais c’est une situation générale. La voilà, la réalité du soi-disant néolibéralisme. Contrairement à ce que dit le Fonds Monétaire International, les prix vrais sont des prix archifaux, ils sont le résultat de la dictature des monopoles généralisés sur l’ensemble du système productif. Le prix vrai de la carotte, dans ce système, il est zéro puisqu’il permet un revenu zéro à l’agriculteur qui l’a produit.
Ce système n’est pas viable. Ce n’est pas une question de goûts, il est incapable de se reproduire. L’écart entre la capacité théorique de production et la demande solvable est grandissant, donc le système est contraint à une fuite en avant qu’on appelle la spéculation financière, et les actif qui représentent le capital se trouvent surévalués. Une machine qui coûte en réalité mille heures de travail, est ainsi estimée à la Bourse à trois fois sa valeur, parce qu’elle permet un taux de profit de 2 % supérieur à une autre.
Au-delà de l’économie, ces monopoles généralisés ont acquis l’exclusivité de tous les pouvoirs. Une vingtaine de banques, qui sont toutes des pays du centre, contrôlent toutes les transactions sur le marché financier monétaire mondialisé. Les monopoles ont obtenu le ralliement néolibéral de la social-démocratie et même des anciens partis communistes. Ils ont domestiqué les médias, que j’appelle le clergé médiatique au service de l’aristocratie financière. C’est une dictature unilatérale. C’est bien une forme de totalitarisme, même si elle est très différente de l’hitlérisme, qui était lui aussi au service du grand capital, mais du grand capital allemand de son époque. C’est cette nouvelle forme qu’incarne l’Union européenne.
Mais la manifestation politique la plus effrayante de la crise systémique, c’est le fascisme, au Nord et au Sud. Ce fascisme peut être religieux en un sens fondamentaliste, ce qui conduit facilement au terrorisme. Il s’agit alors de fonder la société sur l’Islam, sur l’hindouisme, ou sur le bouddhisme avec l’ignoble dalaï-lama.
En Europe, les fondamentalistes chrétiens existent mais ils n’ont pas une puissance de conviction terrible. Mais des formes fascistes existent aussi. Je dois préciser que nous utilisons pour la pensée sociale des termes d’époques passées, dans des sens renouvelés. Le fascisme d’aujourd’hui est un fascisme soft, ce n’est pas celui de Hitler. Le racisme, antisémite ou autre, est toujours utile pour les fascismes, mais il n’est pas aujourd’hui leur dimension principale. Ce que nous connaissons, c’est un fascisme soft, en pantoufles plutôt qu’en bottes, qui affirme que nous sommes des individus libres, indépendants, qu’on fait ce qu’on veut, etc. Il s’agit d’un formatage dans le moule du faux individualisme et de la fausse liberté, qui sont assez conventionnels pour neutraliser tout ce qui pourrait mettre en danger le fonctionnement du système.
Alors, que faire ?
Le capitalisme est une brève parenthèse dans l’histoire, car c’est un système qui crée les conditions de son propre dépassement nécessaire. Les conditions matérielles tout d’abord, par le progrès technologique dans la production en un ou deux siècles qui nous ont fait avancer plus qu’on ne l’avait fait en trente mille ans – c’est une autre allure. Les conditions politiques ensuite par l’idée de démocratie, au-delà du sens vulgaire des élections et du pluripartisme. Les conditions culturelles enfin, avec l’internationalisme comme universalisme. C’est le capitalisme lui-même qui a réuni ces conditions en un temps record.
Les élections sont faites pour empêcher la société d’avancer.
Samir Amin
Cela ne signifie pas qu’il faut faire la révolution, mais qu’il faut conquérir des avancées révolutionnaires. Je n’utilise plus le mot Révolution depuis vingt ans, je parle d’avancées révolutionnaires, parce que le dépassement du capitalisme dans une perspective communiste est une route très longue, qui nous mène peut-être jusqu’à l’an 3000. Ces avancées ne se manifestent pas seulement par de meilleurs taux de croissance – peut-être que oui dans certains cas, mais peut-être pas dans d’autres.
Elles devront se manifester, par exemple, par le progrès de la démocratie. Le progrès de la démocratie n’est pas celui du pluripartisme et des élections. Pour moi, le slogan de 1968 ‘élections, piège à con’ a toujours été vrai. Les élections sont faites pour empêcher la société d’avancer. La société avance, et elle fait parfois des élections après, qui confortent les avancées, mais elle n’avance pas par des élections. Le pluripartisme, aujourd’hui, n’a plus de sens, puisque tout le monde accepte la loi du marché : que l’on vote rose, rouge, blanc ou vert, le lendemain les élus disent « le marché veut que… ». Cela ouvre, hélas, la porte au fascisme en même temps.
Quelle attitude avoir, en Europe comme ailleurs – ce n’est pas très différent ? C’était la conclusion de mon livre sur l’Implosion : de l’audace, encore de l’audace, toujours de l’audace. Il n’y a pas d’autre moyen d’amorcer la transformation dans le bon sens que la nationalisation non pas du barbier du coin, mais des grands monopoles. L’argument qu’on oppose à ce projet, c’est que les gestionnaires feront la même chose, mais en plus mal, parce que ce seront des bureaucrates au lieu d’être mus par le gain personnel. C’est un danger réel, mais c’est la condition d’une possible socialisation, qui prendra un siècle ou plus. Le changement ne peut se faire que de cette manière, il ne se fera jamais par en haut, que ce soit à l’échelle mondiale par une décision collective et gentille de tous les chefs d’État réunis à l’ONU, ou en Europe par un Conseil des présidents et premiers ministres : c’est inconcevable, quels qu’ils soient. Si on veut être méchants, on peut dire que le changement se fera nécessairement par l’éclatement de ces structures. En tout cas, il ne peut pas se faire autrement que par des avancées inégales.
Cette première étape, qu’on peut qualifier de capitalisme d’État, est incontournable. C’est un capitalisme d’État à tendance sociale, c’est-à-dire respectueux de donner aux travailleurs de meilleures conditions, de meilleures garanties – le contraire de la politique de Macron – mais en restant dans notre mode de production tel qu’il est. Il pourra alors passer graduellement, avec la maturation des luttes et de la conscience, vers la socialisation.
Il faudrait donc une secousse révolutionnaire pour mettre en marche ce processus graduel ?
Je suis peut-être un optimiste invétéré, mais je suis persuadé que la France a un potentiel en ce sens, car elle a quand même une histoire. Pour moi, il y a trois grandes révolutions dans l’histoire moderne : française, russe et chinoise. Quand je parle de grandes révolutions, je veux dire qu’elles se donnent des projets qui sont très en avance sur leur temps. D’où leur échec, qui est leur réussite en même temps, puisqu’elles jettent la semence de l’avenir. C’est le contraire des fausses révolutions, comme la révolution américaine faite par des esclavagistes comme George Washington, pour la propriété et l’inégalité, ou la Révolution anglaise qui est une révolution de palais, les aristocrates anglais acceptant qu’un bon bourgeois puisse avoir accès à quelques honneurs puisqu’il a de l’argent.
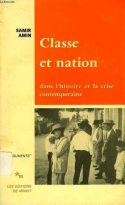
Dans mon livre Classe et nation, écrit en 1985 et publié en 1989, le chapitre conclusif s’appelle « Révolution ou décadence ». J’y affirme qu’à travers l’histoire, les sociétés (pas seulement européennes), se transforment de deux manières différentes. La première est la révolution, lorsque les agents de la transformation ont un projet et sont aussi lucides qu’on peut l’être. On peut discuter les effets de telle ou telle décision, mais c’est du détail. C’est la lucidité historique qui compte. Les révolutions qui peuvent nous servir de modèle sont ainsi accompagnées de certaines conceptions intellectuelles.
C’est le cas de la France des Lumières et de l’Écosse des Lumières au XVIIIe siècle. Dans le cas russe, c’est le marxisme et son interprétation bolchévique, dans le cas chinois c’est le marxisme et son interprétation maoïste.
Mais il y a une autre voie, lorsque les changements se font par la force des choses, sans agent et sans lucidité. Par exemple on ne parle pas de la révolution féodale, mais de la décadence romaine dont est sorti le féodalisme européen. C’est une voie très coûteuse. Le féodalisme a parcouru une route éprouvante, remplie d’invasions et de massacres, pour devenir un système remarquable et la civilisation des cathédrales. Si nous rentrons dans une période de dépassement du capitalisme par la décadence, avec les moyens actuels de destruction de la nature et de l’humanité, j’ai peur que ce ne soit décisif dans le mauvais sens du terme. Nous avons besoin de Marx et de lucidité aujourd’hui, bien plus encore qu’à l’époque de Marx lui-même.
Que pensez-vous de l’hégémonie des États-Unis aujourd’hui ?
Elle est malade.
C’est l’analyse d’Immanuel Wallerstein.

Je dis qu’elle est malade. Wallerstein dit qu’elle a même disparu. Il va trop loin à mon avis. Hélas, ce n’est pas encore le cas. Mais on voit bien des signes de faiblesse, même dans l’actualité. Dans la dispute de Corée, Kim, qui ne me paraît pas le personnage le plus sympathique de l’univers, s’est montré infiniment plus intelligent que Trump. Vous me direz, ce n’est pas difficile. Mais avec Hillary, cela aurait été pire : heureusement qu’il y a un imbécile aux commandes, c’est parfois utile, même si c’est dangereux aussi. Les États-Unis sont aussi engagés dans une bataille commerciale avec la Chine, qu’ils vont perdre, parce que la Chine répond du tac au tac.
Est-ce que cela signifie que les États-Unis ne sont plus l’ennemi prioritaire pour les pays du Tiers Monde ?
Ils sont l’ennemi prioritaire, mais un ennemi sur le déclin. La France est restée l’ennemi prioritaire du Vietnam jusqu’à Ðiện Biên Phủ, mais elle était en déclin !
Quels sont les principaux symptômes de ce déclin de l’hégémonie américaine que vous repérez ?
Ils sont très nombreux, mais d’abord leur incapacité à mener et à gagner une guerre. Ils peuvent bombarder et faire énormément de morts. Ils ont conquis l’Irak : l’Irak est maintenant divisé en guerres civiles permanentes et une bonne partie du pays se trouve maintenant sous la dépendance de l’Iran. C’est une défaite américaine. La Syrie également. Les États-Unis pensaient, avec Israël, faire éclater la Syrie par la guerre islamiste dans toutes les provinces. Il s’agissait de la faire éclater en cinq pseudo-États. Ils ont échoué, grâce à l’aide militaire russe, mais aussi parce que ne s’est pas décomposée l’armée de Bachar El-Assad (qui est un personnage que je ne considère évidemment pas comme un modèle, loin de là). La soi-disant Armée syrienne libre, dont les Européens font tant de cas, c’est dix personnes. Ils sont passés chez les islamistes parce qu’ils étaient dix. Ils n’existent pas. La bataille que gagne Bachar El-Assad est une chose positive à mon avis, et une manifestation du déclin américain.
Passons à l’Europe. Tout d’abord, il faut rappeler que l’orientation mondiale de vos recherches vous a amené à vous opposer à l’eurocentrisme.
En effet, le triomphe de l’Europe au XIXe siècle a engendré l’eurocentrisme. Comme je l’écris dans mon livre sur le sujet, l’eurocentrisme n’est pas dans les gènes des Européens. Il a été fabriqué au XIXe siècle, à partir d’antécédents éblouissants : la Renaissance, les Lumières et la Révolution française. Au cours de ce processus, les Européens se sont donnés un ancêtre grec, et ont forgé l’idée de la Grèce comme capitale de la culture européenne. Mais la Grèce était une capitale de la culture orientale ! L’hellénisme était la fusion de plusieurs grandes civilisations. L’une d’elle correspond géographiquement à ce qu’on appelle aujourd’hui l’Europe, mais c’est elle que les Grecs appelaient barbare. Pour eux, les gens civilisés étaient les Persans, les amis étaient les Égyptiens, les Assyriens, les Babyloniens, les Phéniciens. C’était ça, l’hellénisme. Sur le plan de la civilisation, la Méditerranée était divisée entre l’Est et l’Ouest, mais les Européens en ont fait une coupure Nord-Sud, ce qui leur a permis de rattacher la Grèce à l’Europe et de se donner cette civilisation pour ancêtre. Dans cette fable, on imagine que la civilisation brillante serait passée de la Grèce à l’Empire romain, dont la population aurait aussi été civilisée par le christianisme. Selon la vision eurocentrique, la Renaissance et les Lumières étaient un retour, après des siècles noirs de féodalisme barbare, aux ancêtres grecs et gréco-romains.
L’autre version de l’eurocentrisme, c’est la christianophilie. Il se trouve que le christianisme, avant de se répandre en Amérique et ailleurs, est resté presque exclusivement européen. On en a pris argument pour imaginer une supériorité du christianisme sur les autres religions, ce qui a généré un germe d’antisémitisme.
La troisième version est raciste, et stipule que les peuples européens ont de meilleurs gènes que les autres peuples. Il est amusant de remarquer que Hitler mettait les Germains d’Allemagne en tête, ensuite les Germains qui ne sont pas allemands, les Hollandais et les Scandinaves, puis d’autres. Et il y a des écrits racistes anglais qui avancent la même classification, sauf qu’ils mettent les Anglais avant les Allemands, et pas l’inverse. L’eurocentrisme raciste est la version la plus vulgaire, mais c’est aussi, hélas, celle qui a été la plus criminelle, potentiellement puis réellement.
Quoi qu’il en soit, l’Europe vit encore sur l’eurocentrisme. Ce n’est plus à la mode de dire « supérieur » : la mode est à l’éloge de la différence et de la variété, mais ce n’est qu’une mode, et les Européens restent persuadés que leur mode de vie est différent et supérieur.
Voilà sur le plan culturel. Mais politiquement, que faut-il faire de l’Europe ?

Contrairement aux discours de propagande faits pour plaire au grand public, la construction européenne n’a pas été faite pour faire une Europe forte et capable de concurrencer les États-Unis. L’Europe a été faite par les États-Unis. C’est le cas depuis le traité de Rome en 1957. Puis l’Europe a connu le tournant dit néolibéral, que j’appelle paléolibéral, car il ne s’agit de rien d’autre que de réaliser les vieux rêves de Bastiat des années 1820. Les patrons peuvent battre leurs ouvriers à coups de bâton s’ils le souhaitent et les payer aussi bas que possible, voilà qui n’a décidément rien de nouveau.
En même temps, elle a connu une capitulation démocratique. Car la démocratie, c’est la socialisation, c’est-à-dire la gestion collective réelle de tous les aspects de la vie sociale, y compris bien entendu économique. Et cette gestion doit être prise en main par les citoyens, de vrais citoyens, les producteurs si l’on veut. Tout plutôt que les citoyens d’aujourd’hui, qu’on formate pour qu’ils soient des consommateurs et des spectateurs et non pas des acteurs. C’est ainsi que, au-delà même du néolibéralisme, la démocratie est vidée de tout son contenu.
Voilà pourquoi je suis contre cette construction. L’Europe a été faite en béton armé pour ne pas pouvoir être réformée. Giscard, en 1957, a dit : « le Traité de Rome a rendu le socialisme illégal ». De fait, comme aux États-Unis où elle est protégée par la Cour suprême, la propriété privée est devenue sacrosainte, plus importante que la liberté, qui est désormais avant tout la liberté du propriétaire, même s’il en subsiste quelques autres. Mais la propriété privée est nécessairement celle d’une minorité.
Or le système est rentré dans sa deuxième crise systémique, et j’insiste que ce n’est pas une crise conjoncturelle, que les termes de reprise et de récession n’ont pas de sens ici. Cette crise du système, l’Europe est construite pour refuser de la reconnaître. Elle va donc devenir de moins en moins gérable.
Politiquement, la construction européenne est, par nature, anti-travail et anti-démocratique.
Samir Amin
Je ne suis pas culturellement contre l’Europe, cela me paraît absurde, car si les Européens ne sont pas meilleurs que les autres, ils ne sont pas pires non plus. Il faut aussi reconnaître que c’est l’Europe qui a inventé la modernité : cela aurait pu être ailleurs, mais cela a été là. Mais ce qui compte, politiquement, c’est que la construction européenne, par nature, est anti-travail et anti-démocratique. C’est un fascisme doux. Il n’y a pas plus beau modèle de totalitarisme que l’Europe actuelle. C’est la pensée unique dans tous les domaines.
Pourtant, dans Beyond US Hegemony, vous souligniez le rôle géopolitique que pourrait jouer une puissance européenne indépendante des États-Unis.
Oui. Je l’ai résumé en disant : il faut déconstruire avant de reconstruire. Je ne crois pas du tout à des réformes progressistes de la part de cette Europe telle qu’elle est construite, avec sa constitution, sa bureaucratie de Bruxelles, avec le ralliement de la gauche historique à la droite historique, je n’y crois pas du tout. Je crois que c’est très naïf de le croire, mais beaucoup d’Européens ont cette naïveté. Le peuple grec, notamment, l’avait.
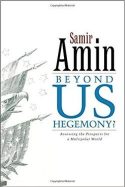
En revanche, la déconstruction peut être une voie. Le Brexit avait des motifs très divers. Il y avait des motifs de droite, notamment à l’égard des immigrés, avec un usage quasi fasciste de ce thème, ainsi que des comportements nationalistes étroits, en particulier de la part des moyennes entreprises britanniques, face aux monopoles mondiaux.
Mais il y avait aussi de bonnes raisons. Je l’ai découvert en discutant avec des Anglais. Les Anglais n’acceptent pas de marcher derrière l’Allemagne – ce que les Français acceptent. Je l’ai dit à un ambassadeur de France : « la France est vichyste ». Elle accepte d’être le second de l’Allemagne, pas avec les formes violentes de l’Allemagne hitlérienne, mais sur le plan économique. L’Angleterre, en revanche, c’est Churchill. Il y a eu quelque chose de symbolique : les Anglais n’ont jamais accepté l’Union Européenne.
Ce sont des raisons de culture politique qui jouent ici ?
Oui. Comme je le dis toujours, c’est l’Armée rouge qui a battu les nazis mais cela ne réduit pas la gloire du peuple anglais en 1940. La monarchie anglaise voulait céder et négocier une paix séparée. C’est Churchill (qui n’était certes pas un homme de gauche) qui a dit non.
C’est donc après avoir défait l’Union européenne qu’il faudrait construire une puissance européenne indépendante ?
Oui. À partir d’avancées inégales la déconstruction de cette Europe permettrait (je l’ai dit, répété, je ne suis pas anti-culture européenne, loin de là) une Europe qui ne rechercherait pas la concurrence commerciale avec les États-Unis, mais la concurrence civilisationnelle.
S’il ne faut pas mener la lutte à l’échelle de l’Union européenne, ce doit donc être au niveau des différentes nations ? C’est ce que vous proposiez dans Classe et nation.
Je sais que cette idée est très impopulaire en Europe. On met un signe d’égalité entre la souveraineté nationale et le nationalisme des abrutis chauvins, et on les rejette tous deux ensemble. Je comprends cela, parce que la souveraineté nationale est invoquée dans l’histoire de l’Europe par les classes dominantes, c’est-à-dire par les bourgeoisies, pour donner une légitimité apparente à l’exploitation de leur propre peuple ou à leur expansion extérieure impérialiste ou coloniale. Cette souveraineté dite nationale a conduit à la guerre en 1914, et je comprends très bien que les jeunes Européens ne trouvent pas cela sympathique, si bien que tous ceux qui ont à cœur la défense des intérêts des classes laborieuses voient dans la souveraineté nationale l’instrument des forces réactionnaires.
Mais, pour ma part, je parle de souveraineté populaire, ce qui est différent. Pourquoi faut-il en passer par là ? Parce que le monde ne va pas changer du jour au lendemain, il n’y aura pas de révolution mondiale comme les écoliers trotskystes ont pu le croire, qui commencerait aux États-Unis pour s’emparer du monde. Je n’ai jamais cru à ces bêtises-là. Le monde se transforme par avancées inégales, à partir de la base. Or la base, que cela nous plaise ou non, c’est l’État. La France, elle existe ; l’Allemagne existe ; l’Europe, ça n’existe pas. Il n’y a pas de solidarité européenne. Un Français n’acceptera jamais une assemblée européenne où il serait totalement minoritaire, un Allemand pas plus, ni même un Scandinave. C’est-à-dire que la transformation ne peut se faire que dans les frontières des États tels qu’ils sont, qu’ils nous plaisent ou qu’ils ne nous plaisent pas.

Ce sont donc des avancées inégales. À ce moment-là, la souveraineté devient une souveraineté populaire de défense de ces avancées face à l’offensive des forces réactionnaires. Et on l’a vu dans l’histoire : ce n’est pas la Révolution française qui a fait la guerre à l’Europe, c’est l’Europe qui a fait la guerre à la Révolution française. Si par la suite Bonaparte en a profité pour essayer de soumettre l’Europe à ce qui restait de la Révolution française, c’est autre chose, mais c’est l’Europe qui a engagé la guerre. À Valmy, ce ne sont pas les Français qui sont allés attaquer les Autrichiens et les Prussiens, c’est l’inverse. C’est la même chose pour la Russie. Il n’y a jamais eu de guerre civile. Après octobre 1917, 80 % de la population a soutenu 1917. C’est l’intervention militaire étrangère qui a semé le trouble, car une intervention militaire étrangère trouve toujours des alliés, comme l’intervention contre la Révolution française a trouvé les Vendéens. Et c’est à ce moment-là qu’on a besoin d’une souveraineté populaire pour défendre ces avancées.
Vous suggériez que la réticence à l’échelle nationale est typiquement occidentale ?
Cette stratégie, qui apparaît comme inacceptable en Europe, est une chose très banale dans le Sud. Elle structure d’abord la reconquête de l’indépendance, qu’elle soit militaire ou parfois moins violente. Et il faut ensuite la défendre pour pouvoir avancer, même si cette avancée est modeste. Je donne toujours un exemple : en 1960, au Congo belge, il y avait neuf – pas dix ! – Congolais à peau noire qui avaient fait des études supérieures, six religieux et trois civils – je n’ai jamais su, ou j’ai oublié, s’ils étaient deux médecins et un avocat ou deux avocats et un médecin. Après trente ans d’un des plus odieux régimes de l’Afrique et du monde, celui de Mobutu, aujourd’hui, il n’y en a pas neuf, mais trois millions. Donc le pire régime a fait des milliers de fois mieux que la belle colonisation.
Ceux qui ont mon âge et qui ont connu des parties du tiers-monde de l’époque de mon enfance savent que ça n’a plus rien à voir avec aujourd’hui. Et ce qui existe aujourd’hui, les peuples du Sud ont dû le conquérir, on ne le leur a pas donné, rien n’a été donné. La souveraineté nationale est ambiguë, parce que c’est celle des classes dirigeantes locales, mais ces classes dirigeantes peuvent être « progressistes », et le terme a un sens si elles font progresser le pays, si elles introduisent un changement utile et nécessaire, même partiel. Voilà donc comment je définirais la souveraineté populaire.
Et je dis : il en sera de même en Europe.
Les Grecs ont été à un doigt de pouvoir le faire. Ils ont échoué à cause d’une contradiction interne : les Grecs étaient, et sont toujours, contre l’austérité – cette austérité criminelle qui leur est imposée avec des milliards de cadeaux aux banques européennes du Nord –, mais en même temps ils se font des illusions sur l’Europe. Les mêmes 70 % qui ont voté, avec Tsipras et Syriza, contre l’austérité, croient qu’il suffit de dire aux Européens : « vous devez faire comme nous », pour que les Européens se mettent à faire comme eux. Mais les Européens n’ont pas choisi de faire comme eux, ils ont choisi de les massacrer – et je ne parle pas seulement des Allemands, les Français ont été complices, comme les Italiens et les autres. Mais il y a un pays qui, en Europe, à mon avis, a de meilleures chances que la Grèce : je pense que la France pourrait amorcer un mouvement. À condition qu’une gauche radicale y renaisse.
Cette stratégie politique nationale a un versant économique que vous avez décrit dans La Déconnexion.

Oui, dans le Sud, cette stratégie a un versant économique. Comme je le dis toujours, la pensée sociale utilise des mots du langage commun et il faut faire attention au sens qui leur est donné, car si on ne se donne pas cette peine, on pourrait penser que la déconnexion consiste à couper tous les liens et à s’en aller sur la lune, à couper tout commerce et toute relation avec tout le monde. Ce n’est pas du tout ce que j’entends. La déconnexion consiste à tenter de renverser le rapport de la périphérie au centre.
Je l’ai écrit très tôt, c’est même dans ma thèse : le processus historique de polarisation périphérie-centre est un processus d’ajustement structurel (j’ai utilisé le terme cinquante ans avant la Banque mondiale !), un processus d’ajustement structurel permanent des périphéries aux exigences de l’accélération et de l’approfondissement de l’accumulation dans les centres. C’est-à-dire qu’on demande aux Congolais de s’ajuster aux besoins des Américains, mais pas aux États-Unis de s’ajuster aux besoins des Congolais.
La déconnexion, c’est tenter de renverser le rapport, c’est-à-dire contraindre le dominant, l’impérialiste, à reculer. Si on peut le battre, c’est tant mieux, mais il s’agit au moins de le contraindre à reculer et à s’ajuster, même partiellement, à nos avancées à nous.
Samir Amin
La déconnexion, c’est tenter de renverser le rapport, c’est-à-dire contraindre le dominant, l’impérialiste, à reculer. Si on peut le battre, c’est tant mieux, mais il s’agit au moins de le contraindre à reculer et à s’ajuster, même partiellement, à nos avancées à nous. C’est cela, la déconnexion. Elle prend des formes historiques différentes, selon l’époque où elle a eu lieu. On a connu par exemple la déconnexion soviétique et la déconnexion chinoise, qui ont été d’abord contraintes, puisque le blocus leur a été imposé. Mais dans tous les cas, la déconnexion est un effort pour renverser la logique du système, pour avancer, pour réduire la polarisation et donc se donner des chances d’avancer. La déconnexion aujourd’hui consiste à refuser le statut de sous-traitant, sous-traitant industriel pour certains pays d’Amérique latine, industriel aussi pour l’Inde, mais pas seulement, puisque les services informatiques des États-Unis et de la Grande-Bretagne surtout sont transférés en Inde.
Donc la déconnexion n’implique pas d’interrompre les rapports commerciaux avec le centre ?
Pas du tout ! Mais ça implique d’obtenir un certain degré de contrôle.
Quelles sont alors les mesures prioritaires ?
Il n’y a pas de recette toute faite. Il faut avoir un minimum de cohérence et d’efficacité, et connaître les limites du possible. Ces limites dépendent de beaucoup de choses : de l’histoire du pays, de la nature du bloc social dirigeant, de la taille du pays, etc. La Chine le fait aujourd’hui. Contrairement à ce qu’on dit, la Chine n’est pas complètement soumise à la mondialisation. Elle y participe, mais pas à la mondialisation financière. Elle contrôle la mondialisation, ou tente de la contrôler, bien qu’elle rencontre des limites. Le cas chinois est, par exemple, complètement différent du cas égyptien, puisque les deux pays n’ont pas du tout la même histoire.
Vous faites référence à l’Égypte actuelle ?

Oui. Un projet de politique alternative a été écrit, pour rassembler au-delà de la gauche, et cela serait une amorce de déconnexion partielle. J’ai publié, avec d’autres, des articles entiers à ce sujet, avec des propositions très concrètes. Le projet a été longuement discuté avec les syndicats. Il portait sur les niveaux de salaire, sur les droits des femmes, les droits à une retraite modeste, mais réelle, etc. Il a été discuté également avec la petite bourgeoisie, même si je n’aime pas le terme, avec les travailleurs aisés des professions libérales, avec les syndicats et les organisations de médecins, d’avocats, d’enseignants, etc. C’est le côté démocratique, celui des droits civils et humains, qui les intéresse davantage que la question économique. Un projet de cette nature doit donc articuler un ensemble de questions, et la déconnexion, c’est l’ensemble de ces choses.
Dans le cas de l’Égypte, qu’impliquerait un tel projet pour les relations économiques internationales ?
Pour l’Égypte, il faudrait peut-être cesser de dépendre des fonds de l’Arabie Saoudite et des pays du Golfe. Il faudrait sans doute accueillir certaines industries sous-traitantes financées en partie par l’Occident (particulièrement européen, mais les Européens sont trop bêtes pour le faire).
Cela impliquerait de développer une industrie manufacturière à l’intérieur du pays ?
Bien sûr. Ça implique toujours cela. Au moins pour les pays, disons, moyens. Peut-être que pour les pays minuscules c’est un peu différent.
Puisque vous parlez de l’Égypte, pourriez-vous revenir sur la période de votre enfance ?

J’ai raconté mon enfance et mon adolescence dans mes mémoires. La population scolarisée de l’époque était partagée. 40 %, dont j’étais, se proclamaient communistes, ce qui voulait dire : il faut foutre dehors le roi, les féodaux, les Anglais et le capitalisme, et faire comme les Russes. 40 % se proclamaient nationalistes : il faut foutre dehors les Anglais, point final. Et 20 % n’avaient pas d’opinion : ces 20 % étaient considérés par les 80 % comme des êtres humains inférieurs, totalement méprisés. Entre communistes et nationalistes, on se bagarrait tous les jours : violence verbale, et parfois même violence tout court. Voilà ce qu’était ma formation. Évidemment, les communistes égyptiens ont vu que j’étais mûr pour être une recrue rapide, ce que j’ai été.
Plus tard, vous vous confrontez au nassérisme.
Je suis rentré en Égypte en 1957 après avoir fini ma thèse. Il y avait alors une vraie lune de miel entre les communistes égyptiens et Nasser. Il a créé des institutions pour gérer le secteur public à partir de la nationalisation des capitaux français, britanniques et belges. J’ai décrit cela dans mes mémoires, et dans un autre livre paru sous le titre de Nassérisme et communisme. J’étais très critique de cette alliance, mais je l’ai acceptée jusqu’aux grandes arrestations. À ce moment-là, j’étais dans la forte minorité pro-maoïste, et j’ai dû m’exiler pour éviter la prison.

Avec le recul, que pensez-vous aujourd’hui du projet nassérien ?
Je pense que le projet nassérien s’est épuisé très rapidement. La réforme agraire a détruit la grande propriété foncière qui était un bastion de l’ancienne bourgeoisie, mais a renforcé le capitalisme agraire. Le secteur industriel d’État a connu une croissance rapide, mais désordonnée. Et tout cela était associé à un manque de démocratie, non pas parce qu’il n’y avait pas d’élections, mais parce que les syndicats ont été mis au bas et que le parti communiste et toutes les organisations populaires ont été systématiquement réprimés. De cette manière, le nassérisme préparait sa propre défaite. Il se rendait aussi incapable de faire face à Israël, non seulement militairement mais aussi politiquement. C’est le nassérisme lui-même qui explique qu’à la mort de Nasser, Sadate a dit, dans ces termes, de façon très vulgaire, qu’il voulait jeter aux ordures le socialisme, les Russes et tout ce bataclan, et devenir l’ami des Américains et du capitalisme.
Donc la bonne manière de prolonger les premières mesures de Nasser aurait été une radicalisation socialiste ?
Oui. En 1967, après la défaite militaire, le mouvement – particulièrement étudiant, mais il y avait aussi les communistes, des embryons de partis syndicaux et des embryons de partis démocratiques – était pour la radicalisation. Nasser ne l’a pas choisie. Il a pensé qu’on ne pouvait pas faire la guerre sur deux fronts, le front extérieur et le front interne. C’était faux : il fallait faire la guerre sur les deux fronts, parce que les deux fronts sont solidaires.
Comme les maoïstes en Chine l’avaient fait ?
Oui.
Quelle est votre opinion sur les événements récents, et notamment sur la chute du président Mohammed Morsi à l’été 2013 ?
Je n’ai pas du tout accueilli Morsi de manière favorable. Les Frères musulmans sont et restent les alliés fondamentaux des Occidentaux, des États-Unis et des Européens. Ces Frères musulmans n’ont pas gagné les élections, car les élections ont été falsifiées, mais l’ambassade des États-Unis a proclamé les résultats avant la commission égyptienne. Les Nassériens avaient soi-disant 200 000 ou 100 000 voix de moins que les Frères musulmans : ce n’est pas vrai. Il faut ajouter que les Frères musulmans avaient des milliards de soutiens financiers, et les Nassériens ont eu zéro. Parvenus au pouvoir avec le soutien américain, les Frères musulmans se sont mis à dos le peuple égyptien en quinze jours. La révolte contre le système théocratique musulman en Égypte a été immédiate et générale.
La manifestation qui a eu la peau de Morsi, c’était une manifestation de trente millions de personnes. Le chiffre est vrai. Ce qui est incroyable, c’est que lorsque quatre cents Frères musulmans manifestaient en Égypte, les médias occidentaux disaient : « grande manifestation des Frères musulmans » ; et lorsqu’il y a eu trente millions de manifestants, ils ne l’ont pas même mentionnée. Il faut le faire ! À ce moment-là, l’ambassadrice des États-Unis a téléphoné au chef de l’armée en lui disant qu’il fallait soutenir Morsi. Sissi a été assez intelligent pour comprendre qu’il serait battu. Il a raccroché en disant : « je sais ce que je fais ». Et il a alors fait une proclamation publique : « Je suis avec vous, peuple égyptien, et je vais déposer militairement Morsi. », ce que la manifestation civile ne pouvait pas accomplir.
Bien sûr, il a gagné là une popularité fantastique. J’ai vu venir la catastrophe : il allait devenir populaire, et il l’était déjà, ce qui était normal, car les gens se disaient « il a prouvé qu’il était avec nous, alors pourquoi ne pas lui laisser un chance ? ». Et je me disais à l’époque : tu vas voir qu’il va continuer la même politique. Et de fait, il continue la même politique de vassalité, mais au profit de l’armée sans les Frères musulmans.
Du point de vue socio-économique et à l’intérieur de l’Égypte, quelle est l’assise des Frères musulmans ?
Les Frères musulmans sont organisés, on connaît leurs chiffres : ils sont 500 000 organisés, dont 200 000 militairement. Et en dehors de cela, ils ont une influence morale à travers un discours démagogique pro-islamique, influence très importante dans les campagnes sur les paysans riches qui sont vraiment leurs alliés, et dans les villes sur les fractions arriérées de la petite bourgeoisie intellectuelle.
Pensez-vous que l’islam politique reconduit toujours en définitive à un alignement sur l’impérialisme ?
Oui.
Vous ne pensez pas qu’un anti-impérialisme islamiste est possible ?
Non. Jamais. Ils sont super libéraux. Leur blabla est amusant à lire. C’est l’Arabie saoudite qui est leur vrai exemple. Pour eux, le marché, c’est une chose magnifique ; le marché mondial, c’est positif ; le libéralisme, c’est magnifique ; il fabrique des pauvres, mais c’est la faute des pauvres eux-mêmes. Il donne surtout des occasions de s’enrichir par le travail. L’ennemi, c’est la culture et la religion chrétiennes. Moi, j’ai appelé ce discours le fascisme des pauvres. C’est une des versions du fascisme, mais c’est la version pauvre.
Le Hezbollah libanais ne constitue-t-il pas un contre-exemple ?
Alors, c’est très curieux, parce que le régime iranien et celui auquel aspire le Hezbollah ne valent pas mieux que celui des wahhabites d’Arabie saoudite. Leur conception du monde et de la gestion de la société ne vaut pas mieux, mais ils sont dans une géo-stratégie différente. Ils se trouvent être – peut-être contre leur volonté – les ennemis d’Israël et des États-Unis. Alors, on les vilipende ; en revanche, ceux qui sont aux côtés d’Israël et des États-Unis, ils sont merveilleux.
Ils sont dans une situation ambiguë. Ils sont anti-impérialistes par la force des choses, parce que l’impérialisme ne veut pas d’eux. Si l’impérialisme acceptait que l’Iran soit la pièce maîtresse dans la région, ce régime ne dirait pas non ! Mais on leur dit que la pièce maîtresse, c’est l’Arabie saoudite.
Puisque vous parlez de l’Iran, que pensez-vous de sa situation politique actuelle ?
Je ne sais pas ce qu’il va s’y passer. Le pire serait un coup d’État pro-libéral et pro-occidental, qui n’est pas impossible. Cela a toutefois peu de chances d’arriver, parce que le Golfe est leur ennemi et empêche cela. Le nationalisme iranien est positif, car il offre une résistance à cela. L’autre option, c’est celle d’un adoucissement des mœurs et des lois dans les faits tout en gardant les formes du régime islamique. C’est un peu un choix à la Brejnev, ce n’est pas un choix qui conduit très loin, mais c’est sans doute le choix de la classe dirigeante au pouvoir à l’heure actuelle.
Pour revenir à la déconnexion, l’exemple qui est aujourd’hui dans tous les esprits, d’un pays qui a voulu suivre une trajectoire économique originale, est celui du Venezuela.
Ah, le Venezuela ! Le Venezuela est une victime du pétrole. (Et cette dépendance ne vient pas de Chavez, elle remonte bien avant.) C’est le pétrole qui a détruit le Venezuela comme société et comme économie. Il n’y avait plus rien, ni industrie ni agriculture. On vendait du pétrole, et avec la rente pétrolière, on achetait tout. 80 % des produits manufacturés sont importés, et presque tous les produits alimentaires. Il n’y a plus du tout de paysannerie, hormis quelques Colombiens à la frontière avec la Colombie.
Avant Chavez, les bénéficiaires de cette rente étaient principalement les riches locaux. J’ai visité le Venezuela avant et après Chavez, et je peux témoigner. Chavez a hérité d’une situation, et si on considère la société et l’économie qu’il a construites à partir de là, on peut dire qu’il a fait des choses magnifiques et très difficiles. Avec l’aide de Cuba, ils ont développé l’éducation, contre l’illettrisme qui était dominant, ils ont développé la construction immobilière populaire et la santé. Mais au niveau productif, ils ont très peu avancé. Ils n’ont pas vraiment eu le temps. Il aurait fallu, pour qu’un système comme celui de Chavez puisse donner des résultats, vingt ans de paix, et on leur a livré une guerre permanente. Y compris en Europe, où l’on a raconté que ce n’était pas une démocratie, patati patata, ce qu’on ne reproche pas à l’Arabie Saoudite ou à d’autres pays.
L’échec de la stratégie de déconnexion du chavisme, c’est donc de ne pas avoir utilisé la rente pétrolière pour développer l’appareil productif ?
On ne peut pas parler d’échec. On peut parler d’avancées très insuffisantes, parce qu’elles ont été faites dans des conditions très difficiles et avec des ennemis très puissants. D’ailleurs, le Brésil a joué un sale rôle là-dedans, parce qu’il était le seul pays à pouvoir aider objectivement, et ne l’a pas fait – il le fera encore moins aujourd’hui, avec son régime actuel qui est ignoble.
La déconnexion n’a-t-elle pas plus de chances de fonctionner dans les grands pays ?
Elle est certainement beaucoup moins difficile pour un pays comme la Chine, elle serait beaucoup moins difficile pour un pays comme l’Inde ou comme le Brésil, que pour le Sénégal ou la Gambie. C’est presque une banalité.
Mais alors, pour les nations isolées, est-ce que cela n’implique pas de chercher des alliances ?
Oui, il faut chercher des alliances. C’est là que les non-alignés, à l’époque, ont été très utiles. Tous les États africains avaient adhéré au non-alignement, et cela leur a rendu service. J’en donne un exemple : grâce aux non-alignés, depuis Léon Mba, avant même Omar Bongo, le Gabon a eu une part importante sur la rente issue de son pétrole. Il a fait de cette rente l’usage qu’il a voulu – y compris d’acheter des politiciens français et de payer Giscard –, mais il l’a eue. Il aurait pu s’en servir pour un autre développement, voire même pour un développement régional et pas seulement gabonais.
Pour faire fonctionner la déconnexion, il faut chercher des alliances.
Samir Amin
La preuve est donnée a contrario : le non-alignement ayant disparu, le Niger, troisième exportateur mondial d’uranium, n’a pas de rente. Il reste un des pays les plus pauvres. Un nouveau Bandung serait requis, une nouvelle grande alliance du Sud.
Un exemple concret que vous avez étudié, c’était le panarabisme.

Le panarabisme, comme le panafricanisme, sont, en un sens, porteurs. Ce dont il faut se méfier, c’est des discours hypocrites des chefs d’État qui se déclarent tels et ne font rien du tout. L’autre risque est identitaire, que le panafricanisme devienne pannégrisme et parle de « nous, les nègres ». Je leur dis toujours : « nous, les nègres, nous ne sommes pas pires, mais nous ne sommes pas meilleurs que les autres ». Et il en va de même chose du panarabisme, qui est rapidement devenu le panislamisme en proclamant : « nous avons la meilleure religion ». Je leur réponds : « elle n’est probablement pas meilleure, pas pire non plus, que d’autres ».
Quels doivent être les principes de regroupement pour constituer ces alliances ?
D’abord, il faudrait faire des petites choses très concrètes sur le plan économique. Par exemple, quand il y a eu l’Union Mali-Guinée-Ghana (qui n’a jamais fonctionné) en 1961-1962, Modibo, qui était le chef de l’État malien, m’a envoyé personnellement négocier avec Sékou Touré et avec Nkrumah. Il s’agissait de commencer par avoir une compagnie aérienne commune, de se répartir les industries par secteur, etc. Ça a marché sur le papier avec le Ghana, mais même pas sur le papier avec la Guinée, qui voulait ne rien faire et tout faire à la fois.

Ça n’a pas marché, mais ça aurait pu, ça aurait dû marcher. Au moment de l’indépendance des colonies françaises, il y avait eu un projet de grand Mali, qui devait regrouper le Sénégal, le Mali, le Niger, la Haute Volta devenue le Burkina Faso. Cela aurait été une région capable d’avancer. Mamadou Dia, qui était le premier ministre de Senghor, en était conscient, et c’est pour cela qu’il a été en prison.
Puisque vous parlez de l’Afrique subsaharienne, que pensez-vous de sa situation aujourd’hui ?
L’Afrique subsaharienne à l’heure actuelle est dans une situation d’ensemble lamentable, parce qu’elle accepte la mondialisation inconditionnelle et n’obtient rien en retour. Par exemple, malgré l’inconditionnalité qui leur est offerte, les investissements en Afrique subsaharienne sont négligeables, inexistants, sauf dans les enclaves minières où les sols sont pillés.
Vous avez évoqué la Chine. Comment caractériseriez-vous sa position dans le capitalisme mondial aujourd’hui ?
La Chine, sur le plan de ses structures réformées internes, est un capitalisme d’État. (Cela n’exclut pas l’existence d’un capitalisme privé, mais celui-ci est mis sous le contrôle de l’État.) C’est un peu la vision de de Gaulle en 1945. Or le capitalisme d’État français n’a pas été si mauvais, c’est lui qui a fait la reconstruction de la France et l’a modernisée – et non pas Giscard, et encore moins Macron ! Et cela a été permis par un compromis historique avec les communistes, qui ont accepté d’entrer dans le jeu. C’était la triade du Comité de libération nationale : les gaullistes, la fraction de la bourgeoisie française qui pouvait dire qu’elle n’avait pas collaboré, et les communistes.
La Chine est donc un capitalisme d’État, à tendance sociale. Je ne dis pas socialiste. Elle a conservé la propriété d’État de la terre, elle a conservé le principe de l’accès au sol de toutes les familles paysannes théoriquement sur un pied d’égalité, elle a conservé une planification réelle assurant, avec des hauts et des bas, l’équilibre entre les villes et les campagnes et des niveaux de vie comparables, assurant le plein emploi même avec des travailleurs urbains surexploités, assurant le contrôle par des politiques économiques (et pas par des moyens bureaucratiques et policiers) de la migration campagne-ville, etc. La Chine a construit en vingt ans la moitié de l’Europe : 200 millions d’habitants urbains. Et quand on va dans les villes chinoises qui ont conçu ces 200 millions, on trouve que ce n’est pas si mal.
Vous pensez que c’est toujours dans cette direction de capitalisme à tendance sociale qu’avance la Chine actuellement ?
Je crois que c’est vraiment, avec beaucoup de lucidité, la vision de Xi Jinping. J’en ai discuté avec les Chinois. Dans le Parti communiste, il y a la gauche qui voudrait aller plus loin, il y a la droite qui, évidemment, est très forte et qui voudrait aller vers un capitalisme classique, et il y a un centre très puissant. C’est sur ce centre que s’appuie Xi Jinping.
Dans Pour un monde multipolaire, vous souligniez en effet que la Chine hésitait entre ces trois scénarios.
En effet, elle gère une association contradictoire, et jusqu’à présent elle ne le fait pas si mal. Elle participe à la mondialisation commerciale, à la mondialisation des investissements, mais pas à la mondialisation financière. Les banques, en Chine, sont toutes des banques d’État chinoises. Et le yuan n’est pas une devise flexible sur le marché : le taux est décidé par la Chine. Le résultat, c’est que, mesuré en parité de pouvoir d’achat, le PIB chinois fait 18 % du PIB mondial, et mesuré en dollars courants ou en yuans courants, 16 %. La différence est très petite. L’Inde, qui participe à la financiarisation mondialisée, pèse 8 % en parité de pouvoir d’achat, mais seulement 1,2 % en dollars courants. Rentrer dans la mondialisation financière, c’est accepter l’accumulation par dépossession, à travers des dévaluations permanentes et continues qui permettent d’acheter pour une bouchée de pain des actifs locaux.

N’est-il pas un peu étrange de parler de déconnexion pour la Chine, qui s’est développée en s’ouvrant aux capitaux étrangers sous Deng Xiao Ping ?
Oui et non. Deng Xiao Ping pensait que le principal était la réforme de l’organisation rurale et son articulation à l’industrialisation, avec des villes ouvertes pour l’exportation. La décennie qui a suivi Deng Xiao Ping, les années 1990, a été désastreuse. À cette époque, le taux de croissance des industries d’exportation était très supérieur au taux de croissance général et au taux de croissance de l’industrie d’une manière générale. Cela a commencé à être corrigé à partir de 2000, et cela l’a été très bien à partir de 2006 et de Xi Jinping. Les taux de croissance industriels des huit provinces du Centre et de l’Ouest sont désormais supérieurs au taux de croissance de l’industrie chinoise dans son ensemble, et même de l’industrie d’exportation. L’exportation permet un financement mondial, mais elle n’est plus le moteur exclusif, ni même le moteur principal.
La Chine donne donc un exemple d’ouverture économique maîtrisée ?
Oui, c’est très amusant à voir : les capitaux étrangers vont en Chine, où on leur pose des conditions ; ils ne vont pas en Afrique, où ils seraient accueillis inconditionnellement. Airbus est un bel exemple. Le train à grande vitesse en est un autre, avec Siemens. C’est-à-dire que dans cinq ans les Chinois construiront eux-mêmes leur locomotive à grande vitesse. Mais pendant cinq ans, Siemens fera de bons profits. Les Chinois font un calcul : on paye cher pendant quelques années, et ensuite on sera beaucoup plus forts. Ils l’ont fait dans l’aviation et dans l’automobile avec succès, ils sont en avance sur le solaire, ils sont à égalité sur l’informatique. Ce n’est pas rien.
Pour terminer : vous nous avez dit que vous vivez une partie de l’année à Dakar. Quelles y sont vos activités ?
Je dirige à Dakar le Forum du Tiers-monde. Comme son nom l’indique, il n’est pas seulement africain, mais aussi asiatique et latino-américain. Mais c’est une très grande chance, et les Sénégalais l’apprécient, que son siège soit en Afrique et au Sénégal. Cela permet de rééquilibrer la position africaine au sein même du Sud : l’Afrique serait davantage marginalisée sans le Forum du Tiers-monde.


