Vous montrez dans votre ouvrage La création des identités nationales que les identités nationales sont des artifices vivants de création assez récente. Pourtant cette genèse est aujourd’hui tout à fait occultée : les succès de la nation – qui a tout de même accompagné le passage à la démocratie moderne dans bien des États européens – auraient-ils largement dissimulé son artificialité ?
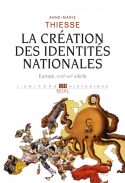
Je serais pour ma part prudente avec la notion de mythe et d’artificialité du national. On a souvent l’idée que l’idée nationale est fabriquée, fausse, et qu’il faut l’éliminer. Ce n’est pas le cas. Quand j’ai travaillé sur le concept de création des identités nationales, j’ai insisté sur le fait qu’il s’agissait de constructions historiquement datables, de processus qu’on pouvait observer et analyser, qu’ils n’étaient pas isolés mais assez largement transnationaux. La plupart des analystes des questions nationales depuis maintenant vingt ou trente ans sont amenés à souligner que le terme de nation, pris dans le sens actuel, politique et culturel associant la nation avec l’idée de l’État, est assez récent. Cette notion ne faisait absolument pas sens au Moyen Âge ni même à l’époque moderne : elle ne commence à faire sens qu’à la fin du XVIIIe siècle et à développer sa signification actuelle au XIXe siècle. Les nations ne commencent pas avant ce moment-là, même si, par ailleurs, on peut constater que les nations ont dès lors produit leur propre histoire, qui, elle, remonte à des périodes bien antérieures. Il y a donc une sorte de disjonction entre la véritable émergence des nations au sens moderne et les origines qu’elles se donnent. La véritable question historique qui se pose est la suivante : pourquoi y a-t-il cette divergence ?
Le terme d’artificialité est donc à nuancer selon vous ?
Oui, car l’artificialité suppose la manipulation, or cette idée nationale a un sens. Et c’est d’autant moins une manipulation que cela a très bien fonctionné et que cela fonctionne toujours. Mais il est vrai que c’est un problème pour les historiens, qui doivent expliquer que les origines des nations divergent de ce qu’on apprend dans les histoires nationales, sans pour autant dire que le phénomène national soit une pure absurdité ou une sorte de mensonge à éliminer. La nation est tout de même le fait politique majeur de la période contemporaine, à tel point qu’il s’est universalisé. Nous vivons et nous sommes formés dans un monde d’États-nations, y compris intellectuellement. C’est pour cela que la perspective d’histoire transnationale est aussi difficile que stimulante puisqu’elle remet en question nos cadres de pensée usuels.
« La nation est tout de même le fait politique majeur de la période contemporaine, à tel point qu’il s’est universalisé. »
Anne-marie thiesse
Vous avez commencé à parler de « cosmopolitisme du national » avant même que l’histoire transnationale soit aussi largement répandue. Comment ce concept, cet oxymore, peut-il s’adapter aux pays d’Europe centrale, où certains hommes politiques font appel de manière très vivace à l’État-nation ?
Deux des démons de l’historiographie sont l’anachronisme et la téléologie. On court le risque de ne comprendre le national qu’à partir de ce que nous en savons après deux guerres mondiales. Quand l’idée nationale se forme au début du XIXe siècle, on est loin d’imaginer les deux guerres mondiales et le nazisme.
Si j’ai forgé l’expression de « cosmopolitisme du national », c’était pour expliquer ce que j’essayais de montrer dans mon livre, à savoir que ces références identitaires, ces éléments des cultures nationales modernes, n’ont pas été forgés de manière isolée mais à travers tout un espace de transferts, d’échanges, de copiage, d’imitations, de reproductions souvent explicites et affichées.

Dans le cas de l’Europe centrale et orientale, ce processus est évident : parmi les grandes références utilisées pour affirmer l’existence d’une nation hongroise spécifique, autonome et prestigieuse, on compte les écrits de Herder, datant de la fin du XVIIIe siècle, où il salue la naissance prochaine d’une nation hongroise et de nations slaves, qui étaient à l’époque essentiellement dominées dans le cadre de l’empire des Habsbourg. C’est donc un Allemand qui proclame l’existence prochaine de ces nations en Europe. Herder, dont on a fait après la Seconde Guerre mondiale un précurseur des Nazis parce qu’il avait été récupéré par eux, était un homme des Lumières qui essayait de penser la nation et la culture nationale dans une perspective universaliste. À partir du moment où il s’intéresse à l’élaboration et à la valorisation de la culture allemande, il pense tout ce qui existe autour.
D’une certaine manière, c’est ce que font tous ces bâtisseurs de nations en Europe : la construction de nations ailleurs en Europe légitime ce qu’ils sont en train de faire dans leur propre nation. On peut aussi évoquer l’exemple des frères Grimm qui, en plus de construire une culture nationale allemande prestigieuse, étudient des manuscrits dans toutes les langues vernaculaires imaginables de l’Europe.
J’avais aussi lancé l’idée d’un universalisme du particulier : la nation a été construite comme une catégorie universelle, dans l’idée que c’était la meilleure organisation sociale et politique possible, et qu’à terme le monde entier devrait être réorganisé selon ce modèle, même si chaque nation est une unité discrète, avec des frontières bien précises et différente des autres, mais différente selon le même standard. C’est ce que j’appelle les différences standardisées : ce standard de la spécificité nationale se construit à partir du XIXe siècle. Il n’y a donc pas d’hétérogénéité, il y a des catégories homogènes avec, à l’intérieur, une déclinaison spécifique, d’où la référence à Ikea, qui permet de faire comprendre une chose difficile à percevoir, à savoir que l’universalisation n’a pu survenir qu’à partir du moment où l’on a posé cette nécessaire standardisation des différences.
Le cosmopolitisme du national fait qu’à chaque instant on se réfère à une norme du moment de l’État-nation : notre nation respecte-t-elle cette norme ? Si l’on est en avance c’est formidable, nous donnons un exemple aux autres, sinon il faut rattraper le retard. Cela se traduit par un système d’échanges intellectuels et de réalisations concrètes qui construit cet univers de nations standardisées : publications, statues, monuments historiques, construction de nouveaux monuments, de mémoriaux, célébrations dans tous les domaines durant tout le XIXe siècle.
Les nations ne sont pas hétéroclites ; le monde politique, social et culturel avant la nation pouvait l’être, il y avait tous les régimes possibles et imaginables. À partir du moment où l’on passe à l’âge des nations survient cette idée d’universalisme, caractéristique d’une pensée postérieure aux Lumières, qui suppose que certaines formes d’organisation politique et sociale sont supérieures aux autres, plus conformes au bien-être de l’humanité et doivent se répandre partout.

Benedict Anderson, dans son ouvrage Imagined Communities, dont il faut au moins lire l’introduction, fait ainsi remarquer que le principe national apparaît avec la fin de la domination des grands principes d’organisation religieux, ou du moins avec leur remise en cause sur le plan politique. Il évoque une sorte de principe de conversion au national comme il y en a dans les grandes religions de conversion que sont le christianisme et l’islam. Mais la grande différence entre l’idée nationale et les religions de conversion, c’est qu’il n’est jamais imaginé qu’il y aura un jour une grande communauté nationale qui englobera l’humanité, la nation n’est pas catholique au sens étymologique – une seule communauté pour l’ensemble de la planète. Le national, c’est un principe universel mais qui se réalise en communautés de taille limitée. J’y ajoute l’idée de la standardisation de leurs grands principes d’organisation. Il y a un mètre étalon de la nation qui n’existe pas au départ mais qui s’élabore petit à petit, par des contributions différentes.
« Le national, c’est un principe universel mais qui se réalise en communautés de taille limitée. »
anne-marie thiesse
Le nationalisme sous sa forme la plus agressive est encore très puissant en Europe centrale et médiane, notamment en Hongrie et en Pologne alors même que ces pays ne connaissent pas une situation économique particulièrement mauvaise.
Il faut rappeler que le nationalisme, comme toutes les créations humaines, se fait pour le meilleur et pour le pire : pour le meilleur, le nationalisme pose des principes comme « liberté, égalité, fraternité », la souveraineté nationale et l’indépendance. Les indépendances coloniales ont ainsi été faites en référence au nationalisme, et durant une grande partie au XIXe siècle c’est également dans le nationalisme qu’entrait la référence à la démocratie. Mais un autre nationalisme existe également, le nationalisme xénophobe, hostile au voisin le plus proche et qui considère que la nation peut être mise en danger par des infiltrés en son sein. Il apparaît essentiellement au moment où le principe national triomphe, lorsque se forment des États-nations, dans la seconde moitié du XIXe siècle et que se pose la question des frontières ou des minorités – faut-il les expulser, les convertir ?
Dans un premier temps, le nationalisme est un mouvement progressiste, il s’agit d’en finir avec l’Ancien Régime, et en 1848, les nationalismes se considèrent comme frères. Mais dès 1848 on voit que l’Assemblée nationale de Francfort, qui rêve d’une grande confédération germanique, soulève immédiatement la question du statut des Slaves, des Hongrois… Et cette tendance est de plus en plus forte au cours du siècle. L’antisémitisme prend également des formes politiques vers la fin du XIXe siècle : l’affaire Dreyfus en France fait écho à ce qui se passe dans d’autres pays. Le plus violent et antisémite des États de l’époque, c’est l’Empire russe.
Pourquoi le groupe de Višegrad existe-t-il actuellement en tant qu’alliance des néonationalismes ?
Il y a tout de même des différences entre la Pologne et la Hongrie. La Pologne renaît à partir de la fin de la Première Guerre mondiale alors que la Hongrie, qui avait son autonomie depuis 1867, perd beaucoup de territoires, notamment la Transylvanie. Les Hongrois parlaient ainsi « des Hongrois de l’extérieur », terme qui existe encore et que j’ai découvert dans les années 1990 en discutant avec un collègue hongrois qui me demandait combien il y avait de « Français de l’extérieur ». Cette notion n’a pas grand chose à voir avec les 300 000 « expats » français ! Il s’agit de Hongrois du point de vue national, c’est-à-dire linguistique et culturel, mais ayant la citoyenneté roumaine pour l’essentiel.

Un des grands motifs de l’élargissement de l’Union européenne au début du XXIe siècle, qui est peut-être moins évident aujourd’hui, visait précisément à geler ces conflits nationalistes, dont on pouvait craindre qu’ils soient du même ordre que ceux de la Yougoslavie, comme celui qui pouvait éclore en Transylvanie. Faire entrer la Hongrie et la Roumanie dans l’Union européenne, c’était en quelque sorte geler ces conflits, cette perte, ce « coup de poignard dans le dos » du traité du Trianon.
Pouvez-vous revenir sur l’histoire de ces pays et leur rapport au nationalisme ?
La Tchécoslovaquie, la Pologne et cette Hongrie très diminuée, se retrouvent après la Seconde Guerre mondiale et les régimes nationalistes qui ont collaboré plus ou moins précocement avec le nazisme, dans l’espace communiste internationaliste. Ces pays sont confrontés à une situation un peu particulière : ils n’ont pas connu le travail plus ou moins différé, réalisé en Europe occidentale en général dans les années 1960 et 1970, de réflexion sur ce qu’a été l’extrême-droite et la collaboration. Ce travail important qui n’est pas fait à l’Est va interférer avec ce qui est vécu comme l’occupation par un régime étranger, celui de l’Union soviétique, régime dit internationaliste, qui en même temps compose avec le nationalisme. Si ces pays ne réagissent pas comme nous aux questions nationalistes, c’est qu’il y a une histoire politique, idéologique et sociale à partir de 1945 complètement différente.
« Ces pays [Tchécoslovaquie, Pologne, Hongrie] sont confrontés à une situation un peu particulière : ils n’ont pas connu le travail plus ou moins différé, réalisé en Europe occidentale en général dans les années 1960 et 1970, de réflexion sur ce qu’a été l’extrême-droite et la collaboration. »
Anne-marie thiesse
À partir de 1990, le retour à l’autonomie nationale ouvre la question d’un nationalisme qui n’avait cependant pas cessé d’exister, car les régimes communistes avaient cultivé une certaine culture nationale très contrôlée. Ils accordaient beaucoup d’attention au folklore, aux cultures traditionnelles en Tchécoslovaquie, en Pologne, en Hongrie, et en Roumanie. On n’avait pas le droit au rock mais aux danses folkloriques, même s’il pouvait y avoir une espèce de rockisation de certains festivals de culture folklorique. C’était le cas en Roumanie et c’était un moyen d’introduire la modernité. On se retrouve donc dans les années 1990 avec la possibilité d’exprimer explicitement un retour à la fierté nationale et en même temps une ambivalence quant à l’entrée dans une Union européenne qui, elle-même, à ce moment-là, se pensait comme post-nationale. Il y a donc eu une très grande ambivalence.
Comment ces pays de l’Europe centrale et orientale pensent-ils leur propre histoire nationale ?
Si vous avez eu l’occasion de visiter des musées d’histoire nationale en Europe centrale et orientale communiste, vous pouvez constater que c’étaient des musées d’esprit national-communiste, qui faisaient un récit d’histoire nationale de « nos glorieux ancêtres » comme on a pu le faire un peu partout, mais avec cette différence que l’histoire de ces glorieux ancêtres, les Daces, les Huns qui avaient fondé les nations prestigieuses et résistantes, s’achevait dans le mouvement communiste et les partisans à l’été 1944. En Roumanie, Ceausescu était dans la dernière salle, de même que Hoxha en Albanie, dans le musée spectaculaire qu’il avait fait construire.
Dans les années 1990 ces musées sont entrés dans la « reconstruction » ou la « rénovation », termes assez ambigus. Il y a eu une longue période d’incertitude quant à ce qu’il fallait faire de cette histoire nationale : comment la rebâtir, la repenser ? Je me rappelle avoir visité le musée d’histoire nationale de Bucarest juste au moment où avait été décidée sa reconstruction, officiellement parce qu’il avait été ébranlé par des séismes. Il n’y avait plus que la première salle sur « nos ancêtres les Daces », dont l’existence est indubitable, puisqu’ils sont présents sur la colonne Trajane. Le reste était en reconstruction. Quelques années plus tard, à la colonne Trajane s’était ajouté 1848.

J’ai également eu l’occasion de visiter le musée de Budapest « reconstruit », à la fin des années 1990. Il avait été repensé dans une logique d’histoire des mentalités et d’histoire culturelle et sociale : c’était non plus l’histoire d’une nation mais celle d’un territoire et des processus qui avaient eu lieu sur ce territoire. C’était donc tout à fait dans l’esprit européen occidental et progressiste, cela n’avait plus rien à avoir avec l’ancien musée des Huns sous le régime communiste, mais on avait tout de même gardé au rez-de-chaussée quelque chose sur la couronne de Saint-Étienne. Mais elle était en quelque sorte détachée du reste. Finalement, tout cela a été repris et on a vu réapparaître l’ancien récit. Que faire pour remplacer cet ancien récit ? L’entrée dans l’Union européenne a certainement gelé des conflits qui auraient pu éclater sans pour autant résoudre toute une série d’incertitudes, comme la reconstruction d’un espace politique, les changements économiques importants et puis la détermination d’un idéal pour la société et la politique nouvelle.
À part les aspects économiques, il n’y a pas vraiment eu de force de proposition ? C’est cet aspect là qui bloque ?
Oui, l’Europe entre dans la mondialisation et dans des changements économiques et financiers extraordinaires au moment où elle est elle-même en train de se reconfigurer politiquement.
Pourtant ces pays ne fonctionnent pas assez bien économiquement ?
On a l’habitude de penser téléologiquement en référence à ce qui passé à la fin du XIXe siècle et surtout après la crise de 1929, et de dire que la crise économique mène fatalement aux nationalismes. Ce n’est pas faux, mais on peut avoir une poussée nationaliste en l’absence de crise économique. Cela peut être aussi lié à des crises idéologiques, à des crises de pensée du politique et nous sommes, au XXIe siècle, dans une période semblable.
C’est justement ce que nous essayons de faire au GEG, notamment en évoquant les régionalismes (Catalogne, Corse, Pays Basque) : nous avions pensé la possibilité d’une Europe des régions qui existe en partie économiquement. Ces dernières sont représentées par des lobbys présents à Bruxelles. Le régionalisme indépendantiste d’aujourd’hui est-il une sorte de copie de ce qui a pu exister au XIXe siècle, ou est-ce quelque chose de différent ?
Ces termes sont très ambivalents : parler de régionalisme c’est un point de vue français, mais du point de vue de la Catalogne, c’est un nationalisme. Pour pallier cette ambivalence on a introduit il y a une vingtaine d’années le terme de « nationalisme sub-étatique » lorsque l’on a affaire à de vrais nationalismes au sein d’États constitués, avec des nations qui se considèrent opprimées et sous domination étrangère. Il n’y a pas de différence de nature fondamentale entre régionalisme et nationalisme : je me suis d’ailleurs intéressée à la question du national parce que j’avais commencé à étudier le régionalisme littéraire.
Au XIXe siècle, on voit se constituer effectivement des affirmations nationales : la Provence mistralienne, la Bretagne, la Catalogne et la Corse, même si c’est beaucoup moins vivant. Toutes ces affirmations se fondent sur le modèle européen : l’affirmation de l’existence d’une langue, d’une culture, la rédaction d’œuvres culturelles, la production d’une histoire. Pendant longtemps cela ne pose pas de problème, y compris à l’État français. Le Félibrige n’empêche pas, alors, Paris de dormir, pas plus que la Bretagne ! Le problème survient quand le mouvement remet en question l’existence de l’État tel qu’il est, quand cette nation réclame l’indépendance. Mais il arrive aussi, ce qui s’est passé en France, qu’à l’intérieur d’un État beaucoup de ces constructions nationales vont subsister, mais sans revendication indépendantiste, sous la forme de régionalisme. Le régionalisme est alors une déclinaison locale de l’identité nationale. Cela participe de l’idée que l’identité nationale est riche de sa diversité, et contrairement à ce que l’on croit, la IIIe République française a été très régionaliste, par patriotisme français.
Mais comme régionalisme et nationalisme se réfèrent aux mêmes catégories culturelles et historiques, la réversibilité est possible et dans certains contextes particuliers un régionalisme peut évoluer en nationalisme. C’est le cas par exemple du régionalisme breton durant la Seconde guerre mondiale où, dans des circonstances extrêmement particulières, un certain nombre de régionalistes vont affirmer un nationalisme autonomiste pronazi. Le cas de l’Écosse est également très ambigu : l’Écosse a pu être considérée comme une région prestigieuse du Royaume-Uni, puisque depuis la reine Victoria les souverains vont passer l’été à Balmoral, s’habillent en tartan et chassent la grouse. Cela fait donc partie d’un élément du patrimoine national, mais dans certaines circonstances ce régionalisme peut être réaffirmé comme nationalisme.
C’est vrai que les Écossais, proportionnellement à la taille de leur pays, ont été très impliqués dans la construction impériale…
Comme les Corses en Afrique du Nord. Les régions pauvres produisent des hommes pour la fonction publique et l’armée. En ce qui concerne la région catalane, c’est un peu différent, car c’est une région riche, et d’une certaine manière, on considère que c’est l’échec ou l’échec partiel de la construction du nationalisme espagnol, c’est-à-dire d’un pays qui reste trop longtemps, par rapport à d’autres pays européens, pris dans une version monarchique, réactionnaire, une absence de modernisation économique et surtout étatique, qui fait que la Catalogne, région riche, progressiste et industrielle, se voit comme un modèle pour l’Espagne, jusqu’à ce qu’elle constate que l’Espagne ne la suit pas et décide de s’en séparer.
C’est étonnant, car la Catalogne est tout de même le moteur de la croissance espagnole. Et sur le plan culturel, Barcelone, dans l’esprit notamment des jeunes européens, a une place plus importante que Madrid.
La Catalogne est effectivement un moteur de modernisation de l’Espagne, jusqu’à ce qu’elle décide de s’en séparer. La bourgeoisie catholique de 1900 de Barcelone pouvait se permettre Gaudi et l’avant-garde culturelle, contrairement à Madrid…
Régionalisme et nationalisme sont donc des catégories qui ne sont pas étanches, qui peuvent tantôt se confondre et tantôt se disjoindre. Dans le cas français, le régionalisme dauphinois ou angevin a existé, et continue d’exister mais ne deviendra jamais un nationalisme, contrairement aux régionalismes basque, breton, occitan, qui, au contraire, peuvent glisser dans ces catégories, même si le régionalisme nord-catalan en France a peu de chance de glisser à l’affirmation nationaliste indépendantiste.
L’Europe des régions a été mise en avant notamment dans les années 1990 : l’Europe comme structure post-nationale pourrait permettre de dépasser tous les problèmes du national, les nationalismes antagonistes et les conflits entre régions et nations… Mais dans les années 2000 on s’aperçoit que cela n’est pas possible. Il y a une réaffirmation des nationalismes d’angoisse si je puis dire, et des nationalismes d’incertitude du politique.
« Il y a une réaffirmation des nationalismes d’angoisse si je puis dire, et des nationalismes d’incertitude du politique. »
anne-marie thiesse
Tout le monde ne partait pas du même point : l’Allemagne avec sa structure fédérale très avancée était prête pour l’Europe des régions car les Länder constituaient déjà des États, alors que les régions françaises n’ont pas le même statut et restent soumises aux réformes de l’État central sans forcément être consultées… D’ailleurs les régions françaises n’ont que des logos et non des drapeaux, contrairement aux Länder.
Cela concerne beaucoup d’autres aspects : les programmes et les rythmes scolaires sont nationaux, contrairement à la scolarité allemande qui est propre à chaque Land. C’est ce qui a posé problème pour les manuels franco-allemands 1 par exemple.
Vous avez repris à Orvar Löfgren l’idée d’un « Do it Yourself » de l’identité nationale, c’est-à-dire d’un processus unique qui consiste à se trouver une histoire et des héros. Pourrait-on envisager une déclinaison de ce processus à l’échelle européenne ? Quels sont les obstacles ?
Avant la chute du mur de Berlin, l’Union européenne ne se posait pas la question de son identité, car elle se définissait jusque-là par un système économique et politique, mais cette question se pose ensuite en urgence et il n’y a plus de limites réelles ou idéologiques. Quelle est la vocation de l’Union européenne ? Qui peut y participer légitimement ? Dans un premier temps, on n’envisage d’ailleurs pas du tout d’intégrer les pays de l’Est européen : les premiers critères des forums européens sont économiques et l’Europe de l’Est en est très éloignée. Des critères idéologiques vont ensuite être introduits car la guerre en Yougoslavie modifie la situation géopolitique et que l’on essaie avant tout d’éviter la catastrophe que serait l’entrée dans la guerre civile et ethnique de l’Europe centrale et orientale.
Les Européens sont experts en construction identitaires nationales mais ils n’ont pas réussi pour l’Europe car la construction entreprise au niveau national avait trop bien réussi ! On a demandé dans les années 1990 à la génération des universitaires et intellectuels d’alors – c’était majoritairement la génération de 1968 –, de produire en urgence les éléments d’une identité européenne qui initialement n’a pas été imaginée autrement que sur le modèle national implicite : on a demandé une histoire européenne commune, des héros nationaux européens, une littérature européenne, des monuments et des valeurs. Ces initiatives ont pour beaucoup été portées par le Conseil de l’Europe et j’ai moi-même été sollicitée. On voyait dans ces discussions des années 2000 apparaître une forte différence Est-Ouest. Tout cela a produit des idées, et de nombreux livres sans pour autant réussir.
Pourquoi cet échec ?
Il n’y a rien sur le continent européen, même un arbre, même un oiseau, qui ne soit nationalement défini. Tout a été nationalement approprié, tous les événements historiques, tous les personnages, les artistes, les peintres, y compris ceux qui sont très antérieurs à l’ère nationale : Attila est hongrois, Beethoven est allemand, Léonard de Vinci est italien… Bien sûr, il y a des conflits d’appropriation : Alexandre le Grand, par exemple, est-il macédonien, est-il grec ? Les paysages et les végétaux également ont été nationalisés et symbolisés, si bien que, lorsqu’on a créé la monnaie européenne, la commande a été de dessiner de fenêtres et des ponts virtuels, c’est-à-dire des éléments d’architecture qui n’existent pas. Imaginez que le billet de cinq euros représente un monument grec et le billet de cinq cents euros un monument allemand… Cela aurait posé problème ! Le patrimoine symbolique commun européen n’est que virtuel. De la même manière, est-ce qu’on peut construire une littérature européenne qui ne soit pas une succession de chapitres de littératures nationaux ?
Ces tentatives se heurtent à de multiples difficultés : à Bruxelles, un musée européen a été construit et les Polonais récemment ont protesté contre la représentation de leur pays. Une histoire européenne, insiste le gouvernement polonais, ne peut être qu’une juxtaposition des histoires nationales. À l’Ouest, il y a encore des entreprises scientifiques qui essaient de dépasser l’échelle nationale vers le transnational européen, mais maintenant, dans le discours officiel, on exprime également qu’il est impossible de dépasser le national. Dans l’espace public français, les positions sont moins exacerbées qu’en Pologne, cependant faire entendre cette problématique au delà du monde universitaire est toujours quelque chose de très difficile.
Le XIXe siècle a consacré l’État comme le prolongement juridique de la nation. Aujourd’hui, la souveraineté étatique semble minorée (par la globalisation, les NTIC, etc.), mais le fait national demeure. Comment expliquer ce hiatus ?
Le principe de la nation au sens moderne est celui de la souveraineté. L’idée de souveraineté s’adosse aussi à une communauté de culture : c’est un corps politique souverain et une communauté de culture. Quelle est la communauté légitimement appelée à être souveraine ? Pour y répondre, l’affiliation culturelle est très fédératrice. Le mouvement national a été extrêmement fort, au XIXe ou au XXe siècle, parce qu’il mobilisait à la fois la raison et l’émotion, et parce qu’il était déterministe tout en sachant se transformer : c’est un modèle très performant. Il s’est combiné avec l’État pour former l’alliance de l’État-nation. De nos jours, l’État est très affaibli, et sa perte de puissance incite à se réfugier dans la nation, comme communauté solidaire de culture, avec toutes les ambivalences, pour le meilleur et pour le pire. Dans cette communauté, on ne délaisse pas les plus faibles, mais on en exclut tous ceux qui ne sont pas conformes.
De nos jours, on a du mal à imaginer des formes politiques autres que cet État-nation, qui a fonctionné pendant deux siècles, et qui est mis aujourd’hui en cause sans qu’on ait élaboré de nouvelles manières de penser le politique. L’Union européenne est née d’un désir de dépassement de l’État-nation en conservant le meilleur de son fonctionnement, mais on s’aperçoit qu’aujourd’hui lui fait défaut tout l’espace mobilisateur du national.
Nous avons bien un drapeau et un hymne de l’Europe…
Mais elle a aussi une devise, que vous avez oubliée : « Unis dans la diversité ». Je pense que si vous posez directement la question, peu de gens le savent. Cela dénote une identité manquante. De même, l’hymne européen n’a pas de paroles, bien qu’il y ait eu de multiples projets pour en ajouter.
Vous vous êtes toujours intéressée à la problématique linguistique comme révélatrice des fabrications nationales. Comment la langue nationale est-elle l’objet de la politique (préservation, patrimonialisation, défense contre les mots étrangers, etc.) dans les pays d’Europe centrale ?
Une grande partie des constructions nationales est passée par la construction de langues pour un territoire. Dans l’Europe centrale et orientale, cela a consisté à valoriser des langues vernaculaires, qui n’étaient ni des langues administratives, ni juridiques, ni des langues de culture, mais des langues du peuple. À partir de ces langues du peuple, on affirmait une nouvelle existence nationale. Ces opérations linguistiques de très grande envergure ont été menées, à la fois pour standardiser, codifier ces langues, et pour en répandre l’usage dans des catégories de population très différentes, avec une dimension militante. Inscrire ses enfants dans un lycée hongrois dans les années 1850, c’est un acte patriotique. De même pour ceux qui, dans les pays baltiques, se mettent à parler l’estonien ou le finnois, alors qu’ils parlent parfaitement l’allemand ou le suédois. La vitesse à laquelle ce mouvement s’est déroulé, en dix ou vingt ans, est impressionnante, et comparable avec ce qui a été réalisé avec l’hébreu en Israël plus tard au XXe siècle. En Tchéquie, on légitime vers le milieu du XIXe siècle les usages linguistiques tchèques. En Hongrie, la magyarisation se fait, au même moment, au détriment des Slaves de l’Empire.
Des usages très nationalistes de la langue se cristallisent aussi. En Hongrie, par exemple, le mot littérature se dit irodalom, un mot délibérément différent des autres racines germaniques, latines ou slaves. De même en Finnois, on désigne la littérature sous un nom totalement finnois, kirjallisuus.
À l’époque, la majorité des habitants de ces régions sont parfaitement polyglottes et multiculturels. Pendant longtemps, mes collègues d’Europe centrale et orientale avaient une compétence en matière de langue incroyable de notre point de vue occidental. Leurs capacités linguistiques nous rabaissent à peu de chose. Le nationalisme linguistique a coexisté avec un multilinguisme réel, au moins jusqu’à la fin du XXe siècle. Qu’en est-il actuellement ? Aujourd’hui, un anglais mondialisé a quelque peu remplacé cette richesse linguistique.
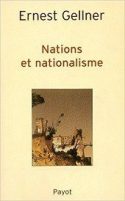
Je vous conseille de lire l’apologue des Ruritaniens d’Ernest Gellner dans Nations et Nationalisme. Il y fait un excellent portrait humoristique du nationalisme culturel dans l’empire austro-hongrois au XIXe siècle.
Comment ce multilinguisme subsiste-t-il aujourd’hui comme phénomène de masse ?
Le multilinguisme était, dans la deuxième moitié du XXe siècle, lié au fait que les grands-parents avaient été éduqués en allemand tout en étant tchèques ou hongrois. Toutes ces populations vivaient dans des contiguïtés linguistiques importantes. Le français lui-même était très présent. Une fois que les individus avaient pris l’habitude de jongler avec plusieurs langues, ils possédaient une ouverture et une mobilité que nous ne connaissons pas en France, avec notre long et douloureux apprentissage d’une, voire deux langues étrangères. Aujourd’hui il faut peut-être déplorer que les universités d’Europe centrale travaillent en anglais et proposent des cursus anglophones pour attirer des étudiants étrangers.
Un des aspects plus « insolites » de votre travail concerne le sport et le culte du corps dans le cadre de l’affirmation d’une nation. Peut-on aussi alors parler d’une Europe des sports qui se perpétue jusqu’à aujourd’hui ?
« Tous les mouvements de réforme nationale et culturelle passent aussi par une réforme du corps. »
anne-marie thiesse
Tous les mouvements de réforme nationale et culturelle passent aussi par une réforme du corps. Ce sont des problématiques relativement masculines, même si on remarque une certaine mixité dans le mouvement des Sokols tchèques, qui rassemblait filles et garçons. Il s’agit de construire la nation par des corps forts et libérés, et quelque peu homogénéisés, pour effacer les différences entre le corps souffrant tordu de l’ouvrier ou du paysan, le corps chétif du bourgeois, ou le corps entraîné à l’escrime de l’aristocrate. La fin du XIXe siècle voit aussi l’avènement du sport collectif et de la société des loisirs. Comme le dit Christophe Charle, le vrai objet européen c’est la bicyclette, constituée de mécanismes inventés dans de différents pays. Les sports d’équipe, nés dans les colleges anglais, se diffusent très vite sur le continent. On réinvente les Jeux Olympiques, qui à l’origine sont avant tout européens.
Aujourd’hui, par les pratiques sportives, et comme dans tous les domaines, les Européens sont extrêmement semblables les uns aux autres, bien plus que ne pouvaient l’être deux Français au XIXe siècle ou même deux Italiens en 1950. On est entré dans un monde où l’on a les mêmes modes de vie, les mêmes pratiques de consommation. Les pratiques de loisir, de spectacles, sont caractérisées par couche sociale, bien plus que par pays. Mais tout cela ne fait pas une identité. Ce n’est pas parce que vous ressemblez à un étranger que vous faites corps avec lui. Le corps naît de la conscience d’être identique, et cette conscience n’existe pas.
Les Européens, depuis les années 2000, sont de plus en plus proches. Prenez par exemple l’arrivée du libre-service en Europe centrale et orientale au cours des années 2000 : en réalité il s’agit presque d’une différence anthropologique fondamentale. L’Européen de l’Ouest était jusque-là surpris par ces épiceries à comptoir, aujourd’hui disparues. Aujourd’hui, bien sûr, il y a des spectacles sportifs communs, des communautés de supporters sans frontières, etc. Mais cela, je crois, ne suffit pas à créer une identité.
Ce qu’on peut aussi remarquer, c’est qu’il y a eu des quantités de tentatives pour lancer des journaux télévisés ou papier européens. Mais aucune de ces tentatives n’a été durable. De même, Arte reste une chaîne majoritairement française, relativement peu regardée en Allemagne ou ailleurs en Europe. Ainsi je crois que ce ne sont pas tant les traits communs qui nous manquent en tant qu’Européens qu’un sentiment et une conscience de notre communauté de destin.


