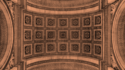Cet article est la deuxième partie d’une longue enquête, dont vous pouvez lire ici la première partie : « L’Europe » comme outil politique hexagonal : un levier d’« Archimède » pour la France ?
2ème partie : La construction européenne, miroir déformant pour la France : le malaise culturel hexagonal vis-à-vis de « l’Europe »
Si la construction européenne n’est pas toujours un outil absolument conforme aux objectifs diplomatiques de la France 1, elle apparaît aussi comme une réalité économique et politique souvent dérangeante dans notre pays, dont elle fait ressortir les spécificités, pour le meilleur et pour le pire. Notre logique nationale de projection ne donne en effet pas seulement lieu à des résultats plus ou moins satisfaisants : elle nous confronte à une « créature politique » qui nous échappe pour partie, et qui révèle à ce titre des traits culturels spécifiques.
Si ces spécificités françaises s’inscrivent dans la longue durée comme dans l’histoire des dernières décennies de la « construction européenne » 2, elles découlent aussi d’éléments plus factuels 3. On mentionnera ci-après les principales spécificités qui nous semblent nourrir le malaise français vis-à-vis de « l’Europe », et qui font pour l’essentiel écho à la prééminence de l’État dans notre culture politique : une culture politique et institutionnelle unitaire en déphasage avec l’univers pluraliste de l’UE (1) ; une vision négative du libéralisme économique, difficilement compatible avec l’Europe marchande (2) et l’ordo-libéralisme communautaire (3) ; enfin un volontarisme politique visant à la recherche permanente de compensations vis-à-vis de la construction économique européenne, sans valoriser ses fondements et ses bénéfices (4).
Notre logique nationale de projection ne donne en effet pas seulement lieu à des résultats plus ou moins satisfaisants : elle nous confronte à une « créature politique » qui nous échappe pour partie, et qui révèle à ce titre des traits culturels spécifiques.
YVES BERTONCINI, THIERRY CHOPIN
Une culture politique et institutionnelle unitaire en déphasage avec l’univers pluraliste européen
Les États membres de l’UE sont plus ou moins à l’aise au sein de l’UE, dès lors que leurs règles constitutionnelles (voir infra Tableau 4) ont un impact structurant sur la manière dont ils perçoivent et activent les mécanismes à l’œuvre au sein du système politique et économique européen. Dans ce contexte, la centralité de l’État dans notre culture politique nationale a des implications très fortes, et plutôt négatives, sur les rapports que les Français entretiennent vis-à-vis de la construction européenne.
La répartition verticale des pouvoirs : État centralisé vs. Fédération d’États-nations
Une première ligne de clivage distingue les pays membres au sein de l’UE : celle qui sépare les pays unitaires des pays fédéraux ou régionalisés. Pour les seconds, le principe même de construction d’une union composée d’entités politiques acceptant de partager l’exercice de leurs compétences ne pose pas de problèmes a priori ; à l’inverse, on comprend aisément le désarroi des pays unitaires comme la France à l’égard d’une structure politique qui disperse le pouvoir, aussi bien verticalement qu’horizontalement.

Les pays unitaires ou fédéraux entretiennent en effet des rapports plus ou moins aisés vis-à-vis des mécanismes de répartition des pouvoirs entre différents niveaux – la comparaison entre l’Allemagne et la France étant révélatrice à cet égard. Le système politique de la « RFA » repose en effet sur une conception pluraliste de la souveraineté, caractéristique des États fédéraux : elle se reflète dans l’agencement institutionnel du pays autour d’un double système de représentation qui fait une place à la représentation des États (au Bundesrat) et sur le principe de subsidiarité comme critère de répartition verticale des compétences entre le niveau central et les unités fédérées.
La centralité de l’État dans notre culture politique nationale a des implications très fortes, et plutôt négatives, sur les rapports que les Français entretiennent vis-à-vis de la construction européenne.
YVES BERTONCINI, THIERRY CHOPIN
À l’inverse, la France se caractérise historiquement par une conception moniste et unitaire du pouvoir, que traduit assez bien la notion de souveraineté « une et indivisible ». Cette culture institutionnelle, à la fois « monarchique » et « jacobine », se traduit par une passion pour l’unité et l’indivisibilité qui implique à son tour une grande réticence voire une aversion à l’égard du fédéralisme 4 comme de tout partage et transfert de compétences assimilés à une perte d’autonomie et, in fine, à une aliénation de la volonté nationale. C’est pour atténuer cette défiance que Jacques Delors a popularisé le concept de « Fédération d’États-nations », sans parvenir à apaiser un « tropisme unitaire » français qui a des conséquences sur l’acceptation hexagonale du système communautaire, dès lors que ce dernier fait précisément l’économie d’un centre de pouvoir unique.
On peut identifier une seconde ligne de clivage politique dans l’UE entre, d’un côté, les pays dont la nation a été créée par l’État, comme dans le cas de la France et, de l’autre, ceux dont la nation a pris forme via le marché (comme l’Allemagne, grâce au « Zollverein »). Les conséquences de cette genèse socio-politique sont également importantes au regard de la manière nationale d’appréhender la construction européenne. Les rapports entre les Français et l’UE sont ainsi rendus complexes dans un pays où le lien entre État et nation est très fort et où la souveraineté est placée au cœur de l’État centralisé. D’où une plus grande difficulté à assumer les transferts de compétences vers l’échelon communautaire, souvent présentés comme des « abandons » alors qu’ils relèvent d’une mise en commun ; d’où également une moindre appétence pour les règles du constitutionnalisme libéral, et donc de l’ordo-libéralisme européen, qui pose le primat du droit communautaire sur la loi française et est notamment incarné par la Cour de Justice de l’UE.
On peut enfin relever que les pays multilingues (comme la Belgique) peuvent aussi sembler plus à l’aise au sein de l’UE, dès lors qu’ils sont par nature accoutumés à la coexistence de cultures politiques diverses. À l’inverse, dans un pays comme la France, la « passion jacobine pour l’unité et pour l’État » s’est traditionnellement accompagnée de la défense de l’unité territoriale de l’État et de la disqualification de toute prétention à la représentation de la diversité des intérêts, sans oublier la promotion énergique de la langue nationale aux dépens des langues régionales et minoritaires.
Les pays multilingues (comme la Belgique) peuvent sembler plus à l’aise au sein de l’UE, dès lors qu’ils sont par nature accoutumés à la coexistence de cultures politiques diverses.
YVES BERTONCINI, THIERRY CHOPIN
La séparation horizontale des pouvoirs : Rousseau plutôt que Montesquieu
La diversité des cultures politiques nationales joue également un rôle non négligeable sur la capacité d’appropriation de la réalité du système institutionnel communautaire par les différents États membres.
À cet égard, il est tout d’abord loisible de constater que la culture « unitaire » ou « moniste » de la France tranche avec la culture des « freins et des contrepoids » (« checks and balances » dirait-on aux États-Unis) qui prévaut dans nombre d’États membres. Cette ligne de partage est structurante dès lors que le système politique communautaire fonctionne sur la base de l’interaction de multiples pouvoirs et contre-pouvoirs : un tel polycentrisme fait partie de l’ADN de l’Union, fondée sur une distribution des pouvoirs visant précisément à éviter qu’il soit sous le contrôle d’un seul acteur politique, qu’il s’agisse d’un État, d’une institution, d’un parti et, a fortiori, d’un individu. La culture politique libérale du Royaume-Uni et de l’Allemagne peut s’accommoder plus facilement d’un tel système pluraliste, même s’il heurtait le « souverainisme parlementaire » britannique. Il n’en va pas de même de notre culture politique jacobine, rétive aux contre-pouvoirs, et moins encore de notre Ve République, fondée sur la prééminence d’un « monarque républicain » auquel les Français confient leur destin, pour le meilleur et pour le pire…
Le fonctionnement de l’UE repose par ailleurs sur une logique du compromis négocié, conforme aux règles du jeu politique de la plupart des pays de l’UE, mais pas à celles du jeu politique national, où les négociations sont largement assimilées à des tractations. C’est particulièrement vrai dans la France du fait présidentiel et majoritaire, dont l’avènement a justement eu pour objectif de trancher avec l’instabilité parlementaire de la IVe République. À l’inverse, la quasi-totalité des États-membres de l’UE sont dotés de systèmes parlementaires fonctionnant sur la base d’un scrutin proportionnel (voir infra Tableau 4) et donc via des gouvernements de coalition (Allemagne, Autriche, Belgique, Pays-Bas, et pays scandinaves en particulier) : ils rencontrent naturellement moins de difficultés à accepter la logique du compromis négocié entre une pluralité de partenaires qui prime au sein des institutions communautaires, ou à tenir pleinement compte de la légitimité parlementaire, perçue comme plutôt secondaire dans notre pays.
La représentation négative du compromis en France empêche beaucoup de nos concitoyens d’accepter que les décisions européennes résultent d’accords négociés et qu’un pays, aussi « grand » soit-il, ne peut imposer sa vision aux autres 5. Cette difficile reconnaissance de la légitimité comparable des autres pays de l’UE hante notre pays depuis 2005, dès lors que les tenants du « non » critiquent le « déni de démocratie » qui aurait consisté à ne pas respecter le verdict du référendum français. Ce sont eux qui pratiquent en l’espèce le déni des autres démocraties nationales 6, dont beaucoup s’étaient prononcées en faveur du texte constitutionnel, y compris par référendum (Espagne et Luxembourg), raison pour laquelle il a fallu adopter un nouveau traité fondé sur un compromis entre tous les pays de l’UE 7.
Beaucoup de Français dénoncent le défaut de légitimité de ces institutions au motif qu’elles ne bénéficient pas de l’onction électorale quand l’indépendance de ces institutions, et notamment celle de la BCE, constitue un dogme intangible pour nombre de pays.
YVES BERTONCINI, THIERRY CHOPIN
L’existence de nombreux pouvoirs accordées à des institutions indépendantes non élues (Commission, Cour de Justice, Banque centrale européenne) est elle aussi diversement perçue par les États membres de l’UE. Elle suppose l’acceptation du principe selon lequel les institutions dotées d’une légitimité électorale ne sauraient avoir le monopole du bien public. La soumission à la sanction électorale peut de fait conduire gouvernements et parlementaires à adopter des décisions de court terme contraires à l’intérêt général, sous la pression populaire. Suivant ce principe, il est alors préférable, par exemple, de confier à des institutions indépendantes la conduite de la politique monétaire ou la régulation de la concurrence. Ce sont ces principes qui justifient par exemple l’indépendance de la BCE ou encore celle de la Commission quand elle exerce ses fonctions en matière de concurrence.
Néanmoins, beaucoup de Français dénoncent le défaut de légitimité de ces institutions au motif qu’elles ne bénéficient pas de l’onction électorale quand l’indépendance de ces institutions, et notamment celle de la BCE, constitue un dogme intangible pour nombre de pays : parmi eux l’Allemagne, pour des raisons historiques qui tiennent à l’histoire du pays dans l’entre-deux-guerres – l’indépendance de la BCE était d’ailleurs une condition sine qua non du passage à l’euro. La critique française du déficit de légitimité politique des banquiers centraux s’adressent même parfois aux membres de la Cour de justice de l’UE – alors que ni les banquiers centraux, ni les juges ne sont élus dans la plupart des pays du monde, y compris la France…
Il n’est pas fortuit que ce soit les pays du Benelux qui aient pris l’initiative du traité de Rome et de la création du marché commun, qui correspondent à leurs « ADN », alors que les Français privilégiaient le projet politique d’« Europe puissance ».
YVES BERTONCINI, THIERRY CHOPIN
Enfin, le fait que l’UE soit largement économique et repose sur un système institutionnel pluraliste très ouvert a pour conséquence de favoriser les processus d’influence et de lobbying. Or, à nouveau, il est frappant de noter que les États membres sont plus ou moins bien « armés » pour appréhender la légitimité de tels processus. Là encore, en ce qui concerne un pays comme la France, le fait que l’État prétende incarner seul la volonté générale semble rendre illégitime la représentation des intérêts particuliers – même si elle est naturellement foisonnante au niveau domestique… Il en découle une moindre reconnaissance de la légitimité du lobbying formel et informel développé au niveau européen, alors qu’il est jugé beaucoup plus normal dans les autres pays de l’Union.
La France et « le grand méchant marché européen » : un rendez-vous manqué
Les États membres de l’UE s’inscrivent plus ou moins aisément au sein de l’Europe économique qu’ils ont contribué à édifier. Il n’est pas fortuit que ce soit les pays du Benelux qui aient pris l’initiative du traité de Rome et de la création du marché commun, qui correspondent à leurs « ADN », alors que les Français privilégiaient le projet politique d’ « Europe puissance ». Notre pays a certes parfois été à l’initiative de certaines avancées économiques de la construction européenne (l’Acte Unique et surtout l’euro), mais c’était d’abord pour des raisons diplomatiques, et sans jamais parvenir à occulter sa défiance envers l’Europe économique, fût-ce lors de la parenthèse plus positive ouverte par la réalisation du marché unique sous l’impulsion de Jacques Delors.
Une forte défiance hexagonale envers le libéralisme économique
Beaucoup a été dit et écrit sur l’importance de l’État dans la formation de la France et, par la suite, dans la culture politique française 8. La tradition libérale française peine depuis toujours à s’imposer 9, y compris en matière économique. Il n’en va évidemment pas de même en Allemagne, qui a vécu l’expérience historique de la création d’un espace économique bâti comme une union douanière (le Zollverein), ou encore au Royaume-Uni, pays où la tradition libérale est plus fortement ancrée dans la culture politique. La perception des interventions étatiques est également plutôt négative dans les pays s’étant libérés du soviétisme dans les années 90.
Aujourd’hui encore, la France est l’un des trois pays membres de l’UE (voir infra Graphique 1) dans lesquels la part des personnes interrogées considérant que le libéralisme est une mauvaise chose est la plus importante (40 % contre 28 % en moyenne au sein de l’UE) 10. L’expression même de « libéralisme « et ses avatars (« ultra », « néo », ou « social-libéralisme ») sont des notions que bien peu osent revendiquer dans le débat public hexagonal, et qui sont souvent évoqués sous couvert d’excommunication de ceux à qui ils sont appliqués, y compris dans le cadre des controverses sur l’UE. Dans ce contexte, le « non » français de 2005 a été pour partie un rejet des « 4 libertés » proclamées par le Traité de Rome, auquel il a été reproché d’avoir conduit à l’avènement jugé funeste du libre-échange européen 11.
Sur le plan des faits, ces dernières décennies, la France a certes accepté les règles de l’économie de marché et de l’ouverture européenne et internationale, elle en a même tiré parti en termes de croissance et d’emplois. Néanmoins, les changements de fait précèdent de beaucoup l’évolution des représentations : à cet égard, il est notable que la France est le pays de l’UE où la défiance vis-à-vis du marché et des processus de libéralisation est la plus forte. Il est même possible que les représentations culturelles ne s’ajustent pas à la réalité factuelle : ainsi nombre de Français affichent leur rejet de la « concurrence libre et non faussée » évoquée par les Traités européens, alors qu’ils en profitent chaque fois que possible pour améliorer leur pouvoir d’achat et de choix.
Les représentations culturelles ne s’ajustent pas à la réalité factuelle : ainsi nombre de Français affichent leur rejet de la « concurrence libre et non faussée » évoquée par les Traités européens, alors qu’ils en profitent chaque fois que possible pour améliorer leur pouvoir d’achat et de choix.
YVES BERTONCINI, THIERRY CHOPIN
La France est dès lors l’un des rares pays où la mondialisation économique est vécue comme une « contrainte », et non comme une donnée de fait ou comme une source d’opportunités (voir infra Graphique 2). Il est fatal que cette vision particulière réactive la figure de l’État tutélaire, dont les responsables sont appelés à accorder leur protection aux Français face à un monde hostile, en contrepartie de leur allégeance et de leurs suffrages – dans un face-à-face où se nouent l’alliance symbolique entre notre système politique monarchique et notre aversion à la mondialisation économique. Tout comme il est fatal que « l’altermondialisme hexagonal » rejaillisse sur la perception française des apports passés et présents du « grand marché européen » et des accords commerciaux conclus par l’UE – dans un décalage frappant avec la plupart de nos voisins européens.
Un consommateur introuvable dans le débat européen français
Le rôle central de l’État dans la vie économique en France et l’audience limitée de la culture libérale semblent expliquer pourquoi la figure du consommateur occupe une si faible place dans la culture politique française, tandis qu’il est au cœur de la culture politique des pays dits « libéraux », notamment anglo-saxons. Cette divergence structure les représentations que les citoyens de tel ou tel pays peuvent avoir de l’Union européenne. Combien des praticiens et partisans français de la construction européenne osent-ils défendre les bienfaits du marché unique et de la concurrence, notamment en matière de baisse des prix pour les Français les plus humbles ? L’Europe étant d’abord un grand marché bénéficiant aux consommateurs, il est somme toute difficile de la défendre en s’interdisant de souligner son impact positif en matière de pouvoir d’achat.
De fait, les Français ne raisonnent guère en consommateurs lorsqu’ils participent au débat politique sur « l’Europe » : s’ils adorent la concurrence dans leur vie quotidienne et dans les faits, ils n’aiment pas la représentation de la concurrence (voir infra Graphique 3). Pascal Lamy a relevé cette spécificité nationale : « Nous n’avons pas le niveau de culture économique permettant de peser correctement – dans la même personne – le consommateur par rapport au travailleur » 12. Encore faut-il ajouter que la focalisation française sur les travailleurs découlent aussi d’éléments très factuels : avec un taux de chômage durablement élevé depuis trop longtemps et l’angoisse provoquée par une éventuelle perte d’emploi, nombre de nos compatriotes se déterminent d’abord comme des travailleurs en danger plutôt que comme des consommateurs avisés, surtout quand sont annoncées des libéralisations européennes, qu’elles soient internes ou externes.
Les Français ne raisonnent guère en consommateurs lorsqu’ils participent au débat politique sur « l’Europe » : s’ils adorent la concurrence dans leur vie quotidienne et dans les faits, ils n’aiment pas la représentation de la concurrence.
YVES BERTONCINI, THIERRY CHOPIN
Le fait que le marché soit mal perçu dans un pays colbertiste comme la France a aussi un impact très négatif sur la représentation que maints Français ont de la politique de concurrence (voir infra Graphique 3). Celle-ci y est en effet traditionnellement plus mal perçue que dans la plupart des autres États membres de l’UE, alors qu’elle vise à protéger les consommateurs des pratiques commerciales déloyales (au travers de la lutte contre les cartels) et les abus de position dominante (via le contrôle des concentrations). Les Français semblent souvent se représenter la politique européenne comme une entrave à l’émergence de champions industriels, là encore sans souci des prix élevés qu’ils pourraient pratiquer, et encore moins des aides d’État dont ils pourraient bénéficier. Ces positions dominantes place le débat français sur la concurrence européenne dans une position relativement périphérique au regard du consensus établi sur le sujet au moment de la signature des traités communautaires, mais aussi dans maints pays de l’UE.
Tous ces éléments concourent au succès du discours traditionnel de protection du modèle social français et à l’usage récurrent à la thématique de « l’Europe qui protège », non pas seulement en matière de sécurité collective, mais aussi en matière économique et sociale.
Un tel protectionnisme hexagonal est parfois non dénué de relents xénophobes, comme ce fut le cas lors du débat de 2005 sur la directive européenne de libéralisation des services dite « Bolkestein ». La figure du « plombier polonais » a en effet été utilisée alors pour laisser entendre que la main d’œuvre des nouveaux États membres allait venir s’emparer du travail des Français. Là encore, on peut souligner que ce rejet instinctif cohabitait sans dommage apparent avec le constat récurrent que les plombiers sont particulièrement chers et peu disponibles dans notre pays – la réalité concrète et l’univers des représentations semblant vivre dans deux mondes parallèles.
Cette défiance vis-à-vis de la promotion de la liberté de circulation est réapparue lors du débat récent sur les travailleurs détachés, nonobstant l’intérêt que leur venue représente du point de vue des entreprises et ménages français donneurs d’ordre.
YVES BERTONCINI, THIERRY CHOPIN
Cette défiance vis-à-vis de la promotion de la liberté de circulation est réapparue lors du débat récent sur les travailleurs détachés, nonobstant l’intérêt que leur venue représente du point de vue des entreprises et ménages français donneurs d’ordre. Ce débat récurrent aura confirmé que, du point de vue des représentations, beaucoup de Français demeurent sur une position hostile vis-à-vis de la concurrence européenne, symbolisée par l’agriculteur espagnol et le plombier polonais hier et le travailleur détaché aujourd’hui, en attendant le maçon des Balkans demain – y compris lorsqu’ils n’ont pas à subir leur concurrence directe en tant que travailleurs…
La prédilection hexagonale pour la dépense publique face à l’ordo-libéralisme européen
Autre contrepartie du stato-centrisme dominant la culture politique française, la préférence hexagonale française pour les dépenses publiques constitue un troisième point de friction urticant dans les relations entre notre pays et la construction européenne.
Non que les Traités communautaires fixent le niveau de ces dépenses publiques, qui culminent à plus de 55 % du PIB en France, contre 47 % en moyenne dans les 19 pays de la zone euro, et moins de 40 % dans sept d’entre eux : nos engagements européens portent en effet sur la limitation des déficits liés aux décalages dépenses/recettes, non sur le niveau global de ces dépenses et recettes, et encore moins sur leur nature et leur répartition.. Pour autant, la dénonciation des « carcans » et « dogmes » imposés par l’ordo-libéralisme européen fait partie des lieux communs du débat français sur « l’Europe », au prix d’un décalage contreproductif avec le débat en vigueur dans de nombreux autres États membres.
Autre contrepartie du stato-centrisme dominant la culture politique française, la préférence hexagonale française pour les dépenses publiques constitue un troisième point de friction urticant dans les relations entre notre pays et la construction européenne.
YVES BERTONCINI, THIERRY CHOPIN
Le pacte de stabilité et l’introuvable « dogme des 3 % »…
La prédilection française pour les dépenses publiques s’exprime en creux à chaque fois que le « pacte de stabilité » européen 13 est mis en cause, alors même qu’il formalise des engagements nationaux pris lors du référendum de Maastricht.
Lionel Jospin et Jacques Chirac se sont ainsi mobilisés en 1997 pour l’adoption d’un pacte de stabilité « et de croissance », comme s’ils refusaient d’endosser la paternité de la seule stabilité, le même Jacques Chirac se battant ensuite pour obtenir « l’assouplissement » de la mise en œuvre de ce « pacte » – tandis que ses successeurs mettront une ardeur relative à en respecter la lettre, et même l’esprit, au grand dam de leurs partenaires européens.
Les limites de 3 % du PIB de déficit public et de 60 % du PIB de dette publique fixés par le pacte de stabilité se sont de fait avérées très peu contraignantes : la France n’a présenté des budgets dont le déficit était en-deçà du seuil de 3 % que 7 fois au cours des 20 dernières années. Mais c’est sans doute parce que la limite des 3 % a été si souvent approchée ou franchie qu’elle est devenue centrale dans le débat public hexagonal, alors qu’elle a été intériorisée et respectée par la plupart des autres pays de la zone euro, hors déficits ponctuels et crise financière 14. Cette situation a nourri une dénonciation systématique et presque « schizophrène » du pacte de stabilité en France, alors même que son extrême flexibilité démontre qu’il n’y a évidemment nul « dogme » européen en matière budgétaire, ni excommunication de la France par ses partenaires et, jusqu’à lors et fort heureusement, ni sanction par les marchés financiers – tout juste un prix politique à payer en termes de manque de crédibilité et d’influence nationales au niveau communautaire…
Cette situation a nourri une dénonciation systématique et presque « schizophrène » du pacte de stabilité en France, alors même que son extrême flexibilité démontre qu’il n’y a évidemment nul « dogme » européen en matière budgétaire.
YVES BERTONCINI, THIERRY CHOPIN
Cette défiance hexagonale vis-à-vis du pacte de stabilité témoigne du peu d’importance accordée en France à la figure du contribuable, beaucoup plus centrale dans la culture politique des autres pays de l’UE. Parfois défendu sous forme protestataire et éruptive (du « poujadisme » aux « Gilets jaunes »), le contribuable peine de fait à s’imposer dans le débat public français sur l’Europe. Derrière les déficits excessifs et le gonflement de la dette, nous avons en tout cas peine à identifier les impôts futurs, et donc le caractère somme toute salutaire des limitations fixées par le pacte de stabilité. Sur ce registre, la France se distingue nettement d’un pays comme l’Allemagne, qui s’est astreint à l’équilibre de son budget fédéral, mais aussi des pays nordiques ou encore de l’Espagne, où la plupart des forces partisanes se sont ralliées à la nécessité de maintenir le budget de l’État à l’équilibre, notamment pour préserver les générations futures du poids du remboursement des dettes. La France se distingue aussi de la Grande-Bretagne, où la démocratie s’est constituée sur des bases financières (autour du nécessaire contrôle de la dépense publique par le Parlement) et où la figure du contribuable est davantage prise en considération 15.
La crise du COVID-19, « étrange victoire » pour l’interventionnisme français ?
Dans ce contexte, la crise du COVID-19 s’avère très éclairante quant aux rapports des Français aux dépenses publiques. L’allégement rapide et bienvenu du respect des engagements européens que nous avons pris en matière d’aide d’État et de déficit semble en effet constituer une « étrange victoire » pour beaucoup de Français, dont on jurerait qu’ils souhaiteraient refermer cette parenthèse le plus tard possible, sans angoisse particulière pour le remboursement des dettes ainsi accumulées.
Cette défiance hexagonale vis-à-vis du pacte de stabilité témoigne du peu d’importance accordée en France à la figure du contribuable, beaucoup plus centrale dans la culture politique des autres pays de l’UE.
YVES BERTONCINI, THIERRY CHOPIN
La même attitude se devine à l’égard des aides d’État accordées aux acteurs économiques français, petits ou grands (Air France, SNCF, etc.), comme si elles étaient d’autant mieux venues que longtemps proscrites. Cette situation temporaire conduira peut-être à rappeler que les aides d’État ne sont nullement interdites par les règles européennes, mais seulement réglementées, ce qui permet d’ailleurs aux autorités françaises d’octroyer chaque année un montant moyen d’une quinzaine de milliards d’euros, notamment destinés au secteur ferroviaire 16. Peut-être l’abondance ponctuelle de ces aides d’État – comme à l’époque du sauvetage des banques en 2008 – 2009 – conduira-t-elle aussi à réévaluer positivement le rôle d’encadrement des règles européennes, qui empêchent les États les plus riches et les mieux gérés (dont l’Allemagne) de subventionner de manière massive leurs entreprises, au détriment de leurs concurrentes des pays voisins, dont la France…
Le débat sur le montant et la forme de la réponse budgétaire européenne massive qu’appelle la crise du COVID-19, y compris via l’utile mutualisation des dettes émises dans un cadre européen, met lui aussi à jour les spécificités du positionnement politique hexagonal. Cette mutualisation des dettes est en effet portée par les autorités de notre pays sans souci affiché ou débat relatif à ses coûts potentiels et aux risques encourus pour nos finances publiques. Ce type de considérations très prosaïques suscitent à l’inverse une attention et des objections beaucoup plus nettes dans les pays du « Nord » de l’UE, et notamment en Allemagne et aux Pays-Bas, dont les habitants jugent d’autant plus naturels de mesurer le coût d’éventuels efforts de solidarité qu’ils font déjà preuve d’une telle solidarité par temps calme 17. Cette dissonance de perception économique et financière entre la France et ses voisins du Sud d’une part, les pays du Nord de l’UE d’autre part, rend la formulation de compromis européens d’autant plus délicate qu’ils doivent rapprocher des points de départ par trop divergents dans un contexte où un surcroît de solidarité européenne est pourtant indispensable 18.
Alors que le taux d’endettement français était comparable à celui de l’Allemagne en 2005 – 2006, il aura quasiment doublé en 15 ans, au prix d’un décrochage périlleux pour la cohésion du « couple » ou du « moteur » franco-allemand…
YVES BERTONCINI, THIERRY CHOPIN
Enfin, il semble à ce stade évident que la France sortira de la crise du coronavirus nettement plus endettée, avec des marges de manœuvre financières encore plus réduites : ce n’est pas « l’Europe » qui l’en aura empêchée, mais il n’est pas du tout certain que cela l’aidera beaucoup à « imposer » ses vues au niveau communautaire, bien au contraire. Alors que le taux d’endettement français était comparable à celui de l’Allemagne en 2005 – 2006, il aura quasiment doublé en 15 ans, au prix d’un décrochage périlleux pour la cohésion du « couple » ou du « moteur » franco-allemand… Peut-être pourra-t-on bientôt davantage méditer en France sur l’utilité des gardes fous fixés par le pacte de stabilité et de croissance, à l’heure où tous les pays européens qui les ont respecté disposent de finances publiques beaucoup plus abondantes, afin de relever les énormes défis économiques et budgétaires liés à la crise du coronavirus ?
Une France en recherche permanente de compensations vis-à-vis de la construction économique européenne
Il est frappant de constater que, dès les années 50 et jusqu’à nos jours, le débat administratif, politique et public hexagonal sur la construction économique européenne s’est focalisé sur une recherche permanente de compensations susceptibles de la rendre acceptable, sinon désirable. Les archives du Ministère des Affaires étrangères et du Ministre de l’Économie et des finances portent la trace d’une telle recherche de compensations 19, qui constitue le volet interne du projet français d’« Europe puissance ». Elles contiennent tous les fragments du discours français sur l’Europe, qui dévalorise systématiquement sa dimension économique, quand il ne la combat bat frontalement.
Changer « l’Europe économique » : une croisade nationale
Ainsi de la mobilisation initiale et constante en faveur d’une politique agricole commune susceptible de compenser les avantages compétitifs allemands en matière industrielle ; de la quête récurrente de davantage d’harmonisation sociale ; du combat sans cesse renouvelé pour la convergence ou l’harmonisation fiscale ; de la promotion d’un budget européen susceptible de financer des projets de recherche, de développement territorial ou d’infrastructures ; du soutien de principe au développement d’une politique industrielle européenne, souvent opposée à la politique de concurrence ; de la défense des services publics et de leur développement, face à une Europe présumée hostile ; on encore de la mise en place souhaitée d’un « gouvernement » de la zone euro fondée sur une BCE plus interventionniste et des capacités financières communes (budget de la zone euro, émissions de dettes…).
Alors que l’élection d’Emmanuel Macron a posé la question de savoir si le libéralisme allait sortir de l’état de minorité qui est le sien en France, le tropisme national en matière socio-économique ne semble pas avoir disparu. Force est en effet de constater que l’actuel Président de la République s’est de fait avéré de plus en plus classiquement « français » depuis son élection, en renouant avec des combats perçus à Bruxelles comme de « vieilles lunes » hexagonales 20 : quand on milite pour la création d’un budget de la zone euro, l’harmonisation fiscale, le SMIC européen et l’Europe sociale, la refonte de la politique de concurrence ou une moindre ouverture en matière commerciale, on prolonge de fait des combats très anciens, souvent très consensuels en France. Si le plupart de ces combats sont justes et légitimes, ils sont difficiles à remporter au niveau européen et nourrissent d’amples questionnements et réticences dans les pays du nord de l’Europe (Allemagne, Danemark, Pays-Bas, Suède, etc.) – où Emmanuel Macron, énarque et ancien inspecteur des finances, est perçu comme un « libéral à la française », c’est-à-dire très étatiste…
Alors que l’élection d’Emmanuel Macron a posé la question de savoir si le libéralisme allait sortir de l’état de minorité qui est le sien en France, le tropisme national en matière socio-économique ne semble pas avoir disparu.
YVES BERTONCINI, THIERRY CHOPIN
L’hémiplégie du récit français sur l’Europe : « it’s the economy, stupid ! »
Le malaise civique que suscitent les combats français au long cours visant à obtenir des compensations ou des correctifs à l’intégration économique européenne n’est pas seulement dû aux résultats plus ou moins tangibles obtenus sur ces différents registres, ou au fait qu’ils font parfois figures d’illusions perdues dans l’Europe à 27… Il est notable que ces combats français se sont souvent heurtés à des oppositions multiformes, tour à tour incarnées par l’ordo-libéralisme allemand, le libéralisme britannique, l’antiétatisme des pays sortis du communisme ou encore le socialisme nordique… Pour la plupart sceptiques vis-à-vis d’un interventionnisme public trop marqué, tous ces pays se sont en outre montrés davantage attentifs aux résultats économiques et sociaux mitigés de notre pays plutôt qu’aux vertus supposées du « modèle français ».
Le malaise civique hexagonal vis-à-vis de la construction économique européenne réside aussi et surtout dans le fait que bien peu de responsables politiques français la promeuvent en tant que telle, qu’il s’agisse du marché unique ou de l’union économique et monétaire. Non seulement ils déplorent le plus souvent les conditions d’européanisation des outils keynésiens jadis à portée directe des États-membres (monnaie et budget), mais ils ne revendiquent que très rarement les bénéfices tirés de l’intégration marchande et monétaire européenne. Ce faisant, les responsables politiques français donnent l’impression d’avoir lâché la proie (la mythique prospérité des Trente Glorieuses) pour l’ombre (qui entoure les promesses d’une « meilleure Europe »), tout en délaissant la promotion de l’Europe telle qu’elle est d’abord, c’est-à-dire une Europe économique, commerciale et monétaire… Qui parmi les responsables politiques français valorise les incidences positives du marché unique et de l’euro en termes de pouvoir d’achat, de croissance, d’emploi, de stabilité financière, etc. – y compris au regard de leur coûts et leurs inconvénients ? Qui défend les bienfaits du marché intérieur européen et les vertus de la concurrence, notamment en matière de baisse des prix pour les Français ? L’Europe étant d’abord un grand marché bénéficiant aux consommateurs, il est difficile de favoriser son appropriation si l’on ne présente pas son impact positif, ainsi que les avantages de l’ouverture commerciale (le dernier exemple en date étant l’accord UE-Canada, très profitable pour la France mais qui y est en même temps fortement contesté).
Les responsables politiques français donnent l’impression d’avoir lâché la proie (la mythique prospérité des Trente Glorieuses) pour l’ombre (qui entoure les promesses d’une « meilleure Europe »), tout en délaissant la promotion de l’Europe telle qu’elle est d’abord, c’est-à-dire une Europe économique, commerciale et monétaire…
YVES BERTONCINI, THIERRY CHOPIN
Au final, non seulement les dirigeants et responsables politiques français ne valorisent qu’a minima les incidences positives des libéralisations communautaires et de l’Europe économique, mais ils utilisent souvent l’échelon européen comme un aiguillon de la modernisation nationale, au risque de le transformer en bouc émissaire commode. Non seulement « l’Europe » n’est jamais perçue comme un « Père Noël » pourvoyeur de bienfaits, mais elle est sans cesse dépeinte comme un « Père fouettard » imposant des contraintes, voire des purges – au prix d’une « double peine » qui nourrit puissamment l’euroscepticisme hexagonal.
Le Général de Gaulle a ainsi engagé une révolution politique et culturelle de grande ampleur lorsqu’il est revenu au pouvoir quelques mois après l’adoption d’un Traité de Rome qu’il avait combattu, mais qu’il a présenté comme devant être mis en œuvre au prix d’importantes réformes structurelles. Il en fut de même de François Mitterrand lorsqu’il choisit de promouvoir le marché unique puis la monnaie unique, après avoir lancé d’importantes réformes domestiques. Sans doute le principal tort de ces deux hommes d’État est-il d’avoir endossé alors le discours hexagonal classique sur « l’Europe agricole », « l’Europe puissance » ou « l’Europe sociale », sans suffisamment insister sur les bénéfices intrinsèques de l’appartenance française au « marché commun » et unique, puis à l’union économique et monétaire.
Nul doute que la projection française vers la construction européenne serait en effet plus sereine et moins schizophrène si elle avait été portée par des récits politiques équilibrant bien davantage Europe politique et Europe économique – au lieu de s’acharner à poursuivre la première avec des fortunes diverses sans défendre suffisamment la seconde, beaucoup plus tangible.
Non seulement « l’Europe » n’est jamais perçue comme un « Père Noël » pourvoyeur de bienfaits, mais elle est sans cesse dépeinte comme un « Père fouettard » imposant des contraintes, voire des purges – au prix d’une « double peine » qui nourrit puissamment l’euroscepticisme hexagonal.
YVES BERTONCINI, THIERRY CHOPIN
Conclusion : Parfaire la France pour mieux « faire l’Europe »
En proclamant qu’il s’agit de « faire l’Europe sans défaire la France », Georges Bidault 21 a identifié dès les années 50 le nœud gordien qui tenaille notre pays, entre projet national et construction européenne. Au terme de cette mise en perspective historique par nature cursive, on pourrait se demander s’il ne faut pas aujourd’hui trancher ce nœud gordien afin de « parfaire la France pour mieux faire l’Europe ». À tout le moins convient-il de sortir de la « quadrature du cercle » où nous enferment trop souvent les contradictions entre « cartésianisme français » et construction européenne. Comme on l’a souligné, le malaise hexagonal vis-à-vis de « l’Europe » découle d’éléments liés à notre culture politique, qui n’est guère en phase avec les caractéristiques institutionnelles et économiques de l’UE. Elle prend également sa source sur un registre beaucoup plus factuel, sur lequel il serait sans doute plus aisé d’agir à court terme afin de mieux concilier aspirations françaises et cadre communautaire.
Il est donc tout d’abord essentiel de souligner que la France a été et continue d’être l’un des principaux architectes de la construction européenne, en mettant en évidence nombre des réalisations concrètes qui portent sa marque de fabrique (de la PAC à Schengen, en passant par l’union monétaire et les initiatives européennes en matière de défense…). Peu de pays ont autant façonné l’UE que le nôtre, qui n’a aucune raison objective de désespérer de « l’Europe », pour peu qu’il conçoive qu’elle ne pouvait pas être créée entièrement à son image. Il convient aussi de souligner que le contexte géopolitique actuel, marqué par l’émergence de nombreux défis externes et le retrait des États-Unis, n’a jamais été aussi en phase avec le récit français traditionnel sur « l’Europe » : il peut donc continuer à donner lieu à des avancées bienvenues en matière de sécurité collective, à court et moyen termes, pour peu que nos dirigeants adoptent une approche maïeutique plutôt qu’impérieuse, et qu’ils s’arment de constance.
Peu de pays ont autant façonné l’UE que le nôtre, qui n’a aucune raison objective de désespérer de « l’Europe », pour peu qu’il conçoive qu’elle ne pouvait pas être créée entièrement à son image.
YVES BERTONCINI, THIERRY CHOPIN
Pour autant, la logique de projection nationale qui caractérise nos relations avec la construction européenne ne saurait continuer sans dommage à favoriser l’exportation de notre malaise domestique vers Bruxelles, Berlin, La Haye ou Varsovie ! La France doit plus que jamais remettre sa « maison en ordre » en matière économique, sociale et budgétaire, d’abord pour le bien de ses citoyens, mais aussi pour apaiser son rapport à la construction européenne et ses relations avec ses partenaires. Sans doute serait-il également utile qu’elle revoit les modalités des interventions de son État, afin d’en améliorer l’efficacité au regard de leur coût substantiel. Sauf à admettre qu’elle est structurellement incapable de rivaliser avec les pays voisins en matière de croissance, de chômage ou de déficit public, la France s’exposera sinon aux rebuffades récurrentes de pays qui la renvoient à ses propres maux, mais aussi aux remèdes nationaux qui sont – et c’est tant mieux – entre ses mains. Il serait dès lors plus productif de pourfendre notre « franco-scepticisme » que de s’engager sans cesse dans des croisades communautaires qui nourrissent à la fois les crispations de nos partenaires européens et les frustrations de nos compatriotes…
Dans cette perspective, notre conviction est que la France gagnerait aussi à mettre de l’ordre dans ses idées européennes, fût-ce au prix d’une forme de « révolution culturelle ». Cette révolution culturelle a largement eu lieu en matière diplomatique, avec la mise en sourdine de notre anti-américanisme compulsif, la pleine intégration à l’OTAN mais aussi à la faveur de la stratégie erratique de Donald Trump. Il serait profitable que les Français amorcent une révolution culturelle comparable à l’égard de la construction économique européenne : il s’agit notamment de mettre davantage en exergue les bénéfices tangibles de notre appartenance au marché intérieur et à la monnaie unique, plutôt que de dénoncer de manière pavlovienne leurs évidents défauts. Il serait enfin très bienvenu que la France revoit l’organisation encore trop unitaire et monarchique de son système politique, dont la crise du COVID-19 a mis en évidence les limites : elle se doterait ainsi d’une « gouvernance » mieux adaptée aux défis domestiques et internationaux contemporains, à la maturité des citoyens de notre pays, mais aussi plus en harmonie avec les systèmes politiques de l’UE et des autres États membres.
Il serait dès lors plus productif de pourfendre notre « franco-scepticisme » que de s’engager sans cesse dans des croisades communautaires qui nourrissent à la fois les crispations de nos partenaires européens et les frustrations de nos compatriotes…
Yves Bertoncini, Thierry Chopin
Il revient aujourd’hui à Emmanuel Macron de porter les ambitions et les « névroses » de la France au niveau européen, dans un environnement géopolitique porteur, mais aussi dans un contexte domestique difficile. Les promesses de « révolution » affichées en 2017 donnent lieu à un bilan pour le moins mitigé à ce stade, aussi bien en France qu’au niveau communautaire 22. La sortie de la crise du COVID-19 sera donc une étape clé, tandis que le premier semestre de l’année 2022 constituera un moment de vérité, puisqu’il verra la France assumer la présidence tournante du Conseil de l’UE et affronter en même temps des élections présidentielles et législatives, pour le meilleur et pour le pire… C’est à cet horizon-là qu’il sera possible de vérifier si nos compatriotes peuvent davantage admettre que « l’Europe » ne saurait être la « France en plus grand », mais aussi se convaincre que la grandeur d’une France réformée peut et doit à nouveau entraîner l’Europe !
Sources
- Voir Bertoncini, Y. et Chopin, T., « L’Europe » comme outil politique hexagonal : un levier d’« Archimède » pour la France ? », Le Grand continent, 8 mai 2020.
- Cf Bertoncini, Y. et Chopin, T. (2005), « Le référendum du 29 mai 2005 et le malaise culturel français », Le Débat, n°137, novembre-décembre.
- Voir Chopin, T. (2008), France-Europe. Le bal des hypocrites, Éditions Saint-Simon.
- Voir Beaud, O. (1999), « Fédéralisme et Fédération en France : histoire d’un concept impossible ? », Annales de la Faculté de droit de Strasbourg, Presses universitaires de Strasbourg.
- Pascal Lamy a relevé ce trait de la culture politique française dans des termes très nets : « Le compromis ne fait pas partie des figures politiques admises en France (…). La culture politique française est mal à l’aise avec l’idée de compromis trop souvent connotée à la compromission (…). Notre culture politique reste fondée sur l’État (…) et est très éloignée de celle du compromis qu’appelle la construction européenne », entretien donné au journal Le Monde, 27 août 2005.
- Sur ce sujet, voir Bertoncini Y. (2016), L’UE et les référendums : trois dénis de démocratie(s), Institut Jacques Delors, mai 2016.
- Voir Bertoncini Y. (2015), 10 ans après le « non : crever l’abcès pour l’Union européenne et pour la gauche, Fondation Jean Jaurès, mai 2015.
- Voir Rosanvallon, P. (2005), Le modèle politique français, Le Seuil, et du même auteur (1990), L’État en France de 1789 à nos jours, Le Seuil.
- Voir Jaume, L. (1997), L’individu effacé ou le paradoxe du libéralisme français, Fayard.
- Eurobaromètre Standard 91, Rapport, « L’opinion publique dans l’UE », Août 2019.
- Sur ce sujet, voir Bertoncini, Y. et Chopin, T.(2005), « Le référendum du 29 mai 2005 et le malaise culturel français », op.cit. et Bertoncini Y. (2015), 10 ans après le « non » : crever l’abcès pour l’Union européenne et pour la gauche op.cit.
- Voir Pascal Lamy, Le Monde, 27 août 2005, op. cit.
- Adopté par les pays de l’Union européenne en 1999 au moment du lancement de l’euro, ce Pacte prévoit que les déficits publics ne doivent pas excéder 3 % du PIB et la dette publique, 60 % du PIB.
- En 2019, le déficit public de la France s’est établi à un montant équivalent à la somme des déficits de l’ensemble des 18 autres pays de la zone euro (dont la moitié ont en réalité dégagé des excédents budgétaires…).
- Sur le plan politique, le libéralisme anglo-saxon est marqué par un encadrement constitutionnel des pouvoirs, visant notamment à assurer que le prélèvement de l’impôt est consenti par ceux qui le paient. C’est une tradition que l’on retrouve dans la Magna Carta ou encore dans la Révolution américaine (« No taxation without representation »).
- Les aides d’État notifiées chaque année par les États membres de l’UE sont inventoriées dans un tableau de bord de la Commission européenne accessible en ligne.
- Sur ce débat, voir Bertoncini, Y. (2020), « La solidarité européenne en temps de crise : un héritage à approfondir face au Covid-19 », , Fondation Robert Schuman, mai 2020.
- Chopin, T., Koenig, N., Maillard, S. (2020), « L’indispensable incarnation politique de la solidarité européenne », Policy paper n°250, Institut Jacques Delors, avril 2020.
- Sur ces sujets, voir à nouveau Gérard Bossuat, Faire l’Europe sans défaire la France, op. cit.
- Voir Bertoncini, Y. et Chopin, T. (2020), « Macron l’Européen : de l’Hymne à la joie à l’embarras des choix », Le Débat, n°208, janvier-février 2020.
- Georges Bidault a été plusieurs fois Ministre français des Affaires étrangères après la Seconde Guerre mondiale, mais aussi Président du conseil, y compris au moment du lancement de la CECA.
- Sur ce sujet, voir Bertoncini, Y. et Chopin, T. (2020), « Macron l’Européen : de l’Hymne à la joie à l’embarras des choix », op. cit.