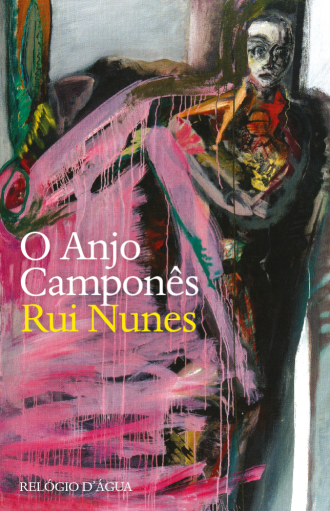La troisième lumière
À l'heure du coronavirus, comment traduire la réalité dystopique en fiction ?
L’une des caractéristiques marquantes de la littérature du XXe siècle est peut-être que la dystopie y a remplacé l’utopie comme lieu privilégié pour penser la réalité au moyen de l’imagination. Les grands mythes de la communauté heureuse qui se déploient au cours de l’histoire de l’Occident (de Platon à Thomas More, Tommaso Campanella et Lord Francis Bacon), s’effondrent, au dernier siècle, dans l’image spectrale des ruines malheureuses de la communauté (une évolution qui est pourtant déjà inscrite dans l’archétype historique de toutes les utopies : le mythe platonicien de l’Atlantide). De la Metropolis de Fritz Lang (1927) à l’Océania de George Orwell (1948), avec petite pause récréative dans le « meilleur des mondes » d’Aldous Huxley (1931), l’avenir du vivre ensemble se dessine alors, dans ses projections artistiques, comme une dégradation et une menace. L’idée de progrès se renverse en régression, la confiance en peur. La science-fiction, cette admirable chronique imaginaire du possible et de l’impossible de l’évolution de la condition humaine dictée par le pouvoir de la science, raconte les déserts apocalyptiques plutôt que les jardins d’Éden : la technique, qui améliore chaque jour les conditions de vie de l’humanité, aboutit paradoxalement à la méfiance et à l’angoisse, lorsqu’elle est pensée comme critère de sélection de l’avenir, dans l’oscillation indécidable entre prévision et imagination. À mesure que le présent se parfait — devenant plus sûr, plus pacifique, moins pauvre pour une grande partie de la population mondiale — la crainte atavique de l’humanité à l’égard des menaces hantant sa vie quotidienne (maladies, famines, misère, guerres, injustice, oppression) se détourne vers l’avenir.
La dystopie, en effet, est essentiellement dyschronie : affirmation de la supériorité de la puissance entropique sur la puissance générative, illustration apocalyptique du passage du temps, du cours de l’histoire. Que la vie ne soit, au fond, rien de plus qu’une course à la mort, non seulement au niveau individuel mais collectif, c’est la peur profonde des grands auteurs de science-fiction du siècle dernier (d’Aldous Huxley à Philip Dick, de J.G. Ballard au transversal Cormac McCarthy), qui nous ont livré des fresques d’une puissance effrayante sur un lendemain qui vient à notre rencontre avec le visage du cauchemar.
L’entrée turbulente dans le troisième millénaire n’a pas arrangé les choses. Mais, si cela était possible, elle les a en quelque sorte « tordues » plus encore.
Sans compter l’urgence des flux migratoires, à son plus fort en 2015, trois crises mondiales majeures ont secoué les vingt premières années du XXIe siècle : la crise terroriste de 2001, la crise économique de 2008 et désormais la crise sanitaire déclenchée par l’épidémie du coronavirus. Cette dernière, en plein cours, même si sa durée et ses conséquences demeurent imprévisibles, est probablement la plus grave des trois, celle qui a le plus grand potentiel de transformation des structures sociales, économiques et culturelles des pays touchés. Personne ne doute que nous en sortirons économiquement à genoux, anthropologiquement différents, dépouillés d’un grand nombre des certitudes paresseuses sur lesquelles nous nous sommes appuyés au cours des dernières décennies.
Avec son habituelle combinaison meurtrière de cognitive fallacy éhontée et de suprême efficacité émotionnelle, Trump a parlé du coronavirus comme d’un « virus étranger ». Il est vain de répondre que les virus n’ont pas de passeport : les citoyens occidentaux ressentent, souffrent de cette contagion comme de quelque chose d’étranger à leur monde de bien-être, fondé sur la liberté et la sécurité, comme aliène au status quo garanti par la formidable machine gouvernementale démocratique et libérale, sans précédent dans l’histoire, qu’ils ont su construire. Les garanties de sécurité collective, avant tout physique, qui ont contribué de manière décisive à alimenter le consensus social pour l’État de droit, se révèlent soudainement précaires. Si le terrorisme avait égratigné le sentiment d’invulnérabilité du citoyen occidental commun, la contagion virale élève le vulnus à la hauteur d’une anxiété mondiale. Tous les maux qui jusqu’à présent étaient étrangers, confinés dans des pays malheureux et lointains — les maux que nous contemplions à l’écran de télévision, entre consternation et distraction, ou que nous lisions dans le journal avec le détachement émotionnel subtil qui nous protège à la fois de la frustration du déjà vu et du sentiment d’impuissance —, sont maintenant chez nous : les murs derrière lesquels nous sommes confinés incarnent leur violence plutôt qu’ils ne nous en protègent.
Restrictions inouïes à la liberté de circulation, ségrégation forcée, fermeture de la majorité des activités commerciales et des établissements publiques, des musées, des théâtres et des églises ; risque individuel d’hospitalisation prolongée et douloureuse et, pour de nombreuses personnes âgées ou malades, l’ombre d’une mort qui devient soudainement, affreusement, une possibilité imminente, comme une peine capitale ; probabilité, individuelle et collective, de la catastrophe économique… Jusqu’à hier, ces circonstances étaient une réalité en Syrie, au Soudan, dans la Corne de l’Afrique, dans des territoires meurtris par des guerres civiles inextinguibles, le sous-développement, des dictatures implacables. Aujourd’hui, elles sont également venues en Europe : la dystopie est la marque de la chronique réaliste de notre temps, non plus un dispositif « inventif » de l’imagination, mais une loupe d’observation. Dyschronique n’est plus le futur, mais le présent. L’effet de distanciation est le code herméneutique de l’actualité, littéralement et charnellement malade, dont nous faisons partie.
Comment donner une voix littéraire à cette réalité ? Comment traduire la chronique dystopique en une expression de sens, à travers la force de la poésie ? Si le sens est une recomposition symbolique du chaos en ordre, en forme, comment éviter la dégénérescence de la recomposition en négation et mensonge, là où le désordre est une expérience réelle, urgente et inévitable ? La dénonciation du sens comme fiction évasive est la grande arme idéologique de la violence, qui choisit la voie du chaos comme loi de survie et de vérité. Nietzsche l’a vu avec une clarté aveuglante et, pour sauver l’art, l’a privé du sens et lui a même assigné la tâche de dissoudre celui-ci. Mais quelle voie demeure pour celui qui ne veut pas sacrifier l’être humain à l’art, qui refuse la dissolution tragique des individus dans la nature ? Quel chemin reste ouvert pour ceux qui continuent à croire que le sens n’est pas la suppression de la réalité, et que la vérité passe par la reconstruction symbolique de la forme sous laquelle l’homme se dit transcendant par rapport au chaos de la contingence ?
À l’écrivain contemporain, témoin du quotidien dystopique d’une histoire assiégée par les menaces apocalyptiques des migrations massives, de la catastrophe écologique et maintenant des urgences sanitaires, ils ne restent pas beaucoup de possibilités d’énonciation du sens crédibles, d’expression d’un ordre symbolique qui ne tombe pas au sol comme le château de cartes de l’esthétisme illusoire ou des velléités moralisatrices. Le fil de la narration qui ne réussit pas à se sublimer en une parabole absolue (art si difficile, si rare) est impraticable. Tout aussi impraticable, à l’heure actuelle, est le funambulisme ludique de l’expérimentalisme formaliste, qui assèche le réel en le subvertissant et, pour la soustraire à la profanation de l’intérêt, fait de la vérité un jouet incompréhensible. La littérature avance à tâtons et il n’y a pas beaucoup de tentatives à la hauteur de cet immense défi.
Encore plus significatif et louable est par conséquent le chemin littéraire de Rui Nunes, un auteur portugais d’une rigueur ardue et lucide. Avec sa nouvelle œuvre, sorte de poème narratif, O Anjo Camponês. Pardais, Deus, Ossos (L’Ange Paysan [Moineaux, Dieu. Os]), Rui Nunes nous offre un exemple de grande générosité artistique pour s’attaquer au cœur du problème, pour faire du noir profond de l’histoire contemporaine l’encre de sa propre écriture, qui littéralement et littérairement, prend l’obscurité en main pour la brandir comme une torche qui ouvre le regard, trop souvent détourné par rapport au vrai : par rapport à la douleur et à l’erreur qui dominent notre temps, à la souffrance qui pave nos pas, et que trop souvent on piétine à la hâte, en faisant semblant de ne pas la voir.
C’est ce faire semblant, cette fiction qui nous blinde contre le réel, dans sa vérité nue de vie (végétale, animale, humaine) sacrifiée et blessée par la violence sociale, économique, politique, religieuse, que dénonce la littérature, nous obligeant à regarder ce que nous ne voulons et ne savons pas voir, perçant l’obscurité de notre aveuglement avec un mot fait chair qui nous ramène à la vision, à l’intérieur de l’écoute, à l’intérieur de la vérité de ce qui est.
Le réel est la vérité que nous renions, témoigne cette littérature qui reconnaît dans la dystopie non un lieu d’imagination, mais d’expérience, s’établissant ainsi comme une écriture non métaphoriquement, mais temporellement apocalyptique. Le verbe poétique est alors une annonce (angélique) de cette perte abyssale que nous sommes, une annonce capable d’énoncer la vérité en se soustrayant à l’enregistrement informatif qui déforme l’expérience en une accumulation de données, en rejetant la dissolution de la subjectivité dans l’immanence des déterminismes — sociaux, économiques, sémiotiques. Celui de l’écriture apocalyptique de l’annonce de la vérité est d’un réalisme mystique, car il écoute et témoigne de cette fracture du réel où l’être se manifeste comme une différence de lui-même, où l’obscurité devient lumière, où le temps est reconnu comme une forme de la vie et de la mort qui ne tient pas en soi-même et où le mot énoncé se produit comme “L’instant clandestin de l’éternité” (p.33).
L’écriture apocalyptique qui dénonce la fiction sociale de la suppression de la vérité du réel, de la blessure causée au vivant par la violence individuelle et collective, est la parole angélique qui, en annonçant que “Le rien est un fragment de Dieu” (p.14), proclame la non-résignation de la vie au néant de la mort et de la violence. Qui proclame l’idée de Dieu comme le principe de plénitude dans lequel la négation de l’être est contredite par un besoin de sens qui, même lorsqu’il est incapable de s’articuler comme un espoir de salut, prononce obstinément sa possibilité comme une alternative au chaos et à l’obscurité du mal, de la souffrance et de la mort. Que l’homme ne se résigne pas à la nuit, est le témoignage angélique d’un Dieu qui se manifeste temporellement dans le mot même qui annonce son absence, son manque :
« Être proche et ne pas savoir de quoi : c’est ma croyance, un vide parlant d’un autre vide » (p.53)
Dieu d’impuissance, le Dieu annoncé par l’ange de la poésie ne sauve pas l’histoire, mais éclaire sa vérité, en réitérant comme une infaillible intuition mystique, contre toute évidence factuelle, la non-équivalence de l’homme au mal dont il est l’auteur ou la victime. Ange de l’impuissance comme le Dieu dont il est un messager, l’ange de la poésie n’est pas porteur de solutions politiques, d’optimismes idéologiques, de messianismes artistiques. Comme l’Angelus Novus de Paul Klee décrit par Walter Benjamin dans ses Thèses de philosophie de l’histoire, comme l’ange de Guernica de Pablo Picasso que le poète portugais Carlos de Oliveira décrit dans le poème qui donne son titre au roman de Rui Nunes, l’ange de la poésie ne réussit pas à éviter le mal qu’il contemple : il ne peut pas arrêter « la catastrophe, qui accumule ruines sur ruines, sans cesse », ni « réveiller les morts et recomposer le brisé » (9ème des Thèses sur la philosophie de l’histoire de Walter Benjamin) ; il ne peut pas suspendre les bombardements. En réalité, il ne comprend même pas pleinement ce qu’il envisage (ses yeux ruraux ne comprennent pas bien les symboles de cette récolte). L’ange n’en sait pas plus que les autres. Mais, terrible et implacable comme seul un ange peut l’être, même si impuissant, en mettant en lumière la vérité de la réalité, dans son fardeau de douleur et de violence, il annonce mystiquement que cette vérité de la réalité n’est pas tout, et que la restitution fidèle du surplus que chaque homme porte en lui commence précisément avec le refus de tout ce qui nuit au vivant. Sa parole est une torche plantée dans le lecteur, de sorte qu’elle y pousse comme un arbre, une mémoire vivante du vide qui parle et se révèle comme un temps lourd d’éternité.
Il entre par la fenêtre
l’ange paysan ;
avec la troisième lumière à la main ;
minutieux, habitué
aux intérieurs des moissons,
aux ustensiles
qui dorment dans la suie ;
ses yeux ruraux
ne comprennent pas bien les symboles
de cette récolte : hélices,
moteurs furieux ;
et il étend son bras plus loin ; il plante
dans l’air, comme un arbre,
la flamme de la lampe.
(Carlos de Oliveira, « Description de la Guerre dans Guernica », Entre duas memórias, Dom Quixote, Lisboa, 1971)