Que vous nous lisiez régulièrement ou pour la première fois, découvrez nos offres pour approfondir et soutenir le Grand Continent en vous abonnant à la revue
Votre entreprise est l’une des premières licornes européennes de l’industrie de défense. Comment vous positionnez-vous sur ce marché ?
Notre entreprise développe des systèmes robotiques autonomes de défense. Nous développons tant des robots que leurs capacités à collaborer et à se coordonner afin de mener des missions complètes sans intervention humaine.
Nous procédons dans une logique d’intégration verticale très poussée, en développant au sein de notre entreprise l’intelligence, les modèles d’IA, le logiciel de commandement et de contrôle (C2), les systèmes de mission en même temps que les radios, les capteurs radar, l’optronique, les contrôleurs de vol, les contrôleurs moteurs et les stations sol.
Nous développons donc le robot lui-même, ainsi que l’intelligence qui va permettre de le contrôler et de s’adapter à de nouveaux événements pendant une mission, par exemple en modifiant sa trajectoire pour éviter un obstacle ou en appelant du renfort pour suivre et frapper un convoi.
En plus de cette capacité d’intelligence locale, nos systèmes requièrent également une intelligence globale, c’est-à-dire l’orchestration de la mission. Nous sommes l’un des seuls acteurs qui développe entièrement ces systèmes autonomes, des composants physiques à l’intelligence globale.
La supériorité technologique ne fait pas forcément la supériorité opérationnelle.
Mouad M’Ghari
Quels nouveaux besoins identifiez-vous aujourd’hui dans l’industrie de défense ?
Comme pour toute société, la meilleure manière de se développer d’une façon réussie est d’identifier un problème, et de chercher à le résoudre. Nous avons compris que la robotisation était en train de changer la manière de mener une guerre et que cet événement était sous-exploité sur le plan industriel.
Injecter de l’autonomie dans les systèmes de défense robotiques permet de développer des systèmes beaucoup plus dissuasifs, complets et puissants. Nous avons décidé de résoudre ce problème — et de le faire d’une façon souveraine.
Cet élément de souveraineté est très important : il signifie qu’il faut être assez indépendant de certaines licences d’export, de certains composants, de certaines chaînes d’approvisionnement, etc., notamment lorsqu’on cherche à produire en grande quantité.
Trois piliers centraux forment le fondement de notre entreprise et sont à la base de sa réussite.
En premier lieu, nous nous concentrons sur le développement de l’autonomie, en accumulant des données de terrain dans des conflits en cours et en développant une IA capable non seulement de planifier des missions mais aussi de les exécuter. C’est un procédé assez complexe qui demande de reconstruire les systèmes physiques par ses propres moyens.
Notre second pilier est la production en grande série. La véritable arme stratégique de la Seconde Guerre mondiale n’est pas le bombardier : c’est l’usine. Que ce soit aux États-Unis, en Allemagne ou ailleurs, tous les belligérants qui ont tenu s’appuyaient sur celle-ci.
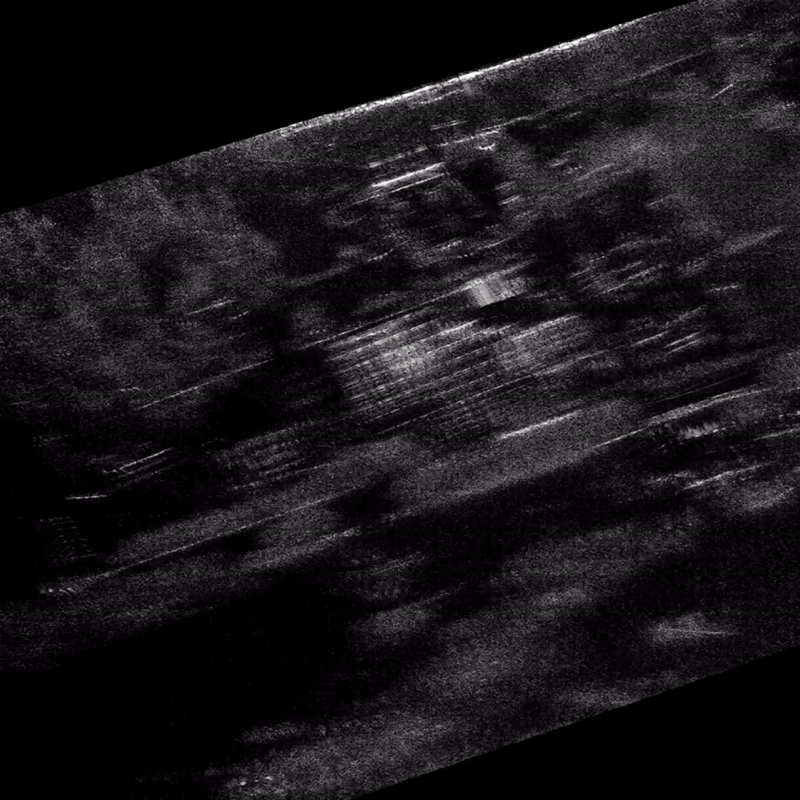
Nous revenons aujourd’hui vers un tel monde, après nous en être écartés. La production de masse avait été délaissée au profit du perfectionnement de systèmes d’armes dernier cri, en général très coûteux : puisqu’il n’y avait plus de combats ou de guerre à mener, on cherchait en temps de paix la supériorité technologique.
Cette approche avait cependant un coût : la supériorité technologique ne fait pas forcément la supériorité opérationnelle. Même si l’on dispose de missiles de la plus haute qualité, il est impossible de faire face à un conflit prolongé de haute intensité sans en disposer en quantité.
La guerre des drones dans le conflit russo-ukrainien a ainsi remis la production de masse sur la table. Alors que de nouvelles tensions éclatent dans le monde — par exemple entre le Pakistan et l’Inde ou entre la Thaïlande et le Cambodge — on observe une dronisation des conflits. Ce qui est intéressant, c’est qu’à chaque fois, l’usine est de nouveau l’arme clef.
Nous avons donc misé très rapidement sur la production de masse. Contrairement à la plupart des startups qui planifient leurs actions pour parvenir le plus rapidement possible à une proof of concept, nous échelonnions les nôtres avec pour horizon la production de masse. C’est là un élément qui nous a singularisés.
Notre troisième pilier est notre rapidité de déploiement, c’est-à-dire notre capacité à développer des systèmes et à les mettre entre les mains d’opérateurs très rapidement. La vente et le déploiement à des armées partenaires s’effectuent en quatorze mois pour l’armée française, quinze mois pour l’armée britannique, en moins de sept mois avec des partenaires estoniens. Cette rapidité nous a permis de recevoir très rapidement des retours et de nous forger une crédibilité.
Vous avez souligné votre attention à la souveraineté. Est-il possible aujourd’hui, dans un domaine dans lequel la Chine semble détenir une telle avance, de bâtir une chaîne d’approvisionnement véritablement autonome ?
Plusieurs sujets doivent être évoqués pour aborder ce point dans le détail.
Dans le domaine de la propriété intellectuelle — notamment pour ce qui touche aux cartes électroniques — la Chine est très en avance, non simplement en raison de ses faibles coûts de production ou de son accès aux matières premières, mais surtout en raison de son avance technologique.
Cette avance n’est pourtant pas un obstacle infranchissable : dans ce domaine, nous avons réussi à devenir souverains et indépendants.
C’est notamment sur le sujet des chaînes d’approvisionnement qu’il nous reste du travail à faire : celles-ci requièrent des étapes de raffinage, souvent de terres rares qu’on retrouve en Chine. Deux composants clefs de nos systèmes sont concernés : les moteurs électriques brushless, notamment les aimants présents dans ces derniers, et les batteries.
Ces deux sujets sont très complexes. On peut depuis peu trouver des aimants sans terres rares chinoises, le raffinage de celles présentes dans l’aimant ayant été entièrement fait en dehors de Chine. C’est une première : ces composants pour moteurs devraient arriver sur le marché dès fin 2026.
Pour ce qui a trait aux batteries, il faut distinguer le raffinage des matières premières qui les composent, leur packaging et, ensuite, la fabrication des composants électroniques. Il existe des solutions souveraines en ce qui concerne le packaging et l’électronique, mais il est plus difficile d’en trouver pour la chimie des batteries. Si des solutions commencent à émerger, notamment au Japon, le raffinage des matières premières est encore détenu en très large majorité par la Chine.
C’est pour cette raison que nous suivons avec beaucoup d’attention ce qui est en train de se passer dans le secteur automobile, qui a aussi des besoins de souveraineté vis-à-vis de la Chine, bien que pour des raisons différentes. Des initiatives commencent à se développer dans ce secteur, dont les résultats devraient être appréciés d’ici trois à cinq ans.
Qu’est-ce que les drones ont changé dans l’art de la guerre ?
Je pense que tous les acteurs ont compris, dès le début de la guerre, une certaine logique de coût reliant celui de l’effecteur à celui de la cible. Nous avons tous vu ces vidéos de drones coûtant entre cinq-cents et mille dollars détruisant des chars qui en valaient plusieurs millions.
La chute de ce ratio coût de l’effecteur sur coût de la cible est extrêmement problématique.
On le constate sur d’autres théâtres que la guerre en Ukraine, comme au Yémen avec l’utilisation de drones Shahed par les Houthis contre des navires militaires ou commerciaux en mer Rouge.
Le faible coût des effecteurs fait émerger le problème de la saturation. Avec un ratio de mille ou de cent entre le coût de l’effecteur et le coût de la cible, on peut envoyer des milliers d’effecteurs et saturer l’espace aérien, mais aussi l’espace maritime. C’est ce que les Ukrainiens ont très bien fait dans la mer Noire, où ils ont porté de sérieux coups contre la flotte de la marine russe avec des drones télécommandés via Starlink. Des bateaux inhabités transformés en drones maritimes, coûtant un quart de million de dollars l’unité, ont détruit des navires qui avaient coûté plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de millions.
Ce sujet de la saturation n’est pas résolu aujourd’hui. C’est un risque vraiment considérable et très difficile à gérer. C’est aussi ce qui a fait le succès ukrainien lors de l’opération « Toile d’araignée » : menée par le SBU, les renseignements ukrainiens, loin à l’intérieur de la Russie, elle a permis d’attaquer des bombardiers russes d’une valeur totale de 7 milliards de dollars, avec des drones faits de bric et de broc, pouvant être assemblés localement et disposer d’une intelligence par un accès au cloud via carte SIM ou une fourniture d’algorithme par clef USB.
Cela nous conduit à mon dernier point : dans cette guerre de saturation très problématique et sans réelle solution, la supériorité viendra de l’intelligence. Aujourd’hui, nous connaissons une forme de saturation « bête », par des systèmes devant frapper une coordonnée prédéterminée et ne montrant pas vraiment d’intelligence ni locale ni globale.
La supériorité de demain viendra de la saturation par des armées robotiques napoléoniennes, c’est-à-dire qui savent se structurer, partager les cibles et s’adapter en temps réel vis-à-vis de la défense et de l’attaque adverse ; des armées de robots qui peuvent mener un assaut coordonné, contrôlé, intelligent avec des boucles de rétroaction très courtes. Ce sont là des éléments auxquels la saturation sans intelligence sera incapable de faire face.
La saturation par des systèmes intelligents et coordonnés a le potentiel de devenir un outil de dissuasion : c’est ce à quoi nous travaillons à l’heure actuelle.
Dans la guerre de saturation, la supériorité viendra de l’intelligence.
Mouad M’Ghari
Quels sont selon vous les systèmes les plus stratégiques — et sur quoi doit porter l’effort européen ?
Je parlais plus tôt de l’utilisation intensive des drones Shahed par les Houthis, notamment dans la mer Rouge.
Le coût d’un Shahed aujourd’hui, selon la gamme, se situe entre 30 000 et 100 000 dollars. J’exclue les dernières générations de drones à turbopropulsion : les générations précédentes, les moins coûteuses, étaient ainsi les plus létales du fait de la saturation.
Aujourd’hui, intercepter des drones Shahed requiert des missiles qui coûtent entre 300 000 et 1 million de dollars. Continuer à devoir utiliser des missiles qui coûtent 500 000 dollars pour détruire des Shahed à 30 000 dollars — voire, pire : des leurres de Shahed qui coûtent 5 000 dollars — nous place du mauvais côté de l’équation.
En conséquence, en Europe, et notamment en Ukraine, on est en train de réfléchir à une forme de drone intercepteur. Aujourd’hui l’intercepteur qu’est le missile anti-aérien, conçu pour être efficace contre des avions valant plusieurs dizaines de millions de dollars, est utilisé contre des drones valant quelques dizaines de milliers de dollars. Il faut renverser de nouveau le ratio coût-effet en remplaçant ce missile par un effecteur beaucoup moins coûteux que le drone qui va être attaqué.
Les drones intercepteurs sont ainsi le nerf de la guerre, notamment si nous voulons défendre la frontière Est de l’OTAN. Les pays limitrophes de cette frontière, comme l’Estonie, la Pologne ou l’Ukraine, ne désirent qu’une chose : acquérir en masse de tels drones intercepteurs.
Les intercepteurs sont un cas d’école de ce qu’est la guerre moderne du drone : celui-ci structurera probablement la défense européenne — dans les quelques prochaines années, il structurera en tout cas la défense des infrastructures critiques et celle de la frontière Est. Cette prise de conscience est progressive. Elle fait suite aux incursions de drones russes en Pologne, en Allemagne et ailleurs.
Aujourd’hui, les Ukrainiens s’équipent déjà en drones intercepteurs, qui souvent ne sont pas autonomes. C’est là un choix intéressant, car un missile, lui, est autonome : les Ukrainiens font donc le choix de la rétrogradation pour avoir des systèmes moins coûteux mais plus soutenables. Le pays a donc porté son choix sur des drones très difficiles à télécommander dans les airs qu’il faut réussir à faire arriver à 300, 400 ou 500 kilomètres/heure sur une cible mouvante, en les pilotant dans un espace à trois dimensions.
Pour que ces drones soient 100 % autonomes et donc plus efficaces, nous avons développé des autodirecteurs, ce qui demande beaucoup d’intelligence, en se fondant sur des capteurs qui ne sont pas ceux qu’un missile peut contenir.
L’intelligence artificielle nous offre la chance de pouvoir le faire. Les données sont donc désormais au cœur de la guerre.

Le drone militaire — dans l’imaginaire, mais aussi dans la réalité aux débuts de cette technologie — était pourtant une plateforme de tir assez chère. Au commencement de la guerre d’Ukraine, on employait ainsi les drones Reaper et Bayraktar. Pourquoi les a-t-on ensuite délaissés ?
En effet. Les Reapers ne sont pas des consommables : ils ont été pensés comme des avions bombardiers ou des avions de renseignement. Ces drones ont été conçus comme on conçoit un AWACS ou un F-35 : en conséquence, un Reaper coûte 100 millions de dollars, ce dont on ne peut pas vraiment s’étonner.
Or c’est précisément de ce coût que vient la déception : il montre de nouveau, en retour, quels drones sont importants : les drones intercepteurs et les systèmes autonomes, ceux qui peuvent être produits en masse et consommés.
Il faut parfois accepter que le mieux est l’ennemi du bien — ce que, historiquement, le secteur de la défense n’a jamais su faire. Une telle acceptation est donc nouvelle : la guerre a changé de forme. Elle est devenue statistique. Ce qui est important est donc la proportion de systèmes pouvant fonctionner au-dessus d’une certaine capacité.
Il est inutile aux belligérants que 100 % de leurs systèmes fonctionnent. Il est plus important qu’une forte proportion des systèmes livrés fonctionnent. Livrer 1000 systèmes dont 100 % fonctionnent est bien moins utile que livrer 100 000 systèmes dont 80 % fonctionnent.
Cette question ne concerne pas simplement la production ou la qualité de production, mais aussi la définition du produit et le programme. Les agences d’achat d’armements des États doivent changer complètement la façon dont ils procurent des systèmes : il ne faut plus penser à dérisquer complètement le développement d’un système, mais accepter que livrer vite un produit est préférable à livrer un produit parfait. En somme, la vitesse est devenue plus importante que la qualité.
Les armes sont un peu comme des vaccins : on préfère ne pas s’en servir, mais le jour où une épidémie éclate, il vaut mieux en disposer en grande quantité.
Mouad M’Ghari
D’un point de vue culturel, est-ce que ce privilège donné à la vitesse sur la qualité n’est pas difficile à accepter ?
Ce déplacement est en effet extrêmement difficile à accepter : il demande à changer complètement de paradigme.
Depuis un an, on observe cependant dans certains pays un début de mise en œuvre. Avant fin 2024, je suis assez confiant pour dire qu’aucun pays de l’OTAN n’avait commencé à réviser son approche. Puis, aux premiers mois de 2025, d’abord au Royaume-Uni puis aux États-Unis, il y a eu un changement de paradigme complet et brutal. Si pour les États-Unis ce changement est en partie lié aux élections, il s’agit pourtant d’une tendance plus large.
Aujourd’hui, les commandes de systèmes faites par le Royaume-Uni ne sont plus soumises à un cycle de validation/définition technique long et complet — de l’ordre de six à vingt-quatre mois. Les agences d’achat d’armements contactent tous les fournisseurs référencés ou pertinents et leur commandent plusieurs milliers de systèmes.
Si on vous appelle au téléphone et qu’on vous commande mille systèmes, vous pouvez livrer à peu près n’importe quoi, y compris quelque chose qui fonctionne à moitié : vous devriez être payé, mais vous n’obtiendrez la commande de 100 000 unités qui viendra après que si vous faites vos preuves. Bref, on entre en fait dans un fonctionnement de marché.
C’est un changement culturel sans commune mesure, qui commence aussi à être observé en France. Le contrat qu’Harmattan AI a gagné en France est, il me semble, le contrat le plus rapide de l’histoire de la DGA : jamais le délai n’a été aussi court entre le moment de la publication de l’appel d’offre et celui de la livraison. Nos interlocuteurs constatent qu’une telle compression des délais fonctionne et, récemment, la ministre des Armées a demandé à ce que celui-ci soit le nouveau standard.
Vous travaillez avec l’industrie ukrainienne de la défense. Que pouvez-vous en apprendre et que pouvez-vous apporter aux Ukrainiens, qui ont acquis et développé tant d’expertise opérationnelle ?
En premier lieu, il est possible d’apprendre de l’industrie ukrainienne que le plus important est la vitesse : les Ukrainiens ont du reste très vite compris que le mieux est l’ennemi du bien.
De manière intéressante, ce constat a été fait après la décentralisation complète de la commande publique ukrainienne dans l’armement. Celle-ci leur a permis de voir ce qui fonctionnait vraiment, et de quoi les gens avaient réellement besoin. Cette façon d’opérer fonctionne probablement en conflit, mais elle n’est sans doute pas pertinente pour établir des programmes de long terme dans des pays en paix : en effet, elle ne permet pas de construire une cohérence capacitaire à long terme. Pour cette raison, je ne pousserai donc pas à ce que les pays européens ou l’OTAN fassent de même.
Il en est ressorti de mes échanges en Ukraine que les systèmes qui fonctionnent à 80 % sont privilégiés par les opérationnels tant que ceux-ci peuvent être produits en masse.
À chaque voyage dans ce pays, je reviens avec dix citations d’officiels ukrainiens, de tout rang et de tout niveau, de la présidence au chef de section en passant par le capitaine, qui lorsqu’on leur demande le système qu’ils préfèrent, nous nomment un système que l’on connaît et dont on sait que les performances ne sont pas formidables. Alors qu’on leur demande pourquoi ils ne choisissent pas tel autre système, dont on sait qu’il est bien meilleur, ceux-ci nous répondent que celui de leur choix est peut-être moins bon, mais peut-être livré à 10 000 unités par mois — bien loin des 300 unités du second.
En somme, 300 unités d’un système par mois ne changent rien à la guerre. C’est là une leçon qui, je pense, n’a pas encore été apprise dans les États occidentaux.
Le jour où une guerre éclatera, ce sont les capacités de production qui primeront : elles sont l’arme véritable. Celle-ci n’est pas le système lui-même qui, même s’il est le meilleur au monde, ne sert à rien s’il n’existe qu’en une seule unité.
Après quarante ans de programmation à long terme sur des porte-avions et des missiles hypersoniques, il est difficile d’accepter une telle réalité. C’est à la faire comprendre que nous travaillons aujourd’hui.
Actuellement, nous déployons des capacités de production qui sont plus importantes que la demande, afin de ne pas proposer simplement aux États un système, mais un système qui peut être produit en capacité suffisante. Cela change beaucoup la manière dont on passe des commandes.
L’épisode des vaccins lors de la pandémie de Covid-19 est un exemple très frappant de cette réalité. Les armes sont un peu comme des vaccins : on préfère ne pas s’en servir, mais le jour où une épidémie éclate, il vaut mieux en disposer en grande quantité.
Pendant le Covid, une initiative très intelligente a vu le jour : l’établissement d’un contrat take or pay par lequel les États — en particulier l’État français — finançaient des capacités de production pour des vaccins. Aujourd’hui, des usines de vaccins tournent à un régime très réduit : leur maintien est financé par un État comme une forme d’assurance-vie, avec des tests de résistance pour vérifier leur capacité de production et leur capacité à passer à l’échelle très rapidement. Cette capacité de passage à l’échelle est vérifiée de temps en temps avec quelques commandes mais, si l’État ne commande pas, il paie cependant pour maintenir la capacité ainsi que le développement des dernières technologies, puisque des évolutions surviennent toutes les six semaines. C’est aussi pour cette raison que l’on peut dessiner une vraie équivalence avec le sujet des vaccins.
Le système de défense robotique d’aujourd’hui n’est pas le même que celui qui sera pertinent dans six semaines : faire des stocks de centaines de milliers d’unités est donc inutile. Il faut donc constituer des stocks pour entraîner, former et développer des concepts d’emplois opérationnels et, le jour du conflit de haute intensité, que la capacité de production existe déjà. C’est là un sujet crucial, qui est pris au sérieux dans les discours, sans que ceux-ci débouchent encore sur une mise en œuvre.
La supériorité de demain viendra de la saturation par des armées robotiques napoléoniennes, c’est-à-dire qui savent se structurer, partager les cibles et s’adapter en temps réel vis-à-vis de la défense et de l’attaque adverses.
Mouad M’Ghari
Y a-t-il des partenariats industriels à envisager avec l’Ukraine ?
Tout à fait, et des deux côtés. Bien des compétences en intelligence artificielle, en logiciels embarqués de précision, pourraient être ajoutées de façon pertinente à des systèmes critiques ou de confiance — même sur des capteurs. Nous avons développé par exemple un capteur unique au monde, un radar d’imagerie pour drone de moins de 150 kilogrammes : ce système va être incorporé à des systèmes ukrainiens et déployé en Ukraine.
En retour, nous avons énormément à apprendre de certains systèmes ukrainiens ou de certains industriels ukrainiens qui ont des années de guerre derrière eux — pas seulement depuis 2022 mais depuis 2014. Ils ont développé une industrie qui évolue toutes les semaines : ils ont bâti une proximité avec le champ de bataille moderne et ses contraintes, qui les ont amenés à développer la robustesse des systèmes.
Il y a donc des choses à apporter à l’Ukraine, mais aussi à en apprendre : il nous faut beaucoup d’humilité.
La coopération industrielle est souvent vue sous un angle mercantile : puisque certaines entreprises vendent des systèmes de défense et qu’une guerre est en cours, il importerait d’aller en vendre là-bas. Ce contrat assez fruste est certes pertinent, tant pour les Ukrainiens que pour nous, mais ce qui est intéressant, c’est aussi de collecter des données et de tirer des leçons industrielles et technologiques pour apprendre à quoi ressemble un théâtre d’opération moderne. Il s’agit de comprendre notamment quelles sont les contraintes de la guerre électronique, lorsqu’on ne peut plus communiquer via les ondes ou se positionner grâce au GPS, comment opérer sur le champ de bataille moderne ?
Aujourd’hui, les systèmes sont de plus en plus autonomes dans la mesure où ils incorporent de plus en plus d’IA. Les données collectées sur le front sont absolument fondamentales : sur les différents théâtres d’opérations, elles feront, demain, la souveraineté des pays qui ont eu l’intelligence de les collecter.
Sur ce sujet, certains pays ont une approche bien plus stratégique que d’autres : les États-Unis sont parmi les premiers. Alors que la guerre en Ukraine éclate le 24 février 2022, le lendemain, des capteurs étatsuniens positionnés sur le front captent des données de guerre électronique, comme des données électro-optiques et thermiques. L’ensemble de celles-ci a énormément de valeur aujourd’hui pour les États-Unis qui savent dans quelle bande de fréquence les communications russes et ukrainiennes oscillent, quelle forme d’onde ont leurs brouilleurs, etc. Ces renseignements sont considérés comme d’une grande importance.
Tandis qu’il existe dans l’administration des États-Unis un poste de Chief Technology Officer, il n’y a pas, dans notre pays, de « directeur technique de la France ». Avec un directeur technique compétent, on pourrait cependant prendre la décision d’envoyer des capteurs dans certains endroits du monde pour récupérer des données qui ont une valeur immense, données aujourd’hui récupérées par d’autres pays.
Le Royaume-Uni et les Allemands ont été les derniers à signer des data deals avec l’Ukraine, après d’autres pays. La France, à ce jour, n’en a pas signé avec Kiev. D’autres pays encore en ont signé avec la Russie — sachant que, certains contrats n’étant pas publics, le nombre de pays contractants est peut-être supérieur aux décomptes aujourd’hui faits. Certains pays prennent donc très au sérieux la collecte des données — notamment les pays en avance sur la question des drones.
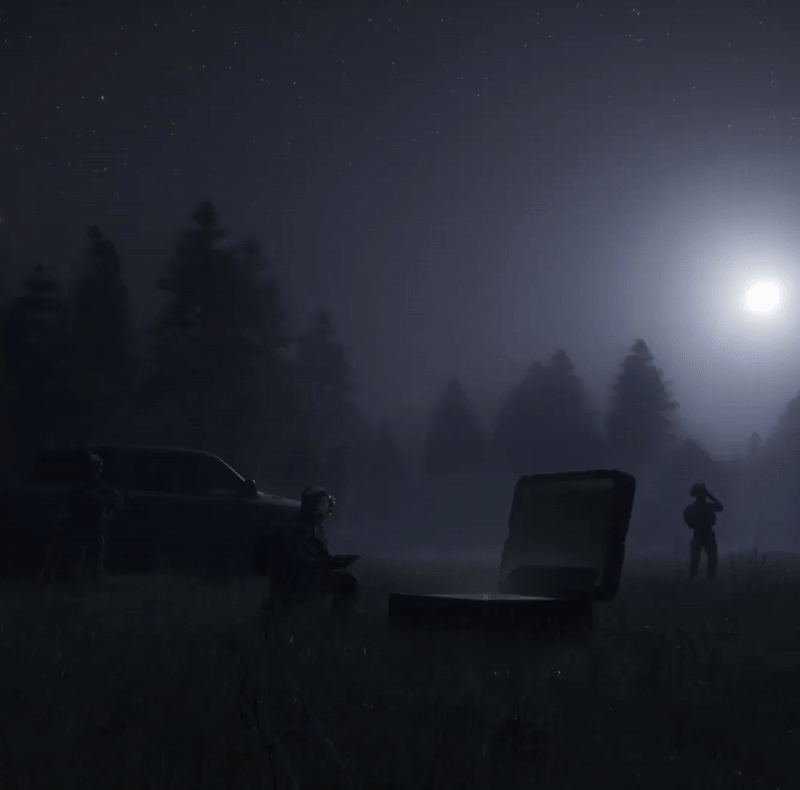
Dès 2022, le président français Emmanuel Macron parlait d’économie de guerre. Tout récemment, le 15 janvier, il a constaté que malgré l’augmentation de la production, les objectifs fixés n’étaient pas remplis. Qu’est-ce qu’il manque aujourd’hui dans l’industrie de la défense en Europe et en France pour réussir un changement d’échelle, afin de préparer une guerre de haute intensité ?
La première chose à faire est de partager le risque.
Les industriels n’ont pas intérêt à en prendre au-delà de ce qui est nécessaire pour optimiser leur maîtrise financière, ce qui est tout à fait compréhensible. En face, l’État ne peut pas s’engager sur des contrats de très long terme pour des raisons budgétaires évidentes, notamment en France. Si les industriels, lorsqu’ils disposent de carnets de commande de vingt ans, ont intérêt à monter leur cadence de production, ils hésitent avec un carnet de commandes de trois ans à faire des investissements industriels lourds.
Les investissements d’un acteur développant des missiles et les industrialisant — cherchant donc à monter une deuxième ou troisième chaîne de production de missiles —, sont colossaux : ils se comptent en centaines de millions. Du point de vue de la gestion du risque, il n’est donc pas pertinent pour cette société-là de monter une telle chaîne lorsqu’elle n’a pas un carnet de commande très long.
Bien sûr, des négociations sont possibles : je ne présuppose pas du carnet de commande d’un industriel ou d’un autre, certains sont d’ailleurs publics. Lorsqu’on a un carnet de commande de deux ans, toutefois, je comprends que l’on soit réticent à augmenter sa capacité de production. Une augmentation serait sensée avec un carnet de commandes de dix ans : l’État serait alors en droit de demander une hausse des capacités de production. Le sujet du partage du risque est donc également lié au budget.
Deux autres leviers pourraient améliorer une situation où les risques sont partagés, à commencer par la tolérance que l’utilisateur doit entretenir à l’égard de l’imperfection de son client.
Il est bien sûr difficile, lors de l’achat d’un avion de combat, d’avoir une tolérance à l’imperfection. Celle-ci doit être à géométrie variable : il ne s’agit pas de tout tolérer. Aujourd’hui pourtant, on constate qu’il n’y a aucune tolérance à l’imperfection, même sur certains sujets sur lesquels on pourrait se la permettre. Certains industriels ont du mal à livrer certains programmes, pour des raisons qui touchent parfois à ce manque de tolérance au risque. Sans celle-ci, il faut livrer quelque chose de parfait : si le produit n’est pas parfait, quelques années de plus seront nécessaires avant de fournir quelque chose. La tolérance à l’imperfection est nécessaire au système d’acquisition et au mode de définition et de développement des systèmes de défense.
Il faut aussi compter avec le décalage qui existe entre les États qui ont des budgets et ceux qui ont une industrie de défense : il suffit pour constater ce décalage de regarder qui a des marges fiscales et budgétaires, et qui a une industrie de défense. En Europe, l’équation est vite faite : l’Allemagne a de nettes marges budgétaires, la France a une industrie de défense.
L’industrie allemande de défense est sans commune mesure avec la française mais, si l’on parle de defense tech (nouvelles technologies de défense), la situation est inverse : celle-ci est beaucoup plus avancée en Allemagne qu’en France. L’Italie est à mi-chemin : du point de vue budgétaire, elle se porte bien mieux que la France et elle a une industrie de défense solide.
Livrer 1000 systèmes dont 100 % fonctionnent est bien moins utile que livrer 100 000 systèmes dont 80 % fonctionnent.
Mouad M’Ghari
L’industrie allemande semble pourtant s’imposer dans le domaine terrestre. Faut-il dire que l’Italie, avec Leonardo et Fincantieri, et la France avec Airbus et Thalès sont meilleures dans les domaines naval et aérien ?
En considérant les industries de défense des pays du Moyen-Orient ou d’Asie du Sud-Est, on constate que certaines sont très sophistiquées et d’autres beaucoup moins. Celles qui le sont moins sont des industries de défense terrestres car produire des véhicules n’est pas le plus compliqué.
Si on prend toutefois le temps d’analyser ces différences, elles expliquent pourquoi les marges des unes sont plus faibles que celles des autres : plusieurs éléments économiques et financiers permettent en effet de prendre conscience de ce qui est complexe à fabriquer ou non. Une société réalisant une marge importante va en général se différencier et se complexifier : ainsi, l’industrie de défense allemande a des marges plutôt faibles par rapport à d’autres industries.
L’industrie de défense terrestre est la base de l’industrie de défense : elle est la défense minimale, et ses systèmes sont simples à faire. Il est beaucoup plus complexe de faire des avions de combat, des navires, des flottes souveraines entières, allant de la frégate au porte-avions, en passant par le chasseur de mines. Ces systèmes se développent sur plusieurs décennies. Il est donc juste de dire, et tous les experts du secteur le confirmeront, que l’Allemagne aujourd’hui n’a qu’une industrie de défense peu développée, pour des raisons historiques évidentes. La situation est cependant en train de changer.
Comme je le disais, on constate aujourd’hui un désalignement entre les pays qui ont des marges de manœuvre financières et ceux qui possèdent une industrie de défense. On parle beaucoup de l’autonomie stratégique européenne — c’est le sujet de la Commission — mais au-delà des belles paroles, il n’y a pas aujourd’hui de mandat européen pour construire une défense européenne. Dans les discussions à huis clos, tout le monde est bien d’accord pour dire qu’un chemin n’a pas été tracé pour arriver à une stratégie de défense européenne.
Ce qui est terrible, c’est que l’Europe pourrait se réarmer très rapidement et se construire une autonomie stratégique si elle acceptait que les pays ont des avantages différents. Il faut faire des concessions et être capable de partager certains éléments de souveraineté pour être capable de construire une souveraineté européenne.
Si tout le monde en Europe était aujourd’hui vraiment prêt à abandonner son autonomie stratégique nationale pour l’autonomie stratégique européenne, demain, la dissuasion serait partagée entre pays de l’Union. Les États membres avec des marges budgétaires — ou un cercle bien plus fermé faits de certains — financeraient un réarmement européen beaucoup plus rapide, fondé sur une industrie existante et sur les industries nouvelles.
Avec cet accord européen un peu utopique, on pourrait construire une défense extrêmement puissante, indépendante des États-Unis et de beaucoup de chaînes d’approvisionnement orientales. Aucun État significatif de l’Union n’est cependant déterminé à un tel changement.
Les marchés européens sont assez cloisonnés : pensez-vous que les récentes initiatives vont dans le bon sens ?
Tout d’abord, il est vrai que les marchés sont fragmentés, mais cela n’a pas empêché les acteurs historiques de réussir à exporter. On accuse souvent l’industrie de défense de vendre à des prix très élevés ou d’avoir des marges importantes, mais il lui faut pénétrer des marchés très complexes et fragmentés — ces marchés étant toujours gouvernementaux. Les coûts de structure de ces sociétés sont assez importants.
Aujourd’hui, nous sommes face à une menace commune : les raisons de créer de la convergence sont donc bien plus fortes qu’historiquement. Malheureusement, nous n’en sommes encore qu’aux balbutiements de cette convergence. Aujourd’hui, la Commission européenne n’a pas de mandat pour mettre en œuvre une stratégie de défense européenne. Elle ne fait que créer des outils qui sont financés par les États membres par les États membres, puis utilisés par ceux-ci en proportion de la façon dont ils les ont abondés, ce qui ne change pas grand-chose.
On constate aujourd’hui très peu d’actions concrètes visant à créer une autonomie stratégique européenne. Je suis d’un naturel optimiste, mais être optimiste au sujet d’une défense européenne demande beaucoup d’efforts.
Si tout le monde en Europe était aujourd’hui vraiment prêt à abandonner son autonomie stratégique nationale pour l’autonomie stratégique européenne, demain, la dissuasion serait partagée entre pays de l’Union.
Mouad M’Ghari
Suite aux propos de Donald Trump à propos du Groenland, observez-vous en Europe une volonté de se dérisquer des États-Unis ?
Le terme « dérisquer » est le bon : on parle souvent de rupture avec les États-Unis, comme l’on dit souvent que ceux-ci rompent avec nous. Ce n’est pas le cas : les États-Unis se dérisquent financièrement, comme nous nous dérisquons stratégiquement.
Cette politique aurait dû être mise en œuvre il y a très longtemps : nous avons été paresseux. Il nous importe maintenant de créer notre propre système stratégique.
Qu’on le veuille ou non, le monde devient multipolaire : il est vain d’aller à contre-sens. Dans ce monde-là, il faut choisir entre pâtir du mouvement général ou renforcer notre autonomie et être un continent puissant qui aura son mot dans le concert des nations.
C’est à cela que nous voulons contribuer, en délivrant à nos partenaires, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou au Moyen-Orient tant qu’ils demeurent des alliés, des systèmes qui contribuent à la souveraineté et à l’autonomie stratégique. C’est la direction dans laquelle va le monde.
Au sein des industries de défense de plusieurs pays européens, nous observons aujourd’hui des efforts pour se dérisquer. Faire de cette volonté un projet pour toute l’Union — la seule échelle pertinente pour créer une autonomie stratégique — est encore bien difficile. C’est pour cette raison qu’il nous reste beaucoup de travail.



