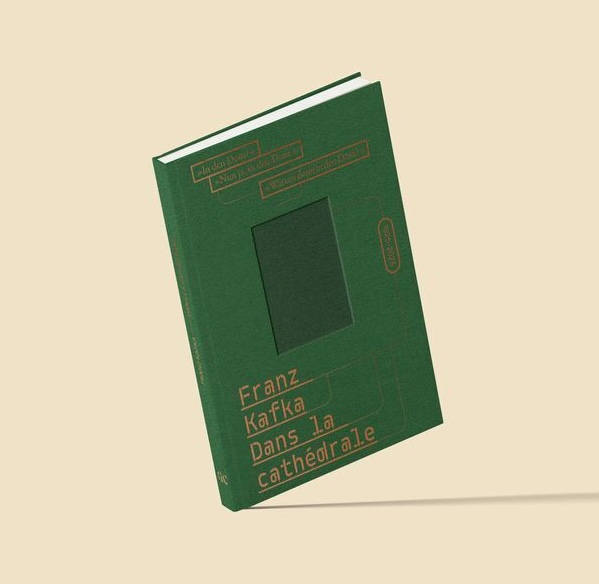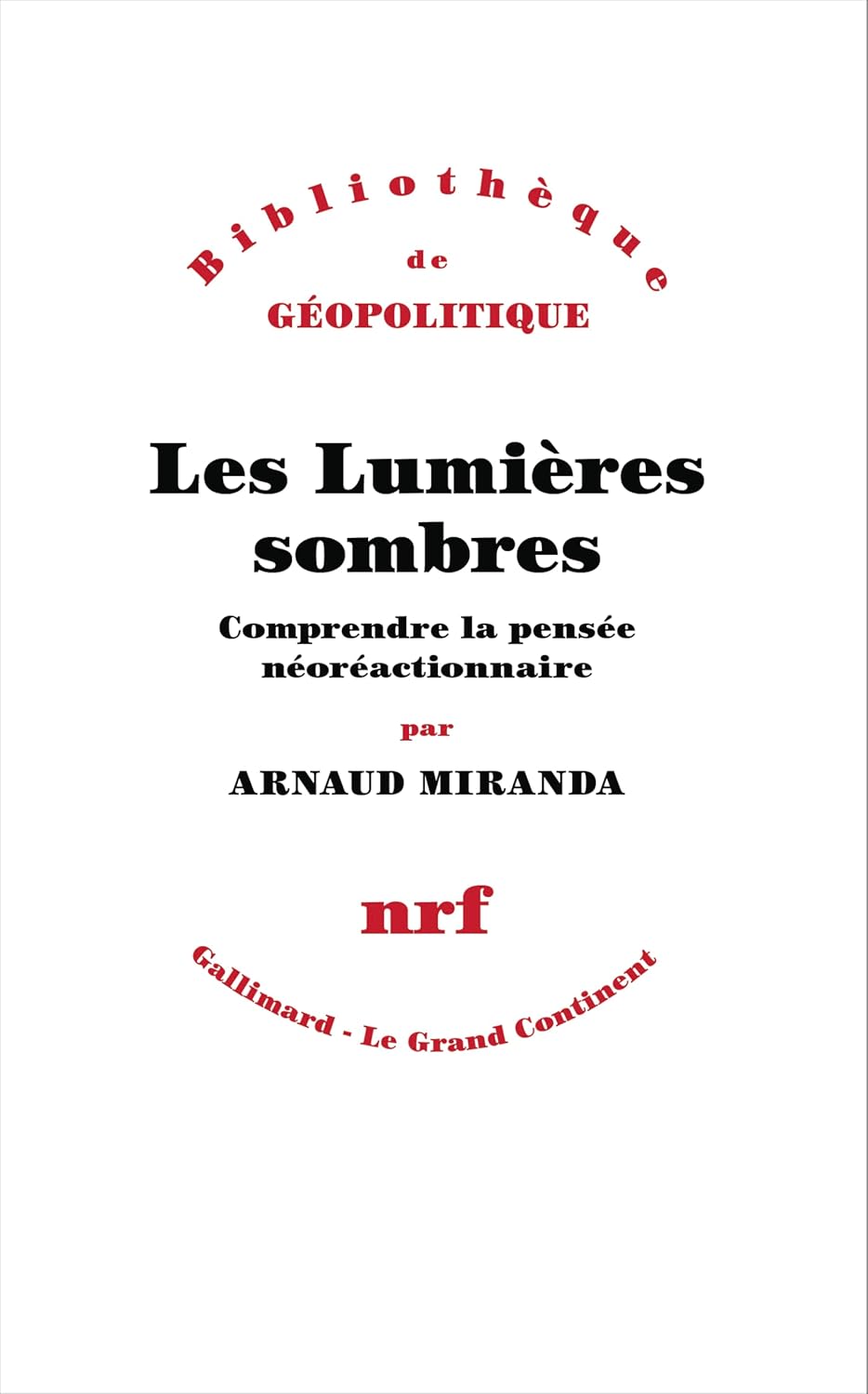Trump et le problème de l’an II : le texte intégral du plan Curtis Yarvin
Selon le principal théoricien néoréactionnaire, Donald Trump n’a pas été assez loin en 2025.
Sans accélérer leur coup — sans aller au bout du changement de régime — les trumpistes risquent désormais de tout perdre.
Nous traduisons et commentons les 60 pages du plan qui circule ces jours-ci dans les boucles du pouvoir à Washington.
- Auteur
- Arnaud Miranda

Il y a près d’un an, Curtis Yarvin sortait de la marginalité pour s’imposer comme l’un des idéologues les plus commentés de la droite radicale américaine. Le grand public découvrait alors ses thèses néoréactionnaires, forgées à la fin des années 2000 dans les confins de la blogosphère, dont la principale est d’en finir avec la démocratie pour la remplacer par une technomonarchie. Les premières mesures de l’administration Trump, ainsi que le ralliement de grandes figures de la tech, semblaient faire de Yarvin le prophète inattendu de ce nouveau trumpisme.
Cependant, depuis l’euphorie des premières mesures, le climat révolutionnaire des premiers mois a laissé place aux premiers craquements d’une alliance idéologique éclectique.
Entre l’alt-right antisémite de Nick Fuentes, les élucubrations théologiques de Peter Thiel, l’enthousiasme évangélique de Tucker Carlson ou encore les projets postlibéraux de Patrick Deneen, le trumpisme semble désormais fragilisé. Les rebondissements de l’affaire Epstein, le shutdown de l’automne dernier et la perspective des midterms, ont achevé de ralentir l’enthousiasme des premiers mois.
En juillet dernier, Yarvin avertissait déjà l’alliance trumpiste : il fallait resserrer les rangs, pour franchir enfin le Rubicon et en finir avec la démocratie.
Pour accomplir le changement de régime, il fallait un coup d’État.
S’il ne semblait pas offrir de solution concrète pour remédier à ce problème, les choses ont changé.
Dans un long texte programmatique publié le 27 décembre, Yarvin appelle à la création d’une nouvelle forme partisane destinée à hacker la démocratie de l’intérieur : un hard party capable de discipliner ses membres comme les soldats du changement de régime, et de préfigurer l’architecture de l’État à venir.
Ce hard party doit aussi s’appuyer sur une application numérique, visant à faire de l’adhésion une forme d’expérience de réalité augmentée. Yarvin ne s’en cache pas : il s’agit de repenser, à l’ère numérique, les formes partisanes qui ont triomphé de la démocratie dans les années 1920 et 1930 – autrement dit, il s’agit de réinventer le fascisme, et de mettre la Silicon Valley à son service.
Si ce texte reprend les thèmes centraux de la pensée néoréactionnaire, il marque un tournant par sa clarté idéologique.
Pour la première fois, la vocation fasciste du projet de Curtis Yarvin n’est plus suggérée mais explicitement revendiquée, inventant une forme politique autoritaire nouvelle qui s’appuierait sur des infrastructures numériques.
Le tableau semble maintenant se dessiner nettement : le second mandat Trump a la forme d’une tragédie.
Voyons ce que cela implique — et ce qu’on peut encore y faire.
Une tragédie n’est pas un désastre comme un autre.
Cela n’a rien de chaotique.
Cela obéit à une construction, à un arc narratif.
Les lois du tragique sont rigoureuses.
Dans une tragédie, perdre ne suffit pas. La défaite n’est tragique que si la victoire était possible.
Perdre par simple accident ne relève même pas du tragique.
Pour qu’il y ait du tragique, il faut qu’il y ait de l’inéluctable : la défaite doit procéder d’un défaut, d’une erreur fatale — qui entraîne une série de catastrophes, dans les règles les plus canoniques du genre.
Toute tragédie appelle des héros — et des parcours héroïques.
Quiconque sait un minimum de choses sur l’administration Trump sait qu’elle est, pour l’essentiel, composée de personnes bien réelles qui ont passé la majeure partie de leur adolescence et/ou de leur vingtaine à subir des persécutions incessantes — sociales, professionnelles, et souvent institutionnelles — pour avoir osé regarder la réalité en face.
Je ne crois pas qu’on puisse mesurer à quel point le nombre de personnes véritablement remarquables ayant accepté des fonctions dans l’administration Trump est élevé.
Comme dans une tragédie, tout héros se fait des amis en chemin.
Hélas, la victoire morale du héros ne suffit pas.
Des héros morts mais moralement irréprochables, il y en a partout.
Et les méchants encore en vie ne se laissent pas enterrer si facilement.
La victoire dont nous avons besoin est une victoire concrète, matérielle — physique.
À vrai dire, si je devais choisir entre une victoire physique et une victoire morale, je choisirais la première. Mais l’alliance des deux est irrésistible et irréversible — et je ne pense pas que nous ayons à trancher.
Or malheureusement, nous n’avons pas cette alliance.
Nous pourrions gagner.
Mais nous ne gagnons pas.
Et la différence est capitale.
Je sais que cela peut sembler étrange. Mais c’est là l’essence même de la tragédie.
Cette position est celle de Yarvin depuis l’élection de Trump. S’il voit dans la nouvelle administration l’opportunité d’en finir avec la démocratie, ce mandat est aussi pour lui porteur d’un grand danger : celui de renforcer l’opposition.
Il écrivait ainsi en juillet dernier : « Ce dont la plupart des membres de l’équipe Trump n’ont pas vraiment conscience, c’est que dans la prochaine administration démocrate, […] tous ceux qui ont travaillé pour l’administration […] seront pris pour cible. »
Les héros ne gagnent pas parce qu’ils sont des héros — pas plus que les méchants ne perdent parce qu’ils sont des méchants.
Ce biais relève de ce qu’appelle « l’hypothèse du monde juste » — on peut y voir une forme du christianisme, mais seulement une forme hérétique et fausse.
C’est un défaut tragique classique.
En vérité, tous nos échecs et toutes nos défaites procèdent d’une seule et même erreur théologique : croire que « Dieu arrange tout ».
Qu’elle soit plus fausse comme théologie chrétienne ou comme athéisme rationaliste, il est difficile de le dire.
Mais rien n’est plus évident — dans la vie, dans l’histoire comme dans la théologie — que ceci : « Dieu aide ceux qui s’aident eux-mêmes. »
Sommes-nous vraiment en train de perdre ? Où en sommes-nous, au juste ?
Cela me coûte de le dire, mais force est de constater que l’administration Trump paraît d’ores et déjà vaincue.
Cela dit, nombreux sont ceux qui ont déjà enterré Donald Trump — et je n’ai pas l’intention d’en faire partie.
La situation
Cela étant dit, toute l’énergie dont disposait l’administration tenait au franchissement du Rubicon — cet élan du point de non-retour, et la possibilité d’articuler cet élan à une capacité réelle d’exécution.
Yarvin reprend ici la métaphore du passage du Rubicon, développée dans son texte de juillet dernier, estimant que Trump avait — contrairement au premier mandat — commencé à franchir le Rubicon, mais s’était arrêté en cours de route. Trump aurait alors eu le courage d’ouvrir la porte à un changement de régime, mais tout restait à faire.
Or une telle énergie ne peut exister que dans une phase de transition.
À présent que l’administration s’est stabilisée et intégrée, consommant son étrange mariage arrangé avec l’État profond, il n’y a plus de place pour cette « énergie du Rubicon ».
Le Sénat, de plus en plus tourné vers la prochaine élection plutôt que vers la précédente, se montre toujours plus ouvertement frondeur.
Collectivement, l’administration n’a pas compris que a) l’enthousiasme suscité par la perspective d’un véritable changement était la source de toute son énergie politique, et que b) cette énergie s’éteindrait dès l’instant où l’offensive cesserait de progresser.
Or l’énergie du Rubicon est difficile à rallumer — infiniment plus que de l’allumer pour la première fois.
La seule chose qui pourrait aujourd’hui la réveiller serait un conflit ou une crise d’une intensité extrême.
Dès qu’elle perdra l’une ou l’autre chambre lors des élections de mi-mandat — probabilité qui s’élève à 80 % à l’heure où j’écris ces lignes — l’administration se retrouvera durablement sur la défensive.
Les élections de mi-mandat correspondent aux élections législatives qui assurent le renouvellement de l’ensemble de la Chambre des représentants — ainsi que d’un tiers du Sénat. Alors qu’elles auront lieu en novembre 2026, de nombreux sondages pronostiquent une victoire des Démocrates, ce qui constituerait un contrepoids majeur au pouvoir exécutif.
À ce stade, le Rubicon sera hors de portée, et toute évocation de son franchissement sera aussitôt assimilée soit à de la démence, soit à une entreprise criminelle. Nixon aurait peut-être pu briser l’État du New Deal en 1969, voire encore en 1973 — plus en 1974.
Les changements de régime sont comme des requins : on ne peut ni les arrêter, ni les ralentir.
Mais s’ils accomplissent x cette semaine et stupéfient tout le monde, ils doivent faire 2x la semaine suivante.
La stratégie du « choc et de l’effroi » est comme une drogue : toute drogue crée de l’accoutumance.
Une révolution ne triomphe que si, face à chaque nouveau seuil d’accoutumance, elle sait augmenter la dose tout en conservant son effet de surprise — jusqu’au moment où il devient clair qu’aucune trace ne peut subsister, non seulement de l’ancien régime, mais même de l’ancienne manière de vivre.
Je dis l’ancienne manière de vivre car oui : dans un véritable changement de régime, la vie de chacun se transforme.
L’événement qui paraissait impossible jusqu’au moment où il se produit semblera, rétrospectivement, inévitable — exactement comme la chute de l’URSS.
Comment savoir si l’on est face à un véritable changement de régime ?
Beaucoup de futurs pères traversent ce type d’incertitude dans la période qui entoure l’accouchement.
Si votre femme vous réveille en disant : « Je crois que j’ai perdu les eaux », alors elle n’a pas perdu les eaux.
Si elle vous réveille en disant : « J’ai perdu les eaux », mettez vite une serviette sur le siège et conduisez-la à l’hôpital.
Autrement dit : s’il faut se poser la question de savoir si le changement est réel, c’est qu’il ne l’est pas.
Un exemple tiré d’un étrange pays peut nous aider à comprendre cela.
Le Royaume-Uni se trouve aujourd’hui dans une configuration politique sans équivalent dans son histoire.
En 2029, à en croire les derniers sondages, le Parti travailliste aura purement et simplement disparu, et Nigel Farage disposera d’une super-majorité lui donnant la pleine maîtrise du Parlement — c’est-à-dire, pour l’essentiel, des pouvoirs de type mussolinien.
« Le Parlement peut tout faire », dit une vieille maxime du droit anglais, « sauf transformer une femme en homme ou un homme en femme ». Verbatim.
Cette phrase de Jean-Louis de Lolme, juriste anglais de la fin du XVIIIe siècle, est devenue un dicton. Elle entend critiquer, d’un point de vue libéral, le déséquilibre des pouvoirs en faveur du législatif.
Pour le meilleur comme pour le pire, le XXIe siècle a supprimé cette « exception à l’exception » : le Parlement est désormais totalement souverain.
Il détient l’exception schmittienne dans toute son ampleur — du moins sur le papier.
Le roi, lui aussi, détient l’exception schmittienne, sous le nom de « prérogative royale » : en droit, il peut absolument tout faire. Sur le papier seulement. Par usage, il ne fait rien. Quant au Parlement, c’est peu ou prou l’inverse.
La prise de conscience que non seulement le Parlement — et pas seulement le Parlement actuel — mais la démocratie représentative elle-même, à l’instar de tant de pouvoirs dans l’histoire, du roi d’Angleterre aux citoyens de Rome, a perdu sa souveraineté pour de bon, m’est venue lorsqu’un jeune homme brillant — qui, comme tant d’autres jeunes gens brillants, aspire à rejoindre cette Angleterre « nigellienne », lumineuse quoique lointaine — me parlait de réforme structurelle de la politique sociale britannique.
La référence à Carl Schmitt est devenue extrêmement fréquente dans les textes néoréactionnaires. Si Thiel en retient la lecture théologico-politique de l’histoire, Yarvin s’intéresse avant tout à sa théorie de la souveraineté et à sa critique de la démocratie parlementaire (voir Parlementarisme et démocratie et la Théorie de la constitution) – qu’il rapproche de sa propre critique de la Cathédrale, c’est-à-dire d’une illusion démocratique sur la nature du pouvoir.
J’ai alors formulé une observation simple, presque triviale : le problème ne tient pas seulement au fait que le Royaume-Uni soit devenu un État international-socialiste aberrant hérité du XXe siècle — même s’il l’est.
Le problème, c’est la manière dont ce waqf-alal-aulad arc-en-ciel, transnational, pansexuel et post-communiste, qui se fait toujours appeler « le gouvernement de Sa Majesté » et distribue des « prestations sociales » à ses « Britanniques », constitue la représentation parfaite du mauvais gouvernement.
L’Angleterre — abstraction faite de la théorie de la dévolution, sur laquelle il serait trop long de s’attarder — n’est pas une grande communauté s’administrant comme un tout.
Elle forme au contraire un jardin foisonnant de micro-démocraties où chaque hameau confortable possède ses anciens municipaux, ses notables marchands, ses poètes et ses dramaturges, et, bien sûr, son propre petit Parlement de dignitaires — ce que l’on appelle un « council ».
Quiconque s’est déjà aventuré du mauvais côté de Londres — au-delà de ce que l’on nomme la Banana — peut admirer les charmants villages neufs édifiés pour les Britanniques par leurs conseillers si sages et si aimés.
On y croirait voir l’elfe Elrond à Fondcombe, drapé dans sa robe, surveiller jusqu’aux moindres volutes des avant-toits.
(Toutes les aides ne relèvent pas du niveau local — le NHS en est un exemple — mais beaucoup y sont distribuées, notamment le logement, y compris celui destiné aux migrants. Naturellement, il n’est pas possible de s’y soustraire.)
Hélas, ces « council houses » se révèlent être ce que, chez nous, on appelle des « projects » — un mot lui-même saturé de l’optimisme scientifique et futuriste du XXe siècle.
Il faudrait évacuer tous les habitants et leurs animaux, puis tout réduire en cendres.
Si quelqu’un s’avise de se plaindre de la fumée, qu’on lui rappelle son origine.
On peut même lui suggérer de s’abstenir de respirer jusqu’à mardi.
Il objectera encore sans doute — c’est probablement un architecte ou un sociologue.
Qu’on le fasse immédiatement arrêter.
À l’époque où les « services sociaux » renvoyaient à la Poor Law élisabéthaine — une législation que je trouve, soit dit en passant, d’une grande prudence et d’une réelle charité — et où ils étaient assurés par une Église établie universelle — l’idée la plus évidente qui soit en science politique —, leur ancrage local avait un sens.
Mais à mesure que les transports ont aboli non seulement la géographie mais aussi la communauté, ne laissant sur la carte que de simples noms, toute idée de gouvernement local est devenue atrophiée.
La seule exception possible tient aux communautés ethniquement homogènes — la fameuse « ségrégation », notion honnie en tout lieu mais remarquablement difficile à éradiquer.
En réalité, la politique des councils n’a rien de démocratique, puisqu’elle est entièrement dictée par des injonctions venues de Whitehall.
Elle n’est même pas réellement mise en œuvre localement, à ce que je comprends, mais par de vastes prestataires nationaux.
Tout, dans ce système de « councils », relève du simulacre, du jeu de rôle grandeur nature.
Sa seule fonction est d’anesthésier les Anglais encore présents dans le pays afin de leur faire croire, d’une manière ou d’une autre, qu’ils font toujours tourner le système d’exploitation de leurs ancêtres.
De toute évidence, un Premier ministre comme Farage devrait simplement fermer l’ensemble du dispositif et le regrouper au sein d’une autorité centrale — conseillers municipaux compris.
Ce bloc unifié pourrait alors, le cas échéant, être réformé.
Si quelqu’un se plaint, que fera Nigel ?
S’ils crient trop fort, il pourra mettre ses AirPods.
S’ils deviennent violents, ils pourront l’être à Sainte-Hélène. Il paraît que c’est un endroit charmant.
La souveraineté est une chose magnifique.
Mais comment réformer la pieuvre des services dits « municipaux » ?
Je fis cette remarque au jeune homme.
Il approuva sans la moindre réserve — évidemment.
Puis il me demanda si, à tout hasard, je n’aurais pas quelques idées sur la réforme structurelle de la politique sociale britannique.
Je n’en avais aucune.
Pour un jeune gentleman anglais formé dans la plus pure tradition mandarinale britannique, supprimer les « councils » sous un régime du généralissime Farage en 2029 paraît à peu près aussi plausible que de louer Buckingham Palace pour y tourner un film pornographique.
Pourtant, pour un Américain, cela va de soi.
Lequel de nous deux voit juste ?
Il est plus facile d’imaginer un changement de régime à l’étranger, parce que l’esprit n’est pas saturé par la réalité quotidienne du pays concerné.
Pour ma part, cela me paraît aller de soi.
Mais le monde n’est pas plat et vous n’êtes pas anglais. Vous êtes américain.
Alors : comment corriger l’équivalent américain de ce champ de distorsion du réel, et déterminer si un changement de régime est réellement un changement de régime ?
Il est malheureusement très difficile d’établir un critère positif sûr pour reconnaître une véritable transition de pouvoir — tant le vrai pouvoir sait se masquer sous des apparences trompeuses.
En revanche, lorsque des réformes structurelles évidentes restent lettre morte par simple inertie des structures, c’est le signe qu’on ne détient pas réellement le pouvoir.
D’où l’intérêt d’un test négatif — qui consiste simplement à transposer l’exemple des « councils»au contexte américain.
Voici un moyen simple de savoir que nous n’avons pas connu de changement de régime : il existe toujours cinquante Department of Motor Vehicles chargés d’enregistrer les plaques d’immatriculation et de délivrer les permis de conduire.
Y a-t-il la moindre raison — autre que l’inertie historique — pour qu’il y en ait cinquante ?
Les États sont-ils vraiment des « laboratoires de la démocratie »… pour les véhicules à moteur ?
Existe-t-il une « manière de conduire propre à l’Arkansas » ? (Ne répondez pas à cette question.) Non ?
Il n’y a pas eu de véritable changement de régime. Vous pouvez vous rendormir. Il ne s’est rien passé.
Pour bien comprendre ce point, il faut saisir que Yarvin s’en prend à la décentralisation moins par républicanisme ou nationalisme que pour critiquer l’inefficacité bureaucratique qu’elle induit. La centralisation autoritaire répond aux exigences de son formalisme, qui vise à simplifier l’organisation sociale. La démocratie étant selon lui dispendieuse, il propose de la transformer en un État-entreprise dirigé par un CEO-monarque.
Si vous vous surprenez encore à défendre, d’une manière ou d’une autre, « la nécessité de nos cinquante Department of Motor Vehicles », c’est que vous vous bercez d’illusions — comme ce pauvre jeune Anglais.
Vous n’avez tout simplement pas mobilisé assez de pouvoir.
Car un changement de régime ressemble — hélas — à une mise en orbite : même si l’on n’est qu’à 99 % de l’énergie nécessaire pour y arriver, on s’écrase. Littéralement.
Dans un véritable changement de régime à l’américaine, on traiterait tout ce kabuki institutionnel — ce théâtre d’Elrond version États-Unis, avec ses tricornes, ses figures tutélaires façon Davy Crockett ou Harriet Tubman, sa Déclaration, sa Constitution, jusqu’à la vénérable et presque sacrée loi de procédure administrative de 1946 — avec autant d’égard qu’une fausse couche dans l’Arkansas.
On l’emballerait dans un sac plastique et on le balancerait par le toit ouvrant.
Sur le bord de la route, les ratons laveurs s’occuperaient du reste.
Faites comme si la vente était conclue, et agissez avec l’énergie d’une armée d’occupation.
Nationalisez, rationalisez.
Faites ingérer les vieilles bandes magnétiques par Palantir.
Mettez à la retraite les serveurs d’un autre âge.
Que Jared [Kushner] s’occupe du foncier et de l’immobilier.
Imaginez un Department of Motor Vehicles national géré comme une start-up de Y Combinator.
Votre permis devient national et embarque une clef publique.
Imaginez que tout, à Washington, fonctionne à ce niveau.
Comme l’Estonie — voire mieux que l’Estonie.
Qu’est-ce qui nous en empêche ?
Rien d’autre que quelques millions de bureaucrates libéraux — qui pourraient pourtant profiter du soleil de Cuba.
Dans un véritable changement de régime, tout le monde est gagnant.
Car le véritable secret d’un changement de régime, c’est qu’une fois la victoire acquise, le personnel de l’ancien régime devient inoffensif. Individuellement comme collectivement.
Même les militaires.
En réalité, ils ne sont pas seulement inoffensifs : ils deviennent souvent utiles. À condition simplement de ne pas les maintenir dans leurs anciens postes — ni même dans leurs anciens secteurs.
Par ailleurs, honorer les engagements réels que l’État a contractés envers ses agents — lesquels ne sauraient être tenus pour responsables d’avoir servi un régime désormais disparu —, c’est assumer la continuité de l’État.
Il est toujours possible de changer de régime tout en répudiant tout ou partie des obligations de l’ancien, mais c’est rarement une bonne idée. Cela donne une coloration bolchevique.
Mieux vaut en fait envisager le changement de régime comme un rachat.
Pour les serviteurs qui avaient réussi sous l’ancien régime — qu’ils aient exercé à l’intérieur ou à l’extérieur de l’appareil officiel — leurs fonctions cumulaient prestige et valeur économique. Elles étaient à la fois des titres de noblesse et des sources de revenus. Ils avaient consacré leur carrière à bâtir ce rang et ce salaire. Les effacer purement et simplement serait une injustice gratuite.
Le personnel doit être reconnu et indemnisé.
Les organisations — qu’elles soient dites « publiques » ou « privées » — doivent être dissoutes, comme on liquide n’importe quelle entreprise morte.
L’expérience consistant à placer de nouveaux responsables politiques à la tête d’agences anciennes, avec leurs procédures et leurs effectifs inchangés, est terminée.
Seuls les naïfs pouvaient espérer qu’elle fonctionnerait.
Parce qu’il faudrait concevoir l’État comme une entreprise, le changement de régime ne peut être pensé qu’en termes de restructuration économique. Yarvin présente le coup d’État comme une forme de liquidation de l’État démocratique.
Revenons à la dure réalité. Et la plus sombre, la plus tragique des réalités, c’est que nous avons bel et bien entrevu cet avenir. Durant l’hiver et le début du printemps 2025, nous avons aperçu, comme par éclairs d’énergie, le potentiel d’un changement véritable, total.
Des agences et des programmes furent balayés.
Washington n’avait jamais rien vu de tel — du moins pas depuis avant la guerre.
Même mesurée en effectifs, cette destruction ne représentait pas le dixième de l’État administratif dans son ensemble — encore moins du régime tout entier — mais ce n’était pas rien.
Il y eut de la « lutte, du fer, des volcans ».
Des éclats d’os se détachaient du vieux dinosaure.
C’était exaltant — et cet élan, bien plus que n’importe quel résultat tangible (même la fermeture de la frontière), constituait la véritable réussite.
Le cycle fonctionnait : l’énergie produisait du pouvoir, le pouvoir produisait des dégâts, et ces dégâts régénéraient de l’énergie.
Malheureusement, il ne semble plus rester grand-chose de cette force de choc — et, pendant qu’elle existait, elle n’a accompli que 0,001 % d’un changement de régime.
Elle devait par ailleurs avancer sous le prétexte narratif convenu d’« économiser de l’argent du contribuable » — un prétexte auquel elle a parfois elle-même cru.
L’économie de l’argent facile est un désastre financier permanent qui, depuis un siècle, gangrène l’Amérique.
Mais ce n’est pas en « coupant dans les dépenses»que l’on réglera ce problème.
Gouverner correctement — je parle même des « victoires»les plus importantes, les plus concrètes — n’est pas en soi mesurable. Du moins pas par nature.
Aucun changement de fond ne compte réellement.
Si vous croyez le contraire, c’est simplement que vous regardez à travers un microscope. Et ce microscope a précisément pour fonction de vous convaincre que vous n’avez rien à faire.
Prenons un exemple : l’immigration.
L’administration Trump a introduit des modifications dans la politique migratoire américaine qui se sont traduites par un différentiel de plusieurs millions de personnes. Passer d’un solde migratoire net entrant de l’ordre de quelques millions à un solde net sortant de même ampleur paraît très concret — c’est le cas. Cela donne l’impression que l’on a fait quelque chose qui compte. Mais cela ne compte pas. Cela n’a d’importance que de manière relative, narrative, microscopique.
Il s’agit là d’un point important pour comprendre la divergence entre la pensée néoréactionnaire et le national-populisme de la sphère MAGA. Le problème de l’immigration constitue la pierre angulaire de la rhétorique nationale-populiste, qui repose sur la défense d’un peuple national sain contre des élites corrompues qui organisent son remplacement par un « nouveau » peuple étranger. Selon Yarvin, cet enjeu est essentiellement démagogique et contribue à maintenir la droite dans un piège démocratique. L’essentiel est d’opérer un changement de régime, ce qui passe par le remplacement de l’élite progressiste en place par une nouvelle élite réactionnaire — remplacer les « elfes blancs » par les « elfes noirs » selon la terminologie de Yarvin. Les revendications de la base populaire ne constituent en rien une orientation politique.
Car quelle quantité de pouvoir cette expulsion massive de population produit-elle réellement ?
En science politique, produire du pouvoir signifie ceci : avoir accompli quelque chose qui rend certaines actions futures — et idéalement toutes — plus faciles.
Sur la trajectoire réelle vers le pouvoir, les vrais problèmes sont ceux dont la résolution d’un seul facilite la résolution de tous les autres.
Dans le cadre d’une stratégie politique de court terme, seules comptent les variations de pouvoir à court terme. Combien de voix en moins les démocrates obtiendront-ils aux élections de mi-mandat de 2026 du fait de ce « succès»migratoire — et des autres réussites de Trump ?
Très peu, j’en ai bien peur — si tant est qu’il y en ait.
Et les images du théâtre de la cruauté de l’ICE constituent une propagande idéale pour l’adversaire. Tout gouvernement est une forme de cruauté, dès qu’on l’observe d’assez près — mais ce microscope-là aussi est un piège. Et Internet est un microscope redoutable.
Pour marquer le centenaire du Procès de Kafka, nous offrons à nos abonnés soutiens une nouvelle édition hors commerce de son chapitre « Dans la cathédrale ».
Les évolutions du pouvoir à long terme comptent elles aussi — et les immigrés, même s’ils ne votent pas en général, produisent des électeurs futurs. C’est ainsi qu’ils ont conquis la Californie — avec la fameuse « majorité démocrate émergente ».
Mais les chiffres de Trump, dans une perspective absolue et de long terme, restent minuscules.
Les États-Unis n’ont pas encore connu de véritable immigration de masse — ni de remigration de masse.
La frontière grande ouverte de Biden, avec ses pistes de fourmis humaines serpentant à travers le Darién depuis toutes les ruches de la planète, est refermée. Soit. Elle peut tout aussi bien être rouverte. Et même bien davantage.
Et si nous perdons de nouveau, elle le sera.
Il suffit d’un juge pour décréter que « personne n’est illégal »— et ce n’est de loin pas la seule acrobatie bureaucratique permettant d’arriver au même résultat.
Le symptôme n’a même pas été durablement soigné. C’est toujours un échec.
Et, pour peu que vous ayez pris la moindre part dans cette petite révolution ratée, la frontière ne sera pas la seule chose à être rouverte en grand : ils poursuivront tout le monde, pour tout et n’importe quoi. Ils traiteront les personnes nommées par Trump comme des assaillants du 6 janvier — y compris si vous n’occupiez qu’un poste obscur dans le domaine culturel ou scientifique.
Et qui sait s’ils auraient tort ?
On parle de plus en plus de corruption avérée au sein de l’administration.
Elle est sans doute bien moindre que sous Biden, ou même sous Clinton — mais eux peuvent se permettre ce que nous ne pouvons pas. Clinton était certes plus habile que Biden, mais pas autant que Biden l’est par rapport à Trump.
Or la corruption ne se limite pas aux pertes financières de l’État : elle abîme aussi l’armature juridique du système.
D’où cette règle élémentaire : plus elle est discrète, moins elle est destructrice.
Et tout cela pour quoi ? Pour une petite chance de victoire ?
La décision fondamentale de l’administration de ne se mouvoir que dans les espaces autorisés, derrière les barrières invisibles du système, avait été prise bien avant l’investiture de Trump — et même avant son élection.
Et, si elle n’a sans doute jamais été très élevée, la capacité réelle de l’administration à s’emparer de Washington s’est mise à reculer, littéralement d’heure en heure, dès le jour de l’investiture.
Dès le mois d’octobre, Trump aurait pu utiliser le shutdown pour prendre le contrôle de la Réserve fédérale (Fed), en faisant valoir l’argument juridique solide selon lequel l’arrêt Humphrey’s Executor a été mal jugé — une question déjà pendante devant la Cour.
Un shutdown est une situation de blocage institutionnel, qui a lieu lorsque le Congrès ne parvient pas à voter le budget fédéral. Yarvin fait ici référence au dernier shutdown, qui a paralysé le gouvernement fédéral pendant 43 jours — le plus long de l’histoire — à partir du 1er octobre 2025.
Sur le plan constitutionnel, le président dispose d’un pouvoir de commandement unilatéral sur l’ensemble du pouvoir exécutif. Il pourrait, par exemple, s’appuyer sur ce pouvoir pour financer directement l’État depuis la Fed, notamment en frappant la fameuse « pièce au trillion de dollars ». L’idée que le Congrès puisse créer ou administrer des agences exécutives est une aberration. Des « lois»qui empièteraient sur la discrétion exécutive normale du président ne sont pas des lois.
Cela aurait permis d’abandonner d’un coup le projet gordien de « réforme » des agences, pour adopter la méthode la plus simple : en créer de nouvelles. C’est, pour l’essentiel, ce qu’a fait Roosevelt.
La référence à Franklin Delano Roosevelt est l’une des obsessions de Yarvin. Ce dernier considère que Roosevelt a eu une pratique dictatoriale du pouvoir, ce qui prouve qu’un virage autocratique serait possible.
Le temps que le Congrès comprenne que le shutdown était en réalité une lettre de suicide et rétablisse le financement du Trésor à l’ancien « exécutif »— en vérité un hybride administratif-législatif —, le nouvel exécutif aurait déjà été opérationnel.
Quant à l’ancien, on l’aurait vu se flétrir en s’accrochant à son bout de liane sectionné, desséché.
Au lieu de cela, l’accord de sortie de shutdown a annulé l’ensemble des réductions d’effectifs décidées par le Budget.
C’était la fin de la révolution.
Un an avant les élections de mi-mandat, le Capitole tient déjà Washington en laisse.
Comme disent les Russes : « on espérait que ce serait différent, mais tout s’est passé comme d’habitude ».
Le Trump de l’hiver dernier, celui du choc et de l’effroi, a disparu.
L’administration est désormais trop intimement intégrée au gouvernement permanent.
Ce mariage est désastreux, mais c’est tout de même un mariage.
Les vitres que Trump devrait briser sont désormais « les siennes ». Voilà pourquoi l’action existentielle n’est possible qu’au tout début d’un mandat présidentiel.
Cela dit, ce ne serait pas la première fois que Donald Trump accomplirait l’impossible.
Pourtant, le défaut tragique de Trump est d’une pureté shakespearienne.
Il est l’exact contraire des reproches qu’on lui adresse sans cesse.
Trump ne désire pas réellement le pouvoir total : il en a peur.
Et ce n’est pas seulement le cas pour lui : ceux qui l’entourent en ont en réalité bien plus peur que lui.
Qui ne le serait pas ?
Presque tout le monde.
Et la plupart des autres sont des imbéciles.
Il faut craindre le pouvoir comme on craint de monter sur une moto — surtout si l’on n’en a jamais conduit une, ni même lu quoi que ce soit à ce sujet. Trump, quant à lui, est réellement sur la moto, et il roule à des vitesses inouïes.
Il consacre son énergie à éviter la chute — pas à regretter de ne pas avoir plus de puissance sous la poignée.
Mais il y a autre chose.
Trump ne peut pas vouloir le pouvoir absolu : ses électeurs ne souhaitent pas le lui accorder. En dernière instance, il travaille pour eux.
Et ce n’est pas non plus que les électeurs désirent ce pouvoir absolu pour eux-mêmes. Ils ne jalousent pas leur souveraineté ultime. Eux aussi, ils ont peur. Ce défaut tragique n’est donc pas seulement celui de Trump. C’est celui des États-Unis.
Et pourtant : hors du pouvoir absolu, tout le reste n’est qu’une manière de perdre.
C’est la configuration même de notre moment historique.
Si le Parti républicain perd la prochaine élection présidentielle, Trump passera le reste de son existence à comparaître — ou derrière les barreaux. Il en ira de même pour tous ses soutiens visibles, les gens qu’il a nommés, ses donateurs.
Ce sera un interminable bûcher de guerre judiciaire, abondamment financé, escorté d’une campagne de communication obséquieuse.
Chaque procureure démocrate du pays trouvera le moyen de prendre sa part au grand nettoyage des ruines du trumpisme — c’est-à-dire de traquer et d’abattre symboliquement les vétérans défaits.
Il y a bien dû se produire quelque chose de trumpiste dans son district.
Les MAGA rôdent partout.
Il faudra donc trancher, puis stériliser.
Les États rouges américains seront traités comme les Highlands écossais après 1745. J’exagère — à peine.
Quant aux électeurs populistes américains, toute la richesse, toute la puissance et toute l’énergie de l’Amérique réelle — l’Amérique côtière, l’Amérique des États bleus, l’Amérique branchée — seront mobilisées pour s’assurer qu’ils n’aient plus jamais, jamais, l’occasion de voter pour se tirer de ce piège.
Et face à cet avenir qui se profile ?
Nous sommes en décembre, un an après l’élection, et « rendre sa grandeur à l’Amérique » en est venu à signifier… un crédit immobilier sur cinquante ans ou un bon chiffre de croissance du PIB. Soit. On nous avait promis le nouvel âge d’or.
L’énergie qui permet de franchir le Rubicon ne peut pas cohabiter avec une autosatisfaction fanfaronne.
De même qu’on ne fait pas la révolution depuis la rue en célébrant l’avenir radieux, on ne peut pas la faire depuis un trône d’airain en se vantant de donner forme à un présent doré — surtout lorsqu’il brille d’un or si tapageur.
Dès lors que l’on feint d’avoir gagné, on se condamne à vivre dans ce mensonge.
Or cette énergie est véritablement la seule chose qui a permis la marge de victoire qui a donné naissance à l’administration Trump — parce que l’énergie du Rubicon est grisante.
Le régime devrait s’y abandonner davantage, pas s’en détourner.
Mais il souffre de ce défaut typique du motard débutant qu’on appelle la « fixation de la cible » (target fixation) : plus ils sentent le vent contraire, plus ils s’en écartent de facto — au point même de reprendre à leur compte le discours du nouveau maire communiste de New York sur « le coût de la vie ».
Yarvin fait ici référence à la stratégie de communication du nouveau maire de New York, Zohran Mamdani, qui a notamment fondé sa campagne sur la question de l’accessibilité du logement.
C’est un état d’esprit à la Gerald Ford. (D’ailleurs, pourquoi n’a-t-on pas déjà créé à Broadway une comédie musicale Gerald Ford ? Une idée de titre : Gerald !)
À la suite du scandale de Watergate, Gerald Ford, vice-président de Richard Nixon, devint à son tour président des États-Unis. La campagne WIN qu’il lança en 1974 pour combattre l’inflation (WIN étant l’acronyme de « Whip Inflation Now ») est considérée comme un échec cuisant. Yarvin fait de Ford le symbole de l’inertie conservatrice face aux progressistes.
Les élections du XXIe siècle ne consistent pas à persuader des citoyens américains réfléchis, indépendants, que votre-gouvernement-tout-neuf-et-tout-brillant fait désormais du bon travail.
Elles consistent à enrôler des armées électorales et à les mettre en mouvement.
À droite, gagner signifie activer des électeurs à faible propension de vote.
À gauche, cela signifie capter — au mieux — des électeurs passifs, apolitiques.
Même le « swing voter » est versatile et désengagé — ce n’est pas du tout un citoyen centriste passionné et hésitant, dévoreur de journaux et féru de politiques publiques.
Qui se soucie des statistiques, de la production céréalière, ou de je ne sais quoi d’autre ?
Cet électeur idéal — soviétique dans son pédantisme statistique — est en fait si insignifiant qu’il en devient inimaginable.
J’imagine que l’Allemagne de l’Est avait elle aussi un problème de « coût de la vie ».
La solution ne fut pas d’offrir des prêts bonifiés pour acheter des voitures Trabant.
La solution a consisté à réduire en une poussière grise et fine — dans un fracas plus retentissant que la voix de Dieu — chaque institution et chaque organisation existant en République démocratique allemande.
Du moins, c’était là la première étape de toute solution concevable — à ce problème de « coût de la vie » comme à bien d’autres maux de la politique est-allemande — où, au demeurant, tout n’était pas entièrement mauvais.
Qu’est-ce qui excite l’électeur de la génération Z aujourd’hui ?
Une vibe positive — et surtout la victoire.
Qu’est-ce qui le refroidit ?
Tout ce qui est cringe — et surtout la défaite.
Les républicains sont déjà revenus à leur niveau habituel de popularité auprès des jeunes — un bon indicateur de leur capacité à produire de l’excitation politique et du potentiel de pouvoir.
Le vieil Holden Bloodfeast III est de retour dans son fauteuil roulant, à vendre des engins infernaux au département d’État. La vie serait plus simple, peut-être même plus lucrative, pour le Congrès républicain s’il n’avait pas à détenir la majorité.
Mais que faire : cela aussi sera bientôt réglé.
Le nom « Holden Bloodfeast » est issu d’un mème partagé sur Twitter en 2018 caricaturant les différents candidats aux midterms. Le personnage portant ce nom est une caricature, telle que la font les réactionnaires, du néoconservateur interventionniste — « bloodfeast » signifiant littéralement « festin de sang ».
Voilà comment ils vous battent.
En dehors des lâches, des traîtres et des escrocs, il existe deux procédés essentiels.
Premièrement : ils vous persuadent que vous avez gagné, alors que vous n’avez encore rien gagné. Vous proclamez la victoire — et vous perdez.
Deuxièmement : ils vous accusent précisément de ce que vous devez faire, mais que vous n’avez pas encore fait. Vous le niez — et vous perdez.
Ce remède contre le pouvoir a été mis au point il y a bien longtemps avec l’institution de la monarchie symbolique.
Le roi mérovingien ou hanovrien conservait tous les apparats de la royauté, sans en détenir le pouvoir. Je me suis longtemps demandé comment tant de dynasties, à tant d’époques et dans tant de régions, avaient pu être amenées à abandonner leurs royaumes tout en gardant leurs trônes.
C’est ce qui est arrivé à notre république, au président — malgré tous ses efforts — et aux électeurs.
L’oligarchie — que l’on rebaptise « méritocratie »— a cocufié à la fois la monarchie et la démocratie — qu’on appelle désormais « populisme ».
Nous préférons faire semblant d’être aux commandes plutôt que d’y être réellement.
Comme tout « monarque » cérémoniel du XXe siècle, nous avons peur du pouvoir de la tête aux pieds, du président au paysan.
Dans la rue, nous sommes des maris irréprochables. Dans les draps, nous sommes loin d’être assez « hommes » pour nos femmes. Le vrai pouvoir n’est plus servi que par l’État profond ou la Cathédrale.
Le rictus avec lequel Washington obéit à l’administration Trump lorsqu’il y est réellement contraint est celui de la femme qui veut l’enfant de son mari — mais pas son mari.
Voilà ce qu’est ce « mariage » entre les institutions et les responsables politiques.
Comment fonctionne ce piège ?
Au fond, la classe supérieure se perçoit comme une classe dominée, tandis que la classe moyenne se perçoit comme la classe dominante.
Le « progressisme » est la foi universaliste de la classe supérieure — assortie d’une exception à l’universalisme lorsqu’il s’agit du tribalisme de ses propres clientèles.
Le « conservatisme » est l’idéologie de la classe moyenne.
Les conservateurs échouent parce qu’ils ne parviennent jamais à voir que l’Amérique n’est, en réalité, pas leur pays.
Les libéraux gagnent parce qu’ils ne parviennent jamais à voir que l’Amérique est, en réalité, leur pays.
Rappelons que Yarvin, comme la plupart des mouvances réactionnaires qui contribuent à renouveler la droite américaine depuis la fin des années 2000, est extrêmement critique du conservatisme – qu’il considère comme l’idiot utile de ce qu’il appelle la Cathédrale, c’est-à-dire le complexe académico-médiatique qui oriente idéologiquement les décisions du gouvernement en démocratie.
La mince parcelle de déférence que l’État administratif concède à un président ou à un candidat républicain — ce théâtre d’ombres soigneusement réglé qui remonte à Wendell Willkie —, juste assez de reconnaissance pour qu’il se sente réellement important — mais pas assez pour causer le moindre dommage systémique — fait partie de l’ingénierie subtile du système politique post-rooseveltien.
De fait, plus les républicains, le président ou les électeurs ont le sentiment sincère d’avoir gagné — sans aucune perspective réelle de victoire — plus ils s’enfoncent dans le piège.
« Nous sommes en train de gagner, et les vainqueurs ne peuvent pas être des rebelles. Après tout, notre Constitution est intacte ! Nous devons préserver notre Constitution menacée. Au moins, nous aurons toujours la Constitution. »
C’est triste. Ces gens n’ont rien. Ils marchent vers leur perte.
Parce qu’ils se laissent si facilement persuader qu’ils ont gagné, nos conservateurs se montrent faibles et passifs dans la résistance.
Et parce qu’ils sont convaincus d’être les audacieux outsiders, les libéraux écrasent cette résistance chétive avec l’énergie héroïque d’un rebelle — un rebelle, certes, extraordinairement chanceux en l’occurrence.
Cette alliance de l’énergie rebelle avec une hégémonie universelle et historique forme un mélange terrifiant.
On observe ce même schéma des parcs de mobile homes de l’Amérique profonde jusqu’au Bureau ovale.
Trump et son administration, une fois « au pouvoir », ce sont les Atréides sur Arrakis — assassinats compris.
Il s’agit d’une référence au cycle Dune de Frank Herbert. Le roman décrit le destin d’une dynastie noble, perçue comme rebelle, qui est placée au cœur du système impérial en recevant le contrôle d’Arrakis, ressource stratégique essentielle. Cette promotion, loin d’être une victoire, constitue un piège : devenue trop populaire et trop puissante, la dynastie Atréides provoque une réaction défensive de l’ordre impérial, menant à un complot destiné à sa destruction.
Or l’énergie qui avait rendu possible le trumpisme était celle de l’effondrement de cette illusion — et de la libération des conservateurs hors du culte de la Constitution.
Hors des rites des ancêtres, dirait-on de manière plus confucéenne.
Il y a d’ailleurs chez le conservateur américain ordinaire plus d’un trait confucéen, avec son respect pour les formes et procédures anciennes et sacrées du gouvernement, tenues pour apodictiquement justes, au-dessus de toute critique. Bref, les rites.
Mais dans l’histoire, il y a des moments confucéens et des moments machiavéliens.
Confucius lui-même, né dans un siècle sans douceur, n’aurait d’ailleurs sans doute rien trouvé à y redire.
Machiavel vous le dira : il ne reste rien des anciens rites.
L’autel n’est plus sacré. Les vieux dieux se sont retirés. Le temple de l’État est un piège — un repaire de démons et de singes.
Votre sacrifice n’a même plus rien de saint : ce n’est qu’un blasphème cruel.
Conservateurs : votre femme vous laisse à peine l’embrasser depuis des années. Pourtant, vous continuez de payer pour ses avortements. C’est un problème, certes. Mais ce n’est pas le problème. Ce n’en est que le symptôme.
Oui, le mariage est sacré. Mais le problème, c’est que vous n’avez plus de mariage — vous avez un fétiche.
Ce passage entier est un appel à rompre avec toute forme de constitutionnalisme. Il peut aussi être lu comme une critique sous-jacente du postlibéralisme qui, tout en étant réactionnaire, considère que le changement de régime doit passer par la réinterprétation de la Constitution. C’est par exemple la proposition d’Adrian Vermeule.
La solution : un véritable parti politique
Comme l’a souligné le président argentin Milei, il faut prendre tout le pouvoir. Car tout ce que nous n’avons pas, ce sont eux qui l’ont.
C’est l’attitude de tous les changements de régime qui ont réussi dans l’histoire. Et c’est aussi, de plus en plus, celle de la « jeune droite»de nos années Vingt — partout dans le monde.
Yarvin reconnaît ici la formation de ce que l’on pourrait nommer une internationale réactionnaire. Il est intéressant de noter qu’il date sa naissance des années 2020, et non des années 2010 — moment de l’essor du trumpisme et des mouvements national-populistes européens, comme le Rassemblement national ou le mouvement pro-Brexit. Yarvin entend bien distinguer les deux stratégies, l’une étant populiste et donc encore démocratique, l’autre essentiellement antidémocratique.
Mais que signifie concrètement cette attitude pour l’action politique ?
D’abord : quel est l’objectif ?
Supposons que la victoire véritable exige beaucoup plus de pouvoir que n’en a jamais mobilisé la seconde administration Trump, même à ses débuts — de combien de pouvoir avons-nous réellement besoin ?
S’il faut un exemple tiré de l’expérience de ceux qui vivent encore, en voici un qui, à mon sens, est allé trop loin — mais que tout le monde considère comme parfaitement légitime : le gouvernement militaire allié en Allemagne, en 1945.
Certains diront que le processus de « dénazification » est en effet allé trop loin dans l’effacement de l’ancien régime.
Mais rares sont ceux qui diraient aujourd’hui qu’il n’est pas allé assez loin.
Commencez par copier cela — puis atténuez là où cela vous semblera sans risque.
Tous les anciens plans et toutes les anciennes procédures sont faciles à retrouver.
Mais comment cela pourrait-il se produire ? Comment produire une telle quantité de pouvoir ? 1945 fut le produit d’une guerre totale et d’une invasion dévastatrice.
Les États-Unis ne peuvent pas s’envahir eux-mêmes.
Ils ne peuvent même pas connaître de guerre civile — non parce que chacun serait devenu trop éclairé, mais simplement parce qu’aucun n’a la force de « bander ».
Que cela vous rassure ou vous déprime dépend sans doute de votre propre taux de testostérone.
L’énergie politique nécessaire n’existe pas, tout simplement.
Cette énergie n’existe pas. Du moins, elle n’existe pas spontanément. La foi dans l’action spontanée est la marque du conservatisme de la fin du XXe siècle — « Dieu s’en chargera », ou quelque chose de ce genre.
L’énergie politique n’existe pas dans la nature. Cela ne signifie pas qu’elle ne puisse pas exister. Cela signifie qu’elle doit être fabriquée. Alors, fabriquons-la.
Les États-Unis ont besoin d’un nouveau type de parti politique — qui est en réalité un très ancien type de parti : un hard party.
L’expression hard party évoque aussi bien la radicalité des méthodes — la « dureté » — que le mot hardware — le matériel concret sur lequel repose tout logiciel (software) —, Yarvin étant familier des métaphores informatiques.
Avec ce hard party, l’idée est de changer les modalités même de la prise de pouvoir. Il ne s’agit pas de radicaliser les idées (le software) mais d’organiser la structure concrète de l’ordre politique à venir (le hardware).
Un hard party est un parti conçu pour prendre le contrôle inconditionnel et total de l’État.
Un hard party est un parti dont tous les membres délèguent 100 % de leur énergie politique au commandement du parti.
Adhérer à un hard party, c’est contracter un mariage politique, pas une aventure d’un soir — une nuit électorale — avec n’importe quel candidat dont le nom vous a accroché sur une pancarte plantée dans un jardin.
Un hard party est une organisation privée légale dont l’objectif est de devenir le parti dirigeant du prochain gouvernement — à l’image du Parti communiste chinois.
Ce sont ses électeurs qui éliront ce gouvernement.
Ce sont ses cadres qui l’occuperont.
Ce sont ses donateurs qui paieront les dîners d’État.
Et ce sont ses idées qui deviendront l’idéologie officielle — la vérité officielle.
Autant dire qu’elles devront réellement être vraies.
Un État à parti unique ? Oui.
Il s’agit là explicitement d’une stratégie fasciste. Dans la doctrine fasciste, le parti a vocation à absorber l’État pour le remplacer par ses propres structures hiérarchiques. Il met aussi en place une logique de mobilisation et de discipline permanente de ses membres. C’est cette idée que Yarvin étaye longuement dans ce texte.
Nous avons essayé de ne pas avoir d’État à parti unique et nous avons fini précisément avec un État à parti unique — jusqu’aux commissars chargés des politiques de diversité dans chaque bureau, public comme privé.
C’était un État à parti unique qui faisait semblant de ne pas en être un.
Un État à parti unique — mais pas sur le modèle du PCC ni des partis marxistes-léninistes du XXe siècle, organisés selon le principe léniniste du « centralisme démocratique ».
Il était réellement décentralisé. Cette différence de nature, si elle avait ses vertus, avait aussi et surtout ses vices.
Et, au bout du compte, elle n’a pas produit une société plus ouverte.
L’efficacité du modèle antidémocratique chinois est une obsession chez les penseurs néoréactionnaires. En témoignent à cet égard les positions de Nick Land. Le changement de régime est avant tout motivé par la thèse selon laquelle la démocratie serait incapable de mener une politique cohérente à long terme, et donc de rivaliser technologiquement avec la Chine dans le monde des empires qui se construit sous nos yeux.
Quoi qu’il en soit, seul quelque chose peut vaincre le néant.
Un régime à parti unique décentralisé, tel que celui que nous subissons aujourd’hui, ne peut être remplacé par aucun nouveau régime décentralisé — qu’il soit à un parti, à deux partis ou à zéro parti.
Du moins, toutes les tentatives en ce sens ont échoué, et je ne vois pas comment y parvenir — mais peut-être suis-je juste idiot.
En revanche, je vois comment y parvenir avec un parti centralisé — un « centralisme démocratique ».
Comme le disait Deng Xiaoping : qu’importe que le chat soit noir ou blanc, pourvu qu’il attrape les souris.
Cette métaphore du chat, filée tout au long du texte, vise à décrire le changement de régime politique. Le chat est l’État. Yarvin entend proposer la création d’un parti qui a vocation à remplacer l’État démocratique — celui-ci étant un chat inefficace, qui n’attrape pas de souris.
Pour ce faire, il s’agit de construire un parti qui ressemblera d’abord moins à un chat qu’à un lapin — puisqu’il s’agit d’une organisation para-étatique.
Si la stratégie fasciste parvient à son but, le parti remplacera l’État, tout en étant bien plus efficace. Yarvin donne la réponse dans les dernières phrases du texte : « Notre lapin des années 1930 n’est pas seulement un chat, mais en fait le meilleur de tous les chats possibles ».
Tout ce que nous savons, c’est que le chat que nous avons n’attrape pas les souris — et nous ne semblons pas capables de lui apprendre à le faire.
Peut-être est-ce parce que ce chat est si doux, si spécial.
Peut-être est-ce parce que ce n’est pas vraiment un chat, mais un lapin.
Peut-être n’avons-nous pas besoin d’un chat spécial.
Peut-être nous faut-il simplement un chat ordinaire.
C’est une prise de conscience un peu déprimante, j’en ai bien conscience.
Peut-être pourrions-nous même avoir un chat ordinaire tout en gardant aussi un lapin ? Peut-être.
Peut-être commençons-nous à nous lasser de retrouver des crottes de souris dans nos céréales, le matin ?
Peut-être faudrait-il commencer, tout bonnement, par le chat.
(Je sais même que cela est possible au XXIe siècle, parce qu’il existe un parti de la « jeune droite » qui, de ce que j’en vois, y parvient plutôt bien — le parti Mission, au Brésil. Ils ne suivent aucun plan de ma part : ils ont simplement eu la même idée évidente. À l’heure où j’écris, ils sont crédités de 7 % sur Polymarket pour l’élection de 2026 — ce qui est plutôt impressionnant.)
Yarvin fait ici référence au parti brésilien Mission, dirigé par Renan Santos et créé en 2023. Le parti est construit sur une doctrine postlibertarienne — c’est-à-dire sécuritaire, conservatrice et fondée sur le démantèlement de l’État —, sur le modèle des positions de Milei en Argentine et Bukele au Salvador. Si Yarvin s’en défend, ses idées ont probablement influencé la ligne de ce parti. Il a d’ailleurs été invité à l’un de ses événements en novembre dernier.
Un hard party au XXIe siècle ne peut pas être la milice de rue paramilitaire des années 1930 de votre grand-père.
Là où les hard parties du début du XXe siècle ne pouvaient se coordonner qu’en uniforme, dans la rue, ceux du début du XXIe siècle ne peuvent se coordonner qu’à travers des pixels sur un écran.
Là encore, il existe deux types de partis : les partis physiques et les partis virtuels.
Dans un hard party virtuel, la seule « action directe » est le vote.
S’ils avaient disposé de nos outils, ils les auraient utilisés.
Mais nous ne pouvons pas utiliser les leurs.
Nous ne sommes tout simplement pas assez forts — et le premier pas vers la victoire consiste à connaître ses limites.
Ils étaient infiniment plus capables que nous, à la fois en termes de violence et en termes d’obéissance.
Nous sommes ce que nous sommes — et la politique est l’art du possible.
Un hard party du XXIe siècle accédera au pouvoir par des moyens légaux et pacifiques.
C’est cela qui est possible.
Rien d’autre.
Ce passage est l’un des plus importants du texte. Yarvin y théorise la nécessité pour la droite néoréactionnaire de réactiver la logique fasciste du parti unique, en l’adaptant aux technologies contemporaines. Il ne faut pas s’y tromper : Yarvin prend ici explicitement les méthodes de manipulation des médias de masse du NSDAP comme un modèle de stratégie politique.
Ce qui est possible, ce sont les applications.
Nous aimons les apps. Nous en utilisons tous les jours.
Le parti de l’avenir sera une application.
Le militant porteur de carte d’hier sera l’utilisateur actif mensuel de demain.
Ces partis virtuels — du moins pour leurs usagers — ne sont pas de simples applications.
Ce sont des applications ludiques.
Des applications de type jeux en réalité augmentée.
Un jeu en réalité augmentée, cela signifie ceci : dans le monde réel, vous accomplissez une tâche ; dans l’application, vous obtenez un badge, des points d’expérience, quelque chose de ce genre.
On peut bien sûr imaginer des tâches physiques — mais aucune n’est réaliste, hormis le vote.
Tous les partis et toutes les machines politiques sont des dispositifs destinés à produire des voix — et à accomplir d’autres actes démocratiques.
L’ancien système de la politique de diffusion de masse du XXe siècle est, précisément, ancien.
Les gens liront-ils vraiment le Los Angeles Times et regarderont-ils CBS News en 2050 ?
Qu’est-ce qui est le plus réaliste : cet ancien monde — ou des applications de vote conçues pour « brigader » des élections dans le monde réel ? Pourquoi vote-t-on ? Il y a toujours une motivation psychologique au vote.
Proposition A : participer au processus civique de notre démocratie en exprimant une préoccupation sincère, éclairée et prudente pour le bien-être de la république.
Proposition B : tirer un coup de feu dans une guerre civile froide, en défendant sa faction de la république contre une autre, de manière réactive ou proactive.
On est soit un micro-homme d’État, soit un micro-soldat.
Dès lors que la vie politique d’une république se réduit à la proposition B, la république est morte.
La seule question est de savoir quelle faction, quelle organisation ou quel parti l’emportera absolument. Un hard party devient nécessaire lorsque l’on renonce enfin à l’illusion de la proposition A — l’illusion de la république défunte, qui n’est pas morte hier ni même l’an dernier, mais avant la naissance de vos parents.
Ne soyez pas cette mère-singe qui transporte partout son petit mort.
La réalité la plus fondamentale est la suivante : une fois parvenu à la proposition B, il n’y a plus de choix.
B est en réalité le seul véritable premier pas vers A.
Si les élections sont une bonne chose, le parti, une fois victorieux, organisera les siennes.
Si elles ne le sont pas, il ne le fera pas.
Qu’importe que le chat soit noir ou blanc.
Une fois que l’on admet que nous votons selon la proposition B, on peut enfin comprendre la motivation émotionnelle du vote.
Voter est amusant, excitant.
La guerre l’est aussi.
Le vote est une guerre symbolique.
D’autres choses sont également amusantes et excitantes : attaquer une tribu ennemie, la surprendre dans son sommeil, massacrer ses combattants, puis ramener leurs femmes et leurs enfants ligotés vers leur nouvelle vie d’esclaves — portant les restes de leurs maris et de leurs pères, déjà découpés en steaks pour la fête.
Puisque c’est ainsi qu’Homo sapiens a vécu pendant des millions d’années, il doit être possible d’activer les ressorts motivationnels de ce comportement — ne serait-ce que sur son iPhone.
Les chimpanzés, eux, ne pratiquent même pas l’esclavage.
La guerre, chez les chimpanzés, c’est le génocide pur et simple — avec force tortures, même si ni l’un ni l’autre ne sont menés de manière « scientifique ».
Les chimpanzés ne parlent pas ; nous ne pouvons donc pas savoir s’ils trouvent la guerre entre chimpanzés excitante et, du côté des vainqueurs, plaisante.
Mais c’est l’impression que cela donne.
Ici, dans la Silicon Valley, nous savons comment parler au chimpanzé intérieur de nos clients — en général sans guerre, sans torture, sans esclavage ni génocide.
D’où ce mystère : comment se fait-il que nous ayons encore un problème d’engagement ?
La motivation émotionnelle du vote tient à l’expression du pouvoir.
Parce qu’un hard party est précisément conçu pour conquérir le pouvoir, il peut offrir bien davantage de cette « vibe chimpanzé ».
Et comme cette dynamique est réelle, elle est bien plus stimulante que la participation à la politique du XXe siècle qui, elle, est factice. Elle peut donc générer beaucoup plus d’engagement.
L’expérience utilisateur fondamentale d’un hard party est la suivante : être membre n’y donne pas l’impression d’être un dirigeant mais celle d’être un soldat.
C’est également amusant — simplement, c’est amusant d’une autre manière.
Il ne faut pas confondre ces deux formes d’engagement.
Dans une foule, et dans un soft party, chacun se vit comme un dirigeant.
On demande à tous d’apporter leurs « opinions » sur les « enjeux ».
À quoi bon ? C’est un prétexte.
Cette activité n’est ni utile ni nécessaire à qui que ce soit.
Une armée est, homme pour homme, bien plus puissante qu’une foule.
Être un membre subalterne d’un hard party, c’est se sentir comme un simple soldat dans une armée — ce qui est aussi amusant, surtout quand personne ne vous tire dessus, mais d’une autre manière.
Et cela fournit au passage une métaphore efficace pour vos badges d’application.
Yarvin insiste ici sur la différence entre un mouvement populiste et une organisation fasciste. Un mouvement populiste reste soumis à l’opinion publique, puisqu’il met en relation un chef charismatique avec une base électorale dont il se fait la voix. Une organisation fasciste est un groupe hiérarchique discipliné dont la mission est de remplacer l’État. Le trumpisme devrait, pour triompher, opérer sa mue fasciste.
Un hard party est une organisation privée légale dont l’objectif est de devenir le parti dirigeant du prochain gouvernement — à l’image du Parti communiste chinois.
Ce sont ses électeurs qui éliront ce gouvernement.
Ce sont ses cadres qui l’occuperont.
Ce sont ses donateurs qui paieront les dîners d’État.
Et ce sont ses idées qui deviendront l’idéologie officielle — la vérité officielle.
Autant dire qu’elles devront réellement être vraies.
Un État à parti unique ? Oui.
Nous avons essayé de ne pas avoir d’État à parti unique et nous avons fini précisément avec un État à parti unique — jusqu’aux commissars chargés des politiques de diversité dans chaque bureau, public comme privé.
Que cela soit ou non intentionnel, tout le passage qui précède est une répétition du même passage quelques paragraphes plus haut dans le texte original.
Si cette expérience historique ne nous apprend rien sur la science politique, que faisons-nous ici, au juste ?
La solution ne consiste pas à faire semblant de pouvoir inventer un autre type d’État.
La solution consiste à faire ce qui doit être fait — et à le faire correctement.
Ce nouvel État à parti unique sera un gouvernement différent.
Sa première étape consistera à effacer l’ancien régime de manière pacifique mais irréversible — jusqu’à ce que la peinture ait disparu et que le métal brille.
Il ne devra subsister aucune institution existante conservant le moindre intérêt à poursuivre la résistance au nouveau régime. Même les bâtiments de l’ancien gouvernement devraient être démantelés, sauf s’ils présentent une valeur historique ou architecturale réelle. Comme les Alliés l’ont bien compris en 1945, la destruction symbolique est aussi importante que la destruction structurelle.
Ce passage permet de comprendre la différence essentielle entre le conservatisme et la réaction. Un conservateur entend préserver un ensemble de valeurs, tandis que le réactionnaire considère qu’il faut créer (ou recréer) un ordre politique. Comme le dit le philosophe Jean-Yves Pranchère, le réactionnaire est porteur d’une volonté révolutionnaire, bien que ce soit pour reconstituer un ordre ancien.
Il existe bien sûr un chevauchement fonctionnel entre tous les gouvernements. Dans certains cas, le régime à venir pourra réutiliser temporairement les installations de l’ancien État administratif, voire contracter avec son personnel. Mais son autorité sera plénière — se réservant le droit inconditionnel de réviser l’ensemble des actes, décisions et engagements de l’ancien régime.
Vous avez encore de la paperasse d’ancien régime ? Très bien.
Mais qu’est-ce que cela signifie ?
Je n’en sais rien : cela dépend.
Toute transition doit certes être aussi ordonnée que possible, mais un hard party n’a ni programme ni plateforme de réformes graduelles. Il ne pense qu’à deux choses : a) comment s’emparer des pleins pouvoirs ; b) qu’en faire une fois acquis.
Les pleins pouvoirs sont la capacité non contrainte de prendre des décisions arbitraires.
Ce type de pouvoir n’est lié par aucun document, aucune base de données, aucun organigramme issu de l’ancien régime — dont la manière de cartographier la société est désormais caduque.
Le nouvel État devra lui aussi « voir comme un État » — mais il devra voir d’une manière entièrement nouvelle.
L’unité absolue d’action est la seule manière d’atteindre cet objectif.
Un hard party fonctionne parce qu’il est un laser, pas une lampe torche.
Et la différence entre un laser et une lampe torche n’est pas juste une différence de degré.
Dans un hard party, chaque personne — membre, cadre ou donateur — délègue l’intégralité de son pouvoir politique au parti. En tant que membre, vous votez, à chaque élection à laquelle vous êtes éligible, conformément aux consignes du parti. Vous n’avez pas besoin de prêter attention aux noms, aux programmes, aux idées, etc. Vous n’êtes même pas censé le faire. Lorsque vous votez, ou que vous agissez politiquement de quelque manière que ce soit, vous suivez les directives du parti.
Il en résulte que vous accomplissez beaucoup moins de tâches politiques fastidieuses que celles que l’on attendrait de vous en tant que « citoyen informé »— tout en exerçant un impact politique bien plus grand. Il vous suffit d’installer l’application, de lui accorder les autorisations de notification, et, lorsqu’une élection survient, de faire simplement ce qu’elle vous indique. Le jeu électoral devient un outil militaire — avec des bulletins à la place des balles.
En tant que cadre, votre tâche est de servir le parti par votre travail. Votre première mission est d’exceller dans ce que vous faites — quel que soit votre métier.
Après le changement de régime, en tant que cadre du parti, vous êtes d’emblée qualifié pour servir le nouveau pouvoir. Cela rend les grandes organisations beaucoup plus faciles à mettre sur pied mais aussi plus faciles à contrôler — si vous êtes exclu du parti, vous perdez évidemment aussi votre poste dans l’administration.
Pour devenir cadre, il faut candidater. Vous passez un test. Vous passez un entretien. Vous servez au bon plaisir du parti. Vous acceptez toute tâche ou tout poste qu’il vous assigne. Tout membre ou tout cadre peut être exclu à tout moment.
La seule chose qui change lorsque vous gagnez, c’est que le parti commande désormais à l’État et peut vous proposer un rôle dans son appareil.
En attendant, ne quittez pas votre emploi — et dissimulez votre niveau d’engagement.
Les cadres paient aussi une cotisation et accomplissent des tâches pour le parti.
Dans toute grande entreprise d’élite, privée — ou même publique —, il existera un noyau de cadres du parti.
Le Grand Continent s’associe aux Éditions Gallimard pour ouvrir une nouvelle Bibliothèque consacrée à la géopolitique — Arnaud Miranda signe le premier volume de la collection.
Ces cadres — dissimulant leur identité — organisent au sein de l’organisation une cellule clandestine du parti. L’objectif de cette cellule est d’être si compétente et de s’entraider à un tel point qu’elle finit naturellement par prendre le contrôle de l’entreprise — puisqu’elle regroupe, de toute façon, les meilleurs éléments.
C’est un point essentiel de la pensée néoréactionnaire : l’ordre politique et social doit être le reflet des hiérarchies naturelles. Dans un monde débarrassé du progressisme et de la démocratie, les meilleurs éléments se retrouveraient naturellement au sommet de l’ordre politique.
Un seuil décisif est franchi lorsque le parti contrôle les recrutements, puis un autre lorsqu’il prend la main sur les ressources humaines dans leur ensemble. Pour constituer de véritables cellules, les cadres n’ont pas seulement besoin d’outils d’organisation comme une application de coordination du vote, mais aussi de véritables outils d’espionnage.
Après la transition, des cadres pourront se voir attribuer des fonctions dans le nouveau régime.
Ils débuteront sans expérience sectorielle particulière — ce qui n’est généralement pas seulement acceptable mais souvent carrément optimal. Dans la plupart des cas, une ignorance compétente et généraliste vaut largement mieux qu’une expertise spécialisée héritée de l’ancien régime. L’expérience acquise à faire ce qu’il ne fallait pas faire est presque impossible à effacer. Même les cadres loyaux qui opéraient sous couverture dans l’ancien régime devraient sans doute changer de département.
Et même si le rôle d’une nouvelle agence correspondait exactement à celui d’une ancienne à l’identique — ce qui est peu probable et, franchement, sous-optimal — il reste facile de récupérer, à l’aide de l’IA, les politiques et procédures de l’ancienne agence.
En tant que donateur, vous versez de l’argent au parti et vous recevez en retour des tokens.
Ces tokens sont des voix au sein d’un Soviet suprême — ou quelque chose du genre. Vous pouvez les utiliser pour voter si vous êtes à jour de vos impôts de parti — lesquels représentent 2 % de ce que vous payez à l’État — ou quelque chose du genre.
Enfin, un véritable parti politique parle d’une voix propre et pense par lui-même.
Si vous êtes consommateur d’information, vous recevez vos nouvelles du parti.
Si vous lisez des livres, le parti les écrit.
Si vous utilisez l’IA, le parti a entraîné sa propre IA.
Si vous consultez une encyclopédie en ligne, le parti dispose de sa propre version de Wikipédia.
Si vous aimez réfléchir à l’histoire, votre parti vous indique quels livres d’histoire lire.
Si vous aimez le cinéma, tous les meilleurs scénaristes et réalisateurs sont au parti — pour de bonnes raisons, puisqu’il peut très bien financer leurs productions.
Si vous avez des enfants et êtes en mesure de gérer leur éducation, le parti a un programme pour cela — plusieurs même, selon la religion.
Et bien sûr, un véritable parti possède une doctrine.
Bien avant de prendre le pouvoir, il sait exactement ce qu’il fera du pouvoir.
Cette doctrine n’est pas l’opinion collective des membres du parti : c’est un document rédigé par la direction. Le résumé est public. Le plan réel est privé. Une fois qu’il a été mis en œuvre, il peut être rendu public.
L’élaboration d’une doctrine fait ici encore écho aux partis fascistes — on pense à La Doctrine du fascisme de Mussolini. Cette obsession pour l’élaboration d’une doctrine travaille aussi le miléisme, avec le projet des Epistolas del Cielo.
À quoi sert un véritable parti ? Examinons-le en deux étapes de son cycle de vie : avant la prise du pouvoir, et après la prise du pouvoir.
Prendre le pouvoir : sans hard party
Imaginez que vous soyez président. Mais que vous ne disposiez pas d’un hard party.
Sans hard party, vous n’avez ni les outils nécessaires pour conquérir le pouvoir politique, ni ceux pour l’exercer.
Sans hard party, vous n’avez pas de corps d’officiers.
Vous êtes donc soumis à d’énormes contraintes pour pourvoir les postes d’un nouveau régime.
Si les candidats aux fonctions ne sont pas filtrés selon leur loyauté, votre administration se remplit de serpents.
S’ils le sont, le processus devient un goulot d’étranglement gigantesque, saturé de jeux d’appareil et de faux négatifs étranges. Vous n’avez même pas la possibilité de remplacer l’ancien gouvernement — vous n’avez pas le personnel pour cela. Tout ce que vous pouvez faire, c’est pourvoir les postes du « Plum Book », et même cela prend plus d’un an. La réponse est simple : ce travail aurait dû être accompli depuis longtemps.
Le Plum Book est l’annuaire des nominations des officiels à Washington.
Sans hard party, vous ne pouvez même pas envisager de contrôler les autres responsables politiques. Votre influence sur votre propre parti au Congrès est très faible. Vous ne pouvez ni remplacer ni même menacer les sénateurs ou représentants chevronnés. Ils disposent toujours de l’infrastructure nécessaire pour remporter leurs primaires. Se présenter au Congrès relève fondamentalement de l’artisanat. Les candidats aux primaires doivent surgir de la rue et bâtir eux-mêmes leur propre infrastructure.
L’engagement réel et passionné des électeurs est négligeable, même lors des élections sénatoriales. Tout se réduit à des dépenses en affiches publicitaires et à quelques formules choc. N’importe qui ayant un pouls peut se dire « républicain ». Si vous le dénigrez auprès de la presse, celle-ci flairera la discorde et offrira au « franc-tireur»une bonne couverture.
Tout cela est extrêmement lassant.
Vous ne disposez pas des outils pour conquérir le pouvoir politique parce que vos soutiens ne délèguent pas efficacement leur pouvoir vers le centre. Votre électorat est une foule, pas une armée. Dans la mesure où ils s’en soucient, ils tiennent à se sentir individuellement importants, pas collectivement efficaces. L’expérience entière de la politique de la foule virtuelle qu’est aujourd’hui la démocratie est composée de 5 % de réalité et de 95 % de divertissement politique — une stimulation vaine de l’instinct humain de puissance, qui rappelle à la fois les sports de spectacle et la pornographie au sens littéral.
Vos soutiens — même les plus passionnés — votent rarement aux élections de mi-mandat, et presque jamais aux primaires. Et même lorsqu’ils votent, ils ne comprennent pas pourquoi ils devraient se concentrer sur la loyauté plutôt que sur la « qualité du candidat ». En réalité, vous ne leur avez même pas dit qu’ils devaient vous donner davantage de pouvoir — sans parler de leur expliquer comment.
Sans hard party, dans un pays gouverné par les médias, vous ne disposez d’aucune infrastructure de communication propre : vous dépendez de votre ennemi pour atteindre vos soutiens.
C’est insensé.
Vous pouvez avoir des entreprises médiatiques sympathisantes. Mais vous n’avez aucun moyen de contrôler leur fiabilité ni leur qualité. Elles peuvent — et vont — mêler votre propagande à des inepties totales, ce qui rebutera nombre de vos soutiens potentiels les plus précieux, en particulier dans les classes sociales les plus élevées.
Il n’existe absolument aucune solution à ce problème.
Prendre le pouvoir : avec un hard party
Avec un hard party, la démocratie ne relève plus de la pornographie.
Les électeurs peuvent réellement prendre le pouvoir.
Imaginez que vous disposiez effectivement d’un hard party. Supposons qu’il compte 15 millions de membres loyaux. Supposons que les membres du parti constituent des votes fiables à chaque élection — fédérale, étatique, locale, tribale — générales comme primaires. Ce n’est pas un parti assez vaste pour prendre le pouvoir directement. Il ne peut pas gagner seul les élections. Mais il est suffisamment important pour représenter une force significative.
Voyons comment cette force peut fonctionner.
À chaque élection, le parti soutient exactement un candidat. Tous les membres du parti votent automatiquement pour ce candidat. Point final.
Tout cela sera, bien sûr, vérifié : si vous ne vous rendez même pas au bureau de vote et ne transmettez pas votre position à l’application — sans parler de prendre une photo du bulletin —, vous n’obtenez pas le badge d’électeur.
Vos nouveaux amis du parti le remarqueront et s’interrogeront. Vous pourriez même être exclu. À quoi pensiez-vous ?
Résultat : même lorsque le parti ne représente que 10 % des électeurs inscrits, il constitue l’un des blocs de vote les plus significatifs de n’importe quelle circonscription — peut-être comparable aux Polonais à Chicago ou aux gays dans le San Francisco des années 1970.
Ici, la référence semble encore être la stratégie fasciste de conquête du pouvoir. Avant la marche sur Rome, fin 1921, le Parti national fasciste rassemblait moins de 350 000 membres.
Et comme le parti impose une discipline de parti, ce bloc se déplace de manière parfaitement coordonnée. Le secret de la science politique démocratique, c’est que la solidarité collective frappe bien au-delà de son poids réel.
À chaque élection, le parti utilise ses propres procédures de décision pour orienter les actions de ses électeurs. S’il voulait organiser une « primaire»interne, il le pourrait. Mais ce serait stupide. Quoi qu’il en soit, ces actions incluent l’inscription au parti.
Si le parti estime qu’il peut avoir un impact plus positif, dans une circonscription donnée, en participant aux primaires démocrates plutôt qu’aux primaires républicaines, ses membres recevront l’ordre de s’inscrire comme démocrates. Pourquoi pas ? Les « démocrates»et les « républicains»ne sont pas de vrais partis — des hard parties. Ce ne sont que des étiquettes.
Qui se soucie des étiquettes ? Ce qui nous importe, c’est de gagner.
En 2025, les Somaliens disposaient de la force électorale nécessaire pour élire un maire somalien à Minneapolis. Mais le vote s’est divisé entre les clans darod et hawiye. Et puisque les Hawiye préféraient servir un Juif plutôt qu’un Darod, devinez quel clan l’a emporté ?
Si tous les Somaliens avaient d’abord tenu une élection somalienne, puis voté pour le vainqueur somalien, Minneapolis pourrait bien être aujourd’hui en route vers l’application complète de la loi islamique.
Un tel niveau d’adhésion à un hard party ne garantit pas des victoires prévisibles aux élections nationales.
Il ne permet pas au président de choisir littéralement son propre Congrès et de lui ordonner d’entériner mécaniquement son programme. Mais, s’il est habilement géré, il peut suffire à produire le même résultat.
Quoi qu’il en soit, dans la Silicon Valley, passer de 15 à 50 millions d’utilisateurs n’a jamais été le problème le plus difficile.
Avec 50 millions de membres, le président peut gagner presque toutes les élections au Congrès dès l’étape des primaires. Une fois l’élection nationale remportée, il n’a plus besoin de bricoler avec des décrets. Il peut écrire une loi le jeudi et la faire adopter le mardi suivant. Il peut « remplir»la Cour. Il peut gagner la partie — pas pour toujours, mais pour une génération.
Il peut alors, réellement, rendre à l’Amérique sa grandeur.
Supposons que vous disposiez de 50 millions de membres mais que vous ne soyez pas le président. Cela n’a aucune importance. Vous pouvez faire de n’importe qui un président.
Il n’est même pas nécessaire que ce soit un véritable poste : il fera ce que vous lui dites puisqu’il n’aura pas le choix. L’URSS avait d’ailleurs un président décoratif.
Quant à votre Congrès, il ressemblera au Soviet suprême ou au Parlement européen : une conversation insignifiante entre anonymes.
Sur Capitol Hill, tout le parti partagera une seule équipe de collaborateurs. Chaque représentant ou sénateur votera avec le parti, à chaque fois.
De plus, avec 50 millions de membres, nul besoin de compter sur des candidats au Congrès, aux assemblées d’État ou aux conseils locaux qui viendraient frapper d’eux-mêmes à la porte. Ils ne se recrutent pas : ils sont sélectionnés sur casting, comme AOC — et moins ils ont d’expérience politique, mieux c’est.
À l’image des députés de l’arrière-ban au Royaume-Uni, ils sont là simplement parce que le poste exige un visage et un nom.
Précision importante : il faut un joli visage et un nom raisonnablement immaculé.
Le candidat gagnant n’est un « homme d’État»ni un « législateur»en aucun sens — c’est juste un nom de papier — de sorte que quiconque s’inquiète de la « qualité du candidat»se moque de vous. Puisque c’est de toute façon ainsi que cela fonctionne, pourquoi ne pas composer avec la réalité ?
Prendre le pouvoir : l’expérience utilisateur
Mais les Américains accepteraient-ils vraiment cela ?
Je n’en ai aucune idée.
Toutefois, la politique est l’art du possible et les véritables professionnels de la politique opèrent au ras du bruit de fond de l’engagement. Les gens se soucient encore de l’élection vedette — la présidentielle. L’idée que des électeurs du XXIᵉ siècle entretiennent encore un attachement émotionnel aux épreuves de seconde partie de programme — le Congrès, la politique des États, etc. — devient de plus en plus invraisemblable.
Passer de cette situation à une sorte de parti à la mode des années 1930, communiste-fasciste, en chemises noires, défilant aux flambeaux, avec escadrons de la mort, centralisme démocratique et serments d’allégeance au chef, est, je l’admets, comique.
Outre le fait que Yarvin admet ici l’inspiration fasciste, la référence aux « partis à la mode des années 1930 » est un changement. Dans ses premiers textes, Yarvin fustigeait le nazisme et le fascisme pour leur populisme et leur étatisme.
On a déjà du mal à convaincre nos soutiens les plus acharnés de voter aux élections de mi-mandat — alors leur dire simplement pour qui voter semble hors de portée des techniques ordinaires de mobilisation politique. De même leur dire d’engager cent pour cent de leur énergie politique.
Du point de vue de la Silicon Valley, les techniques d’engagement des républicains relèvent du spam ou de l’arnaque téléphonique. Tout est du niveau des baies de goji et de « votre médecin déteste cette astuce de grand-mère ».
Quand vos idées apparaissent à côté de ce genre de publicités, vous savez que vous êtes morts.
C’est évident pour tout le monde. Et il est tout aussi évident pour toute personne intelligente qu’il n’existe aucune issue à ce piège.
Mais tout le monde oublie une chose.
Un hard party fonctionne parce qu’un hard party est, en réalité, amusant.
Les défilés avec des torches dans la rue étaient amusants aussi. Un hard party est un jeu. Les idéologies du XXe siècle l’étaient également. Vous pensez que ce n’était pas drôle d’être nazi ? Ou bolchevik ? Vous pensez vraiment que c’est aussi drôle que d’être républicain ? Les gens feront n’importe quoi — même voter — il suffit d’en faire un jeu.
Voter pour les républicains est aussi amusant qu’une pizza en carton — c’est-à-dire : pas très drôle.
Un hard party est drôle parce que c’est réel — ce n’est pas juste une arnaque pour piéger les boomers.
Dans les années 1930, il n’y avait pas Internet. Il n’y avait que la rue. Votre chemise était votre uniforme. Souvent, votre peau était votre uniforme. Les défilés fascistes ou communistes restaient un jeu — mais la rue était le seul endroit où l’on pouvait y jouer.
Dans les années 2020, les rues sont vides. Nous sommes tous à l’intérieur, rivés sur nos téléphones. Il nous faut une machinerie politique conçue pour aujourd’hui, non pour 1930 ni même pour 1960.
Le système politique du XXe siècle est un épiphénomène du complexe médiatico-éducatif du XXe siècle.
Pour l’essentiel du XXIe siècle, il sera inconcevable d’attendre que quiconque vote pour vous s’il n’a pas votre application sur son téléphone. Un électeur est un utilisateur. Un utilisateur est toute personne que vous pouvez notifier de manière fiable. Si vous pouvez faire sonner ou vibrer son téléphone, c’est un utilisateur.
Pourquoi un soutien ne serait-il pas un utilisateur ?
Soixante-quinze millions de « soutiens»qui, pourtant, ne vous soutiennent pas assez pour vous laisser leur dire quoi faire ? Même dans un cadre politique ? (Précision importante : cela n’a rien à voir avec 75 millions d’« abonnés»sur Twitter par algorithme interposé. Un tweet ne peut transmettre ni le degré d’engagement ni l’urgence nécessaires — pas plus que le spam par SMS. Votre liste de diffusion n’est pas une base d’utilisateurs.)
Le jour de l’élection — n’importe quelle élection, n’importe où en Amérique — tous les téléphones vibreront.
Tous les téléphones prendront votre position et votre agenda pour indiquer où, quand et comment voter.
Les gens iront à l’isoloir.
Ils feront en sorte que le bulletin ressemble à leur écran.
Ils prendront une photo du bulletin.
Ils recevront un badge dans l’application.
(Les bulletins par correspondance peuvent aussi être utilisés, s’ils existent encore — mais c’est, d’une certaine manière, moins amusant.)
C’est plus facile — pas plus difficile — que ce qu’on leur demande aujourd’hui. Le simple acte de vote mécanique — infiniment plus puissant que leur ancien vote indépendant — les libère définitivement de toutes les autres responsabilités civiques.
Ils n’ont plus besoin de suivre les « informations ».
Ils n’ont plus besoin de lire sur les « enjeux ».
Ils n’ont plus besoin de connaître les « candidats ».
Voter n’est pas une sorte d’exercice long et stressant, à la Norman Rockwell, fait de choix moraux profonds.
Ils ont fait un seul grand vote : rejoindre le parti.
L’acte concret de remplir les bulletins ne relève plus que de la saisie de données.
À terme, ils seront même déchargés de cette responsabilité.
Le parti se contentera de téléverser sa base de membres sur le serveur électoral.
Rien ne pourrait être plus simple.
L’expérience utilisateur ultime de l’électeur du XXIe siècle : vous votez une fois, pour un parti ou un chef, de manière permanente et transitive.
Oui, vous avez bien lu : transitive.
Une fois que vous avez choisi Trump comme chef, pour chaque élection à laquelle vous êtes éligible, vous votez automatiquement pour Trump.
Et si Trump, lui-même, n’a aucun intérêt à devenir le prochain chef du service de contrôle animalier du comté de Volusia, il doit bien connaître quelqu’un d’autre qui serait parfait pour ce poste.
Vous votez alors automatiquement pour cette personne.
Vous n’avez même pas besoin d’apprendre son nom — encore moins son curriculum vitae, son caractère moral, son bilan en matière de contrôle animalier, etc.
Que feriez-vous de cette information ? Vérifier une nouvelle fois si Trump a fait le bon choix ?
Votre engagement envers Sa Trumpitude est permanent.
Jusqu’à ce que vous changiez d’avis, bien sûr.
Vous pouvez toujours vous réinscrire comme croyant fanatique de Gavin Newsom.
Peu importe.
Mais le principe fondamental est le suivant : moins vous pouvez changer d’avis, plus votre vote est puissant.
Je le répète : moins vous pouvez changer d’avis, plus votre vote est puissant — parce que plus votre vote abandonne de pouvoir.
Exercer son pouvoir politique dans une démocratie représentative, c’est le déléguer à un représentant.
Moins cette délégation est conditionnelle, incertaine ou divisée, plus votre soutien est puissant.
Ce théorème, bien qu’évident, est si contre-intuitif qu’y réfléchir trop longtemps fait un peu mal à la tête.
Pensez au vote comme à une flèche : quand vous tirez la flèche, vous la perdez. Vous interroger sur la « qualité du candidat»revient en fait à poignarder avec des flèches. Si vous voulez créer de la puissance collective, tirez votre coup — et laissez-le partir.
Quand vous déléguez du pouvoir, vous le donnez, ce qui signifie que vous ne l’avez plus.
Votez pour être puissant — pas pour vous sentir puissant.
Voilà le grand secret.
Les gens passent facilement à côté parce qu’ils se préoccupent de leur lutte politique contre l’autre parti — et non de la lutte de la politique elle-même (la démocratie) contre la société civile (l’oligarchie).
Multiplier les élections renforce le contrôle des électeurs sur les responsables politiques.
Mais cela affaiblit le contrôle des responsables politiques sur le gouvernement.
Le second effet domine aisément le premier. C’est aussi pour cela que les « limitations de mandat»ne fonctionnent pas pour le populisme.
Si le pouvoir des représentants est fixe et absolu, il n’existe aucun moyen de le diminuer. Mais si les élus sont en concurrence avec une autre force, alors le pouvoir de la politique elle-même — c’est-à-dire le pouvoir de la démocratie elle-même — est profondément remis en cause. Et n’est-ce pas là, aujourd’hui, la seule question qui vaille — démocratie contre oligarchie ?
« Une république si vous pouvez la conserver », disait Franklin.
Aujourd’hui ce serait plutôt : une république si vous pouvez la reprendre.
Et même si vous parvenez à rassembler à grand-peine assez de force, l’espace d’un instant, pour la reprendre — vous n’avez absolument pas la force nécessaire pour la conserver.
Non : il faut la reprendre, puis aussitôt la donner.
À qui ? Un État à parti unique qui, lui, aura la force de la conserver.
Cela peut paraître invraisemblable. Ça l’est. Ce n’est toutefois pas impossible.
Rien d’autre, de fait n’est possible.
Je n’ai pas inventé ces équations — je les ai seulement trouvées.
Si vous y voyez des erreurs, dites-le-moi. Elles prédisent que ce que nous essayons aujourd’hui ne fonctionnera pas — ce qui semble désormais évident.
Même le président Trump n’a rien qui ressemble aux pouvoirs d’un véritable CEO — mais imaginez à quel point il en aurait peu s’il devait être élu à nouveau tous les jours.
Les sondages sont déjà bien assez pénibles.
De toute évidence, si le président pouvait être élu à vie, il serait bien plus puissant. Si les électeurs américains ne peuvent pas se voir confier le pouvoir d’élire un président à vie — un nouveau FDR — à quel pouvoir peut-on leur faire confiance ? À pas grand-chose, j’imagine.
Ce sera déjà bien assez difficile de « rendre sa grandeur à l’Amérique ».
Avec les pouvoirs qui sont les siens, dans le système actuel, c’est comme demander au président Trump de construire la Trump Tower avec des jouets de plage pour tout-petits.
Et si Trump est davantage un chef qu’un bâtisseur, Elon Musk ne ferait guère mieux : lui non plus n’a pas construit Starship avec des pelles en plastique.
La plupart des commentateurs conservateurs cherchent instinctivement à mettre leur public en colère.
C’est leur incitation : servir de la viande rouge à l’audience.
C’est ainsi que l’on fait croître un public.
Yarvin fait ici référence à la montée en puissance de l’influenceur antisémite d’alt-right Nick Fuentes, devenu une figure majeure de la sphère MAGA depuis la mort de Charlie Kirk. La stratégie de Fuentes consiste notamment à attaquer les trumpistes « modérés » (notamment Kirk, avant sa mort). Yarvin considère cette position comme un retour au trumpisme du premier mandat, empêtré dans sa stratégie populiste.
Mais rendre les gens plus furieux ne fonctionne pas.
Cela n’augmente pas la quantité de pouvoir que tous ces gens projettent vers Washington. Cela n’approfondit pas leur délégation de pouvoir. Peut-être cela les rend-il un peu plus enclins à voter — mais c’est un résultat purement binaire. La rhétorique démocratique laisse constamment entendre que des citoyens en colère pourraient entreprendre autre chose que voter, comme ils l’auraient fait dans l’Amérique du XVIIIe ou du XIXe siècle.
Spoiler : ils ne le feront pas.
Ce passage est implicitement une critique de l’attaque du Capitole comme une preuve que le coup d’État par la mobilisation populaire ne fonctionne pas. Yarvin recommande une stratégie élitiste, marque de la pensée néoréactionnaire.
Les Américains n’ont pas besoin d’être plus en colère. Il y a déjà assez de colère. De fait, n’importe quel commentateur du XIXe siècle — et même la plupart de ceux du XXe — aurait été stupéfait de voir à quel point les électeurs du XXIe siècle tolèrent — et parfois admirent — des gouvernements et des idéologies manifestement et explicitement hostiles à leurs intérêts à long terme, voire à leurs intérêts à court terme. (Chez les libéraux, voter en fonction de ses propres intérêts est même perçu comme un faux pas moral.)
Pour projeter davantage de pouvoir vers Washington, les Américains ont simplement besoin d’être mieux organisés.
Ils ont besoin de machines politiques plus efficaces.
Or nous continuons de faire de la politique comme si tout le monde regardait le journal télévisé du soir et recevait le journal papier lancé sur son perron par le fils du voisin à vélo.
Jouer à faire semblant que ce monde existe encore ne le fera pas revenir.
Ce qui le fera revenir, c’est d’être collectivement plus efficaces que nos adversaires.
La première étape consiste à comprendre qui ils sont et comment ils sont organisés.
Même si nous ne fonctionnerons jamais comme eux, nous devons comprendre les capacités de la gauche et nous mettre à leur niveau.
Prendre le pouvoir : l’opposition
Essentiellement, la gauche américaine est pour l’essentiel un hard party — et l’a toujours été, du moins du point de vue biographique de ceux qui sont aujourd’hui en vie.
Si elle n’a pas d’application de vote, c’est qu’elle n’en a pas besoin.
Il est probable qu’en 2020, les libéraux n’ont pas piraté les machines de vote.
Mais s’ils avaient pu le faire — et s’en tirer sans accroc — ils l’auraient fait.
De manière générale, ils se sont tirés d’affaire — et continuent de le faire — pour tout ce qu’ils peuvent ; et tout est conçu pour leur permettre de s’en tirer avec tout ce qu’ils peuvent. Il n’existe aucun frein moral à cette tendance, qui n’est d’ailleurs même pas consciente.
Parce que la gauche américaine — de Bill Clinton à Bill Ayers — forme un seul et même ensemble.
Et que le gauchisme américain, bien qu’il ne soit en rien centralisé, se comporte comme un hard party, puisque toutes ses croyances fondamentales ont évolué pour maximiser le pouvoir.
Il n’a pas de croyances fondamentales.
Il n’a qu’une seule méta-croyance : le pouvoir.
C’est ainsi qu’il peut pratiquer avec autant d’efficacité son mot d’ordre du « pas d’ennemis à gauche ».
Que peut accomplir la coordination décentralisée de la gauche ?
Personne ayant vécu l’année 2020 ne peut oublier la différence entre le 1er février — lorsque la ruche se moquait de l’obsession xénophobe et marginale de QAnon autour du « Kung Flu»et nous rappelait que, selon la science, la vraie grippe était le vrai danger — et le 1er mars, quand nous nous sommes soudain retrouvés dans un film de Michael Crichton et qu’il fallait préserver nos précieux fluides corporels.
N’était-ce pas frappant ? Et la transition fut à peine remarquée. C’était étrange à l’époque. Cela l’est encore plus avec le recul.
Mais le plus étrange, c’est que ce qui a provoqué ce basculement n’était lié à aucun événement de la pandémie.
C’était une décision inattendue du fantasque Donald Trump.
Il s’est soudain affiché, contre toute attente, comme une colombe du Covid. Pour exister, la gauche devait donc devenir faucon du Covid — ce qu’elle a fait. Instantanément ! (Seule la Suède a résisté à ce retournement — et elle a obtenu les meilleurs résultats.)
Tout le monde a tourné casaque en un clin d’œil — comme sous une forme de contrôle sans fil. Comme avec une puce. Dans le cerveau. Comme s’ils étaient des abeilles. Une intelligence décentralisée, effrayante, inhumaine.
Avant cet événement, j’ai longtemps cru que la fin de 1984 n’était pas réaliste.
La pensée grégaire est une réalité. La gauche peut agir avec une unanimité décentralisée délirante, que l’on ne voit d’ordinaire que dans le monde des insectes. Cette « pensée-ruche » possède une flexibilité préhensile qu’aucun esprit sincère ne peut assimiler.
Elle peut être ici pour un nationalisme du sang et du sol, et là pour un globalisme Disney à grande échelle.
Moralement nihiliste en son cœur, elle fera tout ce qu’elle peut tant qu’elle s’en tire.
La justice est toujours de son côté.
C’est pourquoi tous les gauchistes, même les plus modérés, n’ont « pas d’ennemis à gauche »— non pas qu’ils ne jetteront jamais un camarade sous le bus, mais cela relève toujours du personnel.
(Cette attitude s’étend jusqu’aux sommets les plus prestigieux du « centre droit »— songez au distingué penseur conservateur Robert George, de Princeton, anciennement de la Heritage Foundation. Tandis que Tucker Carlson est trop sulfureux pour la conscience délicate du professeur George, celui-ci se fait volontiers photographier avec Cornel West.)
Quel est le rôle des intellectuels dans cette situation ?
C’est d’expliquer à tous que la seule tâche de la droite américaine — ou de la droite dans n’importe quel pays occidental au début du XXIe siècle — est la prise de contrôle unilatérale, inconditionnelle et permanente de l’État en vue d’un régime entièrement nouveau.
Toute victoire en deçà de cet objectif — à moins qu’elle ne constitue une étape tactique dans un plan stratégique visant à l’atteindre — est en réalité une défaite, et très probablement un désastre.
Et puisque nous ne pouvons pas reproduire automatiquement cette coordination inconsciente de type « pensée-ruche », nous avons besoin de mécanismes de coordination réels, efficaces et solidement conçus.
Ils ont une ligne de parti.
Autrefois, elle était centralisée.
Aujourd’hui, elle est décentralisée.
Puisque le conservatisme décentralisé ne fonctionne pas, il nous faut une ligne de parti centralisée.
Une prise de contrôle inconditionnelle de l’État ne peut pas être obtenue par les mêmes mécanismes que la participation constitutionnelle.
En tant que normiecon, vous voyez Washington comme votre belle-mère narcissique, impossible, insupportable — et en plus alcoolique.
« Normiecon » est la contraction abrégée de normie conservative. Un normie est un suiveur, un tiède. Une fois de plus, Yarvin s’attaque aux conservateurs comme l’opposition contrôlée du système progressiste.
Puisque vous n’avez pas le choix et devez composer avec cette personne, votre rôle serait de la ramener à la raison — peut-être même à la sobriété. Une sorte d’intervention.
Mais c’est la famille. Et on respecte la famille.
Cette attitude est raisonnable dans ce cadre — le problème, c’est que ce n’est pas le vrai cadre.
La réalité est plutôt que votre véritable belle-mère est morte dans les années 1990.
Cette femme que vous appelez « Doris », c’est en fait un vampire égyptien vieux de 6 200 ans — appelons-le : Khemon-Ra.
Contrairement à ce que vous croyez, vous ne pouvez « intervenir»pour « changer » ou « raisonner » Khemon-Ra.
« Elle»n’est pas « narcissique»ni même « alcoolique ».
C’est juste une vampire chalcolithique classique — vous devez enfoncer un pieu en bois dans son cœur et le faire ressortir par les omoplates.
Pendant cette opération, elle pourrait toutefois être plus difficile à maîtriser que vous ne le pensez.
Appelez les amis que vous appelleriez si vous déménagiez.
Et demandez-leur de porter les vêtements qu’ils porteraient s’ils vous aidaient à repeindre votre cuisine.
Le pouvoir politique obéit à une formule simple : e = mc2.
L’énergie (e) est égale à la masse (m) — c’est-à-dire le nombre de partisans — multipliée par l’engagement — ce qu’ils sont prêts à faire : voter ? faire un don ? prendre les armes ? enfiler une veste suicide ? — multipliée par la cohésion — leur degré d’organisation.
Yarvin emploie souvent le terme « énergie » de manière énigmatique. Ici, il semble donner un semblant d’explication : l’énergie serait la capacité de mobilisation d’une masse à des fins stratégiques.
Nous devons maximiser ce nombre : e.
Au XXIe siècle, l’engagement est presque mort.
Nous ne pouvons pas lutter contre cette tendance. Pour la vaincre, nous devons avoir plus de cohésion que jamais.
Nous n’avons pas besoin d’être plus en colère.
Nous devons simplement être mieux organisés.
Mais pour nous organiser, nous devons vivre et agir dans la réalité politique du XXIe siècle, et non dans un fantasme prétendant provenir du XVIIIe siècle — ce qui ferait rire les hommes d’État du XVIIIe siècle s’ils pouvaient le voir.
Et nous devons cesser de penser que la politique ne concerne rien d’autre que la maximisation du pouvoir.
Lorsque nos ennemis nous accusent de penser ainsi, ils « projettent»et tentent de nous empêcher de le faire nous-mêmes.
Nous devons le faire — et le faire mieux.
Ce que nous faisons ne ressemblera pas à ce qu’ils font, car nous sommes différents.
Mais les principes de l’ingénierie politique sont intemporels et objectifs.
Le hard party au pouvoir
Jusqu’à ce que nous ayons gagné, le seul objectif est de gagner.
C’est un élément essentiel de la politique dure.
Quel est le bon moment pour prendre le pouvoir ?
Dès que possible — et jamais avant.
Je suis convaincu que Trump aurait pu, en théorie, faire littéralement n’importe quoi dans la semaine qui a suivi sa deuxième investiture.
Il n’avait ni plan ni infrastructure humaine pour le mettre en œuvre. Mais s’il l’avait eu ? Je pense qu’il aurait pu agir de manière arbitraire sans rencontrer aucune résistance, en s’appuyant sur une théorie parfaitement légitime de la souveraineté égale des pouvoirs, simplement en raison de la faiblesse de son opposition.
Comme l’a souligné Napoléon, il est important de concentrer toute son énergie au moment et à l’endroit décisifs.
Mais il ne fait aucun doute que le contrôle des pouvoirs législatif et exécutif constitue la norme absolue en matière de changement de régime légitime dans le système constitutionnel américain.
Avec 50 sénateurs et la Maison-Blanche, vous pouvez nommer autant de juges à la Cour suprême que vous le souhaitez.
La partie est terminée.
Voilà l’objectif à atteindre.
Dès que son pouvoir est total, le parti agit rapidement pour prendre le contrôle inconditionnel des anciennes institutions civiques. Son objectif est de mettre fin à l’ancien gouvernement et d’en créer un nouveau avec le minimum de chevauchement structurel et de perturbation des services.
Cela ne signifie pas pour autant pourvoir les postes « politiques », sauf pour des raisons juridiques. (Les questions juridiques relèvent toujours des « forces sur le terrain ».)
Que ces nominations doivent être effectuées ou même confirmées, rien ne doit entraver le déroulement concret de la transition.
Pendant la transition, le nouvel État a six tâches principales.
Premièrement : préserver tous les services essentiels.
Deuxièmement : centraliser toutes les ressources et les moyens de paiement de l’exécutif.
Troisièmement : fédéraliser toutes les organisations auxquelles l’État fait confiance, qu’il habilite ou qu’il subventionne.
Quatrièmement : fédéraliser l’ensemble du système financier, en convertissant les avoirs de chacun en dollars.
Cinquièmement : fédéraliser tous les gouvernements étatiques, locaux et tribaux.
Sixièmement : identifier biométriquement chaque être humain dans le pays.
Ces mesures confèrent à tout nouveau régime une souveraineté moderne totale.
Si ce niveau de centralisation inconditionnelle n’est pas nécessairement celui que nous visons dans un nouveau régime, il est toutefois indispensable dans tout processus de transition.
Toute forme d’autorité instable, divisée ou limitée est extrêmement dangereuse tant que cette opération n’est pas achevée.
Ces mesures éliminent toutes les instabilités et placent le nouveau régime en contrôle total de l’État et du pays — tout en permettant à la vie de continuer plus ou moins comme d’habitude à court terme.
À long et même à moyen terme, il devra changer radicalement et s’orienter vers la raison. Mais à court terme, personne ne devrait avoir de raison rationnelle de paniquer. Ils auront suffisamment de raisons irrationnelles.
Sous couvert de transition, Yarvin penche vers la défense d’une forme de régime totalitaire, qui semble bien loin de ses premières convictions libertariennes. L’objectif reste néanmoins de créer un désinvestissement de l’État à terme, excepté en ce qui concerne la sécurité du territoire et de la population, qui est la condition de possibilité d’un cadre libertarien au sens de Yarvin.
Plus important encore : à moins qu’elle ne s’inscrive dans une voie politique réaliste menant à un plan de cette envergure, l’autorité partielle est une tentation politique à laquelle il faut résister.
Les théoriciens des jeux connaissent la définition d’un coup gagnant. Un coup gagnant est un coup qui facilite tous les coups futurs. Chaque action sur la voie du pouvoir doit rendre le reste de cette voie plus plausible.
Un changement de régime n’est pas un massacre. C’est une opération chirurgicale.
On peut de nouveau lire entre ces lignes une critique de l’attaque du Capitole.
Le patient doit être soit anesthésié, soit immobilisé.
En 1945, en Allemagne, le patient a été immobilisé, maîtrisé par une violence écrasante.
Nous n’avons pas cette option.
Nous avons donc besoin d’une anesthésie.
L’anesthésie consiste à éliminer tous les moyens de résistance structurelle.
En matière de pouvoir, comme dans bien d’autres domaines, c’est l’opportunité qui crée l’énergie.
Plus un ancien régime s’affaiblit, moins il bénéficie de soutien — car la grande majorité de ce soutien n’était pas réel, mais simplement motivé par l’ambition.
Lorsque l’arbre tombe, les vignes s’effondrent.
Et rien ne sent plus mauvais qu’un régime mort.
Après juin 1945, le soutien au national-socialisme en Allemagne s’est limité à une minorité insignifiante et inoffensive.
La nécrophilie historique ne sera jamais qu’un fétiche de niche — et les morts récents sont d’ailleurs les plus répugnants.
Plus la démolition de l’ancien régime est irréversible, moins il peut résister ou revenir. Tout effacement incomplet des anciennes structures de pouvoir est un exutoire pour la résistance structurelle.
Le patient, politiquement endormi, n’a pas besoin d’être attaché à la table d’opération.
Le chirurgien, soucieux de faire le plus de bien et le moins de mal possible, peut se dépêcher sans se précipiter, ni se soucier de la sensation que lui procure son scalpel.
Son consentement est durable : il n’y a aucun moyen immédiat de le révoquer.
Pourquoi le patient tenterait-il de descendre de la table d’opération alors que son foie est à l’air libre ?
Si les centres de résistance potentielle ne sont pas immédiatement éliminés de la carte, ils créent leur propre énergie et deviennent des centres de résistance réelle.
Un changement de régime de droite doit mener le jeu dès le début.
En tant que système extropique, le temps ne joue pas en sa faveur.
L’entropie est naturellement progressive et/ou auto-entretenue : révolution rapide ou subversion lente.
L’extropie est tout le contraire.
Un changement de régime vers la droite est un pic d’énergie politique qui franchit un seuil et fait passer le système à un nouvel état stable et bénin.
Ce vocabulaire de l’entropie et de l’extropie présente, dans une veine schmittienne, l’histoire comme une lutte entre ordre et désordre, entre accélération et rétention (katechon). Cette vision est proche de celle de Peter Thiel.
Cette poussée demande plus d’énergie que beaucoup ne le pensent, mais elle ne doit être maintenue que momentanément. Et cette énergie n’est pas une violence chaotique et incohérente, mais une force pacifique et irrésistible.
Elle développera rapidement sa propre stabilité, mais seulement si elle est irrésistible.
Elle doit démontrer ce caractère irrésistible dans tous les domaines de la vie.
Qui se charge de toute cette réorganisation et comment ? Comment maintenir le fonctionnement du gouvernement tout en le restructurant complètement ? À quoi ressemble cette transformation sur le plan opérationnel ? C’est un vaste sujet, difficile à traiter de manière exhaustive dans un petit article Substack.
Pourtant…
D’une manière générale, les rouages de l’ancien État peuvent et doivent être actionnés de l’extérieur, à partir de ses systèmes et de ses documents.
Il n’est généralement pas nécessaire d’intégrer du personnel dans les bureaux existants, ni même de nouveaux utilisateurs dans les systèmes informatiques existants.
Idéalement, les systèmes informatiques existants peuvent être gelés et utilisés uniquement comme ressource.
Les points de service essentiels constituent une exception : ils doivent être extraits de la carcasse de l’ancien régime.
Cette description du désossement de l’État par noyautage fait certes écho à la stratégie fasciste du parti unique, mais aussi à la stratégie de l’entreprise Palantir. Il semble que Yarvin a ici précisément en tête le remplacement des services de sécurité nationale par une entreprise privée de gestion des données. Pour comprendre la stratégie de Palantir et sa visée politique, voir La République technologique d’Alex Karp.
Le nouvel État ne devrait pas être dirigé depuis l’ancienne capitale.
Il devrait être dirigé depuis une installation militaire fermée, selon des règles similaires à celles qui régissaient Los Alamos en temps de guerre.
Le personnel vivrait sur place, sans même avoir accès à Internet.
L’ensemble de la base serait une salle d’information de sécurité (SCIF).
Les membres du personnel ayant une famille pourraient les faire venir.
Tout le personnel devrait être membre du parti — même s’il est facile d’imaginer une procédure d’adhésion accélérée pour les spécialistes indispensables.
Certains membres du personnel déployés sur le terrain pourraient devoir se rendre dans les centres de données sur site afin de reconfigurer les pare-feux et de sécuriser les serveurs contre toute manipulation non autorisée.
Mais toutes les données sur site devraient être localisées, copiées, centralisées et les serveurs physiquement détruits.
Tous les dossiers papier en possession ou sous le contrôle du gouvernement américain devraient être numérisés puis détruits ou réarchivés.
Avant que toute installation du gouvernement américain puisse être mise hors service, toutes les données et tous les documents devraient être supprimés.
Si un membre du gouvernement américain a déjà rencontré des extraterrestres et a rédigé ne serait-ce qu’une note manuscrite sur une serviette à ce sujet, et que cette serviette se trouve dans un casier de self-stockage à Reno loué au nom de « John Bigbootie », le nouveau régime le saura.
La structure organisationnelle de l’ancien État n’a également aucune importance.
L’ancien État comprend deux parties : l’externe — militaire/diplomatique/renseignement/espace — et l’interne — tout le reste.
Ces deux parties ont des interdépendances relativement minimes et peuvent être redémarrées par de nouvelles organisations distinctes. Les anciennes frontières entre les agences n’ont toutefois aucune importance.
De même, la frontière entre les sous-traitants et les employés n’est pas pertinente : les sous-traitants qui ne peuvent plus payer leurs employés peuvent les transférer dans les registres de l’État.
Les contrats « privés»sont fondamentalement une fiction comptable : tout ce qui est financé par le gouvernement est une branche du gouvernement.
Le personnel de l’ancien État fait partie des nombreuses entités et personnes qui reçoivent des chèques de la gigantesque usine de traitement des salaires qu’est le gouvernement américain.
Si le traitement des salaires ne doit pas s’arrêter ni même être interrompu, la plupart des employés du gouvernement américain ne travaillent pas au traitement des chèques ni à aucun autre service essentiel.
À moins qu’ils ne soient nécessaires à la continuité d’un service quelconque, leurs identifiants ne fonctionneront pas et leurs cartes d’accès ne leur permettront pas d’entrer dans le bâtiment.
Mais le paiement de leurs salaires ne doivent pas être interrompus.
Le changement de régime n’est pas une mesure d’économie, du moins pas à court terme.
Non seulement ce groupe de bureaucrates soudainement inactifs ne représente en aucun cas une menace, mais il peut même constituer un atout.
En tant qu’êtres humains, les serviteurs de l’ancien État sont pour la plupart tout à fait acceptables.
Le problème venait de l’idéologie et des procédures.
Le nouveau régime étant organisé selon le principe de la responsabilité de mission et de l’unité de commandement, le personnel n’est pas une politique : il est là pour mettre en œuvre les directives.
Par conséquent, l’ancien personnel peut être réutilisé, en particulier dans différents domaines pour lesquels il doit être recyclé.
Il est facile de faire passer des tests de QI à tout le monde.
Encore une fois, on note l’obsession des néoréactionnaires pour les hiérarchies naturelles. On pourra ici se reporter aux textes de Spandrell, l’un des blogueurs pionniers de cette galaxie.
Ce qui est formidable avec l’État national-sécuritaire, c’est qu’à part son propre fonctionnement, il n’a littéralement aucun point de service direct.
Le gouvernement américain n’est engagé dans aucune guerre réelle.
Ses frontières réelles, ni même ses routes commerciales, ne sont menacées par aucune force.
L’ensemble de l’appareil sécuritaire national, à l’échelle mondiale, peut être fermé, sauf là où il est nécessaire de préserver des biens matériels.
Si, à long terme, cet aspect de l’État ne peut être négligé, à court terme, il peut l’être sans aucun problème.
(Les sources de renseignements humains existantes doivent être extraites rapidement, afin que tous les dossiers de l’empire puissent être publiés rapidement — la continuité de l’État signifie respecter les dettes et les obligations de l’ancien régime. L’une de ces obligations est d’assurer une retraite sûre à tous nos collaborateurs éloignés. Quelles que soient leurs motivations ou leur personnalité, ils appartiennent aux États-Unis. C’est un petit prix à payer pour la légitimité — et en outre, accepter cette offre confirmera leur place méprisable dans l’histoire.)
Dans le domaine militaire proprement dit, de nombreux actifs physiques devraient être conservés.
Certains documents techniques devront peut-être rester secrets.
De nombreux actifs physiques méritent d’être conservés, voire certaines stations de signalisation éloignées, sans oublier, bien sûr, les actifs spatiaux.
Les traditions militaires également — en particulier dans les académies militaires et les unités d’élite.
Sur le plan diplomatique, les services consulaires restent nécessaires à court terme.
Et certains travaux de renseignement peuvent même s’avérer précieux. La géopolitique n’est pas terminée !
Ce qui est révolu, c’est l’héritage de la « diplomatie du gain de fonction»du XXe siècle.
Si l’Amérique est à nouveau appelée à conquérir la planète, qu’il en soit ainsi, mais la prochaine fois, au moins, nous serons honnêtes, avec nous-mêmes et avec le monde, sur ce que nous faisons et pourquoi.
Actuellement, il est difficile d’en voir la nécessité.
Nous devrions toutefois conquérir l’espace et toujours construire les meilleurs robots de combat au monde.
Rien de tout cela n’implique un besoin militaire réel de porte-avions, de chars de combat principaux, de cavalerie à cheval ou d’autres anachronismes — aussi esthétiques soient-ils.
Au niveau national, le gouvernement américain est principalement une gigantesque machine à traiter les chèques. Les chèques doivent circuler. Idéalement, les obligations du gouvernement américain sont simplifiées et même titrisées. Votre sécurité sociale peut être évaluée comme une rente à un montant forfaitaire. Si ce n’est pas le cas, elle peut être modélisée comme une obligation.
Tout ce qui permet de la sortir de la catégorie des cadeaux politiques, dans laquelle elle se trouve aujourd’hui légalement, est bon à prendre.
Il est facile de voir qu’il est impossible de restructurer l’État sans restructurer ses finances.
Et comme les finances du secteur public sont inextricablement liées à celles du secteur privé, l’ensemble du système financier doit être restructuré d’un seul coup.
Il est facile de décrire l’objectif final de cette restructuration : un système financier de libre marché dans lequel (a) les taux d’intérêt à tous les termes sont fixés par l’offre et la demande ; (b) la quantité de monnaie est fixe ; © il n’y a pas de titres informels — tels que le « Greenspan put»dans les actions ou le « too big to fail»dans le secteur bancaire — ; et (d) il n’y a pas d’« investissement passif »— sur un marché efficace, seuls les spéculateurs parient.
Il est clair que cela implique un système de prix entièrement nouveau.
Il est également facile de décrire la contrainte à laquelle ce nouveau système doit répondre : aucun changement significatif dans le pouvoir d’achat de quiconque.
Pour l’essentiel, le gouvernement américain doit racheter tous ses titres informels et éliminer son besoin de gérer les marchés financiers — un processus de restructuration qui nécessite l’émission d’un grand nombre d’actions (dollars).
Mais comme un marché financier libre doit réévaluer les actifs financiers, la seule façon d’y parvenir est de les acquérir et de les revendre.
Lorsque vous ouvrirez votre portefeuille, vous verrez le même montant — mais entièrement en dollars. Même les prix de l’immobilier doivent être réévalués de cette manière.
Le retrait du financement de toutes les fondations et organisations à but non lucratif du XXe siècle contribuera grandement à relancer les arts, la culture, les idées et la politique.
Il ne s’agit pas d’organisations caritatives ou religieuses à proprement parler ; les rares qui le sont sont faciles à identifier.
Le gouvernement leur a accordé des avantages fiscaux parce qu’elles font partie du gouvernement, agissant comme le gouvernement dans « l’intérêt public », mais en dehors de tout contrôle gouvernemental.
Les nationaliser revient simplement à reconnaître leur statut réel.
On retrouve ici la critique de la Cathédrale, un concept cher à Yarvin. L’État démocratique serait une bureaucratie tentaculaire décentralisée, à laquelle participeraient médias et universités. L’idée serait de nationaliser ces entités afin de les démanteler, selon le fameux acronyme RAGE (« retire all government employees ») forgé par Yarvin et qui a vraisemblablement inspiré la création du DOGE.
Dans la phase de transition, les seules entités juridiques qui subsistent sont les particuliers et les petites entreprises.
Washington, en général, impose beaucoup de réglementations banales.
Certaines de ces réglementations sont sensées. D’autres sont absurdes.
Comme il est difficile de distinguer les unes des autres à première vue, il vaut mieux recruter une équipe entièrement nouvelle composée de personnes sensées pour rédiger de nouvelles réglementations sensées à partir de zéro.
Les anciens régulateurs — même les anciens lobbyistes, même les anciens militants — peuvent parfois être utiles en tant que sous-traitants dans ce processus.
Mais aucun des anciens groupes ne peut être chargé de quoi que ce soit. Jusqu’à ce que les nouvelles réglementations soient prêtes, les anciennes restent en vigueur.
Étant donné que la fusion des organismes parapublics entraînera la fusion de la presse grand public (subventionnée par des fuites et des embargos) et des universités (subventionnées pour la recherche et chargées d’élaborer des politiques), ces organismes puissants et dangereux doivent être gérés avec fermeté et de manière appropriée.
Les actifs des entreprises de presse sont transférés vers un nouveau département de l’information ; les universités constituent un nouveau département du savoir.
Enfin, un nouveau département de l’enseignement est nécessaire pour consolider l’enseignement primaire sous une gestion centrale.
Bien que rien ne puisse être sauvé du ministère de l’Information, celui-ci doit être remplacé par une institution publique correspondante avec des normes plus élevées.
Idéalement, bien avant d’arriver au pouvoir, le parti dispose déjà d’une telle institution.
Il n’est pas difficile de battre l’ancien régime à son propre jeu dans ce domaine.
Les anciennes normes du journalisme n’ont rien de répréhensible ; elles ont simplement été systématiquement contournées.
Les renouveler, c’est les battre — aussi durement que possible.
(La liberté d’expression ne doit pas être restreinte. Les anciens employés du ministère de l’Information sont encouragés à exercer leur éloquence sur leurs Substacks ou à devenir des YouTubers, s’ils ont encore quelque chose à dire. Comme ils n’ont plus de scoops, de sources, d’éditeurs, de fréquences de diffusion, de réseaux câblés ou de presses à imprimer, il faudra qu’ils fassent quelque chose de vraiment intéressant. Et évidemment, rien de faux ou de diffamatoire.)
En reconstruisant la quête organisée du savoir, aucun nouveau régime ne peut échapper à la tâche extrêmement complexe qui consiste à distinguer la science de la non-science, voire de la pseudoscience, qui sont toutes aujourd’hui regroupées, au plus haut niveau, sous le nom de « science ».
Lorsque nous appliquons ce terme à toute pensée rigoureuse, il doit également inclure l’histoire, l’économie et les sciences politiques.
La bonne nouvelle, c’est qu’il s’agit là d’une autre tâche que le parti peut entreprendre bien avant d’entrer en contact avec le pouvoir.
Mais comment un nouveau régime peut-il avoir un ministère de la Connaissance avant de savoir ce qu’il sait ?
C’est un problème que le parti doit résoudre bien avant d’avoir besoin de la solution.
En général, une bonne façon d’aborder le problème de l’audit scientifique consiste à faire appel à des universitaires confirmés, généralement âgés de 25 à 40 ans, et bien sûr politiquement fiables — heureusement, nous avons un vrai parti politique — issus de domaines plus quantitatifs et rigoureux.
Les mathématiciens peuvent interrompre leurs démonstrations suffisamment longtemps pour examiner attentivement où nous allons en physique, et les physiciens sont capables de vérifier la réalité dans presque tous les domaines.
De même, toute personne qui maîtrise les classiques est prête à étudier l’histoire et la politique.
Personne ne peut nier que le système médical américain est un désastre financier, administratif et réglementaire. Les médecins sont compétents, la technologie est performante. Mais rien de structurel ne mérite d’être conservé. Tout doit être reconstruit.
Un pays moderne a besoin de trois systèmes de santé distincts : un système caritatif de base financé par capitalisation, qui ne paie pas pour la propriété intellectuelle ; un système standardisé pour la classe moyenne, basé sur des niveaux d’assurance, qui paie pour la propriété intellectuelle ; et un système exécutif complet pour les riches, qui génère de la propriété intellectuelle — en expérimentant sur les riches.
Les arts, la littérature et les lettres doivent être complètement repensés à partir de zéro.
La solution est simple : éliminer toutes les institutions existantes, publiques ou privées, dans le domaine de l’édition et des arts.
Les arts eux-mêmes ne peuvent pas être et ne seront pas affectés.
Même s’ils étaient globalement bons, cette mesure ne pourrait pas leur nuire.
Cependant, le leadership artistique est un signe important de légitimité.
Un nouveau régime, confiant dans sa propre capacité à détecter l’excellence, pourrait juger utile d’exprimer cette capacité en parrainant les arts et les lettres afin d’établir une véritable norme en matière de goût.
Il ne faudrait pas croire que Yarvin se désintéresse du domaine artistique. Il considère d’ailleurs que la formation d’une nouvelle élite passe par l’appui d’une contre-culture subversive. Il est ainsi proche de nombreux artistes contemporains, que ce soit en Californie ou à Dimes Square à New York et avait même l’intention de prendre le contrôle du pavillon américain à la Biennale de Venise.
Si un régime qui échoue à ce test devient la risée de tous, celui qui le réussit figurera parmi les plus puissants de l’histoire.
Pensez au New Deal et à sa relation avec les arts, ou même à l’Europe de l’après-guerre au XXe siècle.
Pour vaincre l’oligarchie, il faut la dominer selon ses propres normes supposées.
Le nouveau régime hérite également du système scolaire primaire, nominalement local mais en réalité national, que l’ancien régime avait longtemps microgéré en secret.
Les écoles primaires ne peuvent pas être fermées pendant un an, ni même fermées du tout, mais elles auront besoin d’un programme scolaire entièrement nouveau. De nouveaux tests standardisés pour la sélection universitaire seront également nécessaires — et ils devront évoluer au rythme du nouveau programme scolaire.
Dans quatre ans, tous ceux qui postuleront dans les universités d’élite devront avoir suivi quatre ans de cours de grec et de latin.
Pourquoi pas ?
La meilleure façon pour une nouvelle élite de s’assurer sa position est de fixer des normes que les anciennes élites ne peuvent pas atteindre.
Une mesure de la capacité de tout nouveau régime consiste simplement à déterminer dans quel délai vous obtenez vos nouvelles plaques d’immatriculation nationales.
La fusion des administrations des États — les 50 Department for Motor Vehicles — est une tâche administrative aussi titanesque que banale.
Les États-Unis regorgent de structures inutiles comme celle-ci, multipliées par 50.
Presque aucune de ces variations n’a de contenu significatif.
Le fédéralisme au XXIe siècle n’est pour l’essentiel que du bruit.
Bien sûr, l’application de la loi est une prérogative importante des États et des collectivités locales.
Avant la fin du premier jour du nouveau régime, celui-ci doit disposer d’une autorité directe et tangible sur tous les agents assermentés chargés de l’application de la loi dans le pays.
Le deuxième jour, tous les policiers du pays doivent porter un signe improvisé indiquant la nouvelle chaîne de commandement. Cela peut être simplement un morceau de ruban adhésif bleu — à l’ukrainienne.
Cette réorganisation d’urgence de la police s’accompagne d’un système de tribunaux d’urgence.
Il est évidemment insensé de penser qu’un régime judiciaire et procédural peut être modifié sans remplacer ses tribunaux et ses juges. Certains d’entre eux sont sans doute des personnes honnêtes — mais comment le savoir ?
Ils portent tous la même robe noire en polyester. Ce n’est qu’un vêtement et cela ne fait pas d’eux ce qu’ils sont.
D’une manière générale, un bon moyen de doter en personnel un système de remplacement consiste à faire appel à des professions voisines, mais plus rigoureuses.
Tout comme les physiciens peuvent être remplacés systématiquement par des mathématiciens, les juges peuvent être remplacés systématiquement par des procureurs ou même des policiers.
N’oubliez pas que même les professions conventionnellement moyennes — comme celle de policier — peuvent être exploitées pour découvrir des talents cachés grâce à des tests de QI.
Il n’y a peut-être qu’un millier de policiers américains dont le QI est supérieur à 135.
Mais si nous parvenons à tous les réunir tous dans une même pièce, nous pourrons mettre fin à la criminalité pour toujours.
Nous n’avons pas seulement besoin de nouveaux juges, mais aussi de nouvelles lois.
Comment séparer le personnel et la procédure ? Conserver l’un revient à conserver l’autre.
Heureusement, les Américains ont enfin perdu leur vénération instinctive, héritée des Romains, pour leurs montagnes de parchemins anciens.
La plupart d’entre eux ne sont même pas de vénérables parchemins anciens mais simplement des documents obsolètes et bureaucratiques du XXe siècle.
Et dans un pays où l’ordre est si peu présent, le concept même de loi est une sorte de parodie.
Les États-Unis d’Amérique sont moins différents des « États-Unis du Mexique»qu’ils ne le pensent.
La transition ne peut même pas prétendre respecter l’ancien système juridique.
Rien n’est possible dans ces conditions.
Elle doit se dérouler dans le cadre d’un système juridique d’urgence simple, conçu pour être rapide et flexible : la loi martiale.
La loi martiale — qui se situe à mi-chemin entre la loi et le simple ordre — met fortement l’accent sur le pouvoir discrétionnaire et la responsabilité personnelle de ses juges. Une fois la transition stabilisée, elle pourra être remplacée par une nouvelle architecture juridique conçue par les meilleurs philosophes du parti en matière de jurisprudence — s’inspirant peut-être davantage du droit romain que de la common law.
En cas de doute, pour se débarrasser d’un virus, il faut juste changer de système d’exploitation.
Le solécisme politique du « gouvernement limité »— limité par qui ? Qui que soient ces limiteurs, ne font-ils pas partie du gouvernement ? — doit être complètement abandonné pour que cette transition réussisse.
Pour se défaire de cette illusion, il faut notamment abandonner certaines idées de « liberté»qui, en fait, ne mènent qu’au désordre, à l’anarchie et à la tyrannie.
La première d’entre elles est l’idée qu’un État souverain n’a pas besoin — voire ne devrait pas avoir — de système d’« identité nationale ».
En réalité, nous disposons d’un système national d’identification.
Il est juste terrible.
Il consiste à utiliser votre nom d’utilisateur comme mot de passe — et d’autres idées similaires qui devaient sembler sensées dans les années 1930.
Il comporte des problèmes tels que « l’usurpation d’identité », qui en 2025 devrait être aussi obsolète que le vol de chevaux.
L’idée générale ici est que l’affaiblissement de la souveraineté est un moyen de protéger la liberté.
En réalité, c’est l’inverse : seul l’ordre protège la liberté.
Chaque fois que le cancer de l’anarchie s’installe dans le monde, il en résulte la tyrannie, et non la liberté.
C’est pourquoi, dans le nouveau régime, tout le monde obtient la certification CLEAR. Vos iris sont scannés. Gratuitement. Vous obtenez également un profil ADN gratuit. Un rapport astrologique gratuit généré par l’IA vous dira même ce que signifient vos empreintes digitales.
Pour Yarvin, l’ordre et la sécurité sont des conditions de la liberté. Il écrivait, en 2010 : « La liberté — l’ordre spontané — est la forme ultime de l’ordre. »
Au XXIe siècle, vous n’avez pas le droit d’être inconnu de l’État.
Vous n’avez tout simplement pas ce droit.
Si le nouvel État choisit de ne pas « voir comme un État » (selon les termes de James C. Scott), ce n’est pas un État du tout.
Il n’a pas confiance en sa propre mission.
Personne ne lui fera confiance. Personne ne devrait lui faire confiance, et il sera sûrement renversé, s’il existe un jour.
La façon d’éviter d’avoir un État malveillant qui abusera de ce pouvoir est de ne pas avoir d’État malveillant.
Libertariens : n’avez-vous pas un État malveillant en ce moment ? À quoi pensez-vous ?
Ce passage pourrait être la définition de ce que nous appelons le postlibertarianisme : Yarvin s’accorde avec le paradigme libertarien, mais considère qu’il est inapplicable en dehors d’un cadre sécuritaire strict — en l’occurrence une technomonarchie.
De plus, il ne suffit pas d’identifier physiquement les Américains. Il faut également les classer socialement.
Si vous ne vouliez pas que ce fût le cas, vous auriez pu être l’Islande. Voir comme un État signifie un État qui voit la réalité, et non des illusions.
L’illusion selon laquelle les États-Unis seraient en quelque sorte un pays homogène, ou « unis par nos valeurs»ou quoi que ce soit d’autre, est une pure hallucination.
Sortir de cette illusion est un impératif urgent pour tout le monde — libéraux et conservateurs confondus.
Comment les gens peuvent réellement croire cela ? Quelle drogue prennent-ils ?
Objectivement, il n’existe évidemment pas de « citoyen américain ».
Ce bout de papier ne correspond à aucune généralisation significative sur les êtres humains. (On peut soutenir que cela n’a jamais été le cas dans l’histoire de l’Amérique du Nord anglophone. Les États ne sont plus aujourd’hui que des étiquettes. Ils ne l’ont certainement pas toujours été.)
Comment un État du XXIe siècle classe-t-il les êtres humains qui se trouvent à l’intérieur de ses frontières ?
Comme dans tous les pays, il existe deux types de personnes : celles qui sont fonctionnelles et celles qui ne le sont pas.
Les membres non fonctionnels de la société — quelle qu’en soit la raison — doivent être pris en charge, réhabilités ou placés en institution.
Évidemment, vous n’avez pas besoin d’être fonctionnel — que vous soyez jeune, âgé ou malade — si vous vivez dans une famille fonctionnelle ou une autre institution qui est prête à assumer la responsabilité de vous prendre en charge.
Le régime idéal aura un programme de réadaptation si efficace et sensé que les gens le suivront simplement parce qu’ils ne sont pas satisfaits de leur situation actuelle.
Voici le véritable « filet de sécurité » : tout adulte peut se présenter au bureau de poste et déclarer au gouvernement qu’il a renoncé à essayer de contrôler sa vie.
Quelqu’un viendra alors le chercher.
Et tout ira bien.
Le marché sera le suivant : il renoncera à toute liberté.
Il sera traité comme un enfant.
Il fera ce qu’on lui dit de faire.
Il n’aura pas la possibilité de prendre de mauvaises décisions.
Il vivra dans une communauté fermée et homogène, sous surveillance totale.
Après avoir acquis de nouvelles compétences — adaptées à ses capacités — et de nouvelles habitudes, il sera réintégré dans la société fonctionnelle, idéalement après un an ou deux.
Un gouvernement compétent, disposant d’une demande de main-d’œuvre suffisante — nous y reviendrons — peut faire fonctionner ce système avec n’importe quel être humain psychologiquement normal.
Bien sûr, tous les êtres humains ne sont pas psychologiquement normaux.
Les schizophrènes et les psychopathes doivent être placés dans des institutions sécurisées. Les personnes handicapées sans famille pour les prendre en charge ont besoin d’institutions ordinaires.
La destruction étrange des institutions offrant un soutien important est l’un des écarts les plus inexplicables de la gouvernance déviante de la fin du XXe siècle. En principe, il devrait être aussi rare de rencontrer un schizophrène dans les rues de Berkeley qu’un puma.
Mais il existe une deuxième manière de distinguer entre eux les êtres humains : moderne ou traditionnelle.
Même parmi les êtres humains fonctionnels du XXIe siècle, il existe deux types de personnes qui vivent de manière fondamentalement différente : celles qui vivent comme des atomes indépendants dans une société libérale et individualiste, et celles qui vivent comme des membres d’une communauté traditionnelle, suivant ses règles et obéissant à son autorité.
Ces deux modes de vie sont valables pour les êtres humains du XXIe siècle.
Le gouvernement doit les respecter et les encourager.
Cependant, il est important de ne pas brouiller les frontières entre les deux.
Perturber la tradition et les structures sociales et politiques traditionnelles est peut-être le vice le plus pernicieux du système gouvernemental moderne. Lorsque l’on observe les sous-sociétés traditionnelles qui ont réussi dans le monde moderne (comme les Amish), on constate qu’elles maintiennent toutes un isolement social complet par rapport à la modernité, et parfois même à la technologie.
L’indépendance traditionnelle serait donc plus facile si l’État la soutenait, au lieu de la menacer constamment.
Si vous êtes une personne fondamentalement moderne, un Américain diplômé de l’université, le gouvernement n’a aucune raison de se soucier de votre origine ethnique, familiale ou nationale.
Par définition, vous êtes un membre productif de la société.
Vous pouvez prendre soin de vous-même et ne causez aucun problème aux autres.
Mais ces normes ne sont pas facultatives.
Si vous cessez de les respecter, il est temps de vous réhabiliter.
Si vous n’êtes pas un Américain diplômé de l’université, on constatera invariablement que vous avez une forte affinité avec une culture historique spécifique, étrangère ou indigène.
Cette culture, si elle est encore légèrement intacte, aura des communautés et des leaders communautaires, généralement de nature religieuse, politique ou même criminelle.
Idéalement, le gouvernement n’interagira jamais directement avec vous, mais avec votre communauté, par l’intermédiaire de ses propres institutions.
En tant qu’Américain « communautaire » — au sens de membre d’une communauté — celle-ci est votre gouvernement.
Vous ne payez pas d’impôts.
Vous payez votre révérend, votre imam ou autre. C’est lui qui paie les impôts.
Si vous imposez des externalités à la société en dehors de votre communauté, c’est lui qui paie les amendes.
Vous pouvez être sûr qu’il se vengera sur vous, et il a certainement le pouvoir de le faire.
Vos enfants ne vont pas dans les écoles publiques. Ils vont dans les écoles communautaires. Le gouvernement effectuera juste quelques contrôles de bon sens pour s’assurer qu’on n’y enseigne rien de vraiment totalement insensé.
En général, les dirigeants d’une communauté traditionnelle doivent dialoguer avec le gouvernement laïc pour s’assurer que la communauté reste un atout pour l’État.
L’ensemble de ce passage peut sembler étonnant aux yeux d’un lecteur de Yarvin, puisqu’il semble opérer des concessions importantes au traditionalisme religieux. On peut voir dans cette tentative de conciliation entre modernité et tradition par patchwork une manière de trouver un accord avec les théoriciens postlibéraux. Le modèle néoréactionnaire de Yarvin s’accorde ici étrangement avec « l’option bénédictine » de Rod Dreher.
Elle doit certainement être un atout économique. Elle ne doit pas non plus être un handicap social.
Les comportements négatifs seront remarqués.
Si ne pas jeter de déchets dans la rue n’est pas une valeur de la communauté amish, cela doit devenir une valeur de la communauté amish — sinon la communauté amish se retrouvera dans un grand bus en route pour l’Allemagne.
Aucun nouveau régime ordonné ne peut tolérer que des étrangers errent au hasard en faisant des petits boulots — ou je ne sais quoi de pire encore.
Mais la plupart des pays occidentaux comptent une grande diversité de communautés étrangères.
Si un Américain non diplômé — là encore, les origines d’un cosmopolite n’ont par définition aucune importance — ne trouve pas de communauté prête à l’accueillir, il est certainement lié à un pays étranger et devrait simplement rentrer chez lui.
Si une communauté d’origine étrangère dans son ensemble n’est pas un atout pour l’État et la société, et ne peut pas le devenir, il est temps de la déplacer dans son ensemble.
Ce n’est pas un problème difficile à résoudre pour un gouvernement sérieux.
Cela ne nécessite aucun raid, aucune descente masquée à l’aube.
Il s’agit d’un processus totalement organisé et planifié, qui n’a rien de chaotique ni de cruel.
Enfin, quiconque hérite du pouvoir du gouvernement américain hérite également de son vaste réseau de prisons.
Bien sûr, il existe parmi les détenus de véritables psychopathes, des tueurs en série, des prédateurs d’enfants, etc., mais ce n’est pas le cas de la plupart des personnes incarcérées.
En général, elles se trouvent là parce qu’elles appartiennent à des sous-cultures criminelles et qu’elles se sont fait prendre un jour.
Ces sous-cultures criminelles existent à l’intérieur et à l’extérieur des prisons.
Il n’y a absolument aucune raison pour qu’une société civilisée les tolère.
Dans un sens, l’extrême gauche a raison au sujet de cet archipel de prisons : la plupart de ces personnes sont des prisonniers de guerre.
Et en général, gagner une guerre signifie que l’on peut libérer les prisonniers — avec une certaine prudence toutefois.
Les gangs classiques ont des structures organisationnelles souples et sont généralement alignés géographiquement avec les liens communautaires.
Déléguer la supervision stricte des criminels, voire des sous-cultures criminelles, aux dirigeants communautaires est un moyen de dissoudre en toute sécurité ces dystopies.
Bonne chance pour mener une vie de voyou quand vous devez travailler toute la journée dans une équipe d’aménagement paysager, que votre ministre prend la moitié de vos gains, que vous avez un AirTag agrafé à votre poignet et que votre urine est testée chaque semaine.
Détendez-vous, travaillez dur et profitez de l’amour infini de Jésus. Pourquoi serait-il important de savoir si cette personne était ou non l’auteur d’une fusillade au volant en 2015 ? Ce qui importe, c’est de lui offrir une vie structurée où il pourra s’épanouir et ne plus faire de mal.
(Mais si ses délits prouvent qu’il est en réalité un psychopathe né, c’est différent. Mon opinion, comme celle de la plupart des sociétés à travers l’histoire, est que les psychopathes devraient être exécutés.)
Gérer l’économie afin de garantir que la demande de main-d’œuvre corresponde à l’offre est une responsabilité essentielle de tout nouveau régime, même si cela ne peut être résolu immédiatement.
À l’ère des LLM et d’une robotique de plus en plus performante, il est difficile de savoir dans quels domaines la plupart des gens seront plus compétents que les robots — si tant est qu’il y en ait.
Mais le but d’une économie n’est pas seulement la consommation, c’est aussi la production.
Les êtres humains ont besoin de consommer, mais ils ont aussi besoin de produire.
Ce n’est pas seulement la quantité de la demande de main-d’œuvre qui pose problème, mais aussi sa qualité.
Dans un avenir hypertechnique, la vie devient un jeu vidéo auquel nous devons tous jouer.
S’il n’y a aucune raison pour que ce soit épuisant, il y a toutes les raisons pour que ce soit difficile, voire dangereux.
Un jeu sûr et facile n’est jamais vraiment un jeu.
En général, des restrictions sur les produits automatisés ou importés qui peuvent être fabriqués à l’aide de techniques artisanales – exigeant une main-d’œuvre qualifiée de haute qualité que la plupart des êtres humains peuvent être formés à exercer, et même apprécier d’exercer – peuvent être nécessaires pour éviter un avenir social et politique sombre où tout le monde serait inutile.
Les progrès technologiques devraient être utilisés pour permettre à davantage d’êtres humains d’exercer le métier pour lequel ils sont nés — et non pour créer davantage de luxes inutiles, distribués de manière inégale ou bureaucratique.
Nous en arrivons ici à des principes à plus long terme pour un nouveau régime.
Comme au baseball, chaque coup de batte doit être suivi d’effet.
Nous ne pouvons pas nous permettre beaucoup plus de petits coups.
Il est donc essentiel, même à court terme, d’avoir une vision claire de l’avenir lointain.
Conclusion
La politique est l’art du possible.
Tout cela est-il possible ? Y a-t-il quoi que ce soit de possible dans tout ce que je viens de décrire ?
En tant qu’expérience utilisateur, un hard party du XXIe siècle basé sur une application est à la fois plus facile et plus amusant que notre expérience politique du XXe siècle, basée sur la diffusion de messages.
Elle est plus facile, car vous pouvez cesser de prétendre être un « citoyen », de défendre des « causes », voire de lire les « actualités ».
Qui s’en soucie ? Tout cela n’est que divertissement.
Peu importe à qui que ce soit à quel point vous êtes « bien informé ».
Toute votre envie kantienne d’avoir un impact positif sur le monde est déléguée au parti.
« Altruisme efficace»signifie : soutenir le parti.
Et c’est plus amusant, parce que cela semble plus réel — parce que c’est plus réel et parce que c’est ce que cela prétend être : un gouvernement fantôme dont le but est de prendre le contrôle du gouvernement réel.
Le véritable obstacle à l’adoption de ce programme est qu’il exige de renoncer complètement aux rêves et aux prétentions avec lesquels vous avez grandi.
Il exige de rejeter complètement toute la mythologie politique américaine — qu’elle soit libérale, conservatrice ou libertarienne.
Il exige un saut intellectuel vers une position si éloignée du courant dominant que la plupart des gens ne peuvent même pas l’envisager.
Il existe deux façons d’amortir ce choc.
La première est la méthode straussienne : mener les gens sur cette voie sans leur dire où ils vont.
Comme tous ceux qui lisent cet article peuvent le constater, je ne suis vraiment pas straussien.
Je pense simplement que cela ne fonctionne pas à notre époque.
Ce qui arrive aux personnes qui infiltrent l’ancien régime à la manière de Strauss, c’est qu’elles repoussent le moment où elles révèlent leur niveau de pouvoir, jusqu’à ce que cela n’arrive jamais.
Il en va de même pour ceux qui créent de nouvelles organisations à la manière straussienne : le plan secret reste toujours secret.
Et ce n’est donc jamais un plan.
Indépendamment de ces considérations, toute tromperie est indigne de la faction de la vérité et ne peut que l’affaiblir dans la lutte.
L’autre voie consiste à réaliser que lorsqu’une porte se ferme, une autre s’ouvre.
Les Américains n’ont plus la vertu politique collective nécessaire pour faire fonctionner une république fédérée du XVIIIe siècle, une république nationale du XIXe siècle ou une république progressiste du XXe siècle.
Ces formes de gouvernement ne fonctionnent pas et ne peuvent pas fonctionner au XXIe siècle — simplement en raison des changements dans le caractère et la composition de la population.
C’est triste — mais quand une porte se ferme, une autre s’ouvre.
Réduire la politique à un réseau social avec un jeu en réalité augmentée est la chose la plus logique à faire au XXIe siècle.
Il en va de même pour demander à chacun de renoncer à ses vieux mythes politiques chers, voire de les profaner en approuvant leur contraire exact.
Rien n’était plus évident, pour moi et pour le monde dans lequel j’ai grandi, que la pire forme de gouvernement est l’État à parti unique.
Qu’avaient en commun Hitler et Staline ?
Voilà. Les libéraux, les conservateurs et les libertariens sont unanimes sur ce point.
Ils ont tous tort. Nous avons tous tort. L’Amérique a tort. Tout l’Occident a tort. L’empire post-1945 a tort. L’empire pré-1939 avait tort.
C’est pourquoi la Chine, Dubaï et Singapour nous surpassent largement en matière de qualité globale de gouvernance.
Les exemples cités incarnent les modèles politiques de la pensée néoréactionnaire. Aux côtés du centralisme chinois, cher à Nick Land, on retrouve les cités-États que Yarvin érigeait déjà en 2007 comme les prototypes de l’État-entreprise qu’il appelle de ses vœux.
Ces endroits devraient être des coins perdus et endormis.
Au lieu de cela, ils nous battent à notre propre jeu — et personne à Harvard ou à Yale n’a de théorie pour expliquer pourquoi.
C’est la façon que l’Histoire a trouvée pour nous dire qu’aucun empire n’est éternel et que quelque chose de nouveau doit être en train de se préparer.
Quand une porte se ferme, une autre s’ouvre.
Aucune société dans l’histoire n’a été aussi imprégnée d’un nihilisme frivole et ironique.
Nos ancêtres connaissaient l’Empire romain pour cette qualité. Les Romains de la fin de l’Empire n’avaient rien à nous envier en matière de nihilisme frivole et ironique.
À côté de nous, ils ressemblent à des puritains.
Nous pouvons rire de tout.
Il est d’ailleurs surprenant qu’il n’existe pas encore d’émissions de télévision où des gens se font tuer devant la caméra.
Cela ne saurait tarder. Ce sera sur Rumble. Ce sera incroyable.
Le jeu politique du parti-application est à la fois amusant et facile.
Le plus difficile sera de renoncer à notre ancienne politique du XXe siècle.
Une quantité surprenante d’ego est liée à l’idée que notre lapin des années 1930 — cette bête ancienne, scabreuse et obèse, le zombie sans tête de l’empire personnel de FDR — n’est pas seulement un chat, mais en fait le meilleur de tous les chats possibles.
Imaginez : vous vous considérez vraiment comme le plus grand amateur de chats, le propriétaire du félin le plus unique de l’histoire.
Et vous êtes censé remplacer cet animal incroyable par un chat tigré pris au hasard dans un refuge ? Un chat de rue vicieux, non stérilisé, atteint du sida des chats ?
Il vous transmettra le sida des chats.
Et pourtant, quand une porte se ferme, une autre s’ouvre.
Alors pourquoi pas ?
Pourquoi ne pas attraper le sida des chats ? Et si cela ne touchait que les chats ? C’est assez inoffensif. C’est même un moyen d’engager la conversation. Allez vers les filles et dites-leur votre nom. Puis dites-leur que vous avez le sida des chats. Ne vous inquiétez pas, c’est inoffensif. Cela ne se transmet même pas par un baiser. « Tu as aussi un chat ? Tu devrais peut-être faire un test. J’ai lu quelque part que même les plus jolies filles peuvent attraper le sida des chats… »
Bien sûr, une fois que votre client a adhéré à l’idée du sida des chats, vous êtes prêt à lui expliquer pourquoi, en réalité, non seulement votre chat est un vrai chat — sans rétrovirus gênant — mais pourquoi c’est aussi le meilleur chat de l’histoire.
C’est un chat et non un lapin — et il ne laisse pas de crottes dans vos céréales…
Voilà comment cela se passe quand on vend des idées politiques extrêmes à la génération Z.
La politique, c’est comme la vente — donc comme le sexe.
Je m’adresse aux gens de la génération Z : vous avez un monde à conquérir. Un siècle.
Apprenez à le vendre.
Mais aussi et surtout : faites-le.
Pour de vrai.