La Guerre de vingt ans, conversation avec Marc Hecker
Le 11-Septembre a ouvert une nouvelle ère, qui semble s'être refermée avec la chute de Kaboul. Que nous a appris cette période ? Quelles leçons en avons-nous tirées ?
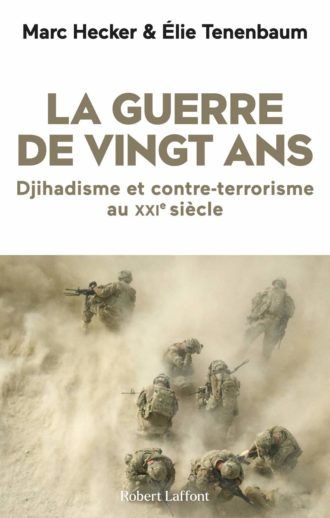
Nous aimerions commencer par l’Afghanistan. Le retrait du dernier soldat américain le 31 août valide votre thèse, mais comment intégrez-vous la chute rapide de Kaboul à votre cadre d’analyse ?
Nous avons terminé la rédaction de La Guerre de vingt ans en février 2021. Nous écrivions alors : « Après avoir signé les accords de Paris en 1973, le secrétaire d’Etat Henry Kissinger avait confié au président Nixon s’être surtout attaché à maintenir l’illusion d’un “intervalle décent” entre le retrait américain du Sud-Vietnam et l’inévitable chute de Saïgon, effectivement survenue deux ans plus tard. Le régime de Najibullah en Afghanistan avait pour sa part survécu trois ans au départ des troupes soviétiques. S’il est difficile de prédire la durée de l’“intervalle” jusqu’à une éventuelle victoire des Talibans, leur retour au pouvoir à Kaboul symboliserait assurément un camouflet historique pour la stratégie américaine de l’après-11 Septembre ».
La faiblesse du gouvernement afghan était connue, la force des Talibans également. Cela étant, nous avons été surpris d’un côté par la rapidité et l’efficacité de l’offensive talibane, et de l’autre par la débandade de l’armée nationale afghane. Nous étions loin d’imaginer le scénario de cet été avec la fuite du président Ashraf Ghani et l’arrivée au pouvoir des Talibans avant même le départ des troupes américaines. Pour les États-Unis et leurs alliés – dont la France, présente militairement en Afghanistan jusqu’en 2014 – c’est un échec cinglant, dont on ne mesure pas encore toutes les conséquences.
L’Afghanistan peut-il redevenir un sanctuaire international comme il l’était lors du premier régime taliban de 1996 à 2001 ?
C’est un risque difficile à évaluer. Les Talibans ont vraisemblablement maintenu des relations avec al-Qaïda au cours des deux dernières décennies. Dans l’accord de Doha de février 2020, ils se sont engagés à rompre ces liens, mais cet accord ne prévoyait aucun mécanisme de vérification. La présence de membres du réseau Haqqani dans le gouvernement intérimaire présenté le 7 septembre 2021 est un mauvais signe.
Les pays occidentaux ne sont pas les seuls à s’inquiéter. Les États de la région – comme l’Inde – redoutent également que l’Afghanistan ne redevienne un hub du terrorisme international. Les Talibans connaissent les lignes rouges de Washington à ce sujet et ils conservent le souvenir douloureux du début de l’opération Enduring Freedom en 2001. Ce souvenir sera-t-il suffisamment dissuasif ? Pour le moment, on ne le sait pas.
Une autre question a trait à la capacité des Talibans à contrôler l’ensemble du territoire afghan. On sait par exemple qu’ils sont opposés à Daech, mais auront-ils véritablement les moyens d’empêcher ce groupe de nuire ?
Vous avez terminé la rédaction de ce livre avant les annonces récentes du désengagement français au Sahel, du moins dans le modèle à forte dominance française qu’on connaît maintenant, pour porter vers un format plus européen. Au vu des résultats de Barkhane – très bons sur un plan tactique, moins sur un plan stratégique – est-ce qu’on peut espérer qu’un format européen soit plus efficace qu’un format français ?
Après le renversement rapide du régime des Talibans en 2001, personne ne pensait que la guerre allait se prolonger pendant vingt ans. On peut sensiblement faire la même remarque pour le Mali, mais avec un horizon temporel un peu plus réduit, puisque l’engagement français a débuté en 2013 avec l’opération Serval, et a ensuite opéré une transition vers Barkhane. L’opération Serval a rapidement été considérée comme un succès avec la « libération » du Nord du Mali qui était occupé par des djihadistes. Ce modèle d’intervention relativement léger et efficace a été observé avec beaucoup d’intérêt à l’étranger, y compris aux Etats-Unis. La suite s’est révélée plus compliquée.
Après le renversement rapide du régime des Talibans en 2001, personne ne pensait que la guerre allait se prolonger pendant vingt ans. On peut sensiblement faire la même remarque pour le Mali, mais avec un horizon temporel un peu plus réduit.
Marc Hecker
L’histoire de cette Guerre de vingt ans est en quelque sorte résumée sur le théâtre sahélien. Pour le dire de manière simpliste, les appareils militaires occidentaux sont efficaces pour détruire un sanctuaire djihadiste, traquer et entraver des réseaux terroristes. On a cependant beaucoup de mal à agir sur les causes profondes de ces conflits, d’autant que ces dernières sont débattues quasiment depuis le début de la « guerre globale contre le terrorisme ». Les observateurs se demandent notamment si les principales causes sont la mauvaise gouvernance, la pauvreté, l’injustice, le manque de dignité conféré aux populations, l’islam radical ou l’islamisme qui se répandent… Il semble en tout cas, au Sahel comme en Afghanistan, qu’on atteigne les limites de l’ingénierie politique et sociale des États occidentaux dans l’aire non-occidentale.
La reconfiguration du dispositif français est-elle liée à un effet de concomitance entre plusieurs événements ou y a-t-il une dimension plus structurelle ?
Évidemment, avant même ce qui vient de se passer en Afghanistan, il y a eu le double coup d’État au Mali et la mort d’Idriss Déby au Tchad, qui ont mis une pression supplémentaire sur les épaules des Français ; mais l’idée de reconfigurer Barkhane était dans les tuyaux depuis un bon moment. Je crois que le problème fondamental est que l’on constate les limites de l’efficacité de notre modèle d’intervention dans les conflits asymétriques, surtout lorsqu’ils se déroulent dans des aires culturelles éloignées. Un des défis supplémentaires au Sahel est la taille de la zone, avec des moyens français qui sont pas comparables à ceux des Américains. 5000 hommes déployés pour la France est conséquent, mais sur une région aussi vaste, cela ne permet pas de quadriller le territoire. La difficulté fondamentale est que la dynamique sécuritaire s’est profondément dégradée au cours des dernières années. On l’a vu avec les multiples attaques contre des forces de sécurité et de défense locales, et puis, de plus en plus, avec des massacres de populations civiles. Dans ce contexte, la France préfère réduire son dispositif pour se concentrer sur du contre-terrorisme au sens strict du terme, c’est-à-dire être capable de frapper les cadres djihadistes, et éventuellement de détruire un semblant de sanctuaire qui pourrait renaître dans ce vaste territoire.
L’ambition est revue à la baisse : il ne s’agit pas tant de peser sur les dynamiques sociales ou politiques que d’entraver l’action de groupes terroristes. On comprend progressivement que l’éradication de la menace n’est pas atteignable, mais que l’on peut au moins l’endiguer. Dans cette logique de reconfiguration et de désengagement partiel (l’adjectif est important) de la France, l’idée est aussi d’impliquer davantage les partenaires locaux : malheureusement, la « sahélisation », avec la création notamment du G5 Sahel a aussi montré ses limites. Par ailleurs, on a l’ « européanisation », en impliquant des partenaires européens, notamment dans la Task Force Takuba. Le fait de miser sur les forces spéciales montre bien que l’objectif essentiel est de faire du contre-terrorisme. Mais si l’on n’agit pas sur les facteurs fondamentaux qui nourrissent le djihadisme, la logique contre-terroriste risque de ressembler à un travail de Sisyphe.
Venons-en au titre du livre. Il affiche l’ambition de concilier la recherche de cohérence chronologique tout en écrivant une histoire du temps présent : comment avez-vous balisé l’écriture pour affronter cette difficulté ?
Mon co-auteur, Elie Tenenbaum, est historien, tandis que j’ai fait un doctorat de science politique. Au Centre des études de sécurité de l’Ifri, nous avons tous deux été formés aux strategic studies. Lorsque nous avons commencé à évoquer le projet d’un livre, en 2018, la thématique des « guerres sans fin » (endless wars) était encore présente dans le débat politique américain. Nous nous demandions si nous avions effectivement affaire à une guerre sans fin, ou s’il pouvait y avoir un terme à la « guerre globale contre le terrorisme ». Au fil du temps et de l’écriture, il nous a semblé que le cycle stratégique ouvert en 2001 touchait à sa fin. Nous avons rédigé les derniers chapitres au moment de la campagne électorale américaine. Joe Biden confirmait alors son intention de retirer les troupes américaines d’Afghanistan, ce qui nous semblait être une illustration forte de cette volonté de clore ce cycle de deux décennies. L’objectif annoncé de Biden était de se concentrer sur d’autres priorités stratégiques comme la montée en puissance de la Chine, ce qui était d’ailleurs déjà envisagé par l’administration Obama avec le « pivot vers l’Asie ». Le titre La Guerre de vingt ans s’est ainsi imposé.
La fin de la « guerre globale contre le terrorisme » ne signifie cependant pas que la menace a disparu, ni même que la lutte contre le terrorisme va s’arrêter. Les djihadistes sont toujours présents, actifs et déterminés. Nous essayons d’analyser leurs évolutions et leurs transformations. Nous sommes à cet égard dans une période de changements et d’incertitudes. Nous ne savons pas encore comment la menace va resurgir. Du côté du contre-terrorisme, la lutte se poursuit, y compris avec des moyens militaires, mais plus légers que ceux déployés en 2001 en Afghanistan, en 2003 en Irak, ou en 2014-2015 dans la zone syro-irakienne. C’est-à-dire qu’on est sur ce que Joe Biden appelait, lorsqu’il était vice-président sous Obama, du « contre-terrorisme plus », le trio : renseignement, drones, forces spéciales. Le « plus » correspond à la formation des armées locales, qui a été un des axes majeurs de ces vingt dernières années, et qui a eu des résultats pour le moins mitigés. L’effondrement de l’armée nationale afghane au cours de l’été en est une tragique illustration. Au Sahel, la formation des armées locales est également très compliquée.
La fin de la « guerre globale contre le terrorisme » ne signifie pas que la menace a disparu, ni même que la lutte contre le terrorisme va s’arrêter. Les djihadistes sont toujours présents, actifs et déterminés. Nous essayons d’analyser leurs évolutions et leurs transformations.
Marc Hecker
Dans l’idée de la Guerre de vingt ans, il y a aussi une certaine idée d’unicité de la menace. Il est difficile d’en donner une définition, mais peut-on aujourd’hui prévoir si elle va réapparaître, sous quelle forme, et est-ce que l’on appellera toujours terrorisme ?
On essaie de réfléchir à cette reconfiguration, mais la prospective est toujours compliquée. On raisonne souvent en prolongeant des tendances existantes, alors qu’il peut aussi y avoir des ruptures inattendues, des surprises stratégiques. Cela étant dit, il nous semble que la bipolarisation de la mouvance djihadiste est durable. La confrontation entre al-Qaïda et Daech apparaît comme un véritable schisme. Des acteurs tiers pourraient néanmoins émerger.
On pressent aussi que l’opposition entre groupes ayant des visées globales, et d’autres plus locales, risque de perdurer. Ce qui se passe autour de la poche d’Idlib en Syrie est intéressant à cet égard. En 2016-2017, lorsque Jabhat al-Nosra s’est allié à d’autres groupes locaux et a annoncé son intention de rompre avec al-Qaïda, beaucoup de chercheurs ont émis des doutes sur la réalité de cette rupture, pensant qu’il pouvait s’agir d’un leurre pour tenter de passer sous les écrans radar du contre-terrorisme. Quelques années plus tard, il semble bien que Hayat Tahrir al-Sham (nom de l’alliance intégrée par al-Nosra) se soit réellement distancié d’al-Qaïda pour se concentrer sur son projet islamiste local. Il faut toutefois demeurer prudent, car on a vu par le passé des groupes locaux s’internationaliser.
Notons que l’opposition local/global se retrouve au niveau du milieu de la recherche. D’un côté les spécialistes de la mouvance djihadiste au sens large ont une vision globale (on les appelle parfois, de façon un peu péjorative, les « djihadologues »). De l’autre, les spécialistes de certaines aires géographiques insistent souvent sur le caractère local et souvent ancestral des conflits. Ces spécialistes des area studies considèrent parfois qu’en insistant sur la dimension globale – par exemple en reprenant les appellations régionales des filiales d’al-Qaïda ou des provinces de Daech –, on fait le jeu de la propagande terroriste.
Cette période de vingt ans est-elle aussi celle du djihad « glocal » ?
La mouvance djihadiste internationale s’est démarquée justement par sa capacité à se greffer sur des conflits locaux. Il faut évidemment considérer les dynamiques locales, mais on ne peut ignorer la dimension internationale. Lorsqu’une filiale régionale est créée et que le logo d’une boîte de production d’al-Qaïda ou de Daech apparaît sur des vidéos de propagande, ce n’est généralement pas seulement un « coup de com’ ». Il y a souvent des dynamiques plus profondes, des rapprochements, des allégeances, des formes de soutien logistique ou financier. L’expression « djihad glocal » est employée au moins depuis la première décennie des années 2000, mais il nous semble qu’elle conserve une certaine validité.
Un autre point que l’on pressent pour l’avenir est la capacité de cette mouvance à innover. C’est un élément structurant, puisque le terrorisme est l’arme du faible, ce que Gérard Chaliand avait montré dans ses ouvrages il y a déjà bien longtemps. Les djihadistes sont persuadés de disposer d’une supériorité morale par rapport à leurs adversaires, ce qui fait qu’ils se projettent dans une guerre totale, tandis que les forces contre-terroristes occidentales sont dans une logique de guerre limitée. Certains spécialistes ont appelé ce phénomène « l’asymétrie des volontés ». Cette supériorité morale ne suffit pas à l’emporter : si le faible engage un choc frontal contre le fort, il sera vaincu. Ainsi, pour survivre – et encore plus pour user l’adversaire –, le faible doit utiliser une approche indirecte, des moyens détournés de porter des coups. Et pour surprendre l’adversaire, il doit innover. Al-Qaïda et Daech ont su innover à différents niveaux : stratégique, organisationnel et tactique.
Une dernière tendance que l’on peut anticiper est la poursuite de la dialectique provocation/surréaction. Pour avoir une chance de l’emporter, les terroristes misent non seulement sur leur détermination et leur capacité à déstabiliser l’adversaire, mais aussi sur cette dialectique susceptible d’entraîner une escalade de la violence difficile à maîtriser. La surréaction peut provenir soit des autorités, soit d’un pan de la société civile. On pense ici en particulier à l’ultra-droite.
Pour avoir une chance de l’emporter, les terroristes misent non seulement sur leur détermination et leur capacité à déstabiliser l’adversaire, mais aussi sur cette dialectique susceptible d’entraîner une escalade de la violence difficile à maîtriser. La surréaction peut provenir soit des autorités, soit d’un pan de la société civile.
Marc Hecker
L’opinion publique, dans cette guerre, est à la fois un vecteur sur lequel les États reposent pour obtenir un certain soutien, et un enjeu en soi car les djihadistes comptent dessus pour atteindre leurs objectifs. Comment avez-vous essayé d’intégrer cette dimension dans le livre ?
Terrorisme et communication sont intrinsèquement liés. Dire que les terroristes cherchent à terroriser est une lapalissade. Plus un attentat ou une exécution d’otage est médiatisé, plus l’effet de terreur sera important. D’une manière générale, la cible stratégique d’une attaque terroriste ne sont pas les victimes directes. Quand des passants sont ciblés au hasard dans la rue, c’est toute une communauté qui est visée – qu’il s’agisse d’une communauté nationale, ethnique ou encore religieuse. Dans certains cas, l’objectif des terroristes est que la population fasse pression sur les dirigeants pour obtenir un changement de stratégie, ou de positionnement, sur un dossier spécifique. Un exemple parlant est l’attentat de Madrid en 2004 qui a abouti à un changement de gouvernement et au retrait des troupes espagnoles d’Irak. C’est parce que la communication est importante que les terroristes visent souvent des cibles symboliques et optent pour des modes opératoires choquants.
Au-delà de cet aspect, la communication est essentielle car la guerre contre le terrorisme est aussi une « guerre des idées » où les perceptions jouent un rôle important. Dans le livre, nous essayons de montrer comment les djihadistes d’un côté et les pays occidentaux de l’autre ont déployé des structures et des méthodes visant à influer sur la sphère cognitive. Par exemple, les djihadistes ont utilisé Internet de façon remarquable pour propager leur idéologie, attirer de nouveaux sympathisants et susciter du « terrorisme d’inspiration ». Ils ont créé des sites web dès les années 1990, puis sont passés aux forums, aux réseaux sociaux, aujourd’hui aux applications chiffrées. La période des réseaux sociaux a été particulièrement frappante, car il s’agissait d’une stratégie de communication grand public. On a vu alors des combats filmés à la GoPro, des films de propagande reprenant les codes hollywoodiens, des webmagazines produits en plusieurs langues, etc…
A-t-on manqué en face d’un contre-discours ou d’un contre-récit suffisamment puissant dans les stratégies de lutte antiterroriste ?
Du côté des pays occidentaux, il y a eu plusieurs initiatives de contre-discours, émanant soit de gouvernements, soit de la société civile. Les initiatives gouvernementales ont parfois été raillées, à l’instar de « stop-djihadisme » en France. Les concepteurs de ces initiatives étaient conscients de leurs limites. Stop-djihadisme a tout de même contribué à faire connaître la thématique de la radicalisation et le numéro vert mis en place pour signaler des cas inquiétants.
Dans le livre, nous citons des sondages qui tendent à montrer que les efforts occidentaux de communication stratégique n’ont pas été totalement vains. Dans un premier temps – surtout à partir de la guerre en Irak de 2003 –, l’image des États-Unis s’est beaucoup dégradée dans le monde arabo-musulman et au-delà. Sur le plus long terme, on a pu voir l’image des États-Unis remonter, en particulier lorsque Barack Obama était au pouvoir, et la popularité des djihadistes a décliné dans les pays musulmans. En revanche, l’islamisme continue à bénéficier de nombreux soutiens.
En France, rétrospectivement, on a l’impression que ce cycle est certes fini, mais qu’on arrive dans une période électorale où le débat est monopolisé par des thèmes, pas nécessairement liés au contre-terrorisme, mais qui jouent sur l’imaginaire et le phantasme de la guerre civile, de la menace, etc. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette dimension interne ?
Il y a beaucoup de choses à dire sur la France. On peut partir du constat que le champ du combat est en train de s’élargir. On passe d’une logique sécuritaire de lutte contre le djihadisme à une approche plus sociétale d’entrave du « séparatisme ». Cette notion et cet élargissement font l’objet d’âpres débats qui n’épargnent pas le milieu académique. Il existe des oppositions fortes entre chercheurs. Les travaux de l’école de Gilles Kepel vont dans le sens d’une forme de continuum entre islamisme, séparatisme et djihadisme. Ils montrent, au-delà de la question du passage éventuel du salafisme au djihadisme, que l’islamisme est une idéologie subversive, qui en soi est dangereuse pour la cohésion de la République. D’autres chercheurs, à l’inverse, réfutent l’idée d’un continuum, et relativisent l’importance du développement de l’islamisme dans le pays. Dans le livre, nous ne tranchons pas le débat mais nous présentons les différentes positions en détail.
Dans le champ sociétal, on voit aussi qu’il existe une forme de dialectique entre djihadisme et extrême-droite. Ce point n’est pas spécifique à la France. En Europe et aux Etats-Unis, si on considère les toutes dernières années, les attentats les plus meurtriers proviennent de l’ultra-droite. On pense aussi au massacre perpétré dans deux mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande en 2019. Dans l’Hexagone, une demi-douzaine de projets d’attentats de l’ultra-droite ont été déjoués depuis 2015. La mouvance djihadiste est toujours évidemment présente dans notre pays avec un nombre d’attentats déjoués ou effectifs beaucoup plus important.
Comme les djihadistes ciblent la société française et que certains d’entre eux sont eux-mêmes français, la rhétorique de la guerre civile se développe. J’ai été marqué par la lecture successive de De l’idéologie islamique française – qui a un certain succès dans le milieu djihadiste – et d’un bréviaire de l’extrême-droite identitaire intitulé Guerre civile raciale. Cela fait froid dans le dos, car on sent bien cette dialectique, et on voit qu’il peut y avoir des dynamiques d’escalade dangereuses. La thèse de Guerre civile raciale est que, non seulement on se dirige vers une guerre civile, mais qu’il faut l’accélérer avant l’avènement du « grand remplacement » : c’est la thèse « accélérationniste ». D’une manière assez étonnante, ce manifeste est en vente libre, alors qu’on peut y lire de l’apologie du terrorisme, de l’incitation à la haine et au passage à l’acte.
Mon point n’est pas de dire que la guerre civile est inéluctable ni même probable dans notre pays, mais il faut être conscient que les doctrines et les volontés existent, à la fois du côté des djihadistes et de l’ultra-droite. L’espoir des tenants de cette thèse accélérationniste est qu’un attentat majeur contre les communautés musulmanes pourrait enclencher un phénomène d’escalade non maîtrisée conduisant jusqu’à la guerre civile. Le risque terroriste est réel, mais rien ne dit qu’un attentat de ce type enclencherait une mécanique de guerre civile. Notre société est peut-être plus résiliente que certains ne le pensent, mais les pouvoirs publics doivent anticiper les pires scénarios pour tenter de désamorcer les dynamiques d’escalade. Cela suppose de bien connaître les acteurs de terrain, notamment dans les quartiers sensibles, et de nouer des relations de confiance avec eux.
La thèse de Guerre civile raciale est que, non seulement on se dirige vers une guerre civile, mais qu’il faut l’accélérer avant l’avènement du « grand remplacement » : c’est la thèse « accélérationniste ». D’une manière assez étonnante, ce manifeste est en vente libre, alors qu’on peut y lire de l’apologie du terrorisme, de l’incitation à la haine et au passage à l’acte.
MarC Hecker
La Guerre de vingt ans est aussi associée à certains modes opératoires bien définis (attentat suicide, attaques à la bombe, fusillades). Est-ce que la fin de ce cycle correspond également à une fin de ces modes opératoires ? Peut-on voir apparaître des menaces avec des armes moins conventionnelles, du type bactériologiques, chimiques… Comment est-ce que l’on s’y prépare ?
La crainte du terrorisme « Nucléaire, Radiologique, Biologique et Chimique » (NRBC) n’est pas récente. Lorsque j’étais jeune assistant de recherche à l’Ifri, en 2005, nous avions accueilli Graham Allison. Ce dernier est surtout connu pour deux livres : L’essence de la décision et, plus récemment, Le piège de Thucydide. Mais à l’époque, dans les années post-11-Septembre marquées par la peur de l’hyperterrorisme, il venait de publier un ouvrage intitulé Nuclear Terrorism. The Ultimate Preventable Catastrophe. Je me souviens de sa présentation : il a projeté une carte de Paris avec des cercles concentriques indiquant les dégâts que provoquerait une « bombe sale » explosant à proximité de l’Assemblée nationale.
Les attentats contre le World Trade Center et le Pentagone ont ouvert le champ des possibles. La veille de ces attaques, si vous aviez présenté le scénario du 11-Septembre, on vous aurait ri au nez. L’attentat a pourtant eu lieu, et a été une surprise stratégique. A partir de là, plus personne n’a pu dire que tel ou tel scénario extrême était impossible. La probabilité était certes faible, mais elle n’était pas nulle. Nous sommes entrés dans l’ère du « risque terroriste élevé permanent », la notion de risque couplant la probabilité d’un événement avec sa gravité. Il faut ici évidemment distinguer le risque de la menace, mais ça a indéniablement été un changement majeur. Les pouvoirs publics ont d’ailleurs pris l’hypothèse du terrorisme NRBC au sérieux. Des tenues de protection ont par exemple été achetées pour les primo-intervenants, le nombre d’unités de décontamination a augmenté et des simulations de crises ont été organisées.
Aujourd’hui, la probabilité la plus élevée reste celle d’une attaque « low cost » classique, à l’arme blanche ou au véhicule-bélier. Toutefois, des incidents sporadiques rappellent que le risque terroriste NRBC existe. Pas plus tard que début septembre 2021, des bombes artisanales et des matériaux radioactifs ont été trouvés lors d’une perquisition dans le Haut-Rhin. D’après les informations de la presse quotidienne régionale, le principal suspect souffrait de troubles psychiatriques.
Quelles leçons polémologiques tirez-vous de cette Guerre de vingt ans ? Est-ce qu’elle correspond à la fin d’une manière de faire la guerre ?
La guerre irrégulière n’est qu’une partie de la guerre. Nous ne tirons pas de leçons polémologiques générales dans notre livre, mais nous essayons d’identifier des enseignements applicables aux conflits asymétriques. Nous faisons aussi le constat que nous entrons dans une période particulière où la lutte contre le terrorisme va devoir se poursuivre, alors même que la compétition stratégique entre grandes puissances devient la priorité des principaux dirigeants politiques et chefs militaires. Cela suppose que les armées disposent du matériel, des hommes et des compétences pour mener des opérations de natures très différentes, pouvant aller du contre-terrorisme à la guerre de haute intensité. Les difficultés rencontrées par les stratèges occidentaux au cours des deux dernières décennies semblent avoir durablement écarté le « regime change », le « state building » et la contre-insurrection. Mais on ne sait jamais ce que l’avenir nous réserve…

