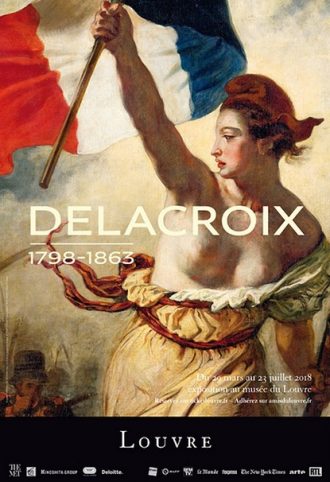Delacroix, lecteur européen moderne
« Delacroix marque le passage du peintre voyageur tel qu’il traverse l’Europe depuis la Renaissance à l’artiste-auteur qui fait de la toile un réseau moderne de relations entre nations. »
Se tiennent actuellement à Paris et jusqu’au 23 juillet deux expositions dédiées à Eugène Delacroix (1798-1863). Alors que se déroule au Musée du Louvre la plus grande rétrospective parisienne consacrée au peintre depuis 1963, le musée Eugène Delacroix propose « Une lutte moderne, de Delacroix à nos jours », exposition présentant les sources et la postérité européennes des décors que le peintre a réalisés pour la Chapelle des Saints-Anges de Saint Sulpice. Après une livraison de l’Euroscope consacrée au théâtre la semaine dernière, c’est l’occasion pour notre rubrique culturelle hebdomadaire gegflix de revenir avec une exploration de l’imaginaire européen, à la fois littéraire et pictural, d’Eugène Delacroix. Dominique de Font-Réaulx, directrice du musée Eugène Delacroix, et Alice de Charentenay, docteure en littérature française, y démontrent que la modernité de l’œuvre de Delacroix provient largement de l’élargissement de ses horizons culturels à l’échelle de l’Europe et du rapport singulier qu’il entretenait avec la littérature de tout le continent.
La mémoire collective associe souvent Eugène Delacroix (1798-1863) à son goût pour l’Orient, apparu très tôt dans son parcours. Son voyage de sept mois au Maroc et en Algérie, où il accompagna en 1832 une mission diplomatique du comte de Mornay, demeure comme le parangon du voyage d’artiste : il en rapporta un ensemble d’objets, de couleurs et de croquis qui furent autant de sources inépuisables pour son travail postérieur, des Femmes d’Alger dans leur appartement en 1834 à sa dernière œuvre, une Lionne prête à s’élancer peinte en juin 1863. Ce goût de Delacroix pour l’Orient a fait l’objet de nombreuses expositions 1.
Or la place de l’Orient dans l’itinéraire du peintre pourrait être saisie par opposition à un autre voyage, jamais accompli, en Italie. Elle en semble un palliatif moins académique, plus moderne, plus napoléonien également. Alors que le cursus honorum classique des étudiants des Beaux-Arts se couronne depuis le XVIIe siècle par cinq années à l’Académie de France à Rome consacrées à copier les maîtres, Delacroix, lui, ne franchit pas les Alpes et cherche directement un public et des commandes sur le marché parisien. L’Italie demeure pour lui un idéal, d’ailleurs très présent dans son œuvre peint, notamment grâce au Louvre : le palais, livré au public par la volonté expresse de la Convention en 1793, a vocation à dévoiler aux citoyens les trésors des cultures conquises par la République. Les traités de Tolentino puis de Campo-Formio, qui entérinent les victoires du général Bonaparte en Italie, prévoient le transfert des trésors de la peinture italienne et notamment vaticane au Louvre. Delacroix y admira ainsi Raphaël, Titien, Solimena ; c’est à Paris qu’il fréquenta de plus près ces maîtres italiens, entre autres 2.
Cette influence italienne diffusée par le musée se fait sentir chez Delacroix dans deux registres principaux. D’une part, dans des natures mortes et des compositions florales qui puisent leur variété dans la veine caravagesque ; d’autre part, dans les imposants décors de commande qui s’inspirent de la grande peinture historique transalpine. La scène de guerre dont il orne en 1843 un des culs-de-four de l’actuelle bibliothèque de l’Assemblée Nationale ne représente-t-elle pas Attila foulant aux pieds de son cheval l’Italie, double synecdoque de la barbarie s’en prenant aux arts ? C’est dire la solidité de l’identification entre la péninsule et l’imaginaire pictural européen.
Si Delacroix rompt avec l’usage académique bien ancré du voyage en Italie pour y substituer la fréquentation du Louvre, il s’appuie également sur deux moyens plus conventionnels pour fréquenter les arts classiques. Le premier est la circulation de copies, notamment par la gravure, moyen courant de connaître les œuvres qui a été celui de toutes les générations qui l’ont précédé : tous les étudiants en arts connaissent la peinture flamande grâce aux gravures du Hollandais Pieter Soutman (1580-1657) ou du Francfortois Matthäus Merian (1593-1650). L’importance du musée n’en est que renforcée : les gravures ne se substituent plus aux originaux mais en conservent le souvenir.
Le second moyen par lequel il fréquente l’art européen, plus occasionnel car Delacroix est un grand casanier, est le voyage : dans une Europe pacifiée, au sein de laquelle la vapeur rétrécit progressivement les distances, voyager marque moins une rupture de carrière qu’une étape ponctuelle. Delacroix se rend ainsi à Londres en 1825. C’est au British Museum qu’il admire les métopes du Parthénon, tout juste importés par Lord Elgin ; il dessine et lithographie certains des marbres et en conservera toute sa vie des copies dans ses différents ateliers : diplomatie, voyage, copie, musée s’unissent pour former une culture classique ample et européenne. L’Angleterre lui présente en outre un rapport entre les genres picturaux beaucoup moins cloisonné, et une liberté qui l’inspire dès son retour notamment pour répondre à des commandes de portraits, comme celle du baron Schwiter en 1826. En 1850, il retrouve à Bruxelles et à Anvers les Rubens in situ dont il goûte le travail sur les corps et leurs mouvements. Son ambition devient de « réconcilier Raphaël et Rubens », ce dont témoigne un travail à mi-chemin entre l’Europe du Sud et du Nord, entre les sujets mythologiques et les sujets religieux. Delacroix appartient donc à cette première génération de peintres sortie du lycée impérial à la chute du régime et dont les conquêtes napoléoniennes ont élargi l’horizon, assoupli les frontières, et accéléré les circulations.
Or au sein de cette génération qui voit s’accélérer le rythme de la circulation des œuvres, ce par quoi Delacroix apparaît peut-être le plus moderne est son rapport à la peinture, saisie à travers un dialogue constant avec les autres arts. Il se démarque en particulier par son rapport à la littérature, art tout aussi prolifique mais inscrit dans un temps plus long et appuyé sur la durée du souvenir.
Plus discrètement mais non moins foncièrement que son admiration pour ses maîtres en peinture, les lectures de Delacroix le situent dans un imaginaire européen, et les textes déterminent une veine essentielle et moderne de son travail. Il faut en revenir à son premier tableau exposé, en 1822, Dante et Virgile aux enfers. L’inspiration des poètes italiens y est revendiquée non plus selon un rapport d’illustration, mais comme une appropriation. L’incarnation des deux poètes, l’aspect visible du travail peint, choque les contemporains par sa matérialité. Et c’est sur ce va-et-vient entre une culture européenne qui le rapproche des classiques et un désir d’authenticité et de corporéité foncièrement romantique que Delacroix construit un art moderne. Ses références courantes à l’Arioste, à Goethe, à Shakespeare surtout, aux mythes ovidiens, dévoilent une identité culturelle qui n’a rien de strictement national, et que ne saurait occulter le drapeau tricolore brandi par La Liberté guidant le peuple.
Il faut rappeler combien l’imaginaire oriental auquel le nom de Delacroix est tant associé, s’il a été alimenté par le voyage, a d’abord été un fantasme littéraire. La scène démesurée et violente de La Mort de Sardanapale, en 1827, puise directement son sujet dans un drame éponyme de Lord Byron paru quelques années plus tôt. La mise en scène du tableau revendique les mêmes contrastes violents et la même couleur locale dont Hugo fait l’éloge par écrit et sur scène. La fascination de Delacroix pour l’Angleterre, pour sa littérature et tout particulièrement pour le personnage d’Hamlet, contribue à l’élaboration d’un romantisme qui déborde la simple nostalgie de l’Ancien régime et promeut une révolution dans les formes qu’on appellera bientôt modernité, même si elle n’est que trop souvent datée de juin 1848. Le goût de la littérature de Delacroix lui confie de changer l’imaginaire qui s’élabore désormais à l’échelle européenne en une iconothèque renouvelée, et fondée notamment sur la matérialité des corps. Mais il le protège également d’une façon tout à fait paradoxale contre la déception du voyage, toujours frappé de mélancolie.
L’itinéraire géographique européen de Delacroix se double donc d’une circulation imaginaire à travers les époques que Delacroix entrecroise sur la toile, à la manière d’un voyage dans sa propre mémoire, en particulier dans la dernière époque de son travail.
En 1855, il lui est rendu hommage au sein de l’Exposition universelle, la première organisée à Paris. Trente-cinq de ses toiles sont présentées sous forme de rétrospective. Le critique Baudelaire y remarque :
« Une autre qualité, très-grande, très-vaste, du talent de M. Delacroix, et qui fait de lui le peintre aimé des poëtes, c’est qu’il est essentiellement littéraire. Non seulement sa peinture a parcouru, toujours avec succès, le champ des hautes littératures, non seulement elle a traduit, elle a fréquenté Arioste, Byron, Dante, Walter Scott, Shakspeare (sic), mais elle sait révéler des idées d’un ordre plus élevé, plus fines, plus profondes que la plupart des peintures modernes. » 3.
Charles Baudelaire, Exposition universelle de 1855, III. Delacroix
Ce talent littéraire de Delacroix le mène à la synesthésie, valeur baudelairienne par excellence, et à l’idée au-delà de la sensation ; or il offre aussi la source d’un renouvellement de sa peinture, à l’heure où la renommée et la consécration du public promettaient de l’embaumer tout vif dans l’image des grands retentissements romantiques. Ainsi, en 1859, à soixante-et-un ans, Delacroix revient-il au Salon présenter des toiles qui déconcertent un public pourtant fidèle : Rebecca enlevée par le Templier, sujet tiré de l’Ivanhoë de Walter Scott, ou La Jérusalem délivrée paraissent des sujets dépassés et anti-modernes à l’heure du triomphe réaliste d’un Courbet. Ovide chez les Scythes, qui fait la part belle à une nature idéalisée, se présente comme le type même du tableau anti-naturaliste. Sur la toile, le poète latin civilise les barbares qui l’ont recueilli, sujet qui sonne comme une profession de foi qu’annonce bien son caractère antique.
Delacroix refuse en fait de sacrifier la beauté à la précision documentaire comme le propose, de façon bien trop tonitruante à ses yeux, l’école réaliste. Là où celle-ci sature la toile de détails authentiques, le cadre de Delacroix semble se vider et faire de l’objet un motif éloigné, comme à distance de souvenir. La mémoire préserve la singularité de l’objet et promeut son évocation plus qu’une préhension réaliste ou une exhibition brutale. Ce faisant, elle laisse un espace à la subjectivité, voire à la psyché, et l’évocation de sujets littéraires c’est-à-dire toujours imaginaires, s’y prête particulièrement. Grand lecteur qui se rêvait dans sa jeunesse en auteur 4, Delacroix s’appuie à l’hiver de sa vie sur un jeu de la remémoration qui ne peut qu’évoquer, pour un analyste de notre temps, celui sur lequel Marcel Proust a ensuite bâti son roman en forme de cathédrale.
C’est au titre de ce travail sur la mémoire plutôt que du fait de l’aspect dépaysant du sujet qu’il faut comprendre son choix de placer La Lutte de Jacob et de l’ange sous un chêne séculaire d’Île-de-France, semblable à ceux qu’il croque autour de sa maison de Champrosay. Plus qu’une recherche d’exotisme qui exacerberait le pittoresque du lointain, Delacroix semble à la recherche de ce qui demeure étranger dans le familier, et ouvre la possibilité d’une exploration de l’intime comme d’un pays lointain. Le souvenir littéraire offre la possibilité de tenir ensemble l’imaginaire et sa réalisation, le passé et son actualisation, l’étranger et le prochain.
Faut-il voir dans ce rapport à la culture européenne, romantique, napoléonienne, la source du succès d’Eugène Delacroix à travers le continent ? Il serait excessif de réduire Delacroix au pur produit de l’unification napoléonienne d’Europe de l’Ouest, à une sorte de ruse de la raison picturale. Mais il convient de souligner d’une part ce que sa trajectoire manifeste comme élargissement des sources imaginaires, et d’autre part que la littérature y joue un rôle crucial : la singularité de Delacroix est de lier littérature classique et littérature de son temps, littérature étrangère et lectures parisiennes.
La dimension temporelle de cet imaginaire fondé sur le souvenir inspire ses émules à travers le continent : les artistes français Henri Fantin-Latour, Gustave Moreau, Paul Cézanne ou Paul Gauguin, Pablo Picasso qui reprend Les Femmes d’Alger, Marc Chagall qui cite la lutte de Jacob et l’ange en la situant lui aussi dans la sphère intime de sa ville natale de Vitebsk, mais encore, moins cités, l’Écossais William Strang et le Lituanien Jacques Lipchitz, qui comme Delacroix ont cherché à donner chair à leur sujet tout en l’inscrivant dans une forme de durée, de distance du souvenir. Delacroix marque ainsi le passage du peintre voyageur tel qu’il traverse l’Europe depuis la Renaissance 5 à l’artiste-auteur qui fait de la toile un réseau moderne de relations entre nations et entre les arts marqué par la durée du souvenir.
Sources
- Voir les expositions de l’Institut du Monde Arabe « Delacroix au Maroc », du 27 septembre 1994 au 15 janvier 1995, et « De Delacroix à Renoir, l’Algérie des peintres », du 7 octobre 2003 au 18 janvier 2004, ainsi que « Objets dans la peinture, souvenir du Maroc », du 5 novembre 2014 au 2 février 2015 au musée Delacroix.
- Voir l’exposition « Copier créer : De Turner à Picasso, trois cents œuvres inspirées par les maîtres du Louvre », du 26 avril au 26 juillet 1993.
- Charles Baudelaire, Exposition universelle de 1855, « III. Delacroix ».
- Voir l’édition récente des œuvres littéraires d’Eugène Delacroix parue chez Flammarion. Eugène Delacroix, Les Dangers de la cour suivi de Alfred et de Victoria, sous la direction de Dominique de Font-Réaulx et Servane Dargnies, Flammarion, 2018.
- Voir le cours sur L’Europe des Images que Victor Stoichita donne cette année dans le cadre de la Chaire européenne du Collège de France