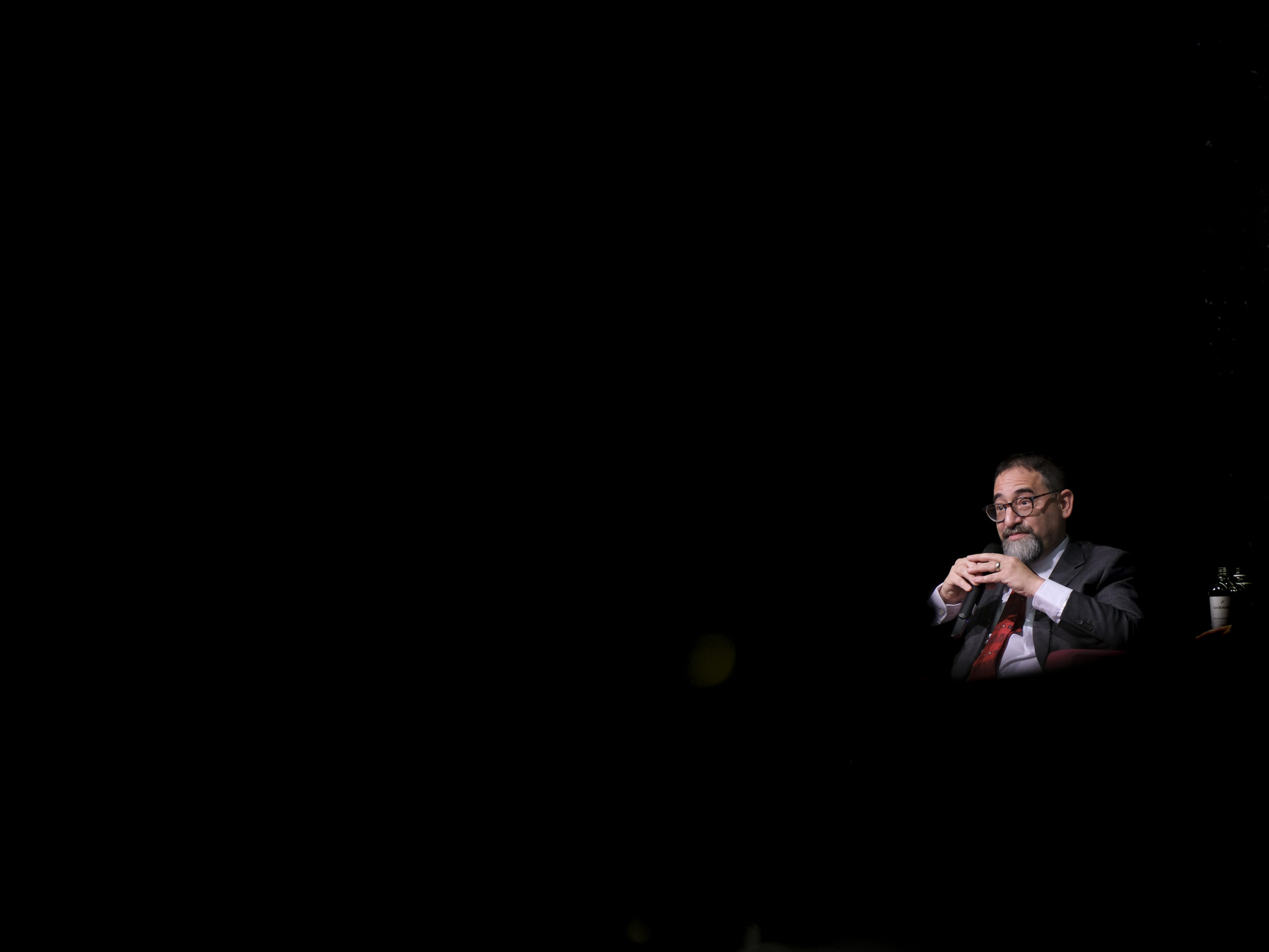Des ponts invisibles avec Carrère, Casiraghi, Da Empoli, Labatut et Perlstein
Khrouchtchev aurait dit un jour à Nixon : « Si les gens pensent qu'il y a une rivière invisible, ne leur dites pas qu'elle n'existe pas. Construisez un pont invisible. »
Lors du Sommet Grand Continent, nous avons invité cinq écrivains contemporains à se pencher sur cette parabole.
- Auteur
- Charlotte Casiraghi, Emmanuel Carrère, Giuliano da Empoli, Benjamin Labatut, Rick Perlstein •
- Image
- © Mario Cruz/Sommet Grand Continent
Charlotte Casiraghi Notre époque est d’un certain point de vue un temps d’hébétude : face à la multiplication des crises, nous n’avons plus sous la main une perspective où ces événements souvent traumatisants pourraient prendre un sens. Pourquoi ceux-ci nous laissent-ils sans voix ?
Il arrive un moment où le trauma dépasse le seuil intime et devient une expérience presque apocalyptique. Quelque chose déchire la psyché si violemment qu’aucune pensée ne peut plus se former ; on entre alors dans une zone où seuls les affects bruts peuvent survivre.
La haine est l’un de ces affects bruts. Dans ces images traumatisantes, ces récits cruels, on risque de s’effondrer sous un excès de réalité. Le réel s’accroche à la peau. Il noie, submerge, sature. Il n’y a plus d’intérieur ni d’extérieur. La brèche a frappé avec trop de force.
C’est à ce moment que la conscience est menacée d’effondrement, car le langage, confronté à ce surplus de réalité, à cette saturation, n’est plus capable de symboliser ce qui s’est produit. La dissociation prend le dessus et nous coupe de la réalité. Le traumatisme attaque la pensée elle-même et la capacité à établir des liens.
Une fois que la pensée devient impossible, des passions plus sombres surgissent, comme la haine, qui devient le seul langage que le sujet est capable de parler.
Dans ses réflexions sur le mal et le totalitarisme, Hannah Arendt montre comment le traumatisme collectif produit une haine diffuse : une haine du monde, de soi-même, de la pensée.
Dans Pouvoirs de l’horreur, Julia Kristeva parle plutôt d’abjection : le traumatisme fait surgir ce qui n’aurait jamais dû être vu. Le sang versé, la mort, les entrailles. Selon elle, la haine naît précisément de cette proximité insupportable avec l’abject ; elle est le revers brûlant du trou noir du traumatisme, et elle maintient la blessure vivante, par une répétition des images de catastrophe et un flot d’histoires traumatisantes en temps réel. La vitesse de cette circulation émotionnelle rend la stupéfaction presque permanente.
Cette rupture se produit aujourd’hui à l’échelle planétaire. Quand une société ne peut plus penser ni symboliser ce qui la blesse, l’imagination est exposée sans cesse à l’horreur, à l’abjection : la polarisation politique, la rhétorique de vengeance, les vagues de haine.
Sur les réseaux sociaux, la haine n’est plus marginale. Elle devient un mode dominant et efficace.
C’est peut-être ce qui rend le travail des penseurs, des écrivains et des poètes si urgent : à travers le langage qu’ils offrent à la catastrophe traumatique, ils esquissent une voie vers le haut. Ils tracent des possibilités éthiques, que les sociétés pourront ensuite intégrer dans leurs modes de régulation et de fonctionnement.
Dans une nation qui n’est pas démocratique ou une nation prétendument démocratique, l’habileté à inventer la réalité est l’un des outils les plus puissants dont dispose un homme politique.
Rick Perlstein
Pour comprendre ce débordement, nous devons revenir à l’acte lui-même. Que faisons-nous lorsque nous essayons de parler ? Le traumatisme de parler, le traumatisme est en soi une expression antinomique. Il ne faut pas oublier qu’il est, par essence, ce qui ne peut être dit ou raconté, ce qui détruit la possibilité du langage. C’est ainsi qu’on le reconnaît : le traumatisme est une expérience violente qui fait irruption dans le psychisme et ne peut être intégrée psychiquement. Le langage nécessite intégration, distance, symbolisation, précisément ce qu’un tel événement empêche.
Rester silencieux n’est pas une solution, car le silence permet à l’innommable d’agir sur nous à notre insu. Ce qui n’a pas été dit se répète à l’infini. Mais parler, c’est aussi prendre le risque de rendre supportable, assimilable ce qui ne peut jamais l’être.
Cette tension entre la nécessité de parler et l’impossibilité de le faire est fondamentale.
Peut-être que pour éviter de rester prisonnier de cette tension, il faut aller au-delà du blessé, du « Je » vers le « Nous » collectif.
Il semble que nous soyons aujourd’hui saturés d’un certain type de récit, les témoignages à la première personne qui exposent un traumatisme ou une violence vécue. Les réseaux sociaux ont amplifié cette explosion de témoignages personnels : parler de son traumatisme est devenu l’une des formes dominantes de narration dans la littérature, les documentaires, les podcasts et les œuvres non-fictionnelles. Les victimes de violence, les femmes et les minorités se sont emparées de cette forme pour des raisons légitimes, se réappropriant la parole, affirmant leur droit d’exprimer leur souffrance, longtemps réduite au silence.
Il ne faut donc pas remettre en question la validité ou la nécessité politique d’un tel discours ; le témoignage est une preuve nécessaire pour condamner la violence. Celui qui parle à partir de sa blessure, qui en porte les traces et les cicatrices, dit une vérité indéniable et parfois essentielle à entendre pour nous.
Parler à partir du traumatisme suspend pourtant le jugement et la continuité du raisonnement. Il élargit parfois un abîme, l’abîme de la stupéfaction, nous laissant sans voix et figés face au récit traumatique ; parler de cette façon ne permet pas en soi d’accéder à une éthique de la responsabilité ni de créer des liens entre les consciences à travers quelque chose qui pourrait être assimilé ou compris.
Aujourd’hui, le traumatisme fait continuellement irruption dans notre psyché, même si nous ne le vivons parfois qu’à travers des images et des récits de catastrophes en temps réel.
Pour comprendre comment la parole peut survivre au traumatisme sans s’effondrer, il faut se tourner vers une poétesse qui a fait de cette impossibilité l’espace même de son écriture, Anna Akhmatova. Cette poétesse russe offre une manière de parler du traumatisme sans le banaliser, en redonnant tout leur poids aux mots et aux événements dans sa quête poétique.
Toute l’œuvre d’Akhmatova est marquée par un sentiment d’effondrement. Ceux qu’elle aime meurent. L’une après l’autre, ses amitiés sont brisées par les purges staliniennes, ses poèmes sont censurés et son fils Lev lui est enlevé par l’histoire.
Lev Gumilyev est arrêté le 10 mars 1938 par la police politique à Leningrad. Il est d’abord placé dans la prison interne de l’Encavite. Anna Akhmatova se rend chaque jour à la porte de la prison, dans l’espoir d’obtenir des nouvelles, d’envoyer un colis ou d’entendre le nom de son fils. Elle ne sait pas s’il est vivant, ni quand il sera jugé.
Ce n’est qu’en septembre 1939 qu’elle apprend qu’il avait été condamné à dix ans de Goulag. Pendant dix-huit mois, elle a enduré cette attente interminable devant la prison, accompagnée d’autres femmes portant la même douleur silencieuse. Ces femmes, unies par le chagrin, se croisaient quotidiennement sans se parler, jusqu’au jour où l’une d’elles a pris la parole.
Un jour, une femme dans cette file d’attente interminable a reconnu Anna Akhmatova ; elle ne lui a pas demandé son nom ni ne s’est mise à pleurer ; elle lui a simplement demandé : « Pouvez-vous mettre des mots là-dessus ? »
Akhmatova a promis qu’elle le ferait. Mais elle ne pouvait pas intégrer l’attente de cette femme devant la prison comme la sienne. Elle ne pouvait pas se dire : « J’ai vécu cela » : c’était une autre qui souffrait. Anna, elle, avait expulsé cette attente insupportable hors d’elle-même, étant incapable de l’intégrer dans la continuité de sa vie ; elle ne pouvait pas souffrir autant — car les événements traumatisants ponctuent les biographies et figent les souvenirs que l’on ne peut ni se rappeler ni oublier.
La femme qui s’adressait à Akhmatova lui offrait cependant une issue au silence. Elle ne lui demandait pas de raconter sa douleur ou ses émotions, mais de parler au nom de ce qu’elles avaient vécu. Elle lui demandait de parler au nom de toutes les autres, de celles qui ne pourraient jamais écrire.
Akhmatova échappait ainsi à son emprisonnement intérieur en passant du « je » au « nous » collectif. En se plaçant parmi les femmes qui portaient cette attente avec elle, elle accédait paradoxalement à sa propre douleur. La promesse d’écrire la liait à quelque chose qui la dépassait et la poussait à surmonter cette impossibilité de dire « je ».
Le traumatisme n’était alors plus un bouleversement intime, une rupture silencieuse dans le tissu psychique : il devenait une rupture partagée et une mémoire collective. Dans le regard de l’autre, dans la pluralité des voix, la parole se libère.
Pour moi, l’art devrait être traumatisant. Nous avons d’autres institutions pour soigner ces blessures et nous rassembler. Cependant, l’art devrait nous montrer ce que nous cachons sous le tapis.
Benjamin Labatut
En écrivant Requiem, Akhmatova ne cherche pas à dire le traumatisme, mais à le contenir dans les quelques mots possibles. Son langage devient presque lapidaire, tentant le paradoxe de rester fidèle aux traumatismes, indicibles, tout en leur donnant forme :
Depuis dix-sept mois, je crie, je t’appelle à la maison. Je me suis jetée aux pieds des bouchers pour toi, mon fils, et mon horreur. Tout est devenu confus pour toujours. Je ne peux plus distinguer qui est un animal, qui est une personne, et combien de temps l’attente peut durer avant une exécution. Il n’y a plus que des fleurs poussiéreuses. Le cliquetis des balles traverse de nulle part vers nulle part et me fixe en face, me menaçant de changement, d’anéantissement, d’une énorme étoile.
Cette économie du langage parvient à préserver un espace sacré de deuil, où chaque mot a tout son poids. Akhmatova invente un langage intermédiaire, entre le cri et le silence, entre la parole et l’absence.
Requiem ne cherche ni consolation ni confession. L’œuvre d’Akhmatova n’est pas un simple témoignage du silence enduré, de la souffrance. Elle repose sur un acte éthique. Elle choisit de parler pour sauver la mémoire de ceux qui ont disparu.
Akhmatova ne transforme pas la douleur en spectacle ou en cri. La vérité n’est pas confondue avec le traumatisme : elle raconte son passage. Son geste repose sur la responsabilité de continuer à dire l’indicible, d’écrire ce qui ne peut être exprimé, de conduire une intériorité muette vers un discours partageable, afin de ne pas oublier ceux qui ont été effacés par l’histoire.
Si la réalité se fracture et se désagrège, c’est à travers la vision, à travers le langage, que nous recréons le lien. Les ponts deviennent internes. Ce sont des ponts d’expérience, de sens, d’émotion. Un pont invisible est la structure sous-jacente, la structure qui crée la continuité malgré ce qui sépare. Il peut s’agir du discours qui relie les gens, de l’amour ou de l’amitié qui lie les cœurs, de l’art qui relie le symbolique et le réel, de l’acte d’écrire qui permet de passer du vague à la forme, d’articuler le présent et le passé, le monde des vivants et des morts, d’agencer les sensations, les couleurs, les sons pour produire une sensibilité partagée.
Construire un pont nécessite parfois la virtuosité d’un architecte, capable d’assembler des matériaux adaptés au terrain, résistants aux intempéries et au poids de ceux qui le traverseront. Une telle construction fait appel à notre inventivité, à notre capacité à organiser et à définir pour défier les contraintes.
Si les médias ne nous rapportent que les horreurs que Trump a pu dire lors de l’un ou l’autre de ses discours, ceux-ci contiennent aussi un élément ludique ; il ne nous amuse pas, mais il est bien présent.
Giuliano da Empoli
Les écrivains et les philosophes sont, en ce sens, des architectes qui tentent de construire ces ponts invisibles avec des mots, que ce soit en assemblant un argument ou en produisant un récit, une vision poétique qui peut servir de structure contre le chaos. Les histoires individuelles ou collectives fonctionnent également comme des ponts en offrant une impression de cohérence lorsque tout semble se briser et se fissurer.
En fin de compte, les histoires que nous tissons deviennent des passerelles invisibles qui nous empêchent de céder sous le poids de la peur, donnant forme à ce qui nous perturbe. Les enfants, avec leur façon instinctive d’évoquer des images et des créatures fantastiques, nous rappellent le rôle essentiel que joue l’imagination pour donner voix à nos angoisses et les dépasser en douceur.
Il semble qu’aujourd’hui que nous ayons pléthore de ces récits sur ce qui nous perturbe, sans intervention des écrivains : les réseaux sociaux agissent comme un formidable relais d’histoires angoissantes, en brouillant également les frontières entre la fiction et le réel. Dans quel entre-deux sommes-nous désormais ?
Dans cet épigraphe, je cite une phrase que Nikita Khrouchtchev a dite à Richard Nixon lorsque celui-ci était en visite en Union soviétique : « Si les gens pensent qu’il y a une rivière invisible, ne leur dites pas qu’elle n’existe pas. Construisez un pont invisible. »
C’est une expression fascinante : elle nous rappelle que dans une nation qui n’est pas démocratique ou une nation prétendument démocratique, l’habileté à inventer la réalité est l’un des outils les plus puissants dont dispose un homme politique.
Nous le voyons aujourd’hui aux États-Unis, sous le gouvernement fasciste de Donald Trump. L’un de ses théoriciens les plus influents, Steve Bannon, a déclaré que leur stratégie concernant les médias était simple : « flood the zone with shit ». En d’autres mots, il s’agit simplement de saturer le champ du discours avec tellement d’inventions que personne ne sait plus ce qui est vrai et ce qui est faux.
C’est également la façon dont procède Vladimir Poutine. Ian Garner a ainsi expliqué comment, en Russie, après que la ville de Marioupol ait été rayée de la carte — 85 % des bâtiments ayant été détruits —, une campagne sur les réseaux sociaux tenta de convaincre les Russes que c’était une métropole florissante, que les gens s’y rendaient en pèlerinage pour voir comment le meilleur des mondes créé par la Russie de Poutine était en train de voir le jour.
Aux États-Unis, l’exemple le plus frappant de cette confusion du vrai et du faux est sans doute celui-ci : de très nombreux partisans de Donald Trump soutiennent que le pays est envahi par des familles émigrant depuis le Mexique ou le Venezuela pour trouver une vie meilleure.
En appliquant les lois américaines, y compris celles de notre Constitution même, l’administration Trump essaie de mettre en place une police secrète pour expulser des personnes vers d’autres pays comme l’Ouganda, dans des camps de prisonniers où ils resteront pour une durée indéfinie.
Aux États-Unis, la ville où je vis est désormais aux mains de la police secrète de Trump ; avec l’autorisation de la Cour suprême, il a déclaré que vous pouviez arrêter n’importe qui sur la base de son apparence, de ce qu’il porte, de son emploi, de l’endroit où il se trouve, sans aucun motif valable.
C’est là un traumatisme pour tous les résidents de cette ville.
Si la réalité se fracture et se désagrège, c’est à travers la vision, à travers le langage, que nous recréons le lien. Les ponts deviennent internes. Ce sont des ponts d’expérience, de sens, d’émotion.
Charlotte Casiraghi
Face à ce traumatisme collectif, comme à d’autres, devons-nous nous tourner vers un récit personnel ou plutôt vers de grandes figures ?
Benjamin Labatut La seconde option ne serait qu’une excuse.
Toujours, les écrivains parlent de quelque chose tout en essayant, secrètement ou non, d’écrire sur autre chose. L’esprit humain fonctionne comme celui d’un enfant : il faut détourner l’attention. Pour séduire, il vous faut donner quelque chose qui est censé être ce qu’il apparaît, pour délivrer en vérité quelque chose de plus profond.
Je crois fermement que, tandis que nous nous dirigeons vers une société mondialisée, nous construisons nos propres mythes et les élaborons. Il en a va aujourd’hui comme à tout autre moment.
Les mythes du passé, les Vedas, les mythes grecs, tout ce que les peuples ont laissé derrière eux pour décrire le monde – nous pouvons les voir très clairement pour ce qu’ils sont. Ce que nous ne pouvons pas voir c’est notre propre mythologie, la manière dont nous vivons dans ce monde.
Mes livres traitent de science, car c’est le mécanisme par lequel nous pouvons construire une telle mythologie. Ses aspects que nous ne comprenons pas, qui racontent le fonctionnement du monde et de notre société, sont ceux qui finissent par prendre le dessus. Ce sont des sortes de fantômes que nous ne nommons pas, mais qui s’infiltrent dans la réalité.
J’ai écrit sur la mécanique quantique parce que j’entendais beaucoup de gens parler avec des termes de mécanique quantique sans en avoir conscience. Auparavant, il fallait environ quatre-vingts ans pour que des grandes idées deviennent courantes, pour que les gens puissent les comprendre et les adopter. De nos jours, il est très facile de voir des gens penser deux choses à la fois, une idée et son contraire. On peut le voir sur les réseaux sociaux concernant la Russie.
Ce sont là les fantômes issus de notre science : nous avons des croyances profondément ancrées qui s’emparent de nos sociétés et contre lesquelles nous n’avons aucune arme, car nous ne voulons pas les nommer. Au contraire, nous les balayons sous le tapis.
Thomas Mann disait qu’un écrivain était quelqu’un pour qui écrire était plus difficile que pour les autres. Je pense que c’est très vrai.
Emmanuel Carrère
Notre espèce est profondément hantée par certaines choses dont nous ne nous débarrasserons jamais. Nous changeons simplement les noms et le type de sacrifices que nous faisons en leur nom.
L’une de ces choses que j’essaie de faire dans mes livres est de montrer la logique qui nous traverse et dont nous ne sommes pas vraiment conscients. Tout le monde parle aujourd’hui de la façon dont nos algorithmes changent nos réseaux sociaux, des informations que nous acquérons et de la façon dont nous sommes désormais dans un état de panique et de traumatisme constant, submergés que nous sommes par ces informations.
Il est utile pour nous tous de comprendre comment fonctionne l’information et d’où elle vient. Ce sont là des choses très modernes : Claude Shannon nous en a donné la première définition dans les années 1940.
J’essaie d’utiliser dans mes livres les images que nous projetons habituellement sur Dieu et la science. Dans la politique actuelle, on a l’impression que les grandes puissances sont devenues tribales — c’est le plus grand, le plus bruyant, le plus violent, le plus vil idiot, celui qui crie le plus fort, que l’on suivra malgré tout, en raison de réflexes très profonds.
Toutefois, d’autres choses passent inaperçues. Certaines logiques « fantômes » opèrent dans notre science et dans notre technologie : nous devons les étudier. L’une des rares façons d’y parvenir par l’écriture est de raconter l’histoire des origines, afin que les gens comprennent comment nous en sommes arrivés là.
Quel fut donc le moment de formation de cette mythologie moderne à laquelle, sans nous en rendre compte, nous croyons ?
C’est quelque part entre les années 1920 et les années 1950 que notre monde moderne est né. À lire les histoires des hommes et des femmes à l’initiative des innovations techniques, à lire ce qu’ils souhaitaient ou rêvaient en les concevant, nous pouvons comprendre pourquoi le monde dans lequel nous vivons a pris cette forme.
Lors du Sommet Grand Continent 2024, Adam Curtis avait dit : « L’une des choses que nous ne pouvons pas oublier, surtout lorsque nous faisons de la politique, est que la forme que nous donnons au monde, même si elle peut sembler inévitable, n’est pas une fatalité. » Nous pouvons toujours refaire le monde de différentes manières. C’est très difficile aujourd’hui, car nous sommes tous dans un état de grande confusion.
C’est une chose dont je parle dans When We Cease to Understand the World. Le titre de sa traduction espagnole, « Un Verdor Terrible », est bien meilleur que le titre anglais ; mais il est intraduisible.
Nous parlons des aspects positifs que peuvent avoir les histoires que nous nous racontons : pour moi, l’art devrait être traumatisant. Nous avons d’autres institutions pour soigner ces blessures et nous rassembler. Cependant, l’art devrait nous montrer ce que nous cachons sous le tapis.
Ce pont que bâtissent les histoires devrait donc nous mener vers l’inconscient, non vers la paix, l’avenir, le passé ou la mémoire ; il nous porterait vers cette immense région obscure qui se trouve en nous et vers laquelle nous n’avons jamais, en tant qu’espèce, créé de moyen d’accéder, si ce n’est pas par l’art.
Pour moi, les livres devraient vraiment vous mener sur un chemin où vous prenez conscience des choses éternelles.
Je ne pense pas non plus que tout ait changé dans la réalité et dans la société : les choses fondamentales qui rendent la vie digne d’être vécue sont à portée de main, même dans les moments les plus horribles. Nos rêves ne se sont pas améliorés ; ils ne se sont pas détériorés non plus.
Où se situe donc le changement réel ?
Lorsque j’écris, je suis bien conscient que je ne peux comprendre d’aucune façon la façon dont ont été conçues ces technologies qui nous ont changé : je ne suis pas un mathématicien de formation, ni un logicien. Cependant je suis convaincu que si vous comprenez la vie et l’esprit des gens qui ont imaginé ces technologies, vous comprenez également à quel point ils ont immédiatement envisagé les choses qui nous font paniquer. La seule différence, c’est qu’à l’époque, le progrès technologique enthousiasmait les gens, alors qu’à présent il les angoisse. Ces inventeurs se réjouissaient à l’idée qu’une machine pourrait penser ; aujourd’hui, cela nous fait peur.
Notre attitude s’est modifiée. La merveilleuse civilisation dans laquelle nous sommes a atteint son apogée dans le passé et, maintenant, nous traversons une période très déprimante. En Europe, tout le monde est déprimé, mais le reste du monde vient ici en vacances parce que c’est une merveille.
Comment exploiter cette peur du progrès technologique, pour en tirer quelque chose de meilleur ?
Notre préoccupation devrait être de questionner ce dont sont faits les rêves ; si nous ne créons pas d’art qui provoque soit des cauchemars, soit des rêves érotiques, je ne pense pas que nous fassions les choses correctement.
L’art devrait n’être qu’un processus pour provoquer des cauchemars ; il n’est pas de la politique, ni quoi que ce soit d’autre.
La promesse fondamentale de personnes comme Trump et d’autres — ceux que j’appelle les prédateurs — est d’opérer une forme de miracle.
Giuliano da Empoli
S’il s’agit, en un sens, de provoquer des cauchemars, comment dépasser le choc et faire de de ceux-ci autre chose qu’un traumatisme ? Quel contrat s’ébauche entre lecteur et auteur, dès lors que le premier accepte d’être violenté ?
Je pense que nous détestons les gens qui écrivent et racontent des histoires parce que nous savons à quel point celles-ci nous lient.
Nous ne vivons pas les récits : nous sommes vécus par eux. C’est là une chose douloureuse et horrible pour un écrivain : les livres tentent de réaliser une opération vraiment étrange dans laquelle les gens participent, tout en se laissant prendre.
Les histoires que je préfère me laissent dans une sorte de superposition quantique où je suis pleinement conscient qu’il s’agit d’une histoire, tout en participant à sa magie, en en voyant les contradictions et les paradoxes. C’est à ce moment-là que nous sommes les plus vivants.
Beaucoup de monde vivent aujourd’hui un moment parmi les pires qui puissent être ; quand le monde est en feu, quand les choses font rage, c’est pourtant à ce moment que nous sommes les plus vivants.
Je ne dis pas que de bonnes choses vont découler de la situation dans laquelle nous sommes, mais simplement que nous devons être conscients du moment unique que nous vivons, où toutes les vieilles histoires s’effondrent et les nouvelles n’ont pas encore pris forme.
Nous sommes pris dans cette période d’interrègne : tout le monde le ressent. Ce n’est pas qu’une impression que ressentent les dirigeants, et chacun retire la même de sa vie quotidienne.
Nous nous retrouvons ainsi dans un espace horrible où notre vision du monde ne s’applique plus, sans que nous puissions voir au-delà ; nous nous regardons les uns les autres, et parlons d’une « crise de l’imagination ».
Ce moment est en quelque sorte le paroxysme de l’ignorance, mais aussi le paroxysme de la sagesse : nous atteignons alors un niveau de conscience que nous n’avions jamais touché auparavant.
Il pourrait être presque impossible de construire une société ou de vivre une vie sans avoir de ces gigantesques histoires. Quiconque a déjà travaillé profondément sur soi-même comprend que ces années de crise font de vous ce que vous êtes.
Nous avons des croyances profondément ancrées qui s’emparent de nos sociétés et contre lesquelles nous n’avons aucune arme, car nous ne voulons pas les nommer. Au contraire, nous les balayons sous le tapis.
Benjamin Labatut
Cet état de panique que nous connaissons est celui où nous n’avons pas d’histoire à nous raconter sur nous-mêmes, de livre qui nous donne la réponse, de professeurs ou d’idoles qui puissent comprendre ce dont on parle.
Nous devons regarder un tel état en face.
Dans cette sidération, quels éléments ne parviennent pas encore à composer un récit d’ensemble ? Doit-on s’étonner de ne pas parvenir à les assembler, ou bien la chose est-elle par essence difficile ?
Emmanuel Carrère Nous avons en français une expression, « l’esprit de l’escalier », qui permet de comprendre davantage ce problème. Cette expression désigne la situation où l’on quitte une soirée après avoir discuté avec beaucoup du monde ; une fois dans l’escalier, en train de redescendre, nous vient à l’esprit la réponse que nous aurions dû faire.
Tout le monde a l’esprit de l’escalier, mais particulièrement les écrivains ; c’est une des raisons pour lesquelles on en devient un. On ne dit jamais la bonne chose au bon moment, alors on la rumine, puis elle vient.
Thomas Mann disait qu’un écrivain était quelqu’un pour qui écrire était plus difficile que pour les autres. Je pense que c’est très vrai.
Mon propre esprit de l’escalier ayant du grain à moudre, je songe depuis le début de notre conversation à cette idée naïve et confiante qu’on avait eue, il y a plusieurs décennies, d’envoyer dans l’espace une sorte de capsule qui contiendrait, à l’intention d’éventuelles civilisations extraterrestres, quelque chose qui nous présente, nous autres Terriens, sous un jour attrayant et en même temps compréhensible.
Que mettre là-dedans ? Peut-être un tableau, quelque chose d’un peu binaire, donc plutôt du Mondrian que la Joconde. De la musique, davantage les Variations Goldberg que la Symphonie pathétique de Tchaïkovski. Devrait-on alors mettre les Variations Goldberg sous forme d’interprétation, comme celle de Glenn Gould, ou simplement de partition ? On pourrait aussi inclure des théorèmes mathématiques, comme les théorèmes de Fermat ou ceux de Gödel.
En vérité, si l’on avait voulu faire comprendre aux extraterrestres ce qu’était l’expérience humaine, dans ce qu’elle avait de plus extrême, dans la puissance avec laquelle elle avait été affrontée, il eût été bon d’envoyer le Requiem d’Akhmatova ou son extraordinaire livre d’entretiens avec Lydia Tchoukovskaïa, qui est, je trouve, une des choses les plus incroyables qu’on puisse lire.
Ce serait un exercice intéressant de songer à ce qu’on pourrait mettre d’autre dans la capsule.
Cet assemblage composite est là pour nous permettre de mieux comprendre le moment de mutation technologique que nous vivons. Cependant ce moment a déjà reçu son discours : on peut songer au techno-optimisme de nombre d’entrepreneurs de la Silicon Valley. Notre récit ne doit-il pas inclure le leur en creux ?
Giuliano da Empoli J’ai grandi à Rome, ce qui me donne une vision cyclique de l’histoire. C’est inévitable pour ceux qui y vivent : chaque matin, en se réveillant, si nous sommes encore assez forts pour nous lever et sortir, nous sommes envahis par cette vision cyclique des civilisations qui s’élèvent, prospèrent, puis commencent à décliner.
Il m’a fallu beaucoup de temps pour intégrer l’idée que nous sommes en train d’atteindre une sorte de seuil. C’est peut-être ce à quoi nous sommes confrontés aujourd’hui, et c’est une perspective un peu vertigineuse.
Les personnes qui nous conduisent vers ce seuil — Trump et les entrepreneurs de la tech — convergent aujourd’hui d’une manière si explicite et si étonnante que cela nous pousse dans une nouvelle direction : chacune s’attelle à nous y conduire comme s’il s’agissait d’un jeu ; il y a un élément ludique dans leur démarche, et il est très effrayant pour nous de l’intégrer.
Si les médias ne nous rapportent que les horreurs que Trump a pu dire lors de l’un ou l’autre de ses discours, ceux-ci contiennent aussi un élément ludique ; il ne nous amuse pas, mais il est bien présent.
De même, si Musk ou Demis Hassabis sont en un sens très sérieux — chacun d’entre eux a une idée différente, mais très précise de l’avenir qu’ils envisagent pour nous — ce sont aussi des joueurs. Ce n’est pas un hasard s’ils ont, comme les autres, une expérience dans le domaine des jeux vidéo ; on pourrait dire que les jeux vidéo structurent d’une certaine façon le nouveau monde dans lequel nous entrons.
Je suis ennuyé de toujours me retrouver dans la position du rabat-joie, à demander à ce que tout soit aussi sérieux et ennuyeux que moi ; c’est aussi le rôle de l’Europe et des gens sérieux. Je ne pense pas que de tels gens sérieux puissent imposer leur vision aujourd’hui. Même si nous le faisons encore pour essayer de déjouer les joueurs aux commandes, je ne pense pas que nous puissions y parvenir aujourd’hui sans jouer le jeu, avec une forme de ludisme dans nos actions.
Nous devons être conscients du moment unique que nous vivons, où toutes les vieilles histoires s’effondrent et les nouvelles n’ont pas encore pris forme.
Benjamin Labatut
Ce côté ludique de leurs propos est-il l’une des raisons de leur succès ? Si ce n’est la principale, quelle est-elle ?
La promesse fondamentale de personnes comme Trump et d’autres — ceux que j’appelle les prédateurs — est d’opérer une forme de miracle.
En théologie, Dieu fait des miracles qui enfreignent les lois et les règles normales de fonctionnement du monde pour produire un effet sur la réalité. Techniquement, c’est ce que de telles personnes proposent : enfreindre ces règles qui auraient été écrites pour protéger le statu quo, les élites, la corruption et tout ce qui ne va pas.
Puisque tout est bloqué et que personne ne peut résoudre ces problèmes, il faut donc enfreindre les règles pour produire un effet sur la réalité. Les mesures prises contre l’immigration, de même que toutes ces scènes terribles que nous voyons tous les jours, sont un élément de cette logique.
Si l’on réagit à un tel récit en disant que le miracle est impossible et illégal, on ne dit guère que des choses sensées : la démocratie repose sur les règles et l’État de droit. Cependant, face aux défis auxquels nous sommes confrontés, c’est une réponse politiquement faible.
Dans un contexte européen, il y a une leçon à tirer de ce qui se passe, en particulier de cette offensive médiatique : le spectre des possibilités est en fait plus large que nous le pensions.
Il ne s’agit pas d’enfreindre la loi, mais d’être beaucoup plus ambitieux nous-mêmes.
Pouvons-nous jouer cependant un jeu avec quelqu’un déterminé à ne pas en respecter les règles ? Il semble qu’on s’empêche ainsi soi-même. Doit-on d’abord démasquer le tricheur, dévoiler ce qu’il fait ?
Rick Perlstein George Orwell a dit que la chose la plus difficile au monde est de voir ce qui se trouve juste sous son nez ; pour cela, il faut des preuves éclatantes.
Il faut commencer par là.
À cette fin, je pense qu’il est éclairant de fournir des témoignages de l’existence d’une police secrète dans ma propre ville, Chicago, à des personnes qui doivent comprendre qu’il n’y a aucun profit à apaiser Trump, de même qu’il était vain de céder sur les Sudètes face à Hitler : cette reculade a conduit à l’invasion de la Pologne.
À six kilomètres de chez moi, il existe une ville appelée Evanston, qui comprend une école primaire. Le jour d’Halloween, alors que les enfants se déguisent et demandent des bonbons, la police secrète a envahi le quartier. Les gens sont sortis de leurs maisons et de leurs voitures, et comme nous avons tous des sifflets à Chicago, ils se sont mis à siffler et à klaxonner pour prévenir que la police était là.
Avec votre permission, j’aimerais partager le témoignage de ce qui s’est passé lorsque la police secrète a débarqué dans un quartier résidentiel bucolique. Le témoin, Jennifer Moriarty est une femme au foyer de la classe moyenne, vivant à Evanston :
Il y avait des gens à vélo. Ils étaient dans la rue et soufflaient dans leurs sifflets. Tout le monde est donc sorti de sa voiture. Alors que je m’approchais avec mon téléphone portable, j’ai vu une jeune femme face contre terre, avec des agents sur elle. Et dès que je me suis approchée, un agent m’a attrapée par le cou, m’a repoussée et m’a jetée à terre. Il était sur moi. Puis un jeune homme est arrivé.
(Daniel Bist, le maire d’Evanston) – Puis-je vous interrompre avec quelques questions ? Pourquoi ont-ils fait ça ?
– Parce que je faisais partie des personnes qui faisaient exactement ce qu’elles étaient censées faire. Protester, alerter la communauté, filmer leurs actions et ce qu’ils faisaient. Je n’avais même pas eu le temps d’appuyer sur ‘enregistrer’ quand on m’a attrapé par le cou et jeté à terre.
– Vous avez donc été agressé pour avoir osé avoir une opinion différente de la leur ?
– Absolument. Tout à fait. Pour avoir été membre d’une communauté qui était en état d’alerte.
– Désolé, continuez.
– Ils ont d’abord fait monter la jeune femme dans la voiture. Elle a réussi à se glisser sur la banquette arrière et à ouvrir la porte de l’autre côté, puis à sortir avec l’aide d’un autre membre formidable de la communauté. L’un des agents, que j’appelle le rouquin, qui était le plus violent de tous, qui a sorti son arme à plusieurs reprises et l’a pointée sur le visage des membres de la communauté, et qui a tenté de pulvériser du gaz lacrymogène sur plusieurs personnes, a couru et l’a plaquée à nouveau. Ils m’ont fait monter et l’ont remise dans la voiture, côté passager. Et pendant tout ce temps, ils continuaient à frapper ce jeune homme à l’extérieur de la voiture, avant que nous ne puissions l’atteindre.
Jennifer Moriarty a ainsi été arrêtée ; après avoir été aspergée de gaz lacrymogène, elle a été emmenée dans un bureau du FBI situé à 25 km de là, pour être enchaînée à une barre. On lui a alors dit qu’elle n’était pas en état d’arrestation, mais qu’elle était détenue par les douaniers.
Après avoir été obligée d’attendre trois heures, elle a été relâchée sans aucune accusation ni document.
Les migrants, qui la plupart du temps n’ont commis aucun crime et se trouvent dans le pays légalement, soit avec une Green Card, soit parce qu’ils sont citoyens, sont ainsi emmenés dans un centre appelé Broadview, dans la banlieue de Chicago.
Nous n’avions aucune idée de ce qui se passait à l’intérieur de ce centre : c’était une boîte noire totale. Le témoignage de Moriarty est le premier qui nous permette de comprendre l’intérieur de la boîte noire et comment cette police secrète fonctionne.
Nous savons désormais ce qui se passe à l’intérieur du centre de l’ICE grâce à une décision judiciaire. Le centre dispose de deux salles. Chacune peut accueillir environ cinquante personnes, hommes et femmes, et dispose d’un sol en béton.
Les lumières restent allumées 24 heures sur 24, et il y a une seule toilette dans chaque salle. Ces salles sont ainsi conçues pour que les personnes y restent deux heures ; pourtant, certaines y sont restées jusqu’à deux semaines. Il n’y a pas de douches ni de savon. Nous avons aussi des preuves que des personnes y ont été battues.
Les personnes dont les papiers d’identité et les documents ont été vérifiés et qui se trouvent en situation régulière aux États-Unis peuvent être libérées, comme elles peuvent être expulsées vers leur pays d’origine, où elles ne sont pas allées depuis des décennies. Certaines ainsi renvoyées vers un pays hispanophone ne parlent pas même espagnol. Dans l’hypothèse où ces personnes ont un casier judiciaire, et même si elles ont payé leur dette à la société, elles peuvent être renvoyées pour une durée indéterminée dans un pays comme l’Ouganda.
Un récent article du New Yorker a documenté ces arrestations ; presque toutes les personnes qu’il mentionne ont obtenu des mesures de protection juridique qui empêchent le gouvernement de les expulser vers leur pays d’origine.
Ces enlèvements secrets conduits par la police aux États-Unis ont commencé à Los Angeles ; ils se sont étendus à Chicago, puis à Charlotte, avant de se propager cette semaine en Caroline du Nord.
Jennifer Moriarty rapporte aussi que, partout où les agents s’arrêtaient sur leur trajet vers le centre, ceux-ci étaient assaillis par des citoyens ordinaires, ce qui les empêchait de procéder à leurs enlèvements. Les habitants ordinaires de Chicago ont ainsi créé une armée non violente qui terrifie ces agents armés de l’État.
C’est là ce qui se passe sous nos yeux.
Rien de bon ne pourra advenir si nous cédons à Donald Trump.
S’il faut documenter la violence de l’autre, et si notre récit doit bien défaire celui qu’on nous propose déjà, il ne peut être une simple contre-proposition. Qu’avons-nous à proposer que l’on puisse vraiment déclarer nôtre ?
Benjamin Labatut Je viens d’Amérique latine, où des histoires telles que celle qui vient d’être racontée sont hélas très courantes.
Nous voyons tous ce qui est en train de se passer ; la politique est menée par de tels personnages. En retour, quelle est cette image de l’humanité que nous pourrions construire ? Que pourrions-nous envoyer ?
Il y a des aspects de notre être qui ne peuvent pas être envoyés dans l’espace parce qu’ils ne peuvent pas être condensés dans un message : c’est là une chose merveilleuse.
Il y a au cœur du monde actuel une question fondamentale, à laquelle nous n’avons pas de réponse. On peut la formuler de plusieurs manières ; l’une d’elles est celle-ci : qu’est-ce qu’un être humain peut faire qu’une machine ne peut pas faire ? Qu’est-ce qui ne peut être traduit en symboles ou en mots ? Quelles sont les limites de ces systèmes symboliques ?
C’est une question très difficile à laquelle nous devons tous réfléchir : les géants de la tech n’ont pas de réponse à celle-ci, et bien que ces limites soient constamment dépassées.
Sur les réseaux sociaux, la haine n’est plus marginale. Elle devient un mode dominant et efficace.
Charlotte Casiraghi
En quoi cette question, qui semble spéculative, est-elle en réalité politique ?
Nous avons construit nos sociétés autour des choses que nous pouvons dire, dont nous pouvons parler. Nous voyons comment des horreurs comme Trump surgissent des jeux dont nous parlons — les jeux de plus en plus violents auxquels nous jouons en politique.
Aujourd’hui, nous voyons se produire aux États-Unis des choses qui semblaient impensables et qui, ailleurs, semblent simplement faire partie du quotidien avec lequel nous avons grandi.
Il nous importe de réfléchir à une telle question car nous nous dirigeons vers un monde où ces décisions et cette violence s’aident de la technologie ; elles sont mises en œuvre par la technologie, et deviennent normalisées.
Notre climat politique est alimenté par la pensée et les systèmes algorithmiques ; ce ne sont pas les tyrans auxquels nous sommes habitués mais à un nouveau scénario, dont nous devons prendre conscience.
Je n’ai pas grand-chose à dire aux décideurs, mais je pense que le travail des écrivains est de réfléchir à ces questions, de trouver comment nous pouvons faire quelque chose d’impossible et de miraculeux, qui consiste à mettre des mots sur l’indicible.
L’une de ces questions essentielles — à savoir ce qui, dans l’humanité, ne peut être instancié dans un système différent — est quelque chose qui devrait guider notre existence quotidienne.
Je pense que ce n’est pas quelque chose qui concerne uniquement les penseurs ou les techniciens ; il s’agit là de quelque chose que l’humanité dans son ensemble doit prendre en considération, car c’est en quelque sorte la direction principale que prend notre monde : nous nous détournons de plus en plus de cette partie de nous-mêmes dont nous savons qu’elle existe, mais dont nous ne pouvons parler.
C’est là quelque chose qu’essayaient de toucher tant la capsule qui fut envoyée dans l’espace avec son message, que les politiciens à la recherche d’un miracle à opérer.
Les gens peuvent faire l’impossible parce que nous faisons l’impossible ; nous l’avons fait de nombreuses fois. Nous devons simplement le faire une fois de plus.
Nous croyons qu’il est impossible de renverser certaines personnes ; au Chili, nous le pensions de Pinochet. Cependant, de telles personnes finissent par tomber. Je ne sais pas combien de temps cela prendra, mais je suis sûr que c’est possible.