« Lorsqu’on voit des partis extrémistes plafonner à 2,6 %, il est dangereux de les balayer d’un revers de main », une conversation avec Laurence Rees
« Beaucoup de gens se bercent d’illusions sur le monde qui les entoure. Ils partent du principe que les structures vont tenir. Mais la vie — et les systèmes qui la soutiennent — est d’une fragilité stupéfiante. »
Pendant trente ans, Laurence Rees a mené des entretiens avec d’anciens nazis pour ses documentaires.
Dans La Pensée nazie, il en tire des enseignements pour le présent.
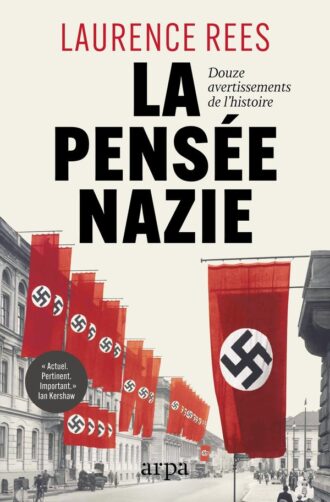
Dans La Pensée nazie, vous vous appuyez sur des témoignages inédits d’anciens nazis et de personnes ayant grandi sous le régime hitlérien. Pouvez-vous nous expliquer comment vous avez collecté ces témoignages ? Concrètement, comment interviewe-t-on un ancien nazi ?
Ce travail est le fruit de trente années de recherche qui ont donné lieu à plusieurs séries télévisées et ouvrages que j’ai réalisés. À bien des égards, nous avons eu une chance extraordinaire.
Mon intérêt pour ces questions a coïncidé avec un moment particulier dans la vie des anciens nazis : ils étaient pour la plupart à la retraite, mais en pleine possession de leurs facultés mentales. Nous avions réuni une masse considérable de documents, mais la télévision ne permet d’en utiliser qu’une infime partie. Une grande quantité d’archives est donc restée inédite, et j’ai voulu la rendre accessible à un public plus large par d’autres moyens.
Un autre facteur décisif a été le moment où j’ai commencé ce travail : juste après la chute du mur de Berlin. Cela correspondait à la fois au début de ma carrière et à une brève fenêtre historique exceptionnelle, qui nous a permis d’accéder aux archives d’Europe de l’Est, notamment en Russie. Nous ne réalisions pas alors à quel point cette période serait courte. Au début des années 1990, de nombreuses archives secrètes russes ont été ouvertes aux chercheurs. Nous avions naïvement cru que la Russie s’engageait alors sur la voie de la démocratie, et nous avons vécu cela comme le début d’une ère nouvelle, exaltante. Cet espoir n’a pas duré. Lorsque j’ai tourné ma dernière série en Russie, vers 2007–2008, nous étions suivis par le FSB, et l’accès aux documents comme aux personnes était devenu pratiquement impossible.
Cette fenêtre historique étroite s’est donc alignée sur mes intérêts personnels et sur la volonté de la BBC de financer ce type de programmes. Rien de tout cela n’aurait été possible sans le soutien de la BBC — non pas parce que nous étions grassement rémunérés, mais parce que le journalisme d’investigation nécessaire à ce travail était coûteux.
Les frais n’étaient pas liés aux salaires, mais à la nature même de l’enquête : retrouver d’anciens nazis, les convaincre de parler, puis vérifier rigoureusement chacune de leurs déclarations. Ce travail de recoupement était — et reste — colossal. Tout journaliste connaît les défis méthodologiques posés par l’histoire orale. Cela exige une grande vigilance, de l’expérience, et une conscience aiguë de ses limites.
Lorsque j’ai tourné ma dernière série en Russie, vers 2007–2008, nous étions suivis par le FSB, et l’accès aux documents comme aux personnes était devenu pratiquement impossible.
Laurence Rees
Heureusement, nous étions bien préparés.
Notre formation provenait directement du journalisme et du documentaire à la BBC, où des normes rigoureuses nous ont été inculquées dès le départ. Tous ces éléments nous ont permis d’aborder ce travail avec le sérieux et la prudence nécessaires.
Un dernier point. Lorsque nous avons réalisé la première série sur ce sujet, The Nazis : A Warning from History, j’ai compris à quel point il était essentiel de contredire les personnes interrogées pendant l’entretien lui-même. Au départ, j’avais imaginé un format documentaire classique — on interroge quelqu’un, puis on apporte un contrepoint via un autre témoignage, et le montage établit un équilibre. Mais cette approche s’est révélée totalement insuffisante. Les spectateurs auraient été scandalisés par certaines des choses que ces personnes disaient. Il est vite apparu qu’il fallait que l’intervieweur incarne clairement l’indignation du public : « Comment pouvez-vous dire cela ? » — « C’est révoltant. » C’est ainsi que les films ont pu adopter une position morale claire, ce qui était crucial. Il y avait bien sûr des inquiétudes légitimes sur le fait de donner la parole à de tels individus. Mais le fait d’encadrer leurs propos par une contestation éthique a permis de s’assurer que leur présence ne soit jamais perçue comme complaisante. C’est ainsi que nous avons réussi à rendre cela possible.
Votre livre intègre des apports issus de la psychologie, notamment des recherches sur l’obéissance et l’autorité. Comment avez-vous équilibré l’analyse historique avec les théories psychologiques, et quels défis cette approche interdisciplinaire a-t-elle posés ?
Ce n’est que très récemment que j’ai envisagé d’intégrer des approches psychologiques à mon propre travail.
L’une des raisons de cette réticence tient à une forte aversion que j’ai toujours eue envers la psychohistoire — en particulier dans ses versions les plus spéculatives. On tombe souvent sur des personnes — presque toujours extérieures au champ historique — qui affirment des choses stupides du genre : « Vous perdez votre temps à essayer de comprendre Hitler sur le plan politique, la vraie clef, c’est qu’on l’a trop emmailloté quand il était bébé. »
Dans l’introduction de mon livre, je tourne en dérision le profil psychologique d’Hitler rédigé pendant la guerre par Walter Langer pour l’OSS. Langer y avance que le Kehlsteinhaus, ou « Nid d’aigle » — auquel on accède par un tunnel et un ascenseur creusés dans la montagne — symboliserait un désir inconscient de retourner dans le ventre maternel. C’est le genre d’interprétation qui est franchement absurde à plusieurs niveaux. D’abord parce que Hitler lui-même n’aimait pas cet endroit. C’est Martin Bormann, son secrétaire, qui en a supervisé la construction. Ce type de lecture pseudo-psychologique m’a toujours paru fantaisiste et complètement déconnecté de la réalité historique.
Cependant, mon regard a commencé à évoluer — en partie parce que mes deux fils ont étudié la psychologie à l’université. En lisant leurs cours et en discutant longuement avec eux, j’ai compris qu’il existait tout un pan de la psychologie — notamment la psychologie sociale, développementale et évolutionniste — qui n’a rien à voir avec ces interprétations réductrices.
Ces disciplines ne s’intéressent pas aux pathologies individuelles, mais aux tendances humaines générales. Et cette perspective a fait écho à mon propre intérêt pour la notion d’« avertissements » historiques : ce ne sont pas des leçons, ce sont des signaux de probabilité, non des certitudes — comme lorsqu’un médecin vous dit que fumer cent cigarettes par jour rend probable un cancer. Vous n’en développerez peut-être pas un, mais la tendance demeure valable.
Les lectures pseudo-psychologiques du nazisme m’ont toujours paru fantaisistes et complètement déconnectées de la réalité historique.
Laurence Rees
Ce cadre m’a permis d’éclaircir ma pensée. J’ai également commencé à m’entretenir avec plusieurs psychologues et neuroscientifiques de renom — des échanges qui se sont révélés extrêmement féconds. Ils ne connaissaient pas toujours les détails historiques, mais je pouvais appliquer leurs idées au matériau documentaire sur lequel je travaillais. Parmi eux, Robert Sapolsky, professeur de neurosciences à Stanford, a eu une influence toute particulière. Sa générosité intellectuelle et sa clarté d’esprit m’ont été précieuses.
Tout cela m’a permis d’affiner ma démarche, mais j’ai toujours tenu à ce que le livre reste avant tout un travail d’historien. Et je crois que c’est bien le cas — une étude historique qui, par moments, s’appuie sur des éclairages psychologiques. La psychologie ne remplace jamais l’histoire ; elle apporte un regard complémentaire. C’est ce principe qui m’a guidé pendant que j’écrivais.
Vous êtes à la fois un historien et un réalisateur de documentaires reconnu. Pensez-vous que votre expérience de cinéaste vous confère un style narratif particulier, différent de celui des historiens traditionnels ?
Absolument. Ce qui continue à me surprendre, c’est à quel point le monde académique a accueilli mon travail avec bienveillance. J’ai reçu deux doctorats honoris causa — ce que je n’avais absolument pas anticipé. Je m’attendais à bien plus de critiques de la part des universitaires et j’ai au contraire rencontré un véritable intérêt de leur part. Cette reconnaissance a beaucoup compté pour moi. Je dois énormément au professeur Ian Kershaw, qui est mon mentor depuis longtemps et dont les conseils m’ont été inestimables au fil des années.
Cela dit, je crois que mon approche reste fondamentalement différente de celle de la plupart des historiens traditionnels — et cela de manière tout à fait assumée. Dès le départ, mon ambition n’était pas de devenir historien académique, mais de réaliser des films historiques. Je viens du journalisme et du cinéma, et cela façonne inévitablement mon style narratif, ainsi que ma manière d’aborder les sources. Être issu du journalisme implique une autre façon d’entrer en relation avec le matériau historique. Bien sûr, tous les bons historiens apprennent à faire preuve de scepticisme face aux sources et à les évaluer avec rigueur, mais lorsqu’on est face à une personne en chair et en os, il y a un scepticisme instinctif, presque réflexe : Pourquoi me dit-elle cela ? Que me cache-t-elle ? Comment puis-je le vérifier ailleurs ? C’est un état d’esprit qui tient à l’enquête, légèrement différent de celui qui caractérise la méthode historique — et ce contact direct avec la parole vivante donne, je crois, une texture différente au récit.
Je viens du journalisme et du cinéma, et cela façonne inévitablement mon style narratif, ainsi que ma manière d’aborder les sources.
Laurence Rees
Ce qui me passionne depuis toujours, ce sont les êtres humains : leurs mentalités, leurs visions du monde, leur vie intérieure — tout ce qui constitue l’expérience vécue de ceux qui traversent l’histoire.
Cette attention portée à la dimension psychologique et émotionnelle de l’existence humaine est le moteur de mon travail. C’est aussi ce qui le distingue d’une histoire plus classique, qu’elle soit militaire ou diplomatique. Je ne pense pas qu’il soit réellement possible de saisir ces mentalités uniquement à partir de documents. Être face à quelqu’un qui a commis des atrocités — qui a, par exemple, tué des enfants — est une expérience sans commune mesure avec la lecture d’un procès-verbal ou d’un compte rendu judiciaire. La confrontation avec la mémoire vivante de tels actes transforme profondément votre compréhension des choses.
Pour en venir au cœur du livre, dans quelle mesure pensez-vous que les atrocités nazies ont été motivées par la conviction idéologique plutôt que par l’opportunisme ? Comment avez-vous discerné ces motivations au cours de vos recherches ?
Dans l’introduction du livre, je précise que je n’aurais jamais imaginé consacrer une si grande partie de ma carrière à l’étude du nazisme et de la Seconde Guerre mondiale. Ce n’était pas une ambition d’enfance ; je ne me suis jamais dit : « je vais me consacrer aux nazis pendant les trente-cinq ou quarante prochaines années. » Ce qui m’a poussé à suivre cette voie, c’est le profond décalage que j’ai ressenti en rencontrant d’anciens nazis. Ils n’étaient absolument pas ce à quoi je m’attendais — et pour un journaliste, ce genre de surprise est irrésistible. Quand la réalité contredit vos attentes, le réflexe naturel est de se demander : pourquoi ?
Je me souviens avoir rencontré un ancien membre de la Waffen-SS en 1990. C’était un homme intelligent, charismatique, qui avait fait une brillante carrière après-guerre dans une grande entreprise automobile allemande. À bien des égards, c’était un individu impressionnant — jusqu’au moment où il s’est mis à parler du nazisme et de la guerre. Là, c’était comme s’il basculait dans une réalité parallèle.
Je n’avais jamais rien vu de tel.
En surface, il semblait parfaitement rationnel, mais ce qu’il disait relevait d’un monde totalement délirant. Il affirmait que la guerre avait été imposée à l’Allemagne, que les Juifs représentaient un « problème » qu’il fallait résoudre « d’une manière ou d’une autre », et que c’était en grande partie de ma faute, en tant que Britannique, s’ils avaient été tués — car mon gouvernement avait refusé de les accueillir. Je m’attendais à ce qu’un ancien nazi me dise qu’il avait obéi aux ordres, que c’était une tragédie, que cela n’aurait jamais dû arriver. Peut-être même qu’il sorte une excuse absurde du type : « Nous étions hypnotisés par Hitler, nous nous sommes réveillés ensuite, nous sommes profondément désolés — mais nous n’y pouvions rien. » Ce n’est pas du tout ce que j’ai entendu.
Les anciens nazis n’étaient absolument pas ce à quoi je m’attendais. Quand la réalité contredit vos attentes, le réflexe naturel est de se demander : pourquoi ?
Laurence Rees
En réalité, nombre d’anciens nazis souhaitaient être interviewés parce qu’ils pensaient que, si nous les écoutions simplement, nous finirions par comprendre — voire par adhérer à leur point de vue. Ce qui m’a frappé, c’est à quel point cette posture était distincte de mes expériences dans d’autres films — sur la guerre entre Hitler et Staline, ou encore sur la mentalité japonaise pendant le conflit. Dans ces cas-là, le comportement des personnes interrogées correspondait en général à ce que j’attendais.
Je me souviens d’un entretien en particulier avec un ancien policier soviétique, impliqué dans les déportations punitives décidées par Staline en Kalmoukie.
Lorsque je lui ai demandé comment il avait pu infliger de telles horreurs à des enfants, il m’a répondu très simplement qu’il n’avait pas le choix : s’il avait refusé, il aurait été exécuté. En tant que journaliste, on enquête sur ce genre d’affirmations — et dans son cas, c’était probablement vrai. Sous Staline, refuser d’obéir pouvait effectivement vous coûter la vie. Mais dans le cas de l’Holocauste, la situation était différente. Comme l’a démontré Christopher Browning, personne n’a été exécuté pour avoir refusé de participer à l’extermination des Juifs. C’est là que surgit un élément essentiel à mes yeux : l’intériorisation de l’idéologie. Beaucoup de ceux que j’ai rencontrés croyaient encore, des décennies plus tard, que ce qu’ils avaient fait était justifié. Cela me semble d’une portée immense — et profondément inquiétante.
Cela m’amène justement à ma prochaine question. Vous avez évoqué brièvement l’idée selon laquelle ces anciens nazis auraient pu invoquer une forme d’hypnose exercée par Hitler — un thème que vous explorez dans The Dark Charisma of Adolf Hitler (traduction française : Adolf Hitler, la séduction du diable, 2014). Comment évaluez-vous le rôle du charisme personnel d’Hitler dans la formation de la mentalité collective nazie ? En quoi a-t-il été un catalyseur de cette dynamique collective ?
C’est une question difficile — et je le dis avec un certain humour, car lorsque j’ai commencé comme journaliste, je posais souvent des questions à des universitaires, et ils me répondaient : « Eh bien, c’est très compliqué. » Et je me disais alors : « Allez, faites un effort. »
Mais la vérité, c’est que c’est effectivement très compliqué.
Le rôle du charisme personnel d’Hitler dans la formation de la mentalité nazie ne peut pas être compris isolément, car de nombreuses dynamiques se chevauchaient.
On ne peut pas dire qu’Hitler ait créé ces idées à partir de rien. Il puisait dans des thèmes déjà largement répandus dans l’Allemagne d’après-guerre — l’antisémitisme, la peur du bolchevisme, le ressentiment nationaliste. Ce qui était singulier, ce n’était pas tant le contenu de son message, que la manière dont il le délivrait, notamment dans les années 1920. Sa puissance oratoire donnait une force émotionnelle nouvelle à des idées qui, en elles-mêmes, n’étaient pas originales.
L’un des éléments les plus marquants que j’ai découverts en écrivant The Dark Charisma of Adolf Hitler — et que je n’avais pas pleinement saisi auparavant — m’est apparu en relisant ses premiers discours. Ce qui m’a frappé, c’est à quel point il cherchait systématiquement à intensifier la peur et l’anxiété de son auditoire. Dans mon nouveau livre, je fais référence au rôle de l’amygdale — cette partie du cerveau essentielle à la survie, qui nous permet de déterminer si quelqu’un est un allié ou une menace. D’un point de vue évolutif, nous sommes programmés pour pécher par excès de prudence. Si nos ancêtres entendaient un bruissement dans les buissons, ils ne se demandaient pas si c’était un chien inoffensif — ils supposaient que c’était un lion. Car si c’en était un et qu’ils hésitaient, ils étaient morts.
La puissance oratoire d’Hitler donnait une force émotionnelle nouvelle à des idées qui, en elles-mêmes, n’étaient pas originales.
Laurence Rees
Cette prédisposition neurologique — interpréter les signes ambigus comme des menaces — est quelque chose qu’Hitler comprenait instinctivement et qu’il savait exploiter.
Il s’adressait à des foules déjà enclines à voir dans les Juifs ou les communistes des ennemis, et son message était toujours : c’est pire que ce que vous croyez. Il ne cessait d’amplifier le sentiment de danger. Plutôt que d’interpeller la partie rationnelle du cerveau — celle qui inviterait à l’analyse ou à la retenue, en disant : « Calmez-vous, ce n’est sans doute qu’un chien dans les buissons » — il maintenait délibérément son auditoire dans un état d’alerte constant : tuer ou être tué. Ses discours entretenaient cet état émotionnel exacerbé, donnant à ses partisans l’impression de vivre un moment extraordinaire, décisif. La vie, soudain, cessait d’être banale ; elle était chargée de sens : C’est maintenant. L’Histoire est en train de basculer — et vous devez agir.
Ce sentiment d’urgence était renforcé par un autre élément tout aussi puissant : la certitude. Je crois que nous sous-estimons souvent l’attrait de la certitude, en particulier dans les contextes autoritaires. La plupart des gens vivent avec des doutes, des incertitudes : Est-ce que je fais ce qu’il faut ? Aurais-je dû dire cela ? Mais un dirigeant qui semble incarner une conviction inébranlable — qui donne l’impression de posséder une clarté morale et politique absolue — peut être profondément rassurant. Il y a presque quelque chose de parental dans cette capacité à soulager ses partisans du poids du choix. Erich Fromm a étudié cette dynamique dans son ouvrage pionnier Escape from Freedom (1941 — traduit en français sous le titre La Peur de la liberté en 1963), où il soutient que beaucoup souhaitent fuir la responsabilité — échapper à l’angoisse que suscite la liberté. On retrouve ce mécanisme chez des figures comme Göring : malgré son charisme et son aura de héros de la Première Guerre mondiale, sa vie est devenue bien plus simple à partir du moment où il a décidé que le Führer avait toujours raison. Cette abdication — au profit d’une certitude, d’une vision — n’était pas seulement de l’obéissance : elle constituait un soulagement psychologique.
En somme, réfléchir au charisme d’Hitler permettrait de dépasser la tension entre les thèses fonctionnaliste et intentionnaliste. Son charisme expliquerait comment il a pu exercer un pouvoir aussi immense tout en intervenant relativement peu dans la mise en place des politiques du régime — en tout cas moins que bien des responsables nazis.
Le point crucial, c’est qu’Hitler s’exprimait en visions, non en politiques publiques. Il n’a jamais formulé de programmes concrets, détaillés. Si l’on regarde la plateforme originelle du parti nazi en 1920, les propositions sont d’une étonnante imprécision — et cette imprécision était volontaire. Hitler cultivait délibérément cette ambiguïté. Ce qui a suivi est tout aussi révélateur : il nommait fréquemment deux personnes à peu près à la même fonction, avec des responsabilités qui se chevauchaient. Lorsque des conflits éclataient inévitablement entre elles et qu’elles s’adressaient à lui pour trancher, il refusait d’intervenir. Sa réponse, en substance, c’était : « Débrouillez-vous. » Il appliquait une logique darwinienne — une forme de gouvernement fondée sur la survie du plus apte.
Mais les responsables nazis avaient compris une chose essentielle : Hitler avait un goût particulier pour la radicalité. Il n’approuvait pas nécessairement chaque proposition extrême, et il ne les mettait pas toutes en œuvre, mais il réagissait positivement aux idées audacieuses, transgressives. C’est là, je crois, que mon approche propose un cadre explicatif pertinent. Prenons l’exemple de Joachim von Ribbentrop. Il est souvent présenté comme un imbécile, voire un pantin ridicule. Mais Reinhard Spitzy, un officier SS qui a travaillé étroitement avec lui, m’a un jour dit : « Quand Hitler disait ‘tiède’, Ribbentrop répondait ‘brûlant’. » Il revenait vers Hitler avec des propositions outrancières, exagérées — non parce qu’elles étaient forcément applicables, mais parce qu’elles s’accordaient avec l’esprit de sa vision.
Dans un tel système — où la vision globale est claire, mais où les politiques concrètes restent indéterminées — la concurrence entre subordonnés devient féroce. Chaque acteur cherche à interpréter et incarner la vision de manière plus fidèle, plus radicale que les autres. Lorsque deux individus occupent des fonctions similaires, l’incitation à se surpasser — non seulement par la compétence, mais surtout par l’intensité idéologique — devient dominante. La radicalité se banalise. Cela produit une structure à la fois extraordinairement dynamique et profondément chaotique, dans laquelle le chef n’a plus besoin de diriger de manière conventionnelle.
Parlons maintenant des Allemands ordinaires. Quels mécanismes, au sein de l’Allemagne nazie, ont permis la dissolution des repères moraux chez des millions de citoyens ?
Le premier point à souligner, c’est qu’il s’agissait d’un processus progressif. Ceux qui ne sont pas familiers avec l’histoire de la Shoah demandent souvent quand la décision d’exterminer les Juifs a été prise — comme s’il devait y avoir un moment précis, un tournant net.
Je soupçonne que cette attente découle de la logique des romans policiers ou des films de braquage, comme Ocean’s Eleven, où les événements suivent une séquence bien ordonnée : l’équipe se forme, un plan est établi, une réunion décisive a lieu, puis l’opération est lancée. Ce modèle narratif favorise une attention excessive à des moments comme la conférence de Wannsee, en janvier 1942, que l’on considère souvent à tort comme l’événement clef où tout a été décidé. Mais ce n’est pas le cas — il ne s’agissait que d’une étape supplémentaire dans une escalade déjà engagée.
Il existe de solides données psychologiques — que j’explore dans le livre — montrant qu’il est bien plus facile d’avancer par petites étapes que de franchir un grand saut brutal. Ce principe ne s’applique pas seulement à la Shoah, mais à l’ensemble du régime nazi.
Prenons les premiers camps de concentration mis en place dès 1933 pour les opposants politiques. Beaucoup d’Allemands ordinaires les ont acceptés, car on les leur présentait comme une réponse nécessaire à la menace présumée du communisme. Les nazis affirmaient que les communistes avaient tenté d’incendier le Reichstag, qu’ils sabotaient la révolution nationale — qu’ils étaient l’ennemi intérieur. Dans ce contexte, l’existence des camps était tolérée.
Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c’est à quel point ces premiers camps étaient différents de ce qui allait suivre. Il y a souvent confusion : si les camps de concentration existaient déjà en 1933, pourquoi la Shoah n’a-t-elle pas commencé à ce moment-là ? En réalité, au cours des premières années, la majorité des détenus étaient des opposants politiques du régime nazi — et même s’ils étaient soumis à des conditions effroyables, aux coups, à la torture, parfois à la mort — la plupart finissaient par être libérés, souvent après dix-huit mois. Quelques Juifs allemands ont été envoyés dans ces camps à cette époque, mais ils restaient minoritaires.
Hitler s’exprimait en visions, pas en politiques publiques.
Laurence Rees
Je me souviens d’un Polonais, interviewé pour la série télévisée que j’ai consacrée à Auschwitz, qui nous a raconté comment il avait été relâché du camp. Cela peut paraître aujourd’hui totalement incompréhensible, tant Auschwitz est associé à l’extermination de masse. Mais quand Rudolf Höss a mis en place le camp en 1940, il s’est inspiré du modèle de Dachau, tout en en aggravant la brutalité. Auschwitz était dès le départ situé en Pologne occupée, sur un territoire désigné pour les prétendus « sous-hommes », et un grand nombre de prisonniers politiques polonais y sont morts de faim, de maladie ou de mauvais traitements. Pourtant, dans cette première phase, la libération restait théoriquement possible. Tout cela a changé par la suite, lorsque le site est devenu le plus grand lieu de mise à mort de l’histoire humaine, et que l’immense majorité des victimes ont été des Juifs.
Cette évolution graduelle permet de mieux comprendre comment les gens l’ont vécue — en particulier les Juifs allemands. Beaucoup m’ont dit : « Nous pensions que les choses finiraient par redevenir normales. » Il y avait un espoir largement répandu, ou une illusion, que la situation allait se stabiliser. Mais elle n’a fait qu’empirer, étape par étape.
L’une des conclusions les plus décourageantes que l’on puisse tirer de cette histoire — s’agissant de la population non juive en Allemagne —, c’est que beaucoup n’étaient pas motivés par une réelle conviction, mais par le pragmatisme, ou simplement par le désir de vivre en paix. La plupart des gens aspirent à une vie de famille, à un emploi stable, à un sentiment de sécurité — et s’adaptent à ce que la société attend d’eux.
Cela apparaît très clairement en 1933, quand une majorité écrasante d’Allemands se précipite pour rejoindre le parti nazi une fois Hitler arrivé au pouvoir. Le parti a même dû suspendre temporairement les adhésions. On ne peut pas croire que tous ces gens se soient soudainement dit : « Hitler a raison. » Ils voulaient simplement améliorer leur situation, faire progresser leur carrière, s’occuper des leurs. Et je ne pense pas une seconde que cette tendance soit propre aux Allemands. C’est une tendance humaine, universelle.
Depuis les travaux fondamentaux de George L. Mosse, l’histoire intellectuelle et culturelle du nazisme est devenue un champ d’étude central pour les historiens. Comment situez-vous votre propre travail par rapport à celui de chercheurs comme Mosse, Johann Chapoutot ou Christian Ingrao ?
Je trouve le travail de Mosse extrêmement précieux pour comprendre l’environnement intellectuel et culturel dont est issu le nazisme. Ses analyses sont particulièrement éclairantes lorsqu’il s’agit du mouvement völkisch du XIXe siècle — un courant fondamental, mais trop souvent négligé, dans la genèse de l’idéologie nazie. Il replace ce mouvement dans le contexte plus large de la modernisation rapide de l’Allemagne après l’unification, ainsi que dans celui de l’émancipation simultanée des Juifs. Aucun autre pays européen n’a connu une transformation aussi radicale au XIXe siècle — qu’elle soit politique, sociale ou économique —, et dans bien des esprits, les Juifs sont alors devenus le symbole même de cette modernité. On les percevait non seulement comme les bénéficiaires du changement, mais aussi comme ses agents — donc comme une menace.
Cette perception, comme le montre Mosse, est à la base de l’antisémitisme völkisch et permet, par exemple, de mieux comprendre la haine viscérale des nazis envers les grands magasins. Ces derniers étaient vus comme des entreprises dirigées par des Juifs, qui détruisaient le commerce traditionnel et local.
Hitler a hérité de ces ressentiments et les a exacerbés.
Mosse décrit — avec beaucoup de brio — un penseur völkisch de la fin du XIXe siècle qui nourrissait une haine passionnée des chemins de fer, qu’il considérait comme des vecteurs de désordre et de déracinement. Cette hostilité à l’infrastructure moderne s’inscrivait dans une vision plus large, une exaltation romantique de la nature et de la forêt allemande, qui a trouvé une expression grotesque chez des figures comme Himmler, fasciné par les arbres sacrés, ou dans l’idéologie du Blut und Boden (le sang et la terre) en général.
Aucun autre pays européen n’a connu une transformation aussi radicale que l’Allemagne au XIXe siècle.
Laurence Rees
On retrouve aussi cette vision dans certaines productions culturelles, comme le film de Goebbels Ewiger Wald (La Forêt éternelle), qui consiste presque entièrement en des images de forêts mises en musique — avec pour objectif de transmettre le message selon lequel la vertu et l’héroïsme naissent dans la pureté des bois, tandis que la ville incarne la décadence et la corruption.
Mosse, mais aussi Emilio Gentile, ont beaucoup insisté sur l’esthétisation de la politique — et sur la politique de l’esthétique — dans les mouvements fascistes. Comment votre recherche aborde-t-elle le rôle des éléments culturels et esthétiques dans la formation de la mentalité nazie ?
On en voit les effets très clairement dans la manière dont Goebbels concevait la stratégie esthétique. Il a longtemps été un objet d’étude privilégié pour moi — j’ai réalisé un film et écrit un livre à son sujet il y a des années — et il est frappant de constater à quel point il était obsédé par ces questions.
Ce n’était d’ailleurs pas seulement le cas de Goebbels, qui cherchait à façonner la vie culturelle du pays, mais aussi de Hitler lui-même, passionné d’architecture, travaillant étroitement avec Speer, et animé par le désir de refaçonner le monde physique pour qu’il corresponde à sa vision idéologique.
George Orwell a écrit un essai remarquable à ce sujet, dans lequel il observe que certains visiteurs britanniques des rassemblements de Nuremberg furent frappés par la puissance esthétique du spectacle — les projecteurs, la célèbre « cathédrale de lumière » qui perçait le ciel.
De nombreuses cérémonies SS avaient également lieu la nuit, à la lueur des torches. Il y avait là toute une esthétique virile — centrée sur la force, la puissance, la rigidité, la grandeur — qui fonctionnait comme une incarnation visuelle du message idéologique.
L’un des aspects les plus fascinants, à mes yeux, est ce que nous avons exploré dans le deuxième épisode de The Nazis : A Warning from History. Nous y soulignions le contraste frappant entre l’esthétique extérieure — l’ordre absolu, les rangées d’individus semblant se mouvoir comme des automates, comme dans Le Triomphe de la volonté de Leni Riefenstahl, l’architecture monumentale — et le fonctionnement réel du régime. En coulisses, c’était un chaos immense, précisément en raison du dynamisme interne que nous avons évoqué plus tôt. Luttes de pouvoir permanentes, responsabilités qui se chevauchaient, promesses sans cesse formulées puis non tenues — tout cela entretenait un état quasi permanent de crise.
Votre livre se termine par douze avertissements. Pouvez-vous expliquer comment vous les avez formulés ? Et pensez-vous vraiment que notre monde pourrait basculer aussi rapidement que celui de nos prédécesseurs dans les années 1930 ? Qu’est-ce qui distingue les prédateurs d’aujourd’hui de ceux du siècle dernier ?
Ces douze avertissements sont nés des échanges que j’ai eus, tout au long de l’écriture, avec des psychologues et des neuroscientifiques. Mais au-delà de ces dialogues, je voulais que le livre possède à la fois une structure narrative et une structure thématique — ce qui est toujours un défi dans un ouvrage historique, comme dans la réalisation de documentaires. Mais c’est un objectif que je me suis toujours fixé.
J’ai structuré chaque avertissement en lien avec un moment historique précis développé dans le récit. Le premier, par exemple — les théories du complot — intervient très tôt, car il est directement lié au climat idéologique qui a conduit à la Seconde Guerre mondiale. Même si cette question revient tout au long du livre, j’ai choisi de la traiter de manière concentrée à cet endroit-là. J’ai appliqué la même logique aux autres thèmes : l’érosion des droits humains est abordée au moment de l’arrivée des nazis au pouvoir ; la « distanciation psychologique » est évoquée dans le contexte de la mise en place des chambres à gaz. J’ai donc tenté de construire une structure où chaque chapitre mettrait en lumière une dimension psychologique ou neurologique sous-jacente à l’histoire. Ce ne fut pas simple, mais je crois que cela a fonctionné — notamment dans le chapitre consacré à la corruption de la jeunesse, qui est le seul à modifier légèrement la chronologie en avançant dans le temps avant de revenir en arrière. Curieusement, peu de lecteurs ont remarqué ce déplacement, mais j’ai réussi à l’intégrer dans l’arc narratif général.
L’essence de l’attrait idéologique hitlérien — son émotionnalité, son exploitation de la peur et du ressentiment — est encore bien présente dans de nombreuses sociétés.
Laurence Rees
Quant à savoir si ce type d’événements pourrait se reproduire : c’est précisément pour cela que le livre est conçu comme un avertissement. Bien sûr, nous ne verrons pas une répétition exacte — il n’y aura pas un nouvel Hitler, un nouveau NSDAP. Mais l’essence de l’attrait idéologique hitlérien — son émotionnalité, son exploitation de la peur et du ressentiment — est encore bien présente dans de nombreuses sociétés. Cela dit, j’ai volontairement évité d’établir des parallèles explicites avec des régimes contemporains, pour deux raisons.
D’abord, cela aurait été présomptueux. J’ai consacré des décennies à étudier cette période précise ; je ne peux pas prétendre avoir la même expertise sur la Russie ou la Chine, que je ne connais qu’à travers les médias.
Ensuite, depuis la parution du livre dans d’autres langues, j’ai constaté que les lecteurs, dans chaque pays, établissent leurs propres correspondances. Ils voient ce qui résonne dans leur propre contexte — bien plus justement que je ne le pourrais, car cela s’enracine dans leur expérience vécue. C’était l’intention dès le départ.
Tout cela reste terriblement actuel. Le dernier chapitre du livre réfléchit à l’extrême fragilité du monde dans lequel nous vivons. Après avoir rencontré tant de personnes dont la vie a été bouleversée de manière brutale et soudaine, j’en suis venu à croire que tout — les institutions, les identités, la sécurité — est bien plus précaire qu’on ne l’imagine. Les Juifs de Hongrie, par exemple, n’ont pas connu le même niveau de persécution que les Juifs allemands jusqu’à l’invasion du pays par les nazis en mars 1944. En quelques semaines, plus de 400 000 d’entre eux ont été envoyés à Auschwitz. C’est à cette vitesse-là que les choses peuvent basculer.
Beaucoup de gens se bercent d’illusions sur le monde qui les entoure. Ils partent du principe que les structures vont tenir. Mais la vie — et les systèmes qui la soutiennent — est d’une fragilité stupéfiante. J’étais récemment à Paris, et je suis passé devant l’Assemblée nationale. Comme beaucoup d’institutions — le Parlement britannique, le Capitole américain —, elle est conçue pour paraître monumentale, éternelle. Mais en réalité, les idéaux que ces lieux incarnent sont bien plus vulnérables que ce que l’on croit.
De nombreux observateurs cultivés ont rencontré Hitler et l’ont pris pour un imbécile, un histrion, un illuminé incohérent : ils ne comprenaient pas qu’il ne s’adressait pas à eux.
Laurence Rees
Il y a une statistique à laquelle je reviens sans cesse : en 1928, soit huit ans après la proclamation du manifeste nazi dans une brasserie de Munich, le parti nazi ne recueillait que 2,6 % des voix.
Une immense majorité d’Allemands rejetait Hitler et son antisémitisme violent.
Moins de cinq ans plus tard, il était chancelier et son parti était devenu le plus puissant d’Allemagne.
Lorsqu’on voit aujourd’hui des partis extrémistes plafonner à 2,6 %, il est dangereux de les balayer d’un revers de main.
Un autre péril est la complaisance intellectuelle. De nombreux observateurs cultivés ont rencontré Hitler et l’ont pris pour un imbécile, un histrion, un illuminé incohérent : ils ne comprenaient pas qu’il ne s’adressait pas à eux. Il ne cherchait pas à convaincre les intellectuels ; il parlait à tous ceux qui ne partageaient pas leur bagage. La complaisance des élites contribue à ouvrir la voie à l’autoritarisme. C’est glaçant de voir à quel point ces schémas nous semblent familiers aujourd’hui. Parfois, je suis stupéfait que la démocratie existe encore. C’est presque un miracle.

