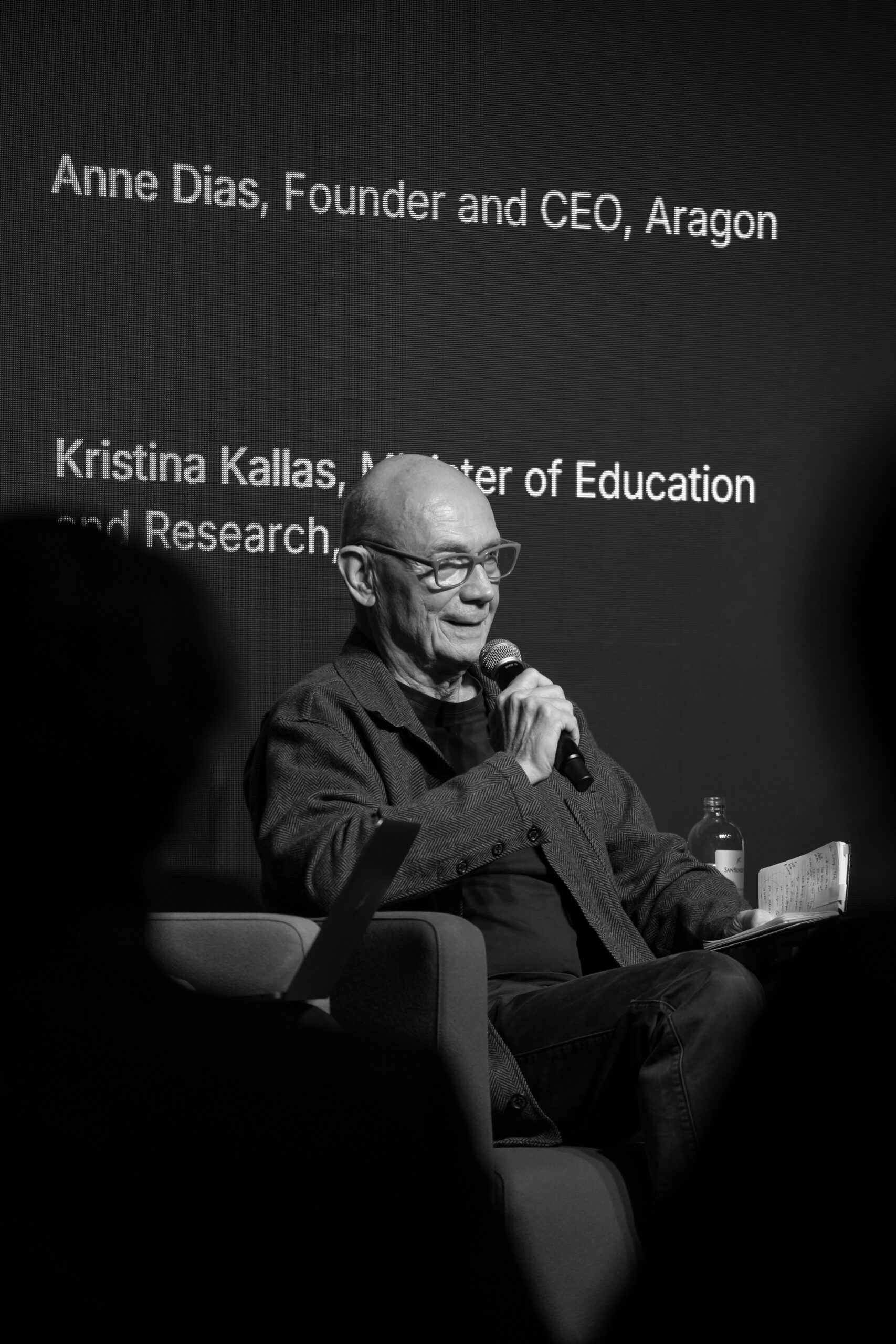Katrin Bennhold
Avant de nous plonger au cœur du sujet, prenons un moment pour examiner le contexte global dans lequel nous évoluons actuellement. Un célèbre milliardaire s’est érigé en porte-parole des Américains ordinaires. La Chine s’est imposée comme le défenseur autoproclamé du libre-échange. La Corée du Nord a désormais des troupes sur le terrain en Europe. Le gouvernement allemand s’est effondré. Le gouvernement français est au bord de l’effondrement. Ironiquement, c’est l’Italie détient désormais le titre de gouvernement le plus stable d’Europe. La situation serait presque comique si elle n’était pas aussi grave.
L’Europe est bien plus vulnérable qu’elle ne l’était lorsque Trump a été élu pour la première fois en 2016. Nous sommes aux prises avec une guerre, une crise économique et une montée en puissance des mouvements nationalistes populistes. Aujourd’hui, huit de ces mouvements dirigent des gouvernements ou participent à des coalitions à travers le continent.

Que nous réserve l’avenir ? La réponse courte est que nous ne savons tout simplement pas — l’imprévisibilité ayant toujours été la signature de Trump. Mais pour nous préparer, nous devons prendre ses mots au sérieux. L’Europe fait face à trois menaces majeures qui exigent une action immédiate : un accord de paix en Ukraine qui permettrait à la Russie de revendiquer la victoire ; une guerre commerciale qui pourrait dévaster nos économies ; une montée en puissance de l’extrême droite nationaliste en Europe, qui pourrait faire s’effondrer le centre libéral qui maintient l’unité de l’Europe.
Commençons par l’Ukraine — sans doute la question la plus urgente. Kristina Kallas, vous êtes membre du gouvernement estonien, et l’Estonie est un État membre de l’OTAN. Que signifierait une nouvelle présidence Trump pour la sécurité européenne, en particulier pour votre pays ?
Kristina Kallas

Je vis pratiquement à la frontière russe. J’enseigne à seulement 150 mètres de la Russie, je suis donc en première ligne. En Estonie, nous ressentons chaque jour le poids de la guerre. Et permettez-moi d’insister sur ce point : cette guerre n’est pas seulement celle de l’Ukraine, c’est aussi celle de l’Europe.
Lorsque l’on pense à l’effondrement du gouvernement allemand, à l’incertitude entourant le gouvernement français, à la crise énergétique en cours et à l’instabilité des relations transatlantiques, on dresse un tableau sombre mais précis de la situation préoccupante de l’Europe. Du point de vue de l’Estonie, quand on est à 150 mètres de la frontière russe, ce sentiment d’instabilité et d’imprévisibilité est directement perceptible.
Dans cet environnement instable, l’essentiel est de rester déterminés et lucides quant aux véritables enjeux. Permettre à la Russie — ou à la Russie en collaboration avec les États-Unis — de négocier un accord sur le territoire ukrainien n’est pas une voie vers la paix. Un tel résultat n’apporterait pas la paix ; il signifierait la guerre. Pour moi, pour ma maison, pour ma famille et pour tout ce que nous représentons — la démocratie, la liberté et les valeurs du centre libéral — ce serait un coup dévastateur.
Du point de vue de l’Estonie, quand on est à 150 mètres de la frontière russe, le sentiment d’instabilité et d’imprévisibilité est directement perceptible.
Kristina Kallas
Nous ne devons pas perdre de vue que toute prétendue « paix » qui légitime l’agression russe n’est pas une paix : c’est une invitation à poursuivre le conflit. L’Europe doit rester unie et déterminée à repousser l’agresseur à ses frontières souveraines — c’est-à-dire là où tout a commencé.
Et pour y parvenir, le message que nous véhiculons sur nous-mêmes devient essentiel.
Comment en convaincre les pays qui ne se trouvent pas en première ligne — sur les investissements nécessaires en matière de défense notamment ?
Si j’avais une réponse claire pour convaincre les électeurs des pays non frontaliers de la Russie d’investir dans la défense de l’Union — et respecter ainsi les engagements initiaux pris par l’OTAN il n’y a pas si longtemps — je serais probablement présidente de l’Union. Mais je n’ai pas de solution simple. Ce que j’ai, en revanche, c’est une profonde conviction que nous devons tous travailler sans relâche pour défendre cette idée.
C’est précisément la raison pour laquelle je suis ici. Je suis ministre de l’Éducation — pas de la Défense. Et pourtant, je suis venue au Sommet Grand Continent pour plaider l’importance d’investir dans notre défense collective, un effort essentiel pour la sécurité et la stabilité de l’Europe. Nous devons nous assurer de consacrer les ressources nécessaires à notre protection, et cela commence par convaincre tout le monde — ici et ailleurs — de l’urgence de cette mission.
C’est un véritable défi pour l’Estonie. Cette année, nous avons investi 3,4 % de notre PIB dans la défense, ce qui a impliqué des coupes budgétaires difficiles dans d’autres domaines, y compris l’éducation. En tant que ministre de l’Éducation, mère de famille et professeur d’université, je prends la pleine mesure des sacrifices exigés. Mais je sais aussi que si nous ne faisons pas cet effort maintenant, il n’y aura peut-être plus d’école ni d’opportunité demain.
Je me suis rendu en Ukraine il y a quelques mois et j’ai vu des écoles où les enfants suivaient des cours dans des abris souterrains. C’est la dure réalité causée par la menace constante d’attaques de drones. Comme le ministre des Finances ukrainien l’a mentionné aujourd’hui, 3 000 frappes de drones ont lieu régulièrement, y compris à Kiev et dans d’autres régions éloignées de la ligne de front. En voyant ces enfants, j’ai compris une chose essentielle : il ne s’agit pas d’une histoire lointaine, mais bien d’une guerre en Europe. Cela se passe sur notre continent.
L’agresseur qui se cache derrière ces actions ne s’arrêtera pas à l’Ukraine. Il ne s’agit pas seulement d’un conflit localisé, mais d’une grande stratégie visant à remodeler l’ensemble de l’équilibre sécuritaire en Europe. Nous devons en être parfaitement conscients. Les responsables politiques européens ont une tâche essentielle à accomplir : expliquer à leurs citoyens pourquoi nous devons agir maintenant, faire les investissements et les sacrifices nécessaires pour nous défendre et assurer l’avenir de l’Europe.
Je suis ministre de l’Éducation — pas de la Défense. Et pourtant, je suis venue au Sommet Grand Continent pour plaider l’importance d’investir dans notre défense collective.
Kristina Kallas
Elizabeth Baltzan, vous êtes conseillère pour le commerce et l’investissement au sein du bureau exécutif du président des États-Unis. L’une des principales préoccupations de l’Europe en ce moment tourne autour des diverses déclarations de Donald Trump sur les droits de douane. Pensez-vous que Donald Trump irait jusqu’au bout d’une telle démarche, compte tenu de son impact inflationniste évident sur l’économie américaine ? Comment l’Europe devrait-elle se préparer à cette éventualité ?
Elizabeth Baltzan

En tant que représentante de l’administration Biden, la meilleure façon pour moi de répondre est peut-être de contester l’une des déclarations que vous avez faites dans vos propos introductifs — en particulier, l’idée que la Chine est le défenseur du libre-échange.
Cette idée a pris de l’ampleur en 2017 à Davos, dans une salle remplie des milliardaires que vous avez également mentionnés. Mais lorsque nous examinons les sept dernières années, il est évident que cette affirmation ne tient pas la route. Prenons, par exemple, les taux de droits de douane consolidés à l’OMC : ceux de la Chine sont de 10 %, ceux de l’Europe de 5 % et ceux des États-Unis de 3,2 %, si je me souviens bien. L’idée qu’une grande économie puisse réellement défendre le libre-échange dans sa forme la plus pure mérite donc d’être examinée de plus près ; pour moi, c’est une idée reçue que nous devrions réévaluer de manière critique.
Par ailleurs, j’aimerais souligner un point connexe qui, je l’espère, contribuera à la réflexion stratégique de l’Europe dans la gestion de ce paysage économique en mutation.
Mon ancien collègue Brad Setser, qui est parmi nous aujourd’hui, a comparé récemment la politique industrielle de la Chine — en particulier dans le domaine des véhicules électriques — à la loi américaine sur la réduction de l’inflation (Inflation Reduction Act, IRA). Les parallèles et les contrastes suscitent la réflexion et offrent une perspective précieuse pour examiner la manière dont les différentes nations se positionnent dans cet environnement mondial en pleine évolution.
Le tollé suscité en Europe par l’IRA a été important. Pourtant, curieusement, la Chine n’a presque pas été mentionnée. En Allemagne, on entend déjà parler de désindustrialisation. Cela signifie que nous devons vraiment reconsidérer les incitations au sein du système commercial mondial afin que nous puissions mieux naviguer dans les temps difficiles qui s’annoncent.
Pensez-vous qu’il soit réaliste pour l’Europe d’être confrontée à des droits de douane de cette ampleur ?
Je ne travaille pas pour l’administration Trump, mais pour Joe Biden.
Le tollé suscité en Europe par l’IRA a été important. Pourtant, curieusement, la Chine n’a presque pas été mentionnée.
Elizabeth Baltzan
Si des droits de douane sont imposés sur les exportations européennes vers les États-Unis, quelles seraient les contre-mesures potentielles que l’Europe devrait envisager ? L’Europe devrait-elle adopter une réponse plus mesurée ou une position plus agressive — et quel impact cela aurait-il sur notre relation avec la Chine ?
Pascal Lamy

La réponse simple est que nous ne savons pas.
Nous savons que Trump se veut imprévisible et transactionnel, ce qui contraste fortement avec la nature de l’Union : nous sommes prévisibles, méthodiques et attachés au respect de certaines règles. Cela équivaut à jouer à un jeu avec quelqu’un qui ne suit pas les mêmes règles.
Nous ne pouvons pas prédire ce que Donald Trump fera en ce qui concerne les droits de douane. D’ailleurs, notons que si l’administration Biden n’a jamais exprimé un penchant particulier pour les droits de douane, elle ne les a pas non plus rejetés catégoriquement. Cela donne une idée de l’attitude générale des États-Unis, qui semblent aujourd’hui croire qu’ils peuvent fonctionner sans ouverture commerciale. Pour l’Union, en revanche, l’ouverture des échanges est essentielle, surtout lorsqu’il s’agit de faire progresser la recherche et le développement.
Trump pourrait jouer le jeu des tarifs douaniers de deux manières contradictoires, qui pour lui n’est pas un problème. La première approche est idéologique : il considère le déficit commercial des États-Unis comme une faiblesse et veut le rééquilibrer en imposant des droits de douane à tout le monde — l’Europe, la Chine, le Brésil, les pays d’Afrique et d’autres encore. Personnellement, je considère qu’il s’agit là d’une interprétation simpliste et que ce n’est pas la plus probable. La raison en est que dans l’administration précédente de Trump, des personnalités comme Bob Lighthizer étaient les véritables idéologues qui poussaient à l’adoption de mesures commerciales pour combler le déficit commercial des États-Unis, et qu’ils ne sont plus là.
Cela dit, le défi reste de taille, non pas tant en raison de l’impact immédiat sur le commerce que des effets potentiels sur l’inflation américaine. Si Donald Trump augmente les droits de douane, il est probable que l’inflation augmente aux États-Unis, ce qui pourrait entraîner une hausse des taux d’intérêt à long terme, dont les coûts seront supportés par toute l’économie mondiale en raison de la prédominance du dollar.
Nos forces sont évidentes : la taille de notre marché et notre unité. Mais nous avons aussi deux faiblesses majeures : notre manque de cohérence géostratégique — pour le dire diplomatiquement — et notre potentielle désunion.
Pascal Lamy
Si ce scénario se réalise, les conséquences macroéconomiques pourraient être considérables, en particulier pour les pays fortement endettés en dollars américains. Ces effets pourraient être plus dommageables que les droits de douane eux-mêmes.
Je pense au contraire — c’est la deuxième option — que Trump utilisera probablement les droits de douane comme un outil transactionnel, considérant le déficit commercial des États-Unis non pas comme une faiblesse — comme il le prétend — mais bien davantage comme une monnaie d’échange.
La stratégie serait simple. En substance : « payez-moi pour éviter les droits de douane qui rendraient vos exportations vers les États-Unis plus chères ». Je pense qu’il s’agit là du cœur de son approche et c’est ce à quoi nous devons nous préparer — il faut aussi se préparer au premier scénario qui, même s’il me semble moins probable, est loin d’etre impossible.
Dans les deux cas, nous devons envisager des stratégies multiples et être prêts à réagir à ses initiatives. Pour l’Union, l’exercice sera douloureux. Nous devons être lucides sur nos forces et nos faiblesses. Nos forces sont évidentes : la taille de notre marché et notre unité. Mais nous avons aussi deux faiblesses majeures : notre manque de cohérence géostratégique — pour le dire diplomatiquement — et notre potentielle désunion.
Pour répondre clairement à votre question, je pense que nous devons démontrer que nous pouvons être forts, en particulier dans le domaine du commerce, en raison du rôle important que joue notre marché pour les exportateurs américains. C’est pourquoi je ne suis pas du tout d’accord avec le commentaire de Christine Lagarde qui, la semaine dernière, suggérait d’acheter plus de gaz liquide aux États-Unis pour calmer le chien qui aboie.
Cette approche me semble totalement erronée.
Il ne faut jamais négocier avec les États-Unis lorsque nous sommes en position de faiblesse — cela vaut quel que soit le président. Avec Trump, qui est connu pour utiliser la force comme levier, c’est encore plus problématique.
Je voudrais également souligner que nos relations avec les États-Unis ne se limitent pas aux relations avec le gouvernement fédéral. Elles impliquent également les entreprises et les États fédérés. Si les États n’ont peut-être pas un droit de regard direct sur la politique commerciale, ils ont certainement le pouvoir de l’influencer de manière significative. Je suggérerais donc de diversifier le type de relation commerciale en impliquant d’autres acteurs que la Maison Blanche — le Bureau du représentant américain au Commerce ou le Département du Commerce.
En matière de politique commerciale, nous devrions en effet être unis mais la réalité est que nous ne le sommes pas : si l’on relie les questions de sécurité et de commerce, comme cela sera inévitablement le cas, on aboutit à un scénario dans lequel Donald Trump pourrait s’engager avec des pays d’Europe de l’Est qui ne le défieront pas sur les droits de douane, craignant de perdre le soutien militaire américain alors que d’autres pays comme l’Allemagne pourraient être plus préoccupés par leurs relations commerciales avec la Chine, en particulier lorsqu’il s’agit de leurs constructeurs automobiles…
Il y a une différence considérable entre la défense et le commerce : la défense est une compétence nationale, alors que le commerce est une compétence fédéralisée depuis le traité de Rome. Cela ne date pas d’aujourd’hui. Les décisions en matière de commerce sont prises au niveau de l’Union, sur proposition de la Commission, et peuvent être adoptées par un vote à la majorité qualifiée, suivi d’une ratification par le Parlement. Il existe donc une tendance institutionnelle à l’unité, dont la Commission européenne sait généralement tirer parti. Toujours est-il que ce monde fondé sur un respect des institutions n’est pas celui dans lequel nous entrerons le 20 janvier au moment de la prise de fonction de Donald Trump — malheureusement.
Il ne faut jamais négocier avec les États-Unis lorsque nous sommes en position de faiblesse — cela vaut quel que soit le président.
Pascal Lamy
Pour mieux comprendre comment la coalition électorale qui a porté Trump au pouvoir a été rendue possible, il est crucial d’examiner les griefs et les intérêts réels — et souvent fabriqués — qui alimentent son succès — en particulier parmi les électeurs de la classe ouvrière. Quelles leçons les Européens peuvent-ils tirer ?
Barry C. Lynn

Je commencerai par rappeler une chose que beaucoup de gens ont peut-être oubliée. Fin août, Donald Trump a menacé par écrit Mark Zuckerberg en l’avertissant qu’il risquait la prison à vie s’il ne faisait pas ce qu’il fallait. Les médias n’en ont pas beaucoup parlé mais il s’agissait d’un événement extraordinaire. À ce moment-là, le futur président des États-Unis a menacé le PDG de l’une des entreprises les plus puissantes du monde d’une peine d’emprisonnement à vie s’il ne supprimait la modération sur ses réseaux sociaux.
Les Européens devraient suivre cette affaire de près, car la menace à laquelle les États-Unis sont confrontés aujourd’hui est fondamentalement différente des préoccupations habituelles concernant les grandes entreprises technologiques américaines.
Cela dit, je suis convaincu que l’avenir de la relation transatlantique peut être incroyablement fort : il pourrait s’agir de l’une des périodes les plus importantes de l’histoire. Mais cela ne se produira que si et seulement si l’Europe prend aujourd’hui des mesures pour faire face à deux menaces existentielles.
La première est la menace que la Chine et la Russie font peser sur la sécurité : la guerre sino-russe contre l’Europe. Je ne parle pas de la Russie ou de la Chine individuellement. Elles sont désormais liées et leur alliance est profondément intégrée. On ne peut pas les séparer. Il est temps pour les Européens de reconnaître qu’ils sont effectivement et objectivement en guerre avec la Chine et la Russie.
La deuxième menace existentielle est l’influence croissante des réseaux sociaux américains qui ont été infiltrés et arsenalisés par Donald Trump. C’est une situation désastreuse : une guerre sur deux fronts, l’un contre votre démocratie et l’autre contre votre sécurité.
Alors, que faut-il faire ?
La première chose à faire est de reconnaître à quel point la guerre de l’information est sérieuse. On peut évoquer les récents événements survenus en Roumanie à cause de TikTok mais il faut prêter une grande attention à ce que fait Elon Musk au Royaume-Uni. Pensez aux émeutes qu’il a provoquées au cours de l’été, à son appel au renversement du gouvernement Starmer et à sa pétition pour de nouvelles élections. Selon certaines informations, Elon Musk aurait même l’intention d’investir 100 millions de dollars sur X pour défier Keir Starmer. Il s’agit ni plus ni moins d’une guerre contre la démocratie. Si cela se passe au Royaume-Uni, c’est que cela peut facilement s’étendre à la France, à l’Allemagne et à d’autres parties de l’Europe — si ce n’est déjà le cas.
Il est temps pour les Européens de reconnaître qu’ils sont effectivement et objectivement en guerre avec la Chine et la Russie.
Barry C. Lynn
Alors, que faire ? Tracer des lignes claires : ne pas se focaliser sur Trump, mais plutôt sur les besoins de l’Europe. Je dirais aux Européens : si vous réagissez constamment aux propos de Trump, vous serez toujours en train de rattraper le temps perdu. Concentrez-vous plutôt sur deux questions essentielles : de quoi l’Europe a-t-elle besoin pour garantir sa démocratie et de quoi a-t-elle besoin pour garantir la paix ? S’attaquer à la menace sino-russe est essentiel pour garantir la paix. Concentrez-vous sur les besoins actuels de l’Europe, rassemblez-vous sur ces questions et vous vous retrouverez en position de force pour négocier avec Trump.
Comme Pascal Lamy vient de le souligner, il est essentiel d’être en position de force pour négocier. Si l’Europe agit de la sorte, Trump cessera de saper votre démocratie et, ensemble, vous pourrez travailler de manière constructive pour faire face à la menace Chine-Russie et garantir la paix, en empêchant la possibilité d’une guerre mondiale.
La difficulté réside toutefois dans le fait que l’Europe n’est pas un acteur unifié.
En juillet dernier, Viktor Orbán a prononcé un discours important dans lequel il disait en substance : « Ne vous préoccupez pas des États-Unis. Ils peuvent laisser l’Europe. Concentrons-nous sur la Chine et mettons tous nos œufs dans ce panier. » La Hongrie est ouverte aux affaires. Quant à l’Allemagne, bien qu’elle ait une conscience morale bien ancrée, elle est fortement liée à l’industrie automobile, elle-même liée à la Chine. Comme vous pouvez le constater, l’unité est plus facile à proclamer qu’à obtenir dans les faits.
L’exemple allemand illustre parfaitement le dilemme auquel l’Europe est confrontée.
L’Allemagne a un problème d’industrie automobile, un problème d’emploi et un problème avec la Chine. Comment les constructeurs automobiles s’y prennent-ils ? Ils transfèrent une plus grande partie de leurs activités vers la Chine — BASF fait d’ailleurs de même dans la chimie, tout comme les sidérurgistes. Mais voilà : j’ai étudié les documents fondateurs de l’Union européenne, y compris les accords sur le charbon et l’acier et il me semble que je comprends parfaitement leur intention. Les accords conclus au début des années 1950 ont établi un cadre de contrôle industriel partagé, notamment dans le contexte de la Communauté du charbon et de l’acier. L’Allemagne n’a pas le droit unilatéral de délocaliser ses grandes industries, comme BASF, vers la Chine. Conformément à ces accords fondamentaux, chaque nation européenne est concernée par ces décisions et devrait avoir son mot à dire sur la manière dont ces mouvements stratégiques sont pris. L’Allemagne ne devrait pas pouvoir prendre une telle décision toute seule.
Anne Dias, vous êtes franco-américaine et gestionnaire de fonds d’investissement. Aux yeux de nombreuses personnes qui critiquent un système dont ils considèrent qu’il ne leur apporte plus rien — entre stagnation des salaires et manque de considération — vous pourriez être perçue comme une membre de l’élite libérale si décriée. Pensez-vous que nous devrions repenser notre système économique et notre libéralisme pour qu’ils répondent à nouveau aux besoins des citoyens ?
Anne Dias

Je ne me considère pas comme la porte-parole de l’élite libérale mondiale telle que vous la décrivez. Mais je peux partager quelques réflexions sur la relation que l’Europe pourrait entretenir avec la nouvelle administration américaine. L’idée que tout cela ne serait qu’une pensée fugace ou le fruit d’un comportement imprévisible commence à s’estomper. Ce que je perçois désormais dans les actions de Donald Trump et dans sa politique économique — que l’on pourrait qualifier de Trumponomics — est l’émergence d’un système structuré, voire d’une véritable doctrine. Les nominations au sein de son administration révèlent une ligne directrice claire qui guide une grande partie de ses politiques et décisions : une nouvelle guerre froide avec la Chine.
Je partage pleinement l’analyse selon laquelle cela implique une redéfinition profonde des relations entre les États-Unis et l’Europe. L’idée que des raisons historiques ou éthiques justifieraient une alliance indéfectible entre les deux blocs ne semble pas être une priorité pour cette administration. La question clef pour moi est de savoir si l’Europe pourrait choisir de rester à l’écart et refuser de négocier. Pour l’instant, cela reste une grande inconnue. Mais je suis convaincue que plus l’Europe tardera à agir — que ce soit par l’intermédiaire d’Ursula Von der Leyen ou d’autres acteurs — plus elle risque d’en subir les conséquences.
Si l’on accepte que l’idée d’une union transatlantique forte et inséparable appartient désormais au passé, alors les Européens n’ont qu’une seule option : aller de l’avant.
Si les États-Unis s’engagent dans une stratégie de déréglementation et de simplification gouvernementale, nous devrions également réfléchir à cette approche de ce côté de l’Atlantique.
Anne Dias
Actuellement, nous n’avons pas de véritable marché unique. Nous disposons d’un potentiel immense, avec le plus grand nombre de consommateurs, mais des secteurs clefs comme les télécommunications, la défense, la banque ou l’assurance restent fragmentés. Il est donc temps de créer un marché unique européen pleinement intégré : un tel marché serait bien plus fort et capable de négocier sur un pied d’égalité avec d’autres puissances économiques.
Pour moi, la situation actuelle impose un véritable bond en avant dicté par les circonstances. En tant qu’investisseur, je suis particulièrement attentive à deux aspects cruciaux : l’intégration et l’échelle. Malheureusement, nous manquons cruellement d’entreprises de grande envergure, ce qui nous empêche de rivaliser avec les grandes puissances sur le plan commercial.
Prenons l’exemple du marché européen des télécommunications : le nombre moyen d’abonnés par opérateur est d’environ 5 millions — contre 125 millions aux États-Unis et 325 millions en Chine. Pour être compétitifs, nous devons impérativement unir nos forces et bâtir un véritable marché unique.
Par ailleurs, nous possédons de nombreux avantages concurrentiels souvent sous-estimés. Par exemple, notre expertise dans le domaine du nucléaire est remarquable mais nos coûts de l’énergie restent élevés. Il est essentiel de revenir au nucléaire, d’autant plus que les États-Unis, avec leur politique agressive d’exploitation des ressources (drill-baby-drill), continueront à bénéficier de coûts de l’énergie particulièrement bas.
Enfin, si les États-Unis s’engagent dans une stratégie de déréglementation et de simplification gouvernementale, nous devrions également réfléchir à cette approche de ce côté de l’Atlantique. Améliorer notre compétitivité et renforcer nos capacités de défense nécessitera des investissements importants. Une partie de ces ressources devra provenir d’un gouvernement plus efficace, plus léger et mieux adapté aux défis actuels.

Pour autant, nous ne pouvons pas simplement continuer à promouvoir une intégration européenne plus poussée sans obtenir un mandat clair des citoyens, qui restent les garants ultimes de la démocratie que nous prétendons défendre. Il est impératif d’avancer avec prudence. Devons-nous repenser certains aspects, alors que notre système économique engendre des inégalités croissantes et un sentiment d’abandon chez ceux qui se sentent méprisés par les élites ou au contraire, pensez-vous qu’il ne serait pas nécessaire de remettre fondamentalement ce système en question ?
Je vois en réalité trois niveaux d’intervention différents : une question diplomatique et géopolitique internationale ; une question de compétitivité en tant qu’investisseur, ce qui me préoccupe en premier lieu ; et une question de démocratie.
Je pense qu’il sera difficile et peu lisible pour la plupart des électeurs de les réunir sous une seule solution systémique.
Nicholas Mulder, vous êtes historien et vos recherches portent sur la politique, l’économie, les institutions internationales et la guerre aux XIXe et XXe siècles. Comment replacer le moment que nous traversons dans une perspective historique ?
Nicholas Mulder

Je travaille spécifiquement sur les sanctions et il me semble que quelques réflexions sur ce sujet peuvent apporter un éclairage pertinent sur l’état actuel des relations transatlantiques.
Dans une certaine mesure, celles-ci sont aujourd’hui plus solides qu’elles ne l’ont été par le passé en raison d’un soutien relativement sans précédent autour de l’effort commun contre la Russie et d’un ensemble cohérent de mesures de soutien économique à l’Ukraine. Trump remet évidemment tout cela en question mais il est intéressant de réfléchir aux forces et aux faiblesses relatives des États-Unis et de l’Europe dans cet équilibre militaro-économique et dans ce cadre géoéconomique.
Les États-Unis demeurent les principaux fournisseurs de sécurité au monde — non seulement en Europe, mais aussi en Asie orientale. On a souvent tendance à analyser cette question sous l’angle des dépenses de défense, mais il existe également un fardeau économique, en particulier pour les pays à forte activité commerciale. Étant plus ouverte sur le monde, l’Europe porte donc un fardeau relativement plus lourd : le ratio entre le commerce et le PIB y est bien plus élevé qu’aux États-Unis. Étant moins dépendante du commerce, l’économie américaine bénéficie ainsi d’un avantage relatif dans l’usage des sanctions.
Pour l’Europe, les sanctions constituent donc un désavantage comparatif.
Nicholas Mulder
Cela implique que si l’on considère l’ensemble des actions entreprises par l’Europe dans ce domaine, la relation transatlantique semble plutôt être celle de deux partenaires concentrés sur des atouts différents. Mais le résultat des sanctions — c’est une chose qui s’observe à travers les réactions populaires, les controverses et les débats qu’elles suscitent — montre que les gouvernements européens se trouvent fortement sous pression : il arrive même qu’ils perdent des élections car les électeurs estiment que les sanctions nuisent à l’économie européenne. Pour l’Europe, les sanctions constituent donc un désavantage comparatif.
Il existe néanmoins un avantage comparatif : pour l’Europe, l’histoire de l’Union au cours des 30 dernières années, notamment ce qu’elle a accompli en Europe de l’Est, à travers des décennies de fonds structurels régionaux, témoigne d’une réelle capacité de convergence. L’Union excelle dans ce domaine. L’OTAN est compétente en matière de coordination militaire et de défense, mais c’est l’Union qui construit les infrastructures telles que les hôpitaux, les routes et les ponts. Je suis donc convaincu que l’Europe devrait davantage se concentrer sur le soutien économique et budgétaire à l’Ukraine.
Le mécanisme qui permet de transformer les revenus des actifs russes gelés en un fonds souverain pour l’Ukraine est remarquable à cet égard. Les s’accumuleront indéfiniment et maximiseront ainsi la capacité d’emprunt de l’Ukraine à l’heure actuelle.
Cette dépendance bien plus marquée de l’Europe vis-à-vis du commerce fait qu’elle pourrait pâtir très fortement — sans doute plus que les États-Unis — du retour d’une politique d’America First. Barry Lynn, partagez-vous ce constat ?
Barry C. Lynn
J’ai eu la chance, après avoir grandi dans la classe ouvrière, d’intégrer Columbia, d’étudier l’anglais et de trouver un emploi. Ayant travaillé comme journaliste pendant de nombreuses années, j’ai écrit le premier article sur les goulets d’étranglement de la capacité de production des semi-conducteurs à Taïwan, en 2002. Cet article a été publié en une du magazine Harper’s — qui était à l’époque était l’un des plus lus. L’histoire que nous observons aujourd’hui, à savoir les problèmes de la chaîne d’approvisionnement et la concentration de la production de semi-conducteurs à Taïwan, est un sujet que nous connaissions déjà depuis 2002. Cet article avait suscité un grand nombre de réactions à l’époque et cela m’a amené à chercher à comprendre comment une erreur aussi fondamentale avait pu être commise.
Vous avez évoqué tout à l’heure les élites économiques. La plupart d’entre elles ne sont plus véritablement libérales. Leur mode de pensée économique — le néolibéralisme — est, en réalité, anti-libéral car le néolibéralisme favorise les monopoles.
La philosophie de gouvernance adoptée aux États-Unis pendant quarante ans — jusqu’à ce que Biden la modifie — et qui régit encore, dans une certaine mesure, ce qui se passe à Bruxelles est un système anti-libéral, anti-démocratique, pro-monopole et pro-contrôle.
Si nous rencontrons les problèmes que nous rencontrons actuellement, c’est en grande partie parce que ce sont ces élites qui ont permis la création d’entreprises comme Google et Facebook. Ce qui est positif — et c’est là qu’intervient l’espoir — c’est qu’il existe un réveil surprenant : les gens s’éloignent peu à peu de cette manière de penser qui a dominé les élites pendant plus d’une génération.
La plupart des élites économiques ne sont plus véritablement libérales. Leur mode de pensée économique — le néolibéralisme — est, en réalité, anti-libéral car le néolibéralisme favorise les monopoles.
Barry C. Lynn
Il est donc crucial que nous adoptions rapidement et de manière radicale cette nouvelle façon de penser — celle qui nous permet de reprendre en main les outils que l’humanité a construits au cours des quatre cents dernières années pour établir une véritable société libérale.
Elizabeth Baltzan
Je me permets de revenir un instant sur la question des classes ouvrières. L’une des choses que nous avons entreprises sous cette administration — et je ne vais pas toutes les détailler — était de mieux comprendre comment la mondialisation, telle qu’elle s’est déployée depuis les années 90, a affecté la classe ouvrière, et comment cela a contribué aux résultats que nous avons observés — et dont vous avez fait mention. Avec la Représentante américaine au commerce, nous avons visité les 50 États : il n’est pas si habituel de voyager autant à l’intérieur du pays… sauf, précisément, lorsqu’il s’agit de promouvoir un accord de libre-échange. Nous avons rencontré des propriétaires de petites entreprises, des travailleurs syndiqués et non syndiqués, ainsi que des personnes ayant voté pour l’autre camp. Nous voulions aller à la rencontre des gens là où ils se trouvaient, écouter leurs préoccupations, au lieu de leur enseigner des concepts économiques abstraits. Nous avons recueilli de nombreuses informations utiles et c’était précisément notre objectif.
Je dirais qu’une conclusion importante de cette expérience est qu’en Europe, on ne fait à mon sens pas suffisamment le lien entre la situation difficile de la classe ouvrière et la politique commerciale chinoise. La désindustrialisation en cours en Europe est en grande partie liée à la façon dont la Chine a intégré le système commercial mondial au cours des vingt dernières années.
En Europe, on ne fait à mon sens pas suffisamment le lien entre la situation difficile de la classe ouvrière et la politique commerciale chinoise.
Elizabeth Baltzan
Pour conclure cette réflexion, je voudrais apporter un éclairage historique — et je suis particulièrement heureuse que Pascal Lamy participe à ce panel, car il a évoqué un point important dans ses remarques. Lorsqu’il était directeur général de l’OMC, il avait mentionné que l’on pouvait remonter à la vision du système commercial mondial qu’avaient Franklin D. Roosevelt et Churchill au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Une vision véritablement globale. Ce n’était pas uniquement une question de réduction des droits de douane. Elle prévoyait aussi des règles anti-monopoles, non seulement pour le secteur privé, mais également pour les gouvernements, reconnaissant que ceux-ci pouvaient être des monopoleurs — une pensée nourrie par les expériences de l’Allemagne des années 1930, mais aussi par les dynamiques futures de l’Union soviétique.
Ce que Roosevelt tentait de faire — et qu’on lui reprochait parfois — c’était de s’assurer que la gouvernance économique — pas seulement le New Deal mais bien la gouvernance économique mondiale dans son ensemble — soit au service des travailleurs, afin de contrer le fascisme à droite et le communisme à gauche.
Pascal Lamy
Trois points pour compléter les remarques précédentes.
Premièrement, il est évident que des deux côtés de l’Atlantique, nous faisons face à un grave problème de légitimité qui permet aux mouvements populistes de gagner du terrain. Je pense que ce problème repose sur deux éléments principaux que nous partageons, même s’ils ne se manifestent pas de la même manière partout. Le premier, qui n’est pas nouveau, est que le capitalisme ne produit pas les avantages économiques et sociaux susceptibles de rendre les individus plus heureux. C’est un problème de longue date, qui perdure. Le second élément, plus récent, réside dans l’émergence d’une identité politique alimentée par les réseaux sociaux, l’immigration, etc. Dans ce domaine, nous sommes vraiment des très semblables : il n’existe guère d’autres régions du monde où nous rencontrons un tel niveau de similarité dans les défis à relever.
Deuxièmement, pour revenir à votre remarque concernant l’intégration de l’Union, je voudrais souligner qu’un récent Eurobaromètre, qui mesure depuis longtemps l’opinion publique européenne à l’égard de l’Union, montre que celle-ci n’a jamais été aussi favorable à l’intégration européenne. Bien que beaucoup de citoyens soient insatisfaits de leur gouvernement, plus de six personnes sur dix estiment que l’avenir de l’Europe réside dans l’Union. Il y a donc une dynamique politique qu’il convient de prendre en compte, car cela pourrait constituer un levier important. Fait notable, lorsqu’on lie cette opinion à un sujet qui reste d’une grande pertinence dans le débat public — à savoir la question environnementale — nous observons également une différence culturelle qu’il est important de considérer.
Enfin, je tiens à préciser que je n’ai jamais utilisé, et beaucoup parmi vous le savent, l’expression « libre-échange ». Le libre-échange n’existe pas en tant que tel. C’est une théorie, un concept abstrait dont des universitaires et des philosophes peuvent débattre mais qui n’est pas la réalité. La réalité consiste à savoir s’il faut ou non ouvrir les marchés au commerce.
Les États-Unis, qui sont devenus protectionnistes progressivement depuis environ 2008, ont veillé à ce que le cycle de Doha ne soit pas conclu en raison de lois absurdes sur les sauvegardes agricoles. Ils ont poursuivi leur trajectoire, administration après administration, y compris sous celle de Biden, avec des mesures comme l’IRA, en dehors du cadre de l’OMC. Dont acte. Les États-Unis peuvent avoir de bonnes raisons de privilégier un commerce moins ouvert : ils représentent 15 % des importations mondiales. Mais 85 % de la population mondiale, du côté des importations, estime que le commerce ouvert est bénéfique. Je passe beaucoup de temps à discuter avec des Latino-Américains, des Africains et des Asiatiques. Ils sont tous convaincus que l’ouverture est la voie à suivre.
Il ne faut donc pas se concentrer uniquement sur les difficultés rencontrées avec le Mercosur ou sur les droits de douane imposés par Trump. Au-delà de nous, il existe une réalité mondiale. Je ne dis pas — et je n’ai jamais dit — que le commerce ouvert était une solution miracle. Vous m’avez toujours entendu affirmer que la mondialisation est à la fois efficace et douloureuse — mais qu’elle peut être aussi inefficace et douloureuse. C’est là où nous en sommes actuellement.
Il y a trente ans, les Chinois nous ont dit : « Bienvenue en Chine » — mais à deux conditions : la création de coentreprises et le transfert de technologie. C’est exactement ce que nous devrions faire aujourd’hui.
Pascal Lamy
L’Europe peut-elle tracer sa propre voie, trouver un équilibre entre les États-Unis et la Chine ? Personnellement, je le pense. Mais je souligne également que, concernant la Chine, comme pour les États-Unis, il faut savoir négocier avec force. Les Chinois chercheront à obtenir une plus grande part du marché européen si le marché américain leur est encore davantage fermé. C’est une position de négociation forte.
Je pense que l’Union a pris la bonne décision en imposant des restrictions sur les véhicules électriques en provenance de Chine, car ils sont trop fortement subventionnés. Je sais que l’Allemagne n’a pas apprécié, mais cela importe peu. Nous avons voté, et la décision a été prise. Ce n’est pas, toutefois, une stratégie à long terme. À mon sens, la stratégie à adopter à long terme serait de s’inspirer de ce que les Chinois ont fait avec nous il y a trente ans. À l’époque, nous possédions un avantage technologique important dans le domaine des moteurs à combustion. Ils nous ont dit : « Bienvenue en Chine » — mais à deux conditions : la création de coentreprises et le transfert de technologie. C’est exactement ce que nous devrions faire aujourd’hui. C’est là que réside notre véritable force, et nous devons en tirer parti.
Nicholas Mulder
Je partage pleinement l’opinion de Pascal Lamy concernant l’Europe et la Chine. En effet, si l’on prend un peu de distance par rapport à l’idée selon laquelle la Chine et la Russie seraient indissociablement liées, il me semble que la majorité des experts s’accorderaient à dire que leur partenariat est en réalité largement opportuniste. La Chine a adopté une attitude opportuniste, semblable à celle d’un pays neutre classique, jouant sur tous les fronts, en s’abstenant de s’engager activement dans ce conflit tout en tirant profit de la vente de ses produits à ceux qui en ont le plus besoin.
L’une des conséquences involontaires de la politique économique des États-Unis — qui bénéficient d’un avantage comparatif dans ce domaine par rapport à l’Europe — a été de renforcer encore davantage les liens entre la Chine et la Russie. À long terme, l’Europe a un intérêt différent, car elle se situe sur la vaste étendue terrestre eurasienne. Pour le reste du siècle, une Eurasie où la Russie et la Chine seraient fortement alignées serait extrêmement peu favorable à l’Europe. Il est donc dans notre intérêt de ne pas laisser cet alignement devenir permanent. Je suis convaincu qu’il s’agit d’un phénomène encore récent, fragile et susceptible d’évoluer.
Par ailleurs, la Chine ne semble pas disposée à accepter le pipeline Power of Siberia 2 pour s’approvisionner en voitures russes — ce qui laisse entrevoir plusieurs raisons de croire que cette situation pourrait évoluer à condition que nous jouions un rôle plus actif et plus déterminé dans les négociations.