« La géopolitique est une science problématique et elle est vouée à le rester », une conversation avec Florian Louis
La géopolitique est partout — au point qu’on ne sait plus très bien ce qu’elle recouvre. Comment une « sciences nazie » a-t-elle passé l’Atlantique jusqu’à hégémoniser la doctrine américaine ? Comment utiliser l’histoire de cette appropriation pour comprendre ceux qui aujourd’hui se réclament de la géopolitique ? Nous avons interrogé Florian Louis, par ailleurs membre de la rédaction du Grand Continent, à propos de la parution de l’important travail issu de sa thèse. Il inaugure notre série « Fondations de géopolitique » qui traduira, présentera et commentera des textes clefs de la discipline.
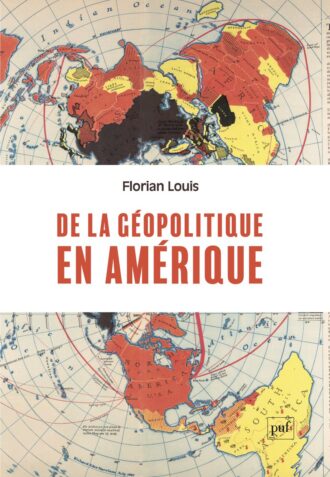
Votre enquête sur la géopolitique aux États-Unis vous conduit à plaider en faveur d’une révision du récit conventionnel de l’histoire de cette discipline. En quoi consiste ce récit et pourquoi doit-il selon vous être repensé ?
L’histoire de la géopolitique est généralement présentée selon un paradigme cyclique : apparue dans les premières décennies du XXe siècle, popularisée dans les années 1930, elle aurait connu un premier âge d’or durant la Seconde Guerre mondiale, notamment du fait de l’influence qu’elle aurait alors exercée sur le pouvoir nazi. Une collusion qui expliquerait en retour le discrédit qui l’aurait frappée à partir de 1945, la condamnant à des décennies de « clandestinité ». Enfin, à partir des années 1980 et surtout depuis la chute du rideau de fer, la géopolitique aurait regagné en pertinence et en popularité. Sous une forme renouvelée, elle connaîtrait depuis lors un nouvel âge d’or. Cette vision cyclique faite d’une alternance de phases d’essor, de déclin et de renaissance, a notamment été diffusée en France par Yves Lacoste qui n’a eu de cesse d’insister sur le « tabou » qui aurait entouré le concept de « géopolitique » jusqu’à ce qu’il le sorte, au début des années 1980, du purgatoire où il croupissait.
Si cette présentation de l’histoire de la géopolitique n’est pas sans avoir une part de vérité, elle me semble toutefois réductrice et même problématique à plusieurs titres. En premier lieu, elle est très occidentalo-centrique. Pour ne prendre qu’un exemple, la spectaculaire vogue de la géopolitique dans l’Amérique latine des années 1960 et 1970 devrait conduire à nuancer l’idée que la discipline aurait alors souffert d’un rejet unanime et universel. Même en Occident, nombreux sont les auteurs à s’en réclamer ouvertement dès les années 1950, raison pour laquelle parler à son égard d’un « tabou » me paraît très exagéré. Certes, des voix s’élèvent contre ceux qui se revendiquent alors de la géopolitique, s’inquiétant de les voir user d’une notion dont la compromission avec le nazisme devrait dissuader quiconque de s’approcher. Mais comme j’essaie de le montrer dans mon livre, ces critiques ne sont en rien nouvelles : elles sont aussi anciennes que la géopolitique, qui a toujours été un savoir controversé.
C’est pourquoi il me semble qu’on saisit mieux la nature complexe et le destin tourmenté de cette discipline clivante qu’est la géopolitique en envisageant son histoire non sous la forme diachronique d’une alternance de phases d’essor et de reflux, mais sous la forme synchronique d’une querelle continue entre ses adeptes et ses contempteurs. Si les arguments avancés pour défendre ou au contraire vilipender la géopolitique ont pu évoluer au fil du temps, l’incapacité à la « normaliser » pleinement n’a en revanche jamais été surmontée. La géopolitique est une science problématique et elle est vouée à le rester.
La géopolitique est une science problématique et elle est vouée à le rester.
Florian Louis
Vous reconstituez l’histoire de la réception et de la diffusion de la géopolitique aux États-Unis pour montrer tout à la fois l’ancienneté et la permanence de ce caractère problématique. Quand et comment les Américains découvrent-ils la géopolitique ?
La géopolitique est d’abord devenue populaire en Europe au cours des années 1930, essentiellement par le biais de la Zeitschrift für Geopolitik. Cette revue mensuelle, la première et longtemps la seule au monde à être entièrement et explicitement consacrée à la géopolitique, a été fondée en 1924 par Karl Haushofer, un ancien officier bavarois devenu géographe après la défaite allemande de 1918. Son activité savante est aussi militante : en dénonçant la supposée incohérence géographique des traités de paix de l’après 1918, il poursuit pour ainsi dire le combat perdu sur les champs de bataille et dans les arènes diplomatiques en le portant sur de nouveaux terrains, éditorial et académique, qu’il contribue donc à transformer eux aussi en champs de bataille. Jusqu’à la fin des années 1930, cette science nouvelle qui s’épanouit en Allemagne et prétend établir des corrélations entre géographie et puissance, ne rencontre pratiquement aucun écho outre-Atlantique. Ce n’est qu’avec le déclenchement en Europe de ce qui allait devenir la Seconde Guerre mondiale que les choses changent.
À partir de 1940, les succès fulgurants remportés par l’Allemagne nazie suscitent en effet la stupeur aux États-Unis. Comment Adolf Hitler, un piètre individu dont on reconnaît certes les talents de tribun, mais auquel on n’a jamais prêté de grandes capacités intellectuelles ou stratégiques, a-t-il pu concevoir et mettre en œuvre une offensive aussi redoutablement efficace ? On se met alors en quête de « l’éminence grise » qui, nécessairement, guiderait en coulisse les décisions du falot dictateur. Et très vite, Karl Haushofer fait figure de coupable idéal. C’est ainsi que se répand autour de l’année 1940, à grand renforts d’articles, de livres et de films, ce qu’à la suite de David T. Murphy, j’appelle le « mythe haushoférien ».
Pour comprendre les succès d’Hitler, on se met en quête de « l’éminence grise » qui, nécessairement, guiderait en coulisse les décisions du falot dictateur. Et très vite, Karl Haushofer fait figure de coupable idéal.
Florian Louis
Ce mythe repose sur une double hyperbolisation : hyperbolisation de la géopolitique d’abord, présentée comme une science totale quasi-magique capable d’offrir à celui qui en maîtrise les arcanes les clefs de l’hégémonie universelle ; hyperbolisation de l’influence de son principal théoricien allemand au sein de l’appareil d’État nazi d’autre part. Le mythe haushoférien implique en effet par contrecoup une dévalorisation excessive du rôle de Hitler au sein du régime nazi, le réduisant au rang de simple marionnette aux mains du véritable « Führer » et orchestrateur de la politique de conquête nazie que serait Karl Haushofer.
La diffusion de ce « mythe haushoférien » contribue-t-elle à populariser ou au contraire à discréditer la géopolitique aux yeux du public états-unien ?
Dans la logique synchronique que j’évoquais précédemment, le mythe haushoférien a des effets contradictoires dans l’opinion publique comme au sein des élites américaines. Pour certains, le fait que la géopolitique serait la science responsable des succès nazis en fait un savoir par principe maléfique et condamnable. Le géographe et président de l’université Johns Hopkins Isaiah Bowman ou le politiste de Princeton Edward Mead Earle incarnent cette ligne dure qui considère que la géopolitique n’est pas une science comme les autres, voire pas une science du tout, car elle reposerait sur des fondements épistémiques biaisés et immoraux. Aucun bon usage de la géopolitique ne serait donc possible et il conviendrait en conséquence de refuser toute compromission avec elle au risque de perdre son âme.
Mais pour d’autres comme le politiste de Georgetown Edmund Walsh ou l’officier de West Point Herman Beukema, si la géopolitique est si efficace qu’on le prétend et que semblent le démontrer les victoires allemandes, alors on aurait tort de s’en désintéresser. Il faudrait a minima l’étudier, comme on décortique une arme prise à l’ennemi, pour en percer les secrets et se donner les moyens de la déjouer. Il peut même être souhaitable de s’y initier pour être en mesure de la pratiquer et ainsi de la retourner contre les puissances de l’Axe. Dans cette seconde perspective, la géopolitique n’est pas considérée comme une science nazie mais comme une science utilisée par les nazis qui pourrait tout aussi bien l’être par d’autres qu’eux et contre eux. La géopolitique ne serait qu’un moyen, axiologiquement neutre, dont la nature ne préjuge en rien des fins auxquelles il peut être mobilisé : telle un couteau, elle peut avoir des usages salvateurs comme homicides, qui dépendent non de sa nature intrinsèque mais des usages qui en sont faits. On aurait donc tort de se refuser par principe à en user.
La géopolitique ne serait qu’un moyen, axiologiquement neutre, dont la nature ne préjuge en rien des fins auxquelles il peut être mobilisé : telle un couteau, elle peut avoir des usages salvateurs comme homicides.
Florian Louis
L’un des domaines les plus affectés par la séduction qu’exerce la géopolitique est la cartographie dont vous montrez qu’elle connaît aux États-Unis, durant la Seconde Guerre mondiale, un profond renouveau en réponse à l’usage qu’en font les géopoliticiens allemands.
La Zeitschrift für Geopolitik était en effet connue pour sa cartographie novatrice qui ne se contentait pas de localiser ou de décrire les phénomènes politiques, mais cherchait à leur donner sens et à montrer leur caractère dynamique par le recours à un large « arsenal » de figurés en forme de flèches ainsi qu’à la schématisation. Certaines des cartes les plus célèbres produites par les géopoliticiens allemands font ainsi ressortir par divers artifices visuels le présumé encerclement dont serait victime leur pays, contribuant à diffuser une phobie obsidionale au sein de l’opinion publique allemande. Haushofer et ses disciples ont ainsi compris très tôt que la carte, loin de décrire de manière neutre une réalité géographique, en donne nécessairement une interprétation possiblement déformée. Par ailleurs, elle est beaucoup plus accessible, frappante et donc convaincante pour le grand public qu’un texte et peut donc constituer un instrument de propagande redoutablement efficace.
Lorsque les États-Unis entrent dans la Seconde Guerre mondiale, la fascination pour la géopolitique y fait naître une inquiétude quant au retard dont souffrirait le pays en matière de cartographie, retard aux conséquences possiblement fâcheuses. L’un des plus ardents promoteurs d’un aggiornamento de la cartographie américaine est alors le géographe George T. Renner qui établit un lien entre l’isolationnisme prédominant aux États-Unis jusqu’à la fin de l’année 1941 et la mauvaise qualité des cartes en circulation dans son pays. Selon lui, le recours quasi-exclusif à des cartes à projection Mercator centrées sur l’Atlantique présente un double défaut aux conséquences dramatiques. En premier lieu, ces cartes donnent l’impression aux Américains que leur continent est une île protégée du reste du monde par de vastes douves océaniques et qu’ils peuvent donc se tenir à l’écart des spasmes qui secouent la lointaine Eurasie. D’un choix de représentation cartographique, découlerait donc un comportement politique, en l’occurrence l’isolationnisme, que Renner pourfend y voyant la conséquence directe de « l’ignorance géographique » de ses concitoyens. Selon lui, le recours à une projection polaire serait plus adapté car il permettrait de dissiper cette trompeuse impression d’isolement et de sécurité que donne à ses concitoyens la projection Mercator, en rappelant que via le pôle nord et la Béringie, Eurasie et Amérique du nord se côtoient. Par ailleurs, l’usage de cartes centrées sur l’Atlantique, qui impliquent de « couper en deux » le Pacifique dont une frange apparaît à gauche et l’autre à droite de la carte, expliquerait que les Américains n’aient pas été en mesure de percevoir la réalité de la menace nippone dans la mesure où Pearl Harbour et Tokyo semblaient, sur ces cartes, situés à deux extrémités fort éloignées du monde. Un centrage sur le Pacifique aurait au contraire permis de saisir leur vicinité.
Certaines des cartes les plus célèbres produites par les géopoliticiens allemands font ainsi ressortir par divers artifices visuels le présumé encerclement dont serait victime leur pays, contribuant à diffuser une phobie obsidionale au sein de l’opinion publique allemande.
Florian Louis
Ces réflexions autour d’un nécessaire renouveau de la cartographie et de ses conséquences pratiques ont rapidement des répercussions concrètes dont la plus saillante est l’œuvre de Richard Edes Harrison qui renouvelle en profondeur la cartographie américaine en développant des représentations révolutionnaires qui cherchent à donner à voir l’espace terrestre tel qu’on peut l’observer depuis le cockpit d’un avion ou au travers des yeux d’un oiseau (« bird’s eye view »). La presse diffuse très largement ses productions durant la Seconde Guerre mondiale. En mars 1943, le magazine Life propose quant à lui un planisphère, conçu par Richard Buckminster Fuller, à découper et assembler par les lecteurs eux-mêmes, afin de mieux saisir les subtilités de la guerre en cours et de ses implications géographiques. Il y a donc au sein d’une partie des élites américaines la conviction que la géopolitique et ses instruments, au premier rang desquels les cartes, sont de véritables armes nécessaires à la victoire et qu’il convient donc non de les dédaigner mais de les adopter et de les diffuser le plus massivement possible auprès du public américain.
C’est ainsi au motif de son utilité présumée dans la lutte contre les puissances de l’Axe que la géopolitique finit par être acceptée et par faire des émules aux États-Unis ?
Effectivement, mais le développement d’une géopolitique américaine suppose toutefois d’en passer par une étape intermédiaire, que je qualifie dans mon ouvrage de « tournant mackindérien », du nom du géographe britannique Halford John Mackinder. Aujourd’hui, ce dernier est mondialement connu comme l’un des « pères fondateurs » de la géopolitique en raison de sa célèbre conférence de 1904 sur le « pivot géographique de l’histoire » dans laquelle il prétendait démontrer que le contrôle du cœur de l’Eurasie — ce qu’il appelait le « Heartland » — constituait la clé de la puissance universelle. Mais quand éclate la Seconde Guerre mondiale, aussi bien aux États-Unis qu’en Angleterre, Mackinder, qui coule une paisible retraite dans le Dorset, est totalement inconnu. Nul ne songe à en faire le père d’une « géopolitique » dont il ne s’est au demeurant jamais réclamé. Lorsqu’elle arrive en Angleterre en 1942 et demande aux officiels britanniques chargés de l’accueillir à rencontrer Mackinder, la journaliste américaine du New York Herald Tribune Dorothy Thompson est ainsi stupéfaite qu’aucun de ses interlocuteurs ne sache de qui il s’agit.
Il y a au sein d’une partie des élites américaines la conviction que la géopolitique et ses instruments, au premier rang desquels les cartes, sont de véritables armes nécessaires à la victoire.
Florian Louis
C’est précisément aux États-Unis, durant les années 1941 et 1942, qu’un petit groupe de promoteurs d’une américanisation de la géopolitique exhument les travaux de Mackinder et l’érigent au rang de fondateur de la discipline, position dont il n’a depuis lors plus été délogé. Cette réécriture américaine, en temps de guerre, de l’histoire de la géopolitique, n’est évidemment pas dépourvue d’arrière-pensées. En faisant d’un géographe anglais le véritable inventeur d’un savoir qu’ils ont pourtant découvert par le biais de ses praticiens allemands, ils marginalisent ces derniers et, par là même, dégermanisent et dénazifient la géopolitique. Ce qui a pour heureuse conséquence de la rendre bien plus « présentable », « adoptable » et adaptable auprès du grand public comme des décideurs américains.
C’est pourquoi les mêmes journaux qui avaient d’abord construit et diffusé le mythe haushoférien se mettent bientôt à le déconstruire en expliquant à leurs lecteurs que loin d’être aussi révolutionnaire qu’on avait pu le croire, Haushofer n’était qu’un épigone sans relief de Mackinder, dont les écrits sont alors réédités à destination du public américain. Haushofer n’aurait donc rien inventé et se serait contenté de traduire, populariser et surtout déformer des idées qui, destinées par leur concepteur anglais à fortifier l’hégémonie anglo-saxonne, auraient été détournées par les nazis au service de l’impérialisme germanique. L’américanisation de la géopolitique ne serait donc qu’un retour à la normale après la malencontreuse parenthèse qu’aurait constitué son détournement pangermaniste.
Le fait que les Américains s’interrogent en 1945 sur l’opportunité de traduire Karl Haushofer devant le tribunal de Nuremberg montre toutefois qu’ils ne tiennent pas son influence et celle de sa géopolitique pour négligeables ?
En toute logique, la déconstruction du mythe haushoférien et l’érection de Mackinder au rang de véritable père fondateur de la géopolitique auraient effectivement dû conduire les Américains à ne pas envisager d’engager des poursuites à l’encontre du géopoliticien bavarois dont on sait dès 1942 qu’il ne fut pas le grand manitou de l’impérialisme nazi qu’on avait d’abord cru. C’était toutefois sans compter sur le suicide de Hitler survenu le 30 avril 1945. Le fait que le principal responsable des crimes nazis ne puisse pas comparaître au procès destiné à en solder judiciairement les comptes est pour le moins problématique. Il n’est dès lors pas étonnant que certains, au premier rang desquels le juriste d’origine polonaise Raphael Lemkin, œuvrent alors à réactiver le mythe haushoférien et plaident en faveur d’une inculpation du géopoliticien bavarois. En exagérant de nouveau l’influence qui aurait été la sienne sur Hitler, il s’agit de diminuer l’importance de ce dernier dans l’appareil nazi et donc de dédramatiser son absence dans le box des accusés. Dans la mesure où Hitler n’aurait été que l’exécutant de Haushofer, qui aurait été le véritable concepteur et commanditaire des crimes de l’impérialisme nazi, sa mort n’enlèverait pas tout son intérêt au procès pourvu que Haushofer y soit quant à lui bien présent.
La déconstruction du mythe haushoférien et l’érection de Mackinder au rang de véritable père fondateur de la géopolitique auraient dû conduire les Américains à ne pas envisager d’engager des poursuites à l’encontre du géopoliticien bavarois. C’était sans compter sur le suicide de Hitler.
Florian Louis
Le juge Jackson ne se laisse toutefois pas convaincre par cet argumentaire. Craignant d’être accusé de mener une chasse-aux-sorcières en engageant des poursuites à l’encontre d’un universitaire n’ayant pas de sang sur les mains, il renonce à inculper Haushofer. Raphael Lemkin, déçu de la décision de Jackson, tente alors de faire inculper Haushofer au procès de Tokyo au motif que ses idées seraient également à l’origine de la politique impérialiste du Japon, un pays où il a séjourné et dans lequel il entretient effectivement de solides relations. Mais Lemkin est là encore désavoué. Malgré tout, se sentant cerné et voyant sa santé décliner, Haushofer se suicide avec sa femme en mars 1946.
Le fait que Haushofer n’ait finalement pas été jugé et donc condamné à Nuremberg ou à Tokyo explique que la géopolitique n’ait pas été aussi largement discréditée qu’on aurait pu le penser après 1945 ?
C’est selon moi d’abord le tournant mackindérien opéré autour de 1942, plus que la non-condamnation de Haushofer en 1945, qui explique que la géopolitique ne sorte pas totalement et irrémédiablement discréditée du second conflit mondial. La dissociation alors opérée entre la discipline et l’Allemagne nazie a en effet permis un spectaculaire développement aux États-Unis de travaux qui, ouvertement ou pas, s’en inspirent. Une géopolitique américaine voit donc le jour dès la Seconde Guerre dont la figure de proue est sans doute le politiste d’origine néerlandaise Nicholas John Spykman. Elle demeure d’autant plus active et prospère après 1945 que la victoire sur l’Axe ne marque pas pour les États-Unis le retour à la paix, mais l’entrée dans un nouveau conflit, la guerre froide, qui d’un point de vue géopolitique, n’est pas sans présenter des similarités avec celui qui vient de s’achever.
Quelles sont ces similarités d’ordre géopolitique entre la guerre froide et cette guerre « chaude » que fut la Seconde Guerre mondiale ?
Dès avant 1945, certains observateurs américains se sont inquiétés des conséquences potentiellement problématiques pour les États-Unis de la défaite allemande qui, à partir de la fin de l’année 1942, apparaît comme inéluctable. Celle-ci serait en effet aussi synonyme de victoire soviétique. Or, comme l’écrit Spykman en 1942, du point de vue américain, « un État russe s’étendant de l’Oural à la mer du Nord ne peut constituer une amélioration par rapport à un État allemand dominant de la mer du Nord à l’Oural ». Tout imprégnés qu’ils sont des schèmes mackindériens relatifs au potentiel de puissance censément inégalable dont recèlerait l’Eurasie, nombre de stratèges américains sont ainsi convaincus que la géopolitique ne mourra pas avec le IIIe Reich qui l’a vu prospérer, mais qu’elle est d’ores et déjà reprise à leur compte par les Soviétiques. Sans le dire, ceux-ci chercheraient à dupliquer les recettes élaborées jadis par Haushofer pour l’Allemagne afin de revigorer le vieil expansionnisme russe.
Nombre de stratèges américains sont convaincus que la géopolitique ne mourra pas avec le IIIe Reich qui l’a vu prospérer, mais qu’elle est d’ores et déjà reprise à leur compte par les Soviétiques.
Florian Louis
Principal pourfendeur de cette supposée géopolitique soviétique, le politiste américain Edmund Walsh affirme ainsi en 1948 que « la principale différence entre la défunte géopolitique allemande et la résurgente géopolitique soviétique réside dans le fait que les révolutionnaires nazis de l’école de Munich ont parlé volubilement » tandis que leurs épigones soviétiques font de la géopolitique sans le dire. Ce qui légitime de son point de vue que les Américains en fassent autant. Pour les tenants américains de la géopolitique, la fin de la Seconde Guerre mondiale ne remettrait donc nullement en cause la nécessité de développer une géopolitique américaine. Elle impliquerait simplement d’en changer la finalité : non plus la lutte contre l’Axe, mais celle contre l’hydre communiste qui, comme lui, cherche à se rendre maître de l’Eurasie et ce faisant du monde.
De fait, vous montrez que les grilles analytiques géopolitiques ne sont pas sans exercer une influence sur certaines des stratégies américaines de guerre froide…
Il est effectivement difficile à un observateur familier des théories géopolitiques de ne pas percevoir dans la stratégie de containment de l’Union soviétique, promue en 1947 par le président Truman, un air de famille pour le moins troublant avec les préceptes mackindéro-spykmaniens popularisés quelques années plus tôt aux États-Unis. Avec Mackinder, les concepteurs de cette doctrine estiment que l’« île-monde » eurasiatique recèle un tel potentiel de puissance du fait de sa taille, de sa situation et de ses richesses matérielles et humaines, que l’URSS deviendrait invincible si elle s’en rendait pleinement maîtresse. Ils estiment en conséquence qu’il faut la « contenir » le plus loin possible des rivages océaniques, cette ceinture littorale stratégique que Spykman avait durant la Seconde Guerre mondiale qualifiée de « Rimland » par contraste avec le « Heartland » continental cher à Mackinder.
Certains comme le politiste James Burnham dénoncent même le containment comme trop timoré et plaident en faveur d’une politique de « refoulement » (rollback) de l’Union soviétique, arguant du fait que « si l’empire soviétique parvient à se consolider dans ses frontières actuelles, il est certain de conquérir la Terre entière » compte-tenu du potentiel de puissance inégalé dont recèle le territoire dont il s’est rendu maître en 1945. Burnham, aux côtés de politistes comme Robert Strausz-Hupé, Edmund Walsh ou John Elmer Kieffer, milite donc tout au long des années 1950 en faveur d’une géopolitique américaine assumée, seule à même de comprendre les ressorts géographiques de la menace soviétique et donc d’élaborer les stratégies à même de la neutraliser.
Certains comme le politiste James Burnham dénoncent le containment comme trop timoré et plaident en faveur d’une politique de « refoulement » (rollback) de l’Union soviétique.
Florian Louis
Ce type de plaidoyer en faveur d’une géopolitique américaine de guerre froide ne fait toutefois pas l’unanimité.
En effet, la position de ces défenseurs américains de la géopolitique est effectivement loin d’être consensuelle. À l’orée de Realities of World Power, un livre qu’il publie en 1952, John Elmer Kieffer se plaint d’ailleurs ouvertement d’être victime d’une forme d’ostracisme académique et social qui serait la conséquence du fait qu’il pratique la géopolitique. Celle-ci continue en effet d’être vertement dénoncée par ceux qui estiment qu’elle manque d’assises scientifiques rigoureuses et pointent ses compromissions passées. Les rivalités disciplinaires doivent également être prises en considérations : le spectaculaire essor, dans les années 1950, de l’étude des « Relations internationales » dans les universités américaines contribue à la marginalisation d’une géopolitique perçue comme une rivale potentiellement menaçante. C’est une des raisons qui pousse l’un des « papes » des RI, Hans Morgenthau, à prononcer une forme d’« excommunication » à son encontre dans son ouvrage fondateur de 1948 Politics Among Nations, dans lequel il présente la géopolitique comme une « pseudo-science ».
On voit également fleurir aux États-Unis après la Seconde Guerre mondiale des critiques de la géopolitique qui en dénoncent le caractère supposément périmé : à l’heure de l’aviation et des missiles intercontinentaux, le poids de la géographie dans les rapports de puissance internationaux serait devenu négligeable. La puissance d’un État n’aurait plus grand chose à voir avec sa géographie et la géopolitique, qui se faisait précisément forte de mettre au jour cette interaction entre espace et pouvoir, aurait donc fait son temps. L’essayiste Eugene Marie Friedwald estime ainsi dans un ouvrage paru en 1948 que ce n’est plus la maîtrise de tel ou tel territoire, mais bien plutôt de telle ou telle technologie, qui détermine la plus ou moins grande puissance des États. Raison pour laquelle il conviendrait selon lui de substituer à une géopolitique frappée d’obsolescence une « technopolitique » plus en accord avec les réalités du monde moderne.
Le spectaculaire essor, dans les années 1950, de l’étude des « Relations internationales » dans les universités américaines contribue à la marginalisation d’une géopolitique perçue comme une rivale potentiellement menaçante.
Florian Louis
Ce clivage autour de la pertinence de la géopolitique demeure-t-il encore actif de nos jours aux États-Unis ? Quelle place la géopolitique y occupe-t-elle dans les paysages académique et médiatique ?
La géopolitique est aujourd’hui moins populaire aux États-Unis qu’elle ne l’a été par le passé ou qu’elle ne l’est actuellement en Europe. Cela s’explique notamment par les spécificités de la structuration du champ académique américain que j’évoquais tout à l’heure : ce sont les politistes spécialistes de « Relations internationales » qui dominent le champ de ce qu’on appelle en Europe et surtout en France la géopolitique. Celle-ci a toutefois d’influents défenseurs et praticiens, mais ce sont le plus souvent des essayistes ou des journalistes plutôt que des universitaires, à l’image d’un Robert D. Kaplan. À l’université, ceux qui se réclament de la géopolitique appartiennent généralement au courant de la « géopolitique critique » qui est en fait une critique de la géopolitique qui s’inscrit dans la continuité d’une longue tradition dont on a vu qu’elle plonge ses racines dans les origines même de l’implantation de cette discipline de ce côté-ci de l’Atlantique. Encore aujourd’hui, le champ de la géopolitique demeure donc aux États-Unis un champ de bataille sur lequel s’affrontent des acteurs ayant à son propos des avis très tranchés et largement incompatibles.

