Les baraques précaires de l’histoire
À travers ce récit, Sabrina Janesch convoque et visite un chapitre méconnu de l’histoire allemande, mais aussi européenne : celle des populations d’origine et de langue allemandes. Cette exploration romanesque suit les trajectoires d'une mosaïque familiale qui s’agence au fil des errances, migrations et déportations.
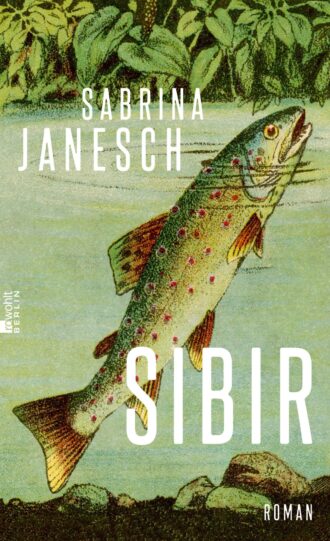
Le premier roman de l’écrivaine germano-polonaise Sabrina Janesch, Katzenberge, salué en son temps par Günther Grass et distingué en 2011 par le prix littéraire Anna Seghers, retraçait les cheminements d’une famille entre la Galicie et la Basse-Silésie pour éclairer la part des reconfigurations territoriales du XXème siècle et des métissages culturels dans notre héritage européen.
Son nouveau roman, Sibir, s’inscrit dans cette continuité. À travers la voix de sa narratrice, Leila, qui tente d’arracher à l’oubli les souvenirs d’enfance de son vieux père atteint de démence sénile, ce récit fouille l’histoire d’une famille ballottée par les vicissitudes de la Seconde Guerre mondiale entre la Galicie, où elle était établie depuis le XVIIIesiècle, le Wartheland, un territoire annexé au Reich national-socialiste après l’invasion de la Pologne, le Kazakhstan et la Lande de Lunebourg située au nord de l’Allemagne. Cette exploration romanesque d’un volet largement ignoré des relations germano-russes exhume un passé qui flotte entre les langues (l’allemand, le russe, le kazakh et le polonais), les appartenances, les territoires (qui s’étalent entre l’Europe centrale et les steppes eurasiennes). Ce faisant, elle interroge ce qui constitue une identité familiale meurtrie par les haines raciales et xénophobes, déchirée par le traumatisme des violences issues de la Seconde Guerre mondiale, des déportations et déracinements multiples.
Cette mosaïque familiale qui s’agence au fil des errances, migrations et déportations, l’auteur la dessine en s’appuyant sur une narration tissée de deux temporalités distinctes et de deux perspectives romanesques : aux souvenirs d’enfance de Josef Ambacher, le père de Leila né en 1935, font écho ceux de Leila elle-même, lesquels couvrent la période autour de 1990, au moment de la dissolution de l’Union Soviétique. Josef est issu d’une famille allemande originaire du Egerland, aux confins de la Bohême, laquelle s’implante au XVIIIe siècle en Galicie, à l’instar de nombreux colons allemands venus peupler cette nouvelle acquisition territoriale de l’Empire austro-hongrois. Suite à l’invasion de la Pologne orientale par l’armée russe en 1939, la famille Ambacher fuit son berceau pour s’établir dans une ferme du Wartheland, territoire anciennement polonais que l’État national-nationaliste vient d’annexer au Reich allemand et qui fait désormais l’objet d’une politique de germanisation. Mais c’est à proprement parler l’année 1945 qui inaugure le récit des souvenirs du petit Josef en le grevant d’une expérience traumatique : celui-ci a dix ans, lorsque la famille est contrainte, sous la poussée de l’Armée Rouge, de quitter son nouveau foyer avant d’être finalement déportée dans une colonie située dans les steppes arides du Kazakhstan, composée de réprouvés de diverses nationalités.
À travers ce récit, l’auteur convoque et visite un chapitre méconnu de l’histoire allemande, mais aussi européenne : celle des populations d’origine et de langue allemandes (à l’instar des Allemands de Galicie ou des Allemands de la Volga), établies depuis le XVIIIe siècle, au gré des politiques de colonisation, sur des territoires d’Europe centrale et orientale, et victimes de déportations suite aux redécoupages géopolitiques provoqués par le second conflit mondial.
Mais l’intérêt de ce roman ne tient pas seulement aux éclairages apportés à l’histoire des transferts forcés de populations allemandes, il réside surtout dans la mise en perspective des bouleversements géopolitiques issus de la Seconde Guerre mondiale et de leur impact sur les destins familiaux. Ainsi le récit que fait le jeune Josef de la déportation brutale de la famille Ambacher dans une colonie précaire des steppes eurasiennes, en marge de la vie et du monde, fait écho à celui de sa fille qui relate son enfance dans une cité périphérique de la Lande de Lunebourg où les Ambacher ont émigré avec toute une communauté de réfugiés d’origine allemande, au gré du rapatriement, négocié en 1955 par le chancelier Konrad Adenauer, des soldats allemands prisonniers en Union Soviétique. À travers cette construction narrative en miroir, des correspondances se dessinent qui nous font mesurer la fatalité d’une histoire familiale qui n’a cessé de s’écrire dans la marginalité : si la famille Ambacher vit sur le qui-vive, assimilée à l’ennemi nazi, dans la colonie reléguée dans les steppes du Kazakhstan, elle ne retrouvera pas pour autant ses racines à son retour en RFA, puisqu’elle se contente de séjourner, déchirée entre de multiples appartenances linguistiques et culturelles, coupée de son passé, dans une cité périphérique dont les constructions donnent une impression de provisoire 1. En effet, si l’enfance sibérienne de Josef connaît également des moments heureux pétris d’amitiés, d’échanges et de rencontres décisives, le retour en Allemagne ne se fait qu’au prix d’une amnésie qui enferme Josef, l’adulte, dans une solitude mélancolique : son grand-père enjoint à l’enfant d’effacer toute trace du passé, condition nécessaire à une intégration réussie dans le nouveau pays.
Ce vide mémoriel dans lequel les souvenirs ne trouvent pas d’ancrage et les descendants ne parviennent pas à s’inscrire est habilement évoqué dans le roman à travers un réseau d’images : ainsi à peine arrivée en « Sibérie », Sibir, mot-valise qui figure à la fois un ailleurs honni et irréel, un désert menaçant, la mort et l’absence 2, la famille devra faire face à une tempête de neige qui engloutira mystérieusement et à jamais la mère de Josef, disparue sans laisser de traces. Cette disparition fait écho à celle d’un autre ressortissant allemand de la colonie sibérienne, Heinrich Quapp, déporté au Goulag, dont les enfants, quelques décennies plus tard, réapparaîtront dans la petite cité d’Allemagne, tels les fantômes d’un passé douloureux, mais irréel. Peut-être cette absence s’illustre-t-elle également à travers la solitude de Josef, qui demeure en partie étranger à sa fille et s’efface lui-même dans l’amnésie de la maladie.
Cette béance s’exprime aussi à travers la multiplication des habitations précaires, que ce soit en Sibérie ou en Allemagne : les baraquements de fortune du Kazakhstan caractérisent des abris plus que des habitations, auxquels font écho ces logements de la Lande de Lunebourg que de nouveaux réfugiés allemands viennent encombrer après 1990 et dans lesquels on continue somme toute de camper. Mais il y a aussi les multiples cabanes dans lesquelles l’enfance enfouit secrets (la langue maternelle allemande interdite qu’on craint d’oublier) et souvenirs (les carnets de notes et souvenirs rapportés de Sibérie que Leila tente de préserver de la volonté paternelle de faire table rase du passé).
Ce monde de l’enfance est relaté à travers un style concis et sobre. Ce dépouillement soustrait le récit au pathos et profite notamment aux descriptions des vastes solitudes du Kazakhstan, de loin les plus beaux passages de ce roman 3.
Sources
- « Dans un premier temps, on avait assigné aux rapatriés, selon l’appellation dans laquelle les gens de Mühlheide englobaient déportés civils et militaires, des logements à la périphérie de la ville », Sabrina Janesch, Sibir, Rowohlt 2023, p. 206.
- « C’est ainsi que les déportés nommaient l’obscure terreur qui s’étendait en arrière et au sud de l’Oural, en arrière de l’Europe, en arrière du bout du monde », ibid., p. 15.
- « Depuis qu’ils avaient dépassé les derniers îlots d’arbres épars, le train traversait le néant, le paysage était devenu informe, plat comme les planches sous la paille, désertique et vide. », ibid., p. 29.

