Un capital en danger : l’après-Première Guerre mondiale en réaction
Si les politiques d’austérité ont pu être décrites comme des politiques irrationnelles manquant — en apparence — de remplir leurs objectifs économiques, on peut au contraire les comprendre comme des réactions visant à défendre le capitalisme lorsque celui-ci est en crise, lorsque ses piliers, la propriété privée et la relation salariale, sont menacés par la masse ouvrière. Telle est la thèse de cet ouvrage de Clara Mattei, qui explore ici la période des « années rouges » (1918-1920), qui voit l’émergence de ces politiques d’austérité, à travers les cas britanniques et italiens.
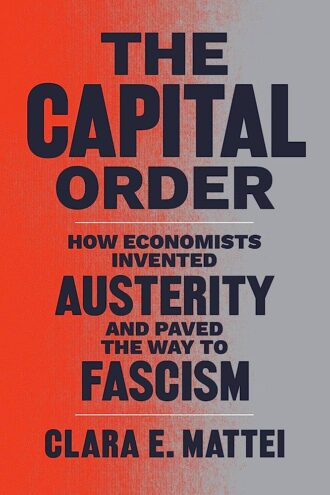
« L’austérité protège le capitalisme, est populaire parmi les États [among states] en raison de son efficacité [effectiveness] et est présentée comme un moyen de “réparer” les économies en améliorant leur “efficience” [efficiency] – c’est-à-dire en acceptant des pertes à court terme en échange de gains à long terme ».
Pourquoi les politiques d’austérité, malgré leurs échecs apparents, sont-elles si répandues, du Royaume-Uni de 1919 à la Grèce des années 2010 ? La citation ci-dessus, extraite de The Capital, Order. How Economists Invented Austerity and Paved the Way for Fascism de Clara Mattei apporte une première explication, qui structure l’ensemble de l’ouvrage autour d’une thèse commune : l’austérité vise à défendre le capitalisme menacé, et, partant, les politiques d’austérité sont des politiques de domination de classe, décidées contre les intérêts des travailleurs. À partir de ce point de départ, Clara Mattei construit son raisonnement en se fondant sur une analyse historique des « années rouges » (1918-1920), période suivant la Première Guerre mondiale et qui a vu la remise en cause du capitalisme libéral hérité du XIXe siècle. Dans son introduction, Clara Mattei soulève trois points importants, qui précisent sa thèse initiale.
En premier lieu, Clara Mattei emploie le terme d’« austérité » pour rendre compte de phénomènes politiques autant qu’économiques. Ainsi, l’austérité ne doit pas seulement se comprendre comme un ensemble de politiques économiques restrictives, centrées sur la maîtrise des dépenses publiques, et dont l’échec récurrent dans leur objectif affiché – restaurer la croissance, diminuer le chômage – serait le signe de leur irrationalité, mais comme des postures économiques et politiques délibérées de la part des dirigeants au pouvoir, dont l’objectif réel est la défense du capitalisme face à sa remise en question par les classes laborieuses. Une politique d’austérité se définit alors comme une politique visant à préserver les fondements mêmes du capitalisme, c’est-à-dire la propriété privée des moyens de production et la relation salariale, ou, pour citer directement l’ouvrage : « l’austérité [austerity] doit être comprise pour ce qu’elle est, et reste : une réaction anti-démocratique à des menaces de changement social venues d’en bas [bottom-up] » (p.7). Cet argument s’appuie principalement sur son analyse de la réaction – notamment italienne – du patronat face aux grèves et aux occupations d’usines ayant marquées les années 1919-1920. Celle-ci fait intervenir des politiques économiques déflationnistes, restrictives et limitant le droit de grève – dans le cas italien, le patronat finit par s’en remettre au fascisme.
Ce faisant, Clara Mattei redéfinit le concept économique d’austérité pour y inclure à la fois des politiques proprement budgétaires, mais aussi des politiques industrielles ou monétaires. Ainsi, des politiques monétaires de hausse des taux d’intérêt ou de maintien de la parité or, et les effets déflationnistes et récessionnistes qu’elles provoquent, doivent être comprises comme des politiques d’austérité. De même, des politiques de limitation du droit de grève, de restriction du pouvoir de négociation des syndicats ou de suppression du salaire minimum font partie de la grande famille des politiques d’austérité. Concernant les politiques budgétaires, que l’on associe plus volontiers au concept, Clara Mattei note que les politiques d’austérité visent à réduire en particulier les dépenses « sociales », c’est-à-dire de services adressés aux citoyens, comme la santé ou l’éducation. Leur objectif (explicite ou non) est double : transférer la richesse de la nation dans les mains des investisseurs et des capitalistes, seuls capables, par leur épargne et leurs investissements, de faire croître l’économie, d’une part ; de faire respecter au monde du travail l’ordre du capital, d’autre part.
Ces deux points constituent l’apport majeur de son ouvrage : les politiques d’austérité ne sont plus seulement des moyens économiques de réduction du déficit ou de contrôle de l’inflation, mais plus profondément des outils pour discipliner les masses et faire respecter l’ordre du capital. À cet égard, Clara Mattei rapproche les cas italiens et britanniques : si elle souligne évidemment la différence de méthode entre la démocratie britannique et le fascisme italien, elle met en avant la ressemblance de nature entre les objectifs poursuivis par les hommes politiques de ces deux États quand ils ont mis en place des politiques d’austérité. Il s’agissait de briser les mouvements ouvriers issus de la Première Guerre mondiale, dont l’objectif affiché était la transformation du système productif pour le faire sortir du capitalisme, et de restaurer la primauté du capital sur les plans économiques et politiques. Les politiques d’austérité apparaissent alors comme autant d’instruments aux mains des classes dominantes qui les utilisent pour réaffirmer leur autorité.
Enfin, Clara Mattei adopte une approche historique. Celle-ci découle de la difficulté de produire une histoire critique du concept d’austérité, tant celui-ci est partie prenante de nos politiques économiques actuelles, et, selon l’autrice, une politique de la classe dominante qui s’approprie le vocabulaire du labeur et de l’honnêteté pour le subvertir de manière à ce qu’il serve les intérêts du capital. Puisque l’austérité n’est pas née avec le tournant libéral des années 1970-1980, mais est, pour Mattei, consubstantielle au capitalisme même, et qu’elle est profondément ancrée dans nos représentations de l’économie, la première partie de l’ouvrage est consacrée à une enquête historique sur l’économie de guerre et ses conséquences sur la perception par les ouvriers du système capitaliste. La méthode historique sert ainsi à montrer comment, à rebours des leçons de la Première Guerre mondiale, les politiques d’austérité se sont imposées en se fondant sur deux piliers : le « consensus », autour de la nécessité d’ajustements économiques coûteux à court terme mais bénéfiques à long terme, et la coercition, c’est-à-dire l’exclusion du grand public du processus de définition des politiques économiques au profit de technocrates, exclusion allant jusqu’à l’obligation de se conformer à un certain modèle de comportement défini d’en haut (p.8).
La première partie de l’ouvrage, consacrée à la Première Guerre mondiale et l’économie de guerre qu’elle met en place, propose un aperçu global à la fois de la rupture avec le système économique du capitalisme libéral du XIXe siècle qu’a constituée le conflit, en particulier du fait de l’extension extraordinaire des pouvoirs de l’État en vue des buts de guerre, ainsi que des conséquences économiques et politiques de cette extension. Après la guerre, il devient impossible de revenir à l’ordre ancien, à la fois car celui-ci a été durablement ébranlé par son incapacité à suppléer aux besoins de la guerre mais aussi parce qu’un nouvel espoir est né chez de nombreux ouvriers, celui d’un monde meilleur, dans lequel l’État régule plus strictement les conditions de travail – mouvement porté par des technocrates réformistes au sein même de l’État britannique. Le livre explore ensuite la manière dont cet idéal a pris corps, à la fois dans le rêve d’une nouvelle forme de démocratie économique, qui associerait les ouvriers au processus de gestion des entreprises par le biais des guildes britanniques, mais aussi dans la constitution de conseils ouvriers, nettement plus révolutionnaires dans leurs pratiques, en Italie, lors des années 1919-1920. Sont analysées aussi les ruptures intellectuelles et méthodologiques qu’introduit le journal italien L’Ordre nouveau (où écrit notamment Gramsci), fer de lance du mouvement ouvrier italien : libération par le savoir et redéfinition des règles du jeu économique.
La seconde partie de l’ouvrage se concentre, en miroir, sur la réaction capitaliste à ces formes d’insubordination ouvrière. L’ouvrage analyse, à travers une relecture des conférences internationales de Bruxelles (1920) et Gênes (1922) la manière dont des économistes ont dénoncé comme cause de la crise économique et des troubles sociaux la constitution d’un mouvement ouvrier puissant, revendiquant la transformation de l’ordre productif capitaliste, et les solutions qu’ils ont apportées. Celles-ci posent les bases d’une austérité technocratique, qui fait du retour au régime d’accumulation du capital la seule source de la prospérité, retour qui, si nécessaire, doit être imposé par la contrainte par des institutions non élues. Des développements spécifiques sont ensuite consacrés à la mise en place de ces politiques, dans les cas britannique et italien. L’intérêt du chapitre 8 est de montrer toutes les ambiguïtés des élites britanniques vis-à-vis du fascisme italien, à la fois régime profondément violent, qui restreint progressivement les libertés publiques, et véritable success story économique du point de vue du capital, car capable de faire appliquer de manière violente les prescriptions des experts économiques réunis à Gênes pour mater les travailleurs. Les deux derniers chapitres sont consacrés à une analyse de plus long terme des formes et des « succès » de l’austérité : succès dans la réduction du nombre de jours de grève, succès dans l’augmentation substantielle de la part qui va au capital en pourcentage de la richesse nationale durant les années 1920, succès dans la limitation des salaires ouvriers. Enfin, un chapitre analyse les formes plus contemporaines de l’austérité, en passant de la crise des années 1970 à l’Italie contemporaine et à la Grèce.
L’intérêt majeur de cet ouvrage est d’introduire une lecture proprement politique et originale des politiques économiques de l’après-guerre, souvent lues sous le prisme des dettes interalliées ou de la question des réparations. À cet égard, la lecture proposée par l’auteure des conférences de Bruxelles et de Gênes apparaît particulièrement stimulante, et montre, à rebours de leur interprétation traditionnelle, en quoi elles ont été un véritable succès. La thèse principale de l’ouvrage – que l’austérité est un moyen de défendre le capitalisme lorsqu’il est menacé – est solidement étayée par des sources de première main et précises, souvent citées dans le texte.
Le sentiment qui se dégage vis-à-vis des « experts » économiques est celui d’un profond dépassement, tant ces hommes formés au XIXe siècle semblent incapables de penser des notions telles que l’inégalité de l’épargne et de l’investissement ou les effets récessionnistes de la déflation par la dette. Le cas de Ralph Hawtrey, assez longuement traité, est particulièrement révélateur : grand intellectuel, intuitionnant des concepts keynésiens comme la demande effective, partisan d’un Gold Exchange Standard qui limiterait la déflation nécessaire au retour à l’étalon-or (auquel il s’oppose, le voyant comme cause du retournement de l’expansion vers la dépression), il est pourtant instrumentalisé par les économistes du Trésor britannique qui trouvent dans sa théorie la justification théorique de leur action.
À cet égard, c’est peut-être ici que l’ouvrage est le moins convaincant : ces économistes, tout pris qu’ils sont dans le cadre conceptuel de la théorie néo-classique, ne peuvent que penser que la clé de la prospérité se trouve dans l’accumulation du capital par l’épargne et que la baisse des salaires et des prix, prérequis pour le retour à l’étalon-or, est bénéfique pour l’économie. Même Keynes ! Celui qui n’est pas encore le Keynes de la Théorie générale et qui a été fonctionnaire du Trésor jusqu’en 1919 débat longuement des politiques économiques à mener avec les membres de l’administration britannique. Il se positionne, en 1924, dans la lignée de la Treasury View qui considère les dépenses publiques comme improductives au motif qu’elles se substituent à des investissements privés. Il déclare ainsi que « les dépenses d’argent public en formation de capital fixe, si elles sont financées par l’emprunt, sont incapables d’améliorer la situation économique ; elles pourraient même la dégrader, si elles divertissent du capital déjà existant de la production de biens 1 ».
Ainsi, plutôt qu’une pensée organisée, on a l’impression d’une incapacité intellectuelle à prendre en compte les bouleversements engendrés par la guerre et ses conséquences économiques – à l’exclusion des économistes membres du Trésor, solidement convaincus de la justesse de leurs théories. Cependant, la réalité de l’application de ces doctrines offre une image plus nuancée que ne laissent suggérer les mémorandums de Blackett ou Niemeyer 2 : ainsi, réunis en septembre 1921 dans le village écossais de Gairloch, le chancelier de l’Échiquier Horne et ses conseillers, contre l’avis du Trésor, décident de débloquer des fonds pour venir en aide aux chômeurs ; G.C. Peden, dans The Treasury and British Public Policy, 1906–1959, note ainsi que :
« L’innovation majeure [de cette rencontre] fut la décision du Cabinet, contre l’avis du Trésor, de débloquer 25 millions de livres pour garantir le paiement des intérêts et du principal de prêts privés et publics concernant des projets comme l’extension de lignes de trams ou leur électrification, dans la mesure où ceux-ci réduiraient le chômage. 3 »
En ce sens, le Trésor, contraint par la pression politique qui s’exerce sur les dirigeants élus, est forcé de renoncer à sa politique d’austérité, signe que le politique peut primer sur l’économie. Ainsi, alors qu’il est confronté à une situation nouvelle, celle d’une remise en cause radicale du capitalisme et d’une extension sans précédent, en parallèle, des dépenses publiques, dans laquelle sa doctrine de l’austérité est profondément inadéquate, le Trésor tente de maintenir sa position traditionnelle de contrôle des dépenses publiques. Si, comme le montre très bien l’ouvrage, cette pression vers l’austérité reste tout à fait présente, une analyse des contre-pressions politiques aurait permis de donner sa juste place Le drame tient ici à la contradiction entre la volonté de maintien du système économique du « capitalisme tardif » hérité du XIXe siècle, et les nouvelles données économiques issues de la guerre, en particulier les aspirations de la classe ouvrière à un changement profond des modes de production.
De même, une mise en perspective des discours économiques faisant de la déflation et de la répression salariale les conditions du retour à la prospérité, aurait permis de souligner en quoi ces politiques d’austérité ont constitué autant d’erreurs économiques, mais aussi politiques – en témoigne la volte-face de Keynes, qui s’oppose à la mise en place de l’étalon-or en 1926, malgré, on l’a vu, son attachement à des politiques orthodoxes au début des années 1920. En effet, l’une des thèses de Clara Mattei est que l’austérité sert à discipliner les travailleurs en brisant leurs espoirs d’un avenir meilleur ; or, le gouvernement britannique devra s’y reprendre à plusieurs reprises pour imposer le retour à l’étalon-or, qui ne se fera qu’en 1926 – et sera abandonné de fait en 1931 avec la dévaluation de la livre – et devra affronter à nouveau des grèves dures à partir de 1925. Ces deux éléments tendent à relativiser le succès de la doctrine de l’austérité, qui n’arrive définitivement pas à policer les relations de classe au Royaume-Uni. Le cas italien est différent, étant marqué par le fascisme autoritaire qui réprime brutalement les actions des travailleurs.
De la même manière, l’ouvrage ne s’interroge jamais réellement sur la portée réelle des discours ouvriers dans l’opinion publique. L’introduction d’une telle discussion aurait permis de rendre à ces thèses économiques et sociales leur juste place dans le débat public de l’époque et de mesurer la pression populaire en faveur d’un changement de l’ordre productif, à la fois venant des ouvriers, mais aussi (éventuellement) des couches moyennes salariés, dont les intérêts peuvent diverger avec ceux des ouvriers mais aussi avec ceux des capitalistes.
Ces interrogations ne doivent pas remettre en cause la qualité du travail de l’autrice, qui associe sources précises, appareillage critique étendu et rigueur intellectuelle dans la construction de sa démonstration dans un ouvrage qui ne peut qu’interroger le lecteur : ces politiques sont-elles révolues ?
Sources
- Keynes, “The General Theory and After. Part I Preparation”, The Collected Writings of John Maynard Keynes, vol. XIII, New York, Cambridge University Press, p. 23, 1973. La traduction est de l’auteur du compte-rendu
- Qui sont deux des principaux artisans des politiques de contrôle des dépenses publiques et de déflation monétaire.
- Peden, G. C., ‘Reorganization and Retrenchment, 1919–1924’, The Treasury and British Public Policy, 1906–1959 (Oxford, 2000 ; online edn, Oxford Academic, 3 Oct. 2011), p.181. La traduction est de l’auteur.

