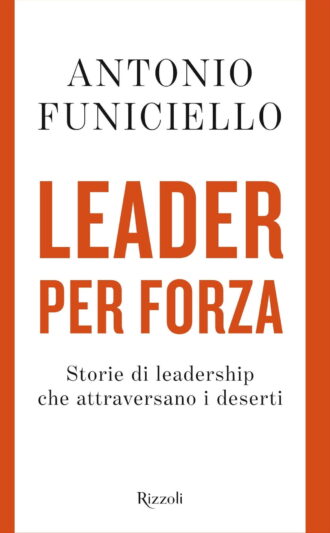Le style Draghi, une conversation avec Antonio Funiciello
Dans son nouvel essai, Leader per forza (Rizzoli), l'ancien chef de cabinet de Mario Draghi et de Paolo Gentiloni explique pourquoi les meilleurs leaders le deviennent souvent par nécessité. Dans cette conversation pleine d'anecdotes sur ses mois passés au Palazzo Chigi, l'ancien conseiller du Président du Conseil réfléchit à la crise de la démocratie et aux solutions possibles face à la montée des autocraties.
Quelle serait votre définition du leadership, et dans quelle mesure a-t-il évolué au cours de l’histoire ?
Diriger, c’est prendre en charge le destin de la communauté, et la substance n’a pas beaucoup changé, le sens est le même depuis l’époque de Périclès ou même avant. Bien sûr, les outils et les contextes changent, mais dans son essence et son identité, le leadership signifie prendre en charge d’autres personnes : on ne traverse pas le désert seul, sinon la définition appropriée serait celle de l’ermite, on traverse le désert avec des disciples dont on est responsable. Avec des adeptes, si nous voulons utiliser le même langage que celui qui entoure le mot leadership.
Le leader a une double représentation, l’une objective et l’autre subjective. La première est sa définition institutionnelle : un dirigeant fait partie d’un système plus complexe, qui a besoin de dirigeants. Les systèmes de gouvernement ont besoin de décideurs au sommet, sinon ils seraient immobiles. En ce sens, ce qui compte, ce n’est pas tant la personne qui, pro tempore, incarne le leadership, mais son historicisation et sa fonction.
Il y a ensuite une dimension subjective dans la mesure où les dirigeants sont différents parce que les personnes qui incarnent le rôle sont différentes. La présidence de la République est un leadership institutionnalisé, tout comme la présidence du Conseil, mais l’interprétation de la fonction par la personne qui l’exerce subjectivement change, car elle l’incarne sur la base des valeurs, des idéaux, mais aussi du caractère, des besoins et des intérêts de la personne représentée.
Le leader a une double représentation, l’une objective et l’autre subjective.
Antonio Funiciello
La dimension institutionnelle est plus pertinente car elle est le fruit de l’histoire de la communauté ; l’homme ou la femme qui l’incarne doit savoir interpréter et représenter les intérêts que la communauté exprime à ce moment historique.
Existe-t-il donc des caractéristiques particulières des dirigeants en fonction de leur nation d’origine ? Dans quelle mesure les systèmes politiques contribuent-ils à la formation des leaderships, par rapport à la personnalité du leader ? Emmanuel Macron pourrait-il gouverner aussi verticalement sans le système derrière lui ?
Certes, les dirigeants français de la Vème République ont des caractéristiques liées à une certaine façon qu’a le peuple français de se penser soi-même, et il n’est pas possible de le nier. On peut déceler des traits de continuité et de similitude entre Macron, Chirac, Mitterrand, Sarkozy ou Hollande, qui les distinguent des dirigeants britanniques ou espagnols contemporains, sans parler des dirigeants allemands ou italiens. C’est que le leadership objectif influence le leadership subjectif.
Il faut dire que le système français est un système particulier, unique en son genre, et cela, cependant, me semble très lié à l’histoire de la France, à la façon dont la démocratie décisionnelle et représentative française est créée, la figure du Président de la République, avec ses pouvoirs et attributions bien plus grands que ceux des Américains, n’est pas accidentelle, elle relève d’un choix des Français à un sentiment commun qui est le leur. Le système, cependant, peut certainement créer plus de conflits que d’autres, parce qu’il connaît moins de contre-pouvoirs, moins de corps intermédiaires. Il s’agit toutefois d’un héritage historique et d’une interprétation du leadership descendant que les Français souhaitent en quelque sorte, exigent : je ne vois pas de particularité d’Emmanuel Macron à cet égard. Certes, le président est un leader de notre temps et interprète sa fonction avec un style contemporain, mais d’un point de vue institutionnel il n’a rien changé, au contraire il subit des réformes approuvées avant son investiture. Je trouve qu’il est un parfait interprète de la grandeur française, de plus il a été réélu et il est le premier à le faire ainsi, au-delà des difficultés incontestables qu’il rencontre, cela comptera pour quelque chose.
Le leadership objectif influence le leadership subjectif.
Antonio Funiciello
Dans votre livre, vous racontez la vie et en particulier l’interprétation du pouvoir de dirigeants très différents, de Moïse à Golda Meir, de Nelson Mandela à Vaclav Havel : quel est le trait commun qui les caractérise ?
Je m’attarde davantage sur les leaderships qui se manifestent de manière moins charismatique, plus décontractée, de nombreuses personnalités sur lesquelles j’écris émergent parce qu’elles divisent moins que d’autres. Je pense à Truman ou Lincoln, mais aussi à Moïse, qui est le premier protagoniste. Vaclav Havel est certainement un autre cas de ce type, de même que Golda Meir, qui est choisie comme leader du parti travailliste israélien en tant que troisième choix : à ce moment-là, il y a deux candidats plus forts qui semblent être favoris, mais ils sont très conflictuels, tandis que Meir est le profil qui fait que le parti se bat moins. Sur son nom une synthèse est trouvée. Il existe cependant de nombreux exemples, comme celui de Sadate succédant à Nasser parce qu’il est le deuxième choix de tout le monde.
J’ai choisi de plonger dans l’histoire de ces personnalités parce qu’elles étaient plus proches du thème que je traitais, à savoir le besoin de leadership. Je pense qu’éluder la question du leadership revient à affaiblir considérablement la démocratie, parce qu’on affaiblit cet élément fondamental du pouvoir démocratique qu’est la prise de décision. Les autocraties sont plus agiles dans la formulation de la décision, dans le processus de prise de décision : si les démocraties ne sont pas capables de décider avec des processus de transparence mais aussi de rapidité, elles perdent du terrain, et dans le monde d’aujourd’hui, cela peut devenir un problème très important.
Je pense qu’éluder la question du leadership revient à affaiblir considérablement la démocratie, parce qu’on affaiblit cet élément fondamental du pouvoir démocratique qu’est la prise de décision.
Antonio Funiciello
Dans le livre, vous racontez un épisode très intéressant : lors du voyage en Ukraine avec Macron et Scholz, en juin 2022, le président Draghi a un objectif, celui de faire entrer Kiev dans l’Union européenne — une ligne que ni la France ni l’Allemagne ne soutiennent pleinement. Malgré leurs divergences, Draghi, Scholz et Macron annoncent à cette occasion qu’ils soutiennent les demandes des Ukrainiens et accordent à Kiev le statut de candidat. L’Italien parvient à obtenir ce résultat politique, qui n’allait pas de soi, en ne prenant pas la parole lors de la réunion décisive. Draghi est-il donc un leader silencieux ?
Silencieux dans ce contexte, dans le sens où je raconte comment, dans un sommet qui a duré près de deux heures et demie, à un moment donné, le président Draghi s’est arrêté de parler et a laissé la place à ses deux homologues. Mais il avait parlé bien avant — parce que Draghi est un bâtisseur de solutions politiques, il a l’habitude d’arriver très préparé au moment où le processus de décision arrive à son terme et produit la décision.
Draghi avait soigneusement préparé cette mission, même avec un effort politique et relationnel assez prononcé dans les semaines précédentes. Préparer le terrain était nécessaire pour arriver ensuite au moment décisif où les dominos tombent les uns après les autres. En ce sens, je compare sa figure à celle de Cavour, qui avait l’habitude de jouer à l’écart, de ne pas imposer sa volonté.
Draghi est un bâtisseur de solutions politiques, il a l’habitude d’arriver très préparé au moment où le processus arrive à son terme et produit la décision. Je compare sa figure à celle de Cavour, qui avait l’habitude de jouer à l’écart, de ne pas imposer sa volonté.
Antonio Funiciello
Lors de la réunion décisive avec Macron, Scholz, le Premier ministre roumain Iohannis et Zelensky, Draghi a laissé l’Ukrainien plaider la cause de son pays, en le soutenant bien sûr, mais en laissant la place à la discussion. Au bout de deux heures et demie, on a l’impression que la décision d’accorder à l’Ukraine le statut de candidat est une idée de Scholz et de Macron, mais en réalité c’est une position italienne, celle de Draghi : il a eu la bonté de laisser ses partenaires, ses principaux alliés, ses amis, s’approprier cette décision. C’est cela le leadership.
Elle affirme que l’Italie peut donc jouer un rôle de premier plan dans les affaires internationales, à condition de ne pas se lancer dans des aventures vagues et solitaires.
Oui, et l’exemple de l’Ukraine est utile en ce sens. Draghi réussit à placer sa position dans un contexte plus général, dans lequel l’Italie devient un acteur international fort parce qu’elle parvient à jouer sur la touche, à ne pas penser à mettre directement la balle dans le trou, parce qu’elle n’a pas la force de le faire de toute façon, ce ne sont pas les États-Unis. En ce sens, il y a une grande différence avec la France, qui veut plutôt lancer elle-même la balle dans le trou, mais la vérité est que Paris ne peut le faire que lorsqu’elle est capable de jouer le rôle de leader européen, lorsqu’elle assume pleinement la responsabilité européenne. En tandem avec l’Allemagne, la France peut réussir à faire beaucoup, car ce sont les deux pays leaders en Europe, et ils doivent travailler ensemble pour tirer tout le monde vers le haut.
L’Italie, en revanche, est attachée à l’image du petit Piémont corsaire qui tente d’insérer sa question nationale dans le grand échiquier international. Rome est forte parce qu’elle est plus agile que les autres, qu’elle peut exploiter des espaces étroits et jouer à l’écart. Mais pour réussir, elle doit affirmer ses alliances.
Au bout de deux heures et demie, tout le monde a l’impression que la décision d’accorder à l’Ukraine le statut de candidat est une idée de Scholz et de Macron — en réalité c’est une position italienne qui vient d’être partagée, celle de Draghi.
Antonio Funiciello
Vous parlez d’un leadership, celui de Mario Draghi, qui n’a pourtant pas eu l’onction du suffrage universel. Avez-vous déjà ressenti l’absence de cette investiture au cours des mois passés au Palazzo Chigi ?
Je crois beaucoup au mandat populaire, il est très important, mais les élections ne sont pas le seul moyen de l’obtenir, il y a un mandat même lorsqu’il est médiatisé par le vote parlementaire. Draghi a été appelé dans des circonstances un peu extrêmes pour gérer des crises, la première était la vaccination, la deuxième était de ramener le PNR à la maison, et puis pendant son mandat il a dû gérer la troisième crise, qui était la guerre en Ukraine. Nous n’avons jamais ressenti l’absence d’un mandat populaire : nous disposions d’une large majorité parlementaire qui soutenait notre action, et si l’on croit en la Constitution, on doit croire que ce mandat parlementaire est pleinement légitime. C’est ce que nous avons cru. Ajoutez à cela le fait que Draghi a toujours bénéficié d’un consensus très fort dans le pays, qui montrait qu’il comprenait et partageait les décisions prises par l’exécutif.
Pensez-vous que la structure du Palazzo Chigi et, plus généralement, les pouvoirs conférés au Premier ministre sont suffisants ? Ou bien le cabinet du Président du Conseil italien est-il encore une institution trop faible par rapport à la chancellerie allemande, au palais de l’Élysée ou à Downing Street ?
Il est plus faible, et c’est une limitation qui, je l’espère, sera bientôt récupérée. Je pense que ce fossé devrait être comblé et que la présidence du Conseil devrait être plus forte. Il est faible parce qu’on veut bien qu’il le soit. La loi qui régit le fonctionnement de l’exécutif date des années 1980, entre autres choses fortement souhaitées par le ministre des relations avec le Parlement de l’époque, qui s’appelait et s’appelle toujours Sergio Mattarella. Mais c’était une autre époque, aujourd’hui il faut repenser le bureau exécutif du gouvernement italien, qui a un rôle moins incisif en raison de l’histoire particulière de l’Italie : le Président du Conseil est un primus inter pares parce que lorsque, la Constitution a été écrite, dans l’immédiat après-guerre, les forces politiques avaient le complexe du tyran, le souvenir du fascisme était encore très fort et les pères constituants ne voulaient pas renforcer le chef de l’exécutif.
En Italien, le Président du Conseil est un primus inter pares parce que lorsque, la Constitution a été écrite, dans l’immédiat après-guerre, les forces politiques avaient le complexe du tyran, le souvenir du fascisme était encore très fort et les pères constituants ne voulaient pas renforcer le chef de l’exécutif.
Antonio Funiciello
Cela ne veut pas dire que ceux qui entrent au gouvernement ont les mains liées ou n’ont aucun pouvoir, et qu’en fait les décisions qui comptent en Italie sont prises par on ne sait qui. Cela n’a aucun sens. En Italie, c’est le chef du gouvernement, avec les ministres et le parlement, qui décide, et dans l’exercice de ses fonctions, il doit tenir compte du Quirinal, de la Cour constitutionnelle et des autres organes de contrôle, et il est normal et juste qu’il en soit ainsi. Mais celui qui siège au Palais Chigi compte beaucoup, son histoire compte, ce en quoi il croit, sa vie, ses convictions. Et cela compte aussi parce que notre République est beaucoup plus forte que la façon dont elle est racontée, quand les décisions ne sont pas prises, il y a une limitation de la capacité de décision, mais cela doit remonter au peuple et non pas à des intrigues obscures. Cela signifie qu’il y a une limitation du pouvoir du Président du Conseil, des ministres, de tous ceux qui ont des responsabilités exécutives.
La politique italienne a pris un pays détruit et dévasté par la Seconde Guerre mondiale et l’a amené à devenir un acteur mondial ; aujourd’hui, l’Italie connaît une phase de marginalisation de son rôle mondial, puisque de nouveaux acteurs beaucoup plus importants ont émergé. Mais nous avons toujours été les protagonistes de la création d’une identité européenne qui peut à juste titre rivaliser avec les grandes identités mondiales, la chinoise et l’américaine. Nous devons poursuivre dans cette voie.
Nous avons toujours été les protagonistes de la création d’une identité européenne qui peut à juste titre rivaliser avec les grandes identités mondiales, la chinoise et l’américaine.
Antonio Funiciello
Notre leadership démocratique est-il en crise aujourd’hui ?
La démocratie est confrontée à deux problèmes distincts et d’égale importance. D’une part, une capacité de décision limitée et, d’autre part, la question de la représentativité. Le leadership doit émerger d’une large représentation, s’il émerge d’une représentation plus petite, c’est un problème : bien sûr, il est légitime sur le plan procédural et constitutionnel, et c’est un principe qui ne peut être remis en question, mais il doit faire face à un problème politique d’importance non négligeable, car une faible participation implique un leadership moins représentatif.
Résoudre l’une des deux crises conduit à résoudre également l’autre : la faible participation est générée par l’insatisfaction liée à la faible capacité de prise de décision ; cette dernière intervient en revanche lorsqu’il n’y a pas de mandat de représentation fort qui permette au décideur de prendre certains risques. Lors de la prise de décision, les risques existent et pour les affronter, il faut du courage politique mais aussi un consensus pertinent au sein de sa propre communauté. Dans le cas contraire, le mécanisme risque de s’effondrer.
Le leadership doit émerger d’une large représentation — s’il émerge d’une représentation plus petite, c’est un problème.
Antonio Funiciello
Dans votre livre, vous dites qu’à court terme, nous assisterons à un changement dans la formation des dirigeants en Europe, qui seront de plus en plus formés dans les institutions européennes et de moins en moins dans les institutions nationales. Comment cela se fait-il ?
Je dis que les lieux où se forment les dirigeants sont les lieux où se prennent les décisions. Pourquoi l’Italie a-t-elle eu Luigi Einaudi, Guido Carli, Carlo Azeglio Ciampi, Mario Draghi, tous de grands dirigeants issus de la Banque d’Italie et dont certains ont aujourd’hui disparu ? Parce qu’au XXe siècle, c’était l’institution qui définissait la politique monétaire, qui prenait des décisions complexes et très importantes, alors qu’aujourd’hui elle a un rôle différent, celui de la supervision, et il est donc plus difficile de faire émerger un leadership qui peut ensuite être dépensé du côté exécutif, du côté des finances publiques, du côté macroéconomique.
Aujourd’hui, le niveau crucial de gouvernance est l’échelle communautaire : de nombreuses décisions exécutives sont prises en Europe, de sorte qu’y accumuler de l’expérience peut avoir une véritable valeur d’exemple pour occuper ensuite des fonctions gouvernementales et les exercer au niveau national. L’expérience communautaire garantit un niveau de compétence et de connaissance d’une échelle de gouvernance qui est crucial lorsque l’on revient dans son propre pays dans des fonctions de haut niveau.
De nombreuses décisions exécutives sont prises en Europe, de sorte qu’y accumuler de l’expérience peut avoir une véritable valeur d’exemple pour occuper ensuite des fonctions gouvernementales et les exercer au niveau national.
Antonio Funiciello
Dans le chapitre sur Nelson Mandela, vous soulignez que son parcours après la prison est également possible grâce à l’absence de polarisation, à la capacité des différents mondes à travailler ensemble. Est-ce encore possible ou nos sociétés démocratiques sont-elles par nature trop polarisées ? Si l’on regarde les États-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Italie, il est difficile de ne pas s’en apercevoir.
Nous vivons une phase de polarisation extrême. La prise d’assaut du Capitole est un phénomène à part : ne pas reconnaître le résultat des élections et détruire le Parlement est la dernière étape avant la destruction complète de la démocratie, ce n’est pas comparable aux manifestations françaises des gilets jaunes, par exemple. Si la polarisation se poursuit et devient encore plus extrême, la démocratie ne peut pas survivre, car elle repose sur l’idée que la polarisation peut être gouvernée, qu’il est possible de parvenir à un compromis dans lequel même les positions les plus éloignées trouvent un accord. La polarisation en Occident a coïncidé avec la phase de déclin de la démocratie libérale au cours des trente dernières années, qui, après une forte expansion, a entamé un lent recul, aujourd’hui à son apogée.
Si la polarisation se poursuit et devient encore plus extrême, la démocratie ne peut pas survivre.
Antonio Funiciello
La conséquence d’une polarisation encore plus radicale dans laquelle nous ne nous reconnaissons pas les uns les autres est la fin de la société telle que nous la connaissons. La démocratie doit être préservée. Je ne pense pas que ce soit le pire système à l’exception des autres, je pense au contraire que c’est un très bon système, qui représente le mieux et fait vivre les droits fondamentaux de l’individu : je dois croire et je crois que cette phase de polarisation peut être suivie d’une phase de rapprochement, dans laquelle les systèmes démocratiques des pays occidentaux redeviennent représentatifs des besoins et des intérêts des citoyens. La démocratie n’est pas seulement un outil permettant d’améliorer les conditions matérielles des gens, mais aussi un formidable instrument permettant d’améliorer les biens immatériels des êtres humains, car elle garantit les droits et les libertés.
Vous consacrez le dernier chapitre à Angela Merkel et décrivez son leadership comme « non résolu ». Êtes-vous sûr que c’est le cas ? En fin de compte, sa politique d’apaisement avec la Russie a échoué. En ce sens, du point de vue des relations internationales, elle est « résolue »…
Angela Merkel a été la dirigeante la plus importante de l’Occident au cours de la première partie du siècle et il ne fait aucun doute que l’Allemagne a été renforcée au cours de ces années ; son leadership a certainement été bénéfique pour les Allemands. Je suis surpris par une coïncidence singulière : la période au cours de laquelle Helmut Kohl a unifié l’Allemagne et inauguré une période de forte expansion et d’amélioration sociale de la République fédérale a coïncidé avec une expansion démocratique globale et une diffusion des valeurs démocratiques. Avec Angela Merkel, c’est le contraire qui se produit, d’où ma définition du leadership non résolu : la chancelière n’a pas réussi à transférer sa capacité à bien gouverner sa démocratie à une plus grande échelle, elle n’a pas réussi à se représenter pleinement en tant que leader occidental.
Ne pas avoir envisagé le leadership de l’Allemagne dans une perspective extra-nationale a été sa limite. L’affaire russe ne peut être négligée, l’apaisement de l’Allemagne vis-à-vis de Moscou n’a pas aidé, il était basé sur le principe que nous devions garder Poutine près de nous, mais à force d’accepter l’agressivité du Kremlin, nous en sommes arrivés à l’invasion de l’Ukraine avec des chars d’assaut.
Ne pas avoir envisagé le leadership de l’Allemagne dans une perspective extra-nationale a été la limite d’Angela Merkel.
Antonio Funiciello
Je suis curieux de lire ses mémoires, les arguments qu’elle a avancés jusqu’à présent, à savoir qu’elle aurait donné à l’Ukraine le temps de s’organiser et de se défendre, je les trouve un peu faibles — je ne pense pas que Nord Stream 2 ait été un choix pour renforcer l’Ukraine. Elle a toujours considéré qu’il s’agissait d’un choix économique, mais c’était en fait un choix géopolitique et géostratégique avec un impact mondial très fort, qui a été fait en toute connaissance de cause et qui était erroné, à tel point qu’ils ont dû le bloquer.
Au cours des trois dernières années, l’Europe a vécu deux moments que l’on peut qualifier d’hamiltoniens : le premier, avec la décision de financer la relance économique du continent après la pandémie par l’émission d’une dette commune, le second avec l’aide compacte à l’Ukraine et les sanctions à l’encontre de la Russie. Quand la vision et la persévérance des dirigeants pour continuer dans cette direction compteront-elles ?
Les dirigeants sont essentiels, mais ils ne suffisent pas : il est nécessaire que les chefs de gouvernement restent représentatifs des intérêts et des aspirations des citoyens européens, qui doivent comprendre la nécessité absolue de ces choix. Nous sommes à la croisée des chemins, avec le programme Next Generation EU, nous sommes allés là où nous n’étions jamais allés auparavant, nous ne pouvons pas revenir en arrière. Le progrès passe toujours par les urgences et les crises, la CECA est née après la Seconde Guerre mondiale et est née de la nécessité, aujourd’hui l’Europe évolue grâce au Covid et maintenant grâce à la menace de la Russie de Poutine. Le fait est que nous avons parcouru un long chemin et que la route à suivre est très complexe : un leadership conscient, courageux et transformateur est un leadership qui veut achever le voyage à ce stade. Le grand rêve reste de transformer la plus grande zone commerciale du monde en une zone politico-économique.