« La diplomatie sert, d’abord, à améliorer la vie des gens », une conversation avec Catherine Ashton
En tant que première Haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la sécurité, Catherine Ashton a dû coordonner la réponse de 28 pays face aux crises internationales. Riche de son expérience de négociatrice d'accords historiques comme celui sur le nucléaire iranien, elle réinterroge, depuis ce poste singulier, l'utilité même de la diplomatie — et la « valeur ajoutée » de celle de l'Union.
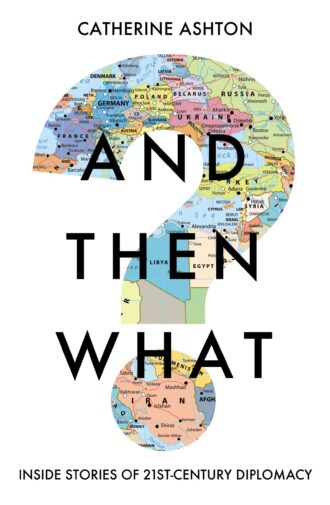
Votre livre montre que le Service européen pour l’action extérieure (SEAE) et le Haut Représentant de l’Union européenne sont très efficaces pour traiter des questions mondiales et multilatérales telles que le JCPOA ou les pourparlers entre la Serbie et le Kosovo. Au début du chapitre consacré à ces pourparlers, vous faites l’éloge de Martti Ahtisaari, l’envoyé des Nations Unies pour le Kosovo. Cela peut conduire à penser que le Haut Représentant ressemble davantage à un envoyé des Nations Unies qu’à un ministre des affaires étrangères d’un État-nation. Pensez-vous que la diplomatie de l’Union européenne soit plus adaptée à traiter de questions multilatérales qu’à représenter des intérêts européens à l’étranger ?
Lorsque je suis devenue Haute-Représentante, une partie essentielle de mon travail était de montrer qu’il y avait des choses que l’Europe pouvait faire en tant qu’Europe et qui étaient mieux faites par l’Europe que par des États membres seuls.
En ce qui concerne la Serbie et le Kosovo, notre rôle était de servir de médiateur, de réunir les deux parties et de les aider à trouver une solution, en utilisant Bruxelles comme un espace leur permettant de se parler librement. Au cours de ces pourparlers, l’attrait du soft power de l’Union européenne, de la possibilité pour eux de rejoindre l’Union un jour, a également été un facteur décisif. Dans d’autres circonstances, mon travail consistait à représenter les points de vue des 28 pays sur des questions particulières. Dans les discussions avec la Chine ou l’Inde ou dans nos discussions avec les pays avec lesquels nous établissions des relations, comme la Corée du Sud, j’avais un rôle plus représentatif.
Au cours des pourparlers avec la Serbie et le Kosovo, l’attrait du soft power de l’Union européenne, de la possibilité pour eux de rejoindre l’Union un jour, a également été un facteur décisif
Catherine Ashton
Vous êtes arrivée à Bruxelles alors que le Service européen pour l’action extérieure était en cours de création, puis vous avez accompagné ses premières années d’existence. Quels sont, selon vous, les principaux atouts du SEAE et comment pensez-vous qu’il pourrait et devrait évoluer au fil des années ?
On m’a confié la tâche de créer ce Service. Les fonctionnaires qui le composaient travaillaient dans différents bâtiments, faisaient partie de différents organes de l’Union ou n’étaient même pas encore arrivés au Service — des diplomates des États membres, par exemple. Le plus grand atout était les personnes que nous avions. Il est extraordinaire de réunir les talents de tout un groupe de pays et de bénéficier des connaissances qu’ils possèdent. La capacité de ces équipes européennes à examiner les questions sous différents angles, à partir de différents points de vue, était fantastique.
Notre deuxième atout était que nous représentions la puissance économique de l’Europe, et que nous devions l’utiliser de manière positive. Par exemple, lors des négociations avec l’Iran, se débarrasser des sanctions signifiait créer des opportunités pour les pays européens, mais pouvait aussi conduire l’Iran à développer des liens avec l’Europe. Quant à la Serbie et au Kosovo, ils étaient motivés par l’objectif ultime d’entrer dans l’Union européenne. Dans nos discussions avec des pays comme l’Égypte ou la Libye, il était question de la force de cette collaboration.
Lors des négociations avec l’Iran, se débarrasser des sanctions signifiait créer des opportunités pour les pays européens, mais aussi pouvait conduire l’Iran à développer des liens avec l’Europe.
Catherine Ashton
Le troisième atout du SEAE est que l’Union unit des pays avec des valeurs fortes : la démocratie, la liberté, l’État de droit. Cela envoie un message très puissant sur notre identité, sur ce qui compte pour nous. Tous ceux avec qui je travaillais, tous les pays avec lesquels je parlais, étaient assez conscients de ce que l’Europe ressentait et de sa position sur les droits de l’homme ou les valeurs de la démocratie et de la liberté.
Vous expliquez dans votre ouvrage que lorsque les Kosovars et les Serbes ont accepté l’idée d’avoir un représentant dans l’autre pays, ce représentant devait être accueilli par la délégation européenne dans chaque pays. Cela illustre l’utilité des délégations de l’Union dans la résolution des conflits. Quelle importance a eu l’intégration des délégations de l’Union dans le SEAE et quelle a été son utilité pour le Haut représentant ?
C’était une situation complexe car la Commission avait des intérêts dans chaque délégation. Le commerce et le développement international, qui relèvent des compétences de la Commission, représentait une part important de ce que les délégations faisaient. Mais nous essayions de les relier non pas à une institution en particulier mais à l’Union européenne dans son ensemble. Nous avons nommé des chefs de délégation qui étaient principalement des diplomates, par opposition aux fonctionnaires de la Commission. Les États membres de chaque pays extra-européen étaient en mesure d’utiliser la délégation et d’établir un lien avec elle. De nombreux pays dans le monde n’accueillent pas sur leur sol une ambassade de chacun des 28 États membres de l’Union.
Il s’agissait des yeux et des oreilles du Haut-Représentant sur le terrain. Ces fonctionnaires qui sont arrivées dans le Service avaient la volonté d’établir quelque chose de nouveau, mais aussi de définir, dans chaque pays, au cas par cas, quel pourrait être le coeur de leur activité. Et nous avons encore eu beaucoup de chance car nous avions et avons toujours des individus fantastiques.
Vous mentionnez également dans le livre des aspects qui pourraient apparaître comme des défauts du SEAE. Par exemple, vous expliquez comment John Kerry a été étonné que vous deviez réserver un billet sur un avion commercial pour vous rendre en Égypte pendant le printemps arabe. Vous mentionnez également comment vous avez eu besoin, pour communiquer avec Hillary Clinton, du service de télécommunications de l’OTAN, car il n’y a pas de système de télécommunications sécurisé au SEAE. S’agissait-il de problèmes ? Cela devrait-il changer pour que le SEAE joue le rôle qu’il est censé jouer dans les affaires mondiales ?
Je parlais ici d’exemples mineurs liés au fait de créer une institution au milieu d’une crise économique. De manière tout à fait compréhensible, personne ne voulait gaspiller de l’argent ou en dépenser inutilement. Je pense que dans le climat actuel, ne pas avoir d’avion est de toute façon une bonne chose. Mais il y a eu de nombreuses circonstances où j’ai dû me rendre dans des endroits où il n’y avait pas de vols ou bien où il était impossible de se rendre sans une sécurité supplémentaire. À cette occasion particulière que vous mentionnez, pendant le printemps arabe, c’est l’immédiateté que je recherchais et que je ne pouvais pas obtenir. J’ai dû attendre pour réserver un billet. Je ne suis pas sûre que vous ayez besoin de tous les atours d’un service extérieur national, loin de là. Vous devez probablement déterminer ce qui est essentiel et ce qui ne l’est pas. Par exemple, je n’ai jamais demandé d’avion et je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Je pense que dans le climat actuel, ne pas avoir d’avion est de toute façon une bonne chose.
Catherine Ashton
Nous avons parfois eu besoin de communications sécurisées — c’était idéal quand nous pouvions utiliser celles de l’OTAN, mais c’était mieux quand nous pouvions utiliser celles de l’Union. Chaque Haut Représentant doit trouver où dépenser les ressources limitées dont nous disposons. Il y a encore des régions du monde qui n’ont pas de délégations de l’Union et certains pourraient dire que vous devriez vous concentrer sur l’ouverture de délégations dans les États du Golfe ou ailleurs, plutôt que de vous soucier des communications. En tout cas, je pense qu’il ne devrait pas y avoir d’avion !
Ursula Von Der Leyen a qualifié sa Commission de « géopolitique » après que Juncker eut nommé la sienne « Commission politique ». Comment percevez-vous cette insistance nouvelle sur la défense des intérêts de l’Union à l’étranger et sur la nécessité de projeter une image de l’Union plus affirmée ? Dans quelle mesure le discours de l’Union sur ces sujets est-il différent de celui des années où vous en étiez sa Haute Représentante ?
Il est essentiel que l’Europe trouve sa force et reconnaisse qu’elle est une puissance incroyablement importante, en particulier une puissance économique. Je suppose que la Présidente de la Commission essayait de montrer que l’Europe avait beaucoup à offrir sur la scène mondiale, à la fois pour résoudre les problèmes et aussi pour faire avancer les dossiers, surtout quand on pense à un monde post-COVID.
Vous avez conclu des accords internationaux très importants, comme l’accord Kosovo-Serbie ou le JCPOA. Comment votre poste et le regard que les autres acteurs jettent dessus ont-ils évolué entre le début et la fin de votre mandat ?
La plupart des gens ne savaient pas ce qu’était censé être ce poste de Haut-Représentant. Il n’y avait pas de description de poste précise inscrite dans le Traité. Le Service d’action extérieure ne représente qu’une ligne dans le Traité : « Le Haut représentant est assisté par un Service européen d’action extérieure ». C’est tout ce qui était dit.
Au début, nous devions déterminer ce qui était le plus logique à faire, à côté du travail des 28 ministres des affaires étrangères nationaux. Nous ne voulions pas prendre leur place, mais rassembler toutes nos positions communes et faire en sorte que nous parlions tous des mêmes questions. Ensuite, nous devions trouver des moyens de montrer comment l’Europe unie pouvait avoir un plus grand effet. Cela a été prouvé tant dans les négociations avec l’Iran qu’en Serbie et au Kosovo, qui sont les deux exemples les plus évidents.
En Égypte, en Libye, en Somalie et dans d’autres pays, les ministres des Affaires étrangères ont eu de nombreuses occasions d’être actifs et de jouer un rôle de premier plan lorsqu’un pays avait une relation spécifique avec la région en question. Par exemple, à Haïti, c’était l’Espagne parce qu’elle avait la présidence du Conseil de l’Union et la France en raison de sa longue relation avec le pays.
J’ai toujours considéré que l’Union apportait de la valeur ajoutée aux nations européennes, et non qu’elle leur en enlevait.
Catherine Ashton
Enfin, nous avons réussi à montrer, à travers les deux accords que vous avez mentionnés, que l’Europe avait un rôle spécifique à jouer. Je pense que les gens se sont habitués à l’idée que l’Union pouvait faire les choses différemment ou pouvait ajouter de la valeur à ce que les pays faisaient individuellement. Et j’ai toujours considéré que l’Union apportait de la valeur ajoutée aux nations européennes, et non qu’elle leur en enlevait.
Y avait-il des formats spécifiques avec certains pays qui vous semblaient particulièrement utiles ?
Cela dépendait de la question. L’E3 sur l’Iran était crucial. Le Quint était également très utile. Toutefois, obtenir l’accord de l’ensemble des 28 était la manière la plus efficace d’agir dans les affaires extérieures, car alors nous étions perçus comme un continent presque totalement uni. Les Norvégiens et les Suisses faisaient partie de nos conversations tout au long, bien sûr. Nous avons beaucoup tendu la main à nos pays voisins et aussi à nos alliés comme les États-Unis.
Y avait-il des formats spécifiques avec certains pays qui vous semblaient particulièrement utiles ?
C’est une question difficile, car à mon époque, l’unanimité était fondamentale. Lorsque vous construisez quelque chose de tout nouveau, il faut éviter de créer un groupe de pays qui sont en désaccord. Il était important pour moi que, dans mes échanges avec d’autres pays, je puisse dire : « tout le monde est d’accord avec moi, c’est notre position commune, c’est ce que nous avons décidé ensemble, et c’est ce que pense l’Union européenne ».
À mon époque, il était difficile d’obtenir l’accord des 28, mais nous n’avons jamais échoué.
Catherine Ashton
Si vous choisissez de procéder par le biais d’une majorité qualifiée, vous devez vous assurer qu’en procédant ainsi, vous ne créez pas de petits groupes de pays qui ne sont pas d’accord. Vous devez vous assurer que si la majorité qualifiée est d’accord, tout le monde soit d’accord. À mon époque, il était difficile d’obtenir l’accord des 28, mais nous n’avons jamais échoué. Dans les cinquante réunions officielles que j’ai présidées, nous n’avons jamais voté. J’avais donc toujours une position commune sur laquelle travailler.
Concernant les pourparlers entre le Kosovo et la Serbie, vous précisez au début de votre livre que « la plupart des États membres de l’Union avaient supposé que l’échec était inévitable et n’ont guère prêté attention aux pourparlers ». Comment expliquez-vous cela ?
Au début, aucun d’entre nous ne pensait que nous allions réussir, mais j’étais convaincue qu’il valait la peine d’essayer. C’était une chose extrêmement difficile à faire. Il est rapidement devenu évident que nous pouvions parvenir à obtenir des avancées. Les États membres n’étaient pas négatifs. Ils ont simplement dit : « Eh bien, bonne chance ! » Mais il y avait peu de raisons de penser que cela irait très loin. Je ne leur en veux pas pour cela. Leur position était raisonnable.
À ce propos, certaines personnes disent que l’une des tâches du Haut Représentant est d’amener certains pays à s’intéresser à la politique étrangère, car les petits pays n’ont pas tendance à s’impliquer beaucoup dans les questions de politique étrangère.
Je ne suis pas sûre d’être d’accord, car les États baltes, par exemple, ont toujours été très engagés dans la politique étrangère, notamment en raison de leur position géographique. Malte était préoccupée par les questions migratoires. Chypre avait une relation complexe avec la Turquie. Je ne pense pas qu’il y ait eu un seul moment où j’ai eu l’impression qu’un pays n’était pas impliqué d’une manière ou d’une autre. Nous nous sommes efforcés de faire en sorte que chaque pays s’exprime au Conseil des affaires étrangères. Le ministre de chaque pays venait à chaque fois. Pour moi, un Conseil réussi consistait à réunir l’intégralité des ministres, car il est facile d’envoyer un ambassadeur. Il y a eu des occasions où cela n’a pas pu se faire, mais en général, ils étaient tous là.
Peut-être s’agit-il davantage d’essayer d’harmoniser les intérêts des différents pays européens sur différents sujets : en raison de leur géographie et de leur histoire, les pays ont tendance à s’intéresser à certains sujets spécifiques de la politique étrangère.
C’est vrai, mais ils savaient aussi que pour obtenir un soutien sur leur sujet, ils devaient apporter leur soutien à un autre pays sur un sujet qui l’intéresse. Ils ont peut-être laissé d’autres pays prendre le premier rôle sur une question parce que ces pays étaient les plus touchés ou comprenaient mieux les problèmes. Par exemple, quand la France parlait du Sahel, d’autres pays étaient prêts à la soutenir même s’ils ne connaissaient pas bien la région. Lorsque les pays baltes évoquaient ce qui se passait en Ukraine, d’autres pays plus préoccupés par d’autres questions ont néanmoins apporté leur soutien. Autour de la table, il s’agissait d’un processus d’apprentissage mutuel qui leur a permis de travailler ensemble sur des questions où certains pays avaient naturellement un rôle plus important à jouer.
Quand la France parlait du Sahel, d’autres pays étaient prêts à la soutenir même s’ils ne connaissaient pas bien la région.
Catherine Ashton
Votre livre met en lumière l’importance des États-Unis pour la politique étrangère de l’Union. Vous mentionnez comment Hillary Clinton a soutenu les pourparlers dans les Balkans. Vous expliquez que les États-Unis ont même impliqué directement un analyste du Département d’État américain dans les pourparlers. Pensez-vous que la politique étrangère de l’Union est trop dépendante de la politique étrangère américaine ?
Les États-Unis sont notre allié le plus évident et ils peuvent faire des choses que nous ne pouvons pas faire. L’Europe, je l’espère, développera et renforcera ses capacités en matière de politique étrangère et de sécurité. Si vous pensez à ce qui se passe en Ukraine, l’impact sur l’Europe est différent de l’impact sur les États-Unis. Par conséquent, l’Union doit avoir une politique étrangère européenne claire en lien avec les États-Unis de l’autre côté de l’Atlantique mais distinctement européenne, qui reconnaît que les défis auxquels l’Europe est confrontée sont différents.
L’Union doit avoir une politique étrangère européenne claire en lien avec les États-Unis de l’autre côté de l’Atlantique mais distinctement européenne, qui reconnaît que les défis auxquels l’Europe est confrontée sont différents.
Catherine Ashton
La mauvaise relation que le président Trump avait avec l’Europe était, dans un sens, une opportunité pour l’Union de rassembler et de renforcer sa propre politique étrangère. Les États-Unis sont le plus grand ami et allié ainsi qu’un partenaire extrêmement important. C’est à l’Europe de décider si elle veut essayer de faire ce que font les États-Unis. Mais l’Europe doit aussi exercer sa propre force en étant capable de faire des choses dans son propre voisinage. C’était en partie l’objet de l’accord Serbie-Kosovo : montrer que l’Europe pouvait résoudre ou essayer de résoudre un problème dans son arrière-cour.
Les sanctions sont l’un des outils les plus utiles dont dispose la politique étrangère de l’Union. Vous étiez Haute-Représentante lorsque la première série de sanctions a été prise, contre l’Iran, puis contre la Russie lorsqu’elle a envahi la Crimée. Comment, d’un point de vue institutionnel, a été créée cette capacité de sanctions et comment a-t-elle été renforcée au fil des ans ? Quelle importance revêt-elle encore aujourd’hui ?
Il y a toujours eu la capacité d’utiliser des sanctions, mais nous avons essayé de travailler avec les États membres pour les rendre plus efficaces. Nous avons également essayé d’éviter autant que possible de toucher les gens ordinaires. De manière plus générale, les sanctions sont un moyen et non une fin. Il est vraiment important d’éviter de penser que sanctionner signifie résoudre un problème. Les sanctions tentent d’empêcher le problème de s’aggraver ou, idéalement, de l’inverser. Mais vous devez toujours faire face à ce qui se passe. Et il est donc important de ne pas les laisser devenir le seul outil à disposition.
De manière plus générale, les sanctions sont un moyen et non une fin.
Catherine Ashton
Vous mentionnez dans le livre l’importance des relations personnelles, illustrée par les dîners avec Javad Zarif avant les tours de table lors des négociations nucléaires ou par l’atmosphère constructive que vous avez contribué à créer entre les Premiers ministres du Kosovo et de la Serbie. Quelle importance accordez-vous aux relations personnelles en politique étrangère ?
Je pense qu’elles ajoutent une dimension supplémentaire. Je ne dis pas que si vous n’avez pas de bonnes relations avec quelqu’un, vous ne pouvez pas faire le travail. Il y a beaucoup de personnes avec lesquelles vous devrez discuter malgré une absence complète d’affinité. Le travail doit être fait quoi qu’il en soit.
Il y a beaucoup de personnes avec lesquelles vous devrez discuter malgré une absence complète d’affinité. Le travail doit être fait quoi qu’il en soit.
Catherine Ashton
Mais lorsque vous pouvez établir un certain niveau de confiance dans le processus entre les parties, vous êtes en mesure d’obtenir deux choses. Premièrement, les autres croient ce que vous dites. Deuxièmement, vous permettez que l’on essaye des idées originales. Ce dont je ne parle pas dans le livre, ce sont les choses que les gens ont essayées et qui n’étaient pas nécessairement dans leur mandat. Si vous avez des relations entre les individus qui permettent de proposer des idées originales, cela est très utile. Dans certains cas, cela peut créer entre chacun un lien plus fort qui leur permet de parler plus en profondeur de certains des problèmes auxquels ils sont confrontés. Mais ce n’est pas garanti et ce n’est pas nécessaire pour réussir.
Un autre thème de votre livre est celui des relations avec la presse. Lorsque vous arrivez à Bruxelles, vous dites qu’« être vue en train de m’amuser aurait été un désastre dans la presse ». C’est pourquoi vous ne dînez pas à Bruxelles. Comment décririez-vous de ce point de vue la différence entre le paysage médiatique à Bruxelles et au Royaume-Uni ? Pensez-vous que nous devrions remodeler la façon dont les médias perçoivent les affaires européennes ?
L’histoire est jonchée de photos de politiciens qui, dans des moments de crise, se trouvaient au mauvais endroit au mauvais moment. La presse de nombreux pays européens fonctionne de la même manière, même si tout le monde sait que vous n’êtes absolument pas au courant de ce qui se passe. Lorsque vous créez quelque chose de tout nouveau, la suspicion est encore plus grande parmi la presse de tout le continent. Certaines personnes pensaient qu’elles auraient dû être nommées à votre place. Certains pays pensent que le poste aurait pu leur revenir. Il y avait beaucoup de raisons pour lesquelles les gens portaient sur ma personne et mes fonctions un regard suspicieux. Par conséquent, je devais faire de mon mieux pour ne pas donner une opportunité évidente à la presse, car cela diminuerait mes chances de réussite.
Vous concluez votre livre en écrivant, sur un ton assez grave, que vous avez été la première Haute-Représentante britannique, mais aussi la dernière, en raison du Brexit. Votre histoire avec la construction européenne remonte à loin, puisque vous avez joué un rôle très important pour faire adopter le traité d’Amsterdam et le traité de Bruxelles à la Chambre des Lords. Comment voyez-vous l’avenir de la relation entre le Royaume-Uni et l’Union en termes de politique étrangère ? Est-ce que quelque chose comme le E3+EU pendant les négociations nucléaires constituerait un exemple de ce qui pourrait être réalisé à l’avenir ?
La conclusion évidente est, à terme, que la Grande-Bretagne et l’Europe doivent collaborer aussi étroitement que possible. La manière dont cela se concrétisera est incertaine. Par exemple, lorsque j’étais Haute-Représentante, nous invitions souvent la Norvège à nos réunions avec les ministres des affaires étrangères. Il n’est pas inconcevable qu’il y ait des réunions au format E3. L’initiative du président Macron, la Communauté politique européenne, a le potentiel de créer une coalition informelle, pour ainsi dire, de pays. Avec le temps, je pense que le Royaume-Uni se rapprochera en matière de politique étrangère et de sécurité, car cela a du sens des deux côtés. J’espère que ce sera le cas.
Les relations internationales et la diplomatie impliquent de se rappeler pourquoi nous faisons tout cela : pour améliorer la vie des gens.
Catherine Ashton
Vous avez commencé votre carrière dans le travail social. Vous mettez l’accent sur les problèmes humanitaires et sur l’amélioration de la vie quotidienne des gens par la diplomatie. Lorsque vous vous rendez au Kosovo, vous visitez le camp de Srebrenica avec une association de mères ayant perdu leurs fils. Voyiez-vous une continuité entre le travail social au niveau local et la diplomatie, la seule différence étant l’échelle à laquelle se place l’action d’un seul individu ?
La diplomatie consiste à s’assurer que son propre pays est sûr et sécurisé et que ses intérêts soient représentés et défendus. Les relations internationales et la diplomatie impliquent de se rappeler pourquoi nous faisons tout cela : pour améliorer la vie des gens. Ce qui m’a le plus frappé, c’est que tout le monde veut les mêmes choses.
Tout le monde veut vivre en sécurité, avoir un foyer, que ses enfants aillent à l’école et trouvent un emploi. Que vous essayiez d’aider à résoudre un conflit, de fournir les meilleurs soins de santé possibles dans votre communauté locale ou de vous assurer que les écoles locales fonctionnent bien, il s’agit toujours de rendre la vie des gens meilleure. Je voulais mettre en application mes connaissances. Trouver des solutions aux problèmes, essayer de s’engager sur des questions, essayer de comprendre ce qu’il faut faire, essayer de maintenir ce soutien. Les personnes que j’appelle les « vrais diplomates » sont brillantes dans ce domaine.

