Le système des relations internationales est comme les mathématiques… C’est simplement un calcul, disait en 2007 Vladimir Poutine lors de la Conférence de Munich sur la Sécurité1, où il avait impressionné ses « partenaires occidentaux » par son langage délibérément brutal, humiliant et sans concession à leur encontre. De l’économie à la construction d’Empire par puzzle, tout est, en effet, « mathématique » chez Poutine : l’on additionne votes, missiles, kilomètres carrés conquis, pipelines inaugurés, sites hackés, tonnes d’acier et de blé produits ou exportés… et lorsque le compte semble y être, l’on passe à l’étape suivante pour s’engager dans un nouveau conflit.
Simple comme les mathématiques ? « Pas si évident » aurait répondu Ibn Khaldûn, historien et penseur maghrébin mort en 1406, s’il était de retour dans notre monde et qu’on lui avait offert un strapontin à ce sommet : « certes, je ne connais rien en relations internationales, discipline qui n’existait pas dans mon XIVe siècle brutal où ne comptait que le droit de l’épée, mais les nations et les empires ont été ma passion de mon vivant », avant d’ajouter : « et je peux vous affirmer que, sans même évoquer les accidents qui peuvent se produire dans l’histoire, la volonté de reconstituer un Empire défunt par la guerre relève purement et simplement de la folie, et ce pour des raisons qui n’ont rien à voir avec les mathématiques »2.
Les leçons d’Ibn Khaldûn
La question, en effet, n’est pas celle de la puissance économique ou militaire, registre dans lequel la Russie, dont le PIB est à peine supérieur à celui de l’Espagne pour une population trois fois plus nombreuse, ne brille d’ailleurs guère. Pour construire un Empire, entreprise d’ordre sacerdotal selon le penseur maghrébin, il faut une ‘asabiyya, une solidarité interne égalitaire mais déjà différenciée qui pousse le groupe au-devant de la scène presque indépendamment de sa volonté et une da’wa, à savoir un appel ou une idéologie qui lui apporte une légitimité universelle et lui permet d’endurer l’énorme effort sacrificiel indispensable dans la durée. Le pacte des kleptocrates, tel qu’il s’est noué en Russie entre les oligarques, le complexe militaro-industriel et une élite d’opportunité forte des thèses eurasistes, ne pourra jamais forger une ‘asabiyya, tandis que le nationalisme étroit fondé sur la concordance entre espèce et espace russes, ne saurait jamais donner naissance à une da’wa. Quant à l’esprit de sacrifice et la gloire qui l’accompagne en récompense, il ne s’acquiert assurément pas par l’aviation ou les missiles supersoniques, mais par l’acceptation de la mort « pour la cause ». Il s’agit là de ressources qu’on ne peut acheter avec les 640 milliards de dollars de réserves dont la Banque centrale russe se vantait avant la guerre : fonder un Empire, aurait rappelé encore Ibn Khaldûn à Poutine, exige qu’on parte du rustique pour arriver au sophistiqué dans et par le processus de construction impériale, indépendamment des gadgets raffinés, donc déjà usés et achevés d’une civilisation vieillie.
Fonder un Empire, aurait rappelé Ibn Khaldûn à Poutine, exige qu’on parte du rustique pour arriver au sophistiqué dans et par le processus de construction impériale, indépendamment des gadgets raffinés, donc déjà usés et achevés d’une civilisation vieillie.
Hamit Bozarslan
Et Ibn Khaldûn aurait continué sa leçon pour expliquer pourquoi il était profondément sceptique de son vivant quant aux ambitions des Arabes de reconstruire leur Empire défunt : car un Empire est une expérience, mais aussi un apprentissage : en se construisant, mieux encore en se désintégrant, il apprend aux autres comment devenir Empire. Bien entendu, l’Ukraine n’est pas un Empire et n’a ni l’ambition ni les moyens de le devenir. Mais elle apprend comment constituer les ressources que la Russie a perdues, forger une ‘asabiyya inscrite dans une dynamique qui se déploie d’elle-même pour ne devenir consciente de ce qu’elle accomplit qu’a posteriori, développer une da’wa présentée et reçue par les démocraties comme universelle, un esprit sacrificiel. Elle sait aussi transformer ses ressources initialement rustiques en outils sophistiqués de guerre, de défense, d’aménagement de territoires et d’axes routiers menacés, d’organisation complexe, hiérarchisée et pourtant encore largement égalitaire de ses forces volontaires.
La Russie post-soviétique n’avait en effet que deux choix, dont le premier était une démocratisation profonde, mieux encore, une refondation démocratique de la société russe. Cela exigeait qu’elle acceptât de s’inscrire dans un temps mélancolique post-impérial pour le transformer en un temps d’avenir, comme ce fut le cas de l’Autriche post-1945. Si cette hypothèse fut écartée dès l’accession de Poutine au poste du Premier ministre en 1999, puis publiquement raillée dans les années 2000-2010, elle n’en reste pas moins la seule qui, demain, lui apportera stabilité et prospérité.
Quant au deuxième choix, il avait déjà été dessiné en 1978, à un moment où rien ne laissait encore présager la chute de l’Empire soviétique, par Alexandre Soljenitsyne lors de son fameux discours de Harvard3. Le poutinisme radicalisa le panslavisme, ce rejet de l’« Occident » autant que de la démocratie qu’exprimait le Prix Nobel de littérature de 1970 et à sa suite une certaine droite radicale russo-soviétique, par des arguments dignes des revanchards de l’Allemagne des années 1920. Faisant fi des réalités de la société russe post-soviétique, il estima que les nations vaincues d’hier seraient les nations vainqueurs de demain. Or on le sait : le désir de revanche sur le passé exprimé dans les années 1920 provoqua la plus grande catastrophe de l’histoire allemande. En outre, contrairement à l’empire wilhelmien, l’empire soviétique ne fut pas vaincu par une guerre : au grand étonnement de tous, il s’éteignit de lui-même pour la simple raison que la Russie, qui en constituait le cœur, n’était plus en mesure de le porter sur ses épaules et avait perdu la capacité de se mentir quant à la supériorité de son modèle sur le système capitaliste, voire, à sa simple viabilité.
Un Empire est une expérience, mais aussi un apprentissage : en se construisant, mieux encore en se désintégrant, il apprend aux autres comment devenir Empire.
Hamit Bozarslan
L’effondrement de 1989-1991 couronna en effet près d’un siècle de perte d’élan : si après sa désastreuse guerre d’Asie en 1905 l’Empire tsariste se restaura, donna même de nombre de signes de prospérité au tournant des années 1910, il fit face ensuite à la Grande guerre suivie de la dramatique année 1917, la Guerre civile d’une rare brutalité et les répressions staliniennes dont la famine de 1933 et la Grande Terreur de 1937-1939 ne constituèrent que les épisodes les plus intenses. La « vie meilleure et plus gaie » que Staline disait déjà advenue en 1934 ne vit jamais le jour ni sous son règne, ni des décennies après sa mort. Il est vrai que la Perestroïka, dont la Glasnost était le prénom, permit une atmosphère euphorique où soudain tout débat devenait légitime, la mémoire refoulée ou réprimée refaisait surface, une projection optimiste dans l’avenir semblait possible. Mais de courte durée, cette ère se saborda d’elle-même. L’effondrement économique et la désintégration sociale généralisée qui marquèrent la décennie eltsinienne furent certes enrayés dans les années 2000, mais la Russie continua à perdre ses forces vives, notamment en termes démographiques. La seule année où l’on put noter une croissance démographique significative fut 2014, lorsque l’annexion de la Crimée créa un effet mécanique d’augmentation de la population.
Nul doute que dans les centres d’« études stratégiques » qui pullulent dans la Russie des années 2000-2020, dans les salles de rédaction que le pouvoir contrôle dans leur quasi-totalité et quelques séminaires de l’Eglise orthodoxe étroitement liés au Kremlin, les « intellectuels organiques » du poutinisme se chauffent à blanc en évoquant un temps russe ontologiquement pur, une « civilisation russe » à l’antipode de la « civilisation corrompue de l’Occident », la « mission historique » qui incombe à la nation russe pour créer le noyau central d’un monde à venir à cheval sur l’Europe et l’Asie. Relayé par les médias jusqu’à la saturation, ce « roman national » supposément entamé depuis un millénaire mais pour l’heure encore inachevé, est sans doute aussi partagé par une partie de la population russe en quête de grandeur historique et d’une revanche sur un Occident imaginaire, qu’on lui désigne depuis des décennies comme l’ennemi.
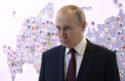
Mais, de retour parmi nous, Ibn Khaldûn aurait constaté avec le brin d’amusement d’empiriste qu’il exprimait toujours avec doigté de son vivant, que cette « idée nationale » peine à se transformer en un « idéal », une force mobilisatrice, moins encore à créer l’esprit sacrificiel poussant les Russes, jeunes et vieux, hommes et femmes, ouvriers et oligarques à se disputer la gloire de mourir le premier pour la patrie. Le problème n’est pas uniquement dans l’illusion selon laquelle l’« Occident », prétendument incapable de défendre sa « virilité », serait mûr pour tomber au premier coup de marteau : les citoyens russes eux-mêmes rechignent à prendre le risque qu’entraine le maniement du marteau pour leurs doigts. La Russie vient à un monde vieux en tant que nation vieillie, qui ne présente rien de nation jeune et « régénératrice » exaltée par le poutinisme. En Russie comme ailleurs, y compris dans les sociétés démocratiques, le renouvellement du monde vieilli ne peut se réaliser que si les « vieux » acceptent de passer la relève à leur jeunesse pour permettre aux dynamiques de la créativité qui existent en elle de s’épanouir. La « régénérescence », s’il faut à tout prix utiliser ce terme si étroitement liée à la syntaxe vitaliste et social-darwiniste des siècles révolus, ne peut être compatible avec la notion de « mission historique », encore moins des visées chiliastiques qui brutalisent le monde et exigent le sacrifice des jeunes. Elle doit également abandonner toute définition ethnocentrée de l’aliénation, appréhendée comme la souillure de la « nation pure » dans et par le contact avec autrui, pour redéfinir cette notion dans la bonne vieille tradition marxienne, à savoir en lien avec l’asservissement des humains par d’autres humains, souvent de sexe masculin.
La Russie vient à un monde vieux en tant que nation vieillie, qui ne présente rien de nation jeune et « régénératrice » exaltée par le poutinisme.
Hamit Bozarslan
Une telle perspective signifie, enfin, de repenser l’universel, et interroger les « paniques identitaires »4 qui se sont emparées jusqu’à de larges secteurs des sociétés démocratiques, non seulement pour les réfuter, mais pour les déconstruire dans leurs prémisses mêmes : la Russie, pas plus que la Chine qui formule les mêmes prétentions dans des termes différents, ou tout autre pays, n’a reçu de « mission historique » à réaliser, moins encore à imposer au reste du monde par la guerre. Pas plus que la Chine, pourtant forte d’atouts reconnus pour exercer sa domination hégémonique à l’échelle mondiale, la Russie ne peut être considérée comme une puissance ascendante du XXIe siècle. N’en déplaise à certaines âmes chagrines, d’une manière parallèle, rien n’indique que l’Europe ou les États-Unis soient dans une phase de décadence, pour la simple raison qu’ils n’ont pas non plus de mission historique à accomplir ou de civilisation à préserver dans sa supposée singularité. Nous y reviendrons : la lutte qui se déroule aujourd’hui en Ukraine, pays européen attaqué par la Russie, puissance également européenne, n’est pas entre l’« Orient » et l’« Occident », le « monde euroasiatique » et le « monde euro-atlantique », mais bien entre la démocratie et l’anti-démocratie, toutes deux nées sur les terres de l’« Occident ».
Le poutinisme : un national-bolchévisme russe
Nous n’analyserons pas ici le poutinisme5, mais il nous semble nécessaire de planter son décor historique, pour insister sur sa visée chiliastique, qui veut briser : « toute relation avec ces phases de l’existence historique qui sont en processus quotidien de devenir parmi nous. Elle tend à tout moment à se changer en hostilité vis-à-vis du monde, sa culture et toutes ses œuvres et accomplissements terrestres et à les considérer comme des satisfactions prématurées d’efforts plus importants qui ne peuvent être intégralement satisfaits que par kaïros »6.
C’est un lieu commun de préciser que, fait de bric et de broc impérial-russe et impérial-soviétique verni d’un langage profondément nationaliste et conservateur qu’on retrouve de l’Amérique de Trump à l’Inde de Modi, le poutinisme n’est pas « une idéologie ». Cette affirmation serait justifiée si par idéologie l’on entendait uniquement une syntaxe structurée en quête de cohérence par la suppression de toute contradiction interne ou polysémie, à l’instar du léninisme sous Staline ou Brejnev, ou de l’islamisme des années 1960-1980. L’éclectisme qui marque effectivement le poutinisme ne signifie pas qu’il n’est pas une idéologie, mais qu’il cherche à produire une lecture lisse de l’histoire de la Russie, à unifier ses mémoires pour faire de cet alpha également son oméga, et charger la nation russe d’une mission impériale débutée par Vladimir, le fondateur, réactivée après bien des luttes externes et trahisons internes, sous et par Vladimir Poutine, le refondateur d’Empire. Cette lecture ne nie pas les fractures internes russes, qu’il s’agisse de l’occidentalisation du XIXe siècle ou du léninisme, mais estime qu’elles n’ont pas pu altérer la pureté ontologique de la nation incarnée par ses tsars des temps de crise ou de grandeur comme Vladimir, Ivan le Terrible, Catherine II ou encore Poutine le « Président ». D’autre part, elle les explique non pas à l’aune de l’histoire interne de la nation russe, mais comme autant de conséquences directes d’une guerre, permanente, frontale ou sournoise, imposée par l’Occident. C’est une lecture national-bolchévique non seulement parce que certains de ses idéologues comme Alexandre Dougine s’en revendiquaient encore récemment, mais surtout parce qu’elle transfère tout un vocabulaire socialiste/bolchevique de la lutte des classes vers la lutte des nations, des civilisations ou des ethnies. Les Russes deviennent une ethno-classe ou une nation-classe, opprimée en tant que nation et en tant que classe par d’autres « ethno-classes », obligée par conséquent de livrer une double lutte d’émancipation.
Chez Poutine, les Russes deviennent une ethno-classe ou une nation-classe, opprimée en tant que nation et en tant que classe par d’autres « ethno-classes », obligée par conséquent de livrer une double lutte d’émancipation.
Hamit Bozarslan
Il importe, avant tout, de récuser avec force une telle lecture : quels qu’aient pu être les liens de soumission que la Russie dut nouer avec les puissances européennes, notamment par les mécanismes d’endettement, la société russe du XIXe siècle ne fut jamais opprimée et exploitée que par son propre pouvoir et, au XXe siècle, pour terrifiante qu’elle ait été en termes d’humiliations, de pertes humaines et de destructions matérielles, la domination nazie ne dura que trois ans. Enfin, au XXIe siècle où elle n’est soumise à aucune puissance extérieure, elle n’est nullement condamnée à avoir la guerre, en interne ou en externe, comme destin. Elle peut, comme toute société qui en fait le choix, devenir démocratique, autrement dit adopter un modèle de société à la fois consensuel pour se doter de repères temporels et spatiaux, d’institutions représentatives et participatives, de modes de constitution et d’alternance des pouvoirs, et dissensuel, pour légitimer, institutionnaliser et négocier ses conflits et clivages internes.
Le pays connut, d’ailleurs, par le passé, quelques brefs moments démocratiques comme le soulèvement de 1905, la Révolution de février 1917, ou la Glasnost des années 1980. Chacun, avec ses limitations, ses contradictions, les impensés qu’il n’a pu surmonter, mais aussi son effervescence intellectuelle, l’élargissement du champ des possibles7, constitue un précieux héritage sur lequel peut se construire la Russie de demain. Analysée dans cette perspective, la guerre d’Ukraine cesse d’être un enjeu géopolitique pour devenir une guerre autour du sens, de la vérité, du choix de la société démocratique dans l’ex-espace soviétique. La Russie est au cœur de cette guerre, et pour parodier Lénine qui estimait que les socialistes européens devaient transformer « 14-18 » en une guerre civile, nous pouvons dire qu’elle a aujourd’hui l’obligation de transformer l’agression lancée contre l’Ukraine en sa bataille de sens et de projets de transformations démocratiques à l’intérieur de ses frontières.
Sources
- Isabelle Mandraud & Julien Théron, Poutine, la stratégie du désordre, Tallandier, 2021, p. 214.
- Pour sa théorie d’Empire, cf. Gabriel Martinez-Gros, Brève histoire des empires. Comment ils surgissent, comment ils s’effondrent, Paris, Seuil, 2014 et notre Le luxe et la violence. Domination et contestation chez Ibn Khaldûn, Paris, CNRS Editions, 2014.
- Pour la version intégrale, cf. « Discours de Harvard, Soljénitsyne, 1978 »
- Cf. Laurence de Cock & Régis Meyran (dir.), Paniques identitaires. Identité(s) et idéologie(s) au prisme des sciences sociales, Paris, Éditions du Croquant, 2017.
- Cf. Michel Eltchaninoff, Dans la tête de Vladimir Poutine, op.cit. et Françoise Thom, Comprendre le poutinisme, Paris, Desclée de Brouwer, 2018.
- Karl Mannheim, Idéologie et utopie, Paris, Marcel Rivière, 1956, p. 167.
- Cf. Guillaume Sauvé, Subir la victoire. Essor et chute de l’intelligentsia libérale en Russie, Paris, EHESS, 2019.


