« Parfois, le langage de la décroissance manque de finesse », une conversation avec Nancy Fraser
Pour comprendre ce que nous voulons comme décroissance, il faut d'abord s'entendre sur ce que nous entendons par la croissance. Dans cet entretien, nous revenons avec Nancy Fraser aux analyses qu'elle développe dans son dernier livre Cannibal Capitalism.
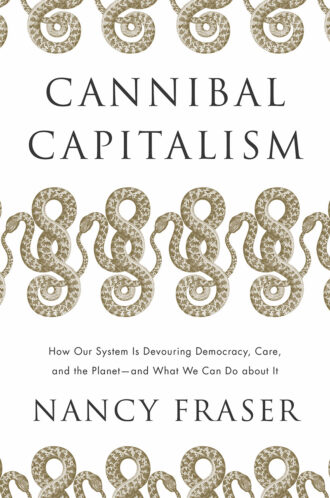
« Le capitalisme est de retour » comme vous le mentionnez au début du premier chapitre de votre ouvrage : qu’est-ce que cela signifie ? Et comment percevez-vous ce retour ?
Ce que je veux dire en premier lieu, c’est simplement que le mot est en très large circulation. Il est sur toutes les lèvres, le sentiment que c’est un problème et qu’il faut en parler est partagé par un certain nombre de personnes. Ce développement est relativement récent dans la mesure où, pendant peut-être 30 ans, le sujet n’était plus discuté aussi largement, à gauche mais pas seulement, qu’auparavant.
Le capitalisme est donc de nouveau à l’ordre du jour. Vous demandez pourquoi ? Je dirais que c’est parce qu’il y a un sentiment répandu que les problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd’hui ne sont pas simplement un ensemble de difficultés déconnectées. Ce qui est en crise, c’est tout un système social dysfonctionnel. Dès lors que nous sentons que le problème provient de tout un ordre social, il est naturel de vouloir le nommer. Il est alors intéressant de noter que de nombreuses personnes ont choisi le terme « capitalisme », même s’ils ne savent pas toujours exactement ce qu’ils entendent par ce terme. L’utilisation de ce mot est certes en partie un symptôme, mais un symptôme qui est réellement prometteur pour comprendre la réalité sociale.
Ce qui est en crise, c’est tout un système social dysfonctionnel. Dès lors que nous sentons que le problème provient de tout un ordre social, il est naturel de vouloir le nommer.
Nancy Fraser
La structure de votre analyse repose sur l’idée que Marx n’est pas allé assez loin dans l’étude de la face cachée du capitalisme : il faut non seulement aller derrière l’échange marchand pour étudier la production, mais encore aller derrière la sphère de production pour voir quelles sont ses conditions de réalisation, d’existence. Pourriez-vous revenir sur cette idée ?
Permettez-moi de commencer par expliquer la motivation politique qui sous-tend ma stratégie théorique. Je suis frappée par le caractère chaotique et dispersé de la scène politique actuelle. Beaucoup de formes d’engagement ont émergé, souvent régressives, réactionnaires mais aussi progressistes et potentiellement émancipatrices. Mais ces dernières sont dispersées, elles ne s’additionnent pas pour former un nouveau sens commun ou une contre-hégémonie. Dans ce contexte, j’ai cherché à développer une théorie qui pourrait aider à surmonter cette dispersion en reliant les différents points. En créant une carte institutionnelle de la société capitaliste, j’ai essayé de montrer que nos problèmes apparemment distincts sont en fait enracinés dans un seul et même système social, que nous devons transformer.
Je débute ma réflexion avec Marx parce que c’est le point de départ évident pour une théorie critique du capitalisme. Marx a été particulièrement perspicace en comprenant et en montrant que l’on ne peut pas comprendre le capitalisme du seul point de vue de l’échange marchand, comme il apparaît initialement dans le bon sens et dans les courants économiques dominants. Je suis d’accord avec lui pour dire que nous devons regarder derrière l’échange marchand, vers ce qu’il appelle la « face cachée » de la production. C’est là, dans l’usine, que la plus-value est générée. Vous ne comprendrez jamais d’où vient le profit si vous vous en tenez au marché. Ce changement de niveau d’analyse, de l’échange à l’exploitation, est la signature de Marx. C’est extrêmement éclairant – mais je considère qu’il ne va pas suffisamment loin.
En créant une carte institutionnelle de la société capitaliste, j’ai essayé de montrer que nos problèmes apparemment distincts sont en fait enracinés dans un seul et même système social, que nous devons transformer.
Nancy Fraser
Pour comprendre pleinement d’où vient la plus-value, nous devons également examiner ce qui rend la production possible. Nous devons regarder derrière la face cachée éclairée par Marx, vers d’autres « demeures » qui sont encore plus cachées. Tout d’abord, d’où viennent les travailleurs ? D’où vient la force de travail ? Il faut regarder les familles, il faut regarder la reproduction, la procréation, l’éducation des enfants, les soins de santé, l’éducation, toutes ces choses qui produisent la force de travail sur laquelle le capital s’appuie.
De même, d’où viennent les matières premières et l’énergie ? Pour comprendre cela, nous devons nous pencher sur la nature et la reproduction de la nature – sur les processus naturels qui assurent (ou non !) l’approvisionnement continu de ces « intrants » matériels et énergétiques et des conditions générales de l’environnement (air respirable, eau potable, climat habitable, etc.) dont dépend également le capital.
Viennent ensuite les pouvoirs publics dont le système dépend également. Je veux parler des capacités réglementaires de l’État, des systèmes juridiques, des forces répressives, des infrastructures et des biens publics. Sans les pouvoirs publics, il ne peut y avoir de production de marchandises ou d’accumulation par l’exploitation.
Enfin, une grande partie de la richesse est essentiellement volée aux populations assujetties, conquises et souvent racialisées de la périphérie et aux minorités racisées du centre, comme aux États-Unis, où l’esclavage a été la « pierre fondatrice », comme l’a dit W.E.B. Dubois, de tout le système industriel. Cet accaparement des richesses est, lui aussi, une condition indispensable de l’accumulation. Derrière la demeure cachée de l’exploitation de Marx se trouve celle encore plus dissimulée de l’expropriation.
C’est l’idée centrale de mon livre : le capitalisme n’est pas le nom d’un système économique mais de quelque chose de plus grand : un ordre social qui institutionnalise une relation contradictoire et perverse entre son sous-système économique et les conditions de possibilité non économiques de ce dernier. La plus-value peut provenir du travail exploité dans l’usine, mais le profit, notion plus large, provient également de l’accès du capital à des formes de richesse – sociale, naturelle, politique – pour lesquelles il ne paie pas et qu’il ne reconstitue pas.
Le capitalisme n’est pas le nom d’un système économique mais de quelque chose de plus grand : un ordre social qui institutionnalise une relation contradictoire et perverse entre son sous-système économique et les conditions de possibilité non économiques de ce dernier.
Nancy Fraser
Avec cette analyse plus approfondie, vous définissez quatre couples de termes, quatre distinctions qui façonnent le capitalisme compris comme une forme de société et qui doivent être pensés dans leur dualité : l’exploitation, par exemple, existe par opposition à l’expropriation, tandis que le travail de production existe par opposition au travail de reproduction, et ainsi de suite. Un système de « frontières » artificielles a dès lors été établi entre ces différents domaines. Alors, comment fonctionne ce système de frontières ?
L’idée générale, comme je viens de le dire, est que le capitalisme est quelque chose de plus grand qu’une certaine forme d’organisation économique : c’est un système social complexe avec des divisions institutionnelles internes. Le système sépare l’économie de la politique, la production de la reproduction, la société de la nature, l’exploitation de l’expropriation. Le résultat, dans chaque cas, est une dualité, comme vous l’avez dit, dans laquelle les termes appariés sont codéfinis, de sorte que chaque terme ne peut être compris que parce qu’il n’est pas l’autre : ils sont co-constitués.
Le capitalisme est le seul système à séparer le lieu du travail rémunéré de l’espace de vie, de la maison, où se déroule une grande partie du travail de care. Cette distinction entre production et reproduction est une distinction sexuée, la sphère de la reproduction étant codée comme féminine alors qu’historiquement, la production économique était codée comme masculine. Aujourd’hui, il y a bien sûr beaucoup de femmes dans le travail salarié, mais leur participation est toujours limitée et affectée par le fait qu’elles ont la responsabilité principale du travail de care, non rémunéré. Le care et le travail sont co-définis comme s’excluant mutuellement, même si en réalité ils sont entremêlés, et le travail de care est une condition préalable nécessaire au travail rémunéré — une condition nécessaire dont le capital use librement, tout en essayant de fuir toute responsabilité, et en ne reconstituant ou en ne réparant pas ce qu’il prend ou ce qu’il endommage.
Le travail de care est une condition préalable nécessaire au travail rémunéré – une condition nécessaire dont le capital use librement, tout en essayant de fuir toute responsabilité
Nancy Fraser
De même, la distinction entre société et nature ne peut être considérée comme acquise.
C’est vrai. Dans la société capitaliste, les relations humaines, y compris les relations productives, sont présentées comme créatives, historiques, impliquant des compétences et un apprentissage. La nature non humaine, en revanche, est censée être simplement répétitive, instinctive, inerte et anhistorique. Il en résulte une division nette entre la nature humaine et la nature non humaine, même si, bien sûr, nous faisons partie de la nature et que celle-ci a elle aussi une histoire.
Loin d’être uniquement de l’ordre de la représentation, cette attitude est institutionnalisée. Le système incite le capital à s’emparer de parties de la nature qui étaient auparavant considérées comme extérieures à l’économie et censées n’appartenir à personne. En conséquence, le capital peut utiliser ces ressources gratuitement ou à moindre coût. Il est exonéré de toute obligation de payer les coûts de reproduction de ce qu’il prend ou de réparer ce qu’il endommage.
Comme vous l’affirmez dans votre livre, la société elle-même est divisée en fonction de ses membres, entre lesquels le capitalisme établit une distinction assez nette.
En effet. Le capitalisme institutionnalise une distinction entre le travail exploité d’une part et le travail exproprié d’autre part. Ceux du premier groupe sont constitués en « citoyens-travailleurs » libres ; ils ont des droits opposables et peuvent demander à leur État de les protéger en cas de violation. En revanche, ceux du second groupe sont des sujets non libres ou dépendants qui n’ont pas de droits opposables et ne bénéficient pas de la protection de l’État ; ayant été asservis, conquis ou colonisés, ils sont vulnérables, même aujourd’hui, aux violations – comme le sont, d’une part, les citoyens postcoloniaux des États faibles ou défaillants et, d’autre part, les minorités racialisées soumises à la violence policière dans les États forts. Dans les deux cas, les personnes en question sont considérées comme expropriables et violables par nature – incapables de fixer des limites à ce que les autres peuvent leur faire.
La violabilité est la signification la plus profonde de l’oppression raciale, à mon avis : être construit comme expropriable, c’est devenir quelqu’un dont la richesse peut être prise, dont la personne peut être blessée, dont le travail et la terre peuvent être saisis sans compensation ni recours.
Cette division, entre le « simplement » exploitable et le carrément expropriable est profondément ancrée dans la société capitaliste, et elle correspond à la ligne « raciale » établie mondialement. C’est pourquoi l’oppression raciale, comme la subordination sexuelle, est une caractéristique non accidentelle de la société capitaliste. Ces deux lignes de faille sont intégrées dans la conception institutionnelle du système.
Ces quatre divisions (économie/politique, production/reproduction, expropriation/exploitation, société/nature non humaine) sont constitutives de la société capitaliste et profondément impliquées dans sa propension à la crise. Il ne peut y avoir d’exploitation rentable sans les matières premières bon marché qui sont fournies par l’expropriation. Il ne peut y avoir de production sans le parasitisme de la nature, du travail et des biens publics fournis par les États. Et pourtant, dans tous les cas, le capital n’admet pas sa dépendance à ces intrants bon marché ou gratuits. Il décline toute responsabilité pour reconstituer ce qu’il prend et réparer ce qu’il endommage. Par conséquent, il s’agit d’un système social très pervers et contradictoire, qui est sujet à des crises majeures.
Être construit comme expropriable, c’est devenir quelqu’un dont la richesse peut être prise, dont la personne peut être blessée, dont le travail et la terre peuvent être saisis sans compensation ni recours.
Nancy Fraser
Ces distinctions, notamment celle entre l’exploitation et l’expropriation, montrent que le capitalisme est inéquitable, injuste, et la justice est, dans votre vision, non pas une vertu mais le fondement des vertus, et des sociétés. Donc, si le capitalisme n’est pas juste dans sa base, il ne peut pas engendrer une société vertueuse. Est-ce correct ?
Absolument. Vous pouvez déjà avoir cette idée en lisant Marx. Certes, il a souvent nié que sa critique était une critique de l’injustice. Pourtant, il n’y a aucun doute que ce qu’il décrit est un système d’injustice de classe, de domination de classe, d’oppression de classe, d’exploitation de classe. Quoi qu’il en soit, je n’ai aucun scrupule à utiliser des catégories normatives telles que l’injustice pour décrire le capitalisme, d’autant plus que mon point de vue met à jour davantage d’injustices intégrées au système. Une fois que vous aurez creusé sous la face cachée de l’injustice de classe, vous trouverez d’autres axes d’injustice – racial/impérial, de genre/sexuel.
Pour moi, cependant, il s’agit de lignes de faille injustes au sein de la classe ouvrière. Même s’il est vrai que la classe ouvrière dans son ensemble est traitée injustement par la classe capitaliste, il existe d’autres axes d’injustice en son sein. Je viens d’expliquer l’axe racial-ethnique. Mais l’injustice de genre est également présente dans le capitalisme, précisément parce qu’il ne sépare pas seulement la reproduction de la production, mais subordonne également la reproduction à la production, tout en assignant le travail reproductif en grande majorité aux femmes. La production est ce qui compte, car c’est ce qui génère le profit final, et donc tout le reste est subordonné à cela.
Le capitalisme consacre donc de multiples formes d’injustice – y compris, aux yeux de certains, l’injustice envers la nature non humaine, ou du moins envers les générations futures d’êtres humains. De mon point de vue, on peut dire qu’il y a deux choses qui ne vont pas avec le capitalisme : premièrement, il est intrinsèquement injuste, et deuxièmement, comme j’ai commencé à le dire auparavant, il est profondément irrationnel, contradictoire, pervers et en proie à des crises, et cela même sans être injuste. Le système a une tendance intrinsèque à cannibaliser la nature et donc à mettre en danger la planète, ainsi qu’à vider les pouvoirs publics de leurs prérogatives et à dévorer nos capacités de reproduction sociale. Même en dehors des inégalités et des injustices, c’est un système profondément dysfonctionnel.
Je n’ai aucun scrupule à utiliser des catégories normatives telles que l’injustice pour décrire le capitalisme, d’autant plus que mon point de vue met à jour davantage d’injustices intégrées au système.
Nancy Fraser
On peut affirmer, en suivant votre raisonnement, que même si la relation entre capitalisme et racisme fluctue, le capitalisme – par le biais de l’expropriation – est structurellement raciste, et l’expropriation est ce qui a rendu l’exploitation – c’est-à-dire le capitalisme – possible. La distinction entre exploitation et expropriation, et donc le racisme dans le capitalisme, est-elle encore un trait distinctif du capitalisme actuel ?
C’est une question importante. J’ai déjà dit que l’appétit du capital pour les intrants bon marché l’incite à exproprier des populations, dans leur travail ou dans leurs terres, qui ne peuvent pas se défendre efficacement. Mais il y a une autre question : l’exploitation et l’expropriation doivent-elles toujours être aussi nettement séparées qu’elles l’ont été dans le passé ? Je dirais que le capitalisme contemporain (néolibéral, financiarisé) estompe ces divisions auparavant nettes.
Il y a encore beaucoup de formes d’expropriation, comme il se doit dans ce système, mais ceux qui en pâtissent ne sont plus exclusivement des personnes racisées soumises et leurs descendants. Sont également inclus des gens qui étaient auparavant « simplement » exploités : les travailleurs citoyens qui perdent aujourd’hui une partie des gains obtenus au cours de la période précédente. Sous le néolibéralisme, ils sont eux aussi soumis à l’expropriation, même s’ils continuent d’être exploités.
Il y a eu, aux États-Unis, un affaiblissement spectaculaire des syndicats. C’est le résultat de la délocalisation de la production vers des régions à bas salaires et du remplacement de la main-d’œuvre syndiquée à salaires élevés par des services précaires à bas salaires. Aujourd’hui, ce ne sont pas seulement les travailleurs racisés, mais aussi les travailleurs blancs dont l’emploi ne paie pas un salaire décent et qui doivent recourir à des niveaux élevés de dettes de consommation qui sont expropriés. Contraints de vivre de la promesse de salaires futurs, ils sont eux aussi expropriés, par la dette.
L’expropriation touche donc maintenant même ceux qui étaient, comme vous le dites, « simplement » exploités avant le néolibéralisme ?
Il semble que l’exploitation devienne plus universelle dans cette forme de capitalisme – et pas seulement dans le noyau historique, mais aussi dans la semi-périphérie des pays développés. Avec la délocalisation de la production vers ce que l’on pourrait appeler la post-colonie, beaucoup de travailleurs font maintenant du travail d’usine exploité.
Pourtant, ils n’ont pas échappé à l’expropriation car ils sont eux aussi soumis à l’expropriation par la dette. Ici, la dette est à la fois « souveraine » et personnelle, car les États postcoloniaux sont obligés de consacrer des sommes toujours plus importantes au paiement des intérêts aux institutions financières internationales et aux banques privées. Cette fuite massive des richesses est une forme néoimpériale d’expropriation.
Nous sommes donc confrontés à une situation où les deux populations (les exploités et les expropriés) ne se distinguent plus aussi nettement qu’avant.
Nancy Fraser
Nous sommes donc confrontés à une situation où les deux populations (les exploités et les expropriés) ne se distinguent plus aussi nettement qu’avant. Cela pourrait amener à penser que l’oppression raciale diminue, alors qu’en fait les antagonismes raciaux augmentent. Subjectivement, ceux qui étaient « simplement » exploités vivent leurs pertes (en termes de salaire, de sécurité et de statut) à travers un prisme paranoïaque ; ils craignent de « tomber » dans la condition dégradée qu’ils associaient aux populations racisées, voire d’être « remplacés » par ces dernières. C’est là qu’ils puisent de très mauvaises idées dans les mouvements populistes de droite, qui les encouragent à rejeter la responsabilité de leurs problèmes sur les personnes racisées qui « prennent » leur emploi et leurs prestations sociales.
Ainsi, une situation objective plus floue entraîne une intensification de l’antagonisme subjectif. Ce dont nous avons besoin, à mon avis, c’est d’une gauche qui présente un compte rendu clair et convaincant de la cause réelle du déclin de la classe ouvrière, un compte rendu qui explique pourquoi ces individus ont beaucoup plus à gagner qu’à perdre en s’alliant aux personnes qu’elles désignent aujourd’hui comme boucs émissaires.
Pour revenir plus en détail sur la deuxième distinction établie artificiellement, le capitalisme a également besoin d’une reproduction sociale externe, dans un sens large, à savoir le travail du care, pour fonctionner, mais il le cannibalise également, et historiquement, ce domaine a été un site majeur de la crise capitaliste.
On a pu le constater au début du capitalisme industriel du XIXe siècle, qui a essentiellement poussé les personnes nouvellement prolétarisées, y compris les femmes et les enfants, dans les usines et les mines. Il les faisait travailler de longues heures dans des conditions très dangereuses, ce qui rendait impossible le maintien d’une vie familiale. En effet, le capital partait du principe qu’il n’avait pas à se soucier de la capacité de la main-d’œuvre existante à se reproduire. Il pouvait toujours en obtenir davantage de l’« extérieur », en particulier des anciens usagers et des paysans dépossédés.
Le résultat a été une grave crise de la reproduction sociale, qui a également provoqué une panique morale. Les classes moyennes de l’Angleterre victorienne ont été scandalisées par le fait que les femmes de la classe ouvrière devenaient « masculinisées » et/ou corrompues. Pour trouver une solution sociale, il a fallu des décennies de lutte sociale, qui ont abouti à l’invention d’une nouvelle forme de capitalisme : le capitalisme géré par l’État, le capitalisme social-démocratique ou le New Deal. Dans ce régime, les États des pays riches ont assumé une certaine responsabilité publique pour assurer la reproduction sociale de la classe ouvrière. Ils réglementent le travail, acceptent la syndicalisation, fournissent des services sociaux et des droits publics, et taxent les entreprises pour les financer. Sans l’éliminer complètement, ils ont fixé certaines limites à la capacité du capital à cannibaliser la reproduction sociale.
Cette solution qui, comme vous le dites, dépendait de la prédation impériale, a fonctionné pendant un certain temps, mais vous affirmez qu’il existe aujourd’hui une nouvelle crise de la reproduction sociale, dans le néolibéralisme. Comment fonctionne cette nouvelle forme de cannibalisation ?
Oui, cette solution reposait sur le drainage continu de la richesse impériale ainsi que sur le drainage de la richesse de la nature sous la forme d’une production industrielle alimentée par des combustibles fossiles – c’était, après tout, l’ère de l’automobile. Mais ce régime injuste et insoutenable a maintenant cédé la place à quelque chose qui est sans doute pire. La néolibéralisation du système a intensifié la contradiction inhérente au capitalisme : la contradiction liée à la reproduction sociale. Comme l’économie des services a réduit les salaires, il devient de plus en plus impossible de faire vivre un ménage avec un seul salaire ; il faut augmenter le nombre d’heures de travail rémunéré par ménage. Les femmes sont de plus en plus nombreuses à entrer sur le marché du travail, au moment même où les États réduisent les services sociaux. Il en résulte une « pénurie de soins » aiguë, le système se déchargeant du travail de soins, du care sur les familles et les communautés tout en réquisitionnant le temps et l’énergie de ceux qui l’ont toujours effectué. Donc, oui, nous vivons une nouvelle crise de la reproduction sociale.
Ce régime injuste et insoutenable a maintenant cédé la place à quelque chose qui est sans doute pire. La néolibéralisation du système a intensifié la contradiction inhérente au capitalisme : la contradiction liée à la reproduction sociale.
Nancy Fraser
La pandémie de Covid a vraiment mis cela en lumière. Nous avons vu la quantité de travail reproductif nécessaire pour faire fonctionner une société à un moment où les gens étaient enfermés. Et cela a rendu la dimension de genre de cette crise très visible.
C’est pourquoi nous voyons tant de luttes sociales, de conflits sociaux autour de questions comme les soins de santé, les soins aux enfants, les soins aux personnes âgées et les écoles. Historiquement, une part considérable du travail social et reproductif se fait en dehors des ménages privés – dans les communautés, les villages, les institutions publiques. Aujourd’hui, une part de plus en plus importante de ce travail est effectuée dans des entreprises à but lucratif. Le paysage actuel de la reproduction sociale est très inégal. Il est différencié et divisé de manière tout à fait dysfonctionnelle.
Pour parler davantage de la reproduction sociale et de son aspect sexué, nous pourrions revenir à l’analyse que vous faites de la deuxième vague du féminisme. Dans Fortunes of feminism, vous affirmez qu’il pourrait y avoir une sorte d’affinité élective entre la deuxième vague du féminisme et le néolibéralisme. D’où vous vient cette idée ?
J’ai été influencée par le livre de Luc Boltanski et Eve Chiapello, Le nouvel esprit du capitalisme. Ils s’appuient sur l’idée de Max Weber selon laquelle la transition vers le capitalisme exigeait quelque chose de plus que la cupidité, un « esprit » ou une vision du monde significative et motivante qui incite les gens à quitter leur monde de vie traditionnel familier pour ce que Marx appelait « les eaux glacées du calcul égoïste ».
Weber a soutenu que l’ « esprit du capitalisme » originel consistait dans l’idée d’un travail discipliné dans une vocation, comme un moyen d’apaiser l’horrible anxiété qui accompagne la doctrine calviniste de la prédestination. Boltanski et Chiapello confirment l’affirmation de Weber selon laquelle le capitalisme n’aurait pas pu décoller sans un tel « esprit », tout en rejetant son point de vue selon lequel, une fois établi, il continuerait à fonctionner en pilote automatique, dépourvu de sens, enfermant ses sujets dans une « cage de fer ». Pour eux, le système a toujours besoin d’un esprit lors de ses crises périodiques, lorsque quelque chose doit céder, et qu’une masse critique de personnes doit faire le saut — vers une nouvelle forme de capitalisme, ou peut-être vers autre chose. Ce fut le cas, disent-ils, dans les années 1960, lorsqu’une importante couche de la population a été incitée à rejeter la social-démocratie au profit du néolibéralisme. Boltanski et Chiapello affirment de manière surprenante que ce qui a fourni le « nouvel esprit » nécessaire était la « critique artistique » de la Nouvelle Gauche. C’est l’idéal de la Nouvelle Gauche de libération personnelle des institutions bureaucratiques qui a conféré au projet néolibéral le charisme ou l’« excitation » nécessaire.
Le système a toujours besoin d’un esprit lors de ses crises périodiques, lorsque quelque chose doit céder, et qu’une masse critique de personnes doit faire le saut — vers une nouvelle forme de capitalisme, ou peut-être vers autre chose.
Nancy Fraser
Je pense que c’est juste, mais il y a une autre partie de l’histoire, plus cachée, qui concerne le féminisme.
Alors, que signifie cette « affinité élective » plus particulière entre seconde vague du féminisme et néolibéralisme ?
Les féministes de la deuxième vague reprochaient à la social-démocratie d’ancrer la dépendance des femmes. Elles rejetaient le modèle familial de l’homme en tant que soutien de famille et de la femme au foyer, qu’elles jugeaient inégalitaire, ce qui était bien sûr le cas. Mais cette critique s’inscrivait dans le cadre du projet néolibéral visant à libérer les entreprises de la réglementation et de la fiscalité de l’État.
Les néolibéraux ont également rejeté l’idéal du salaire familial, mais pour des raisons différentes. Ils voulaient recruter des femmes dans la population active et faire baisser les salaires en général. Ainsi, les deux critiques ont convergé vers un nouvel idéal de la famille à deux revenus. Cet idéal a été légitimé non pas parce que « la cupidité est bonne », mais parce qu’il portait le charisme du féminisme. Ce dernier a également contribué au « nouvel esprit » qui a guidé la transition vers le capitalisme néolibéral. Il en a résulté un nouveau bloc politique, que j’ai appelé le néolibéralisme progressif, qui a associé une redistribution très régressive des richesses vers le haut aux courants libéraux des mouvements sociaux progressistes – féminisme libéral, antiracisme libéral et écologisme libéral.
Quand je parle de féminisme libéral, j’entends le féminisme « brisez le plafond de verre » « en avant toutes » : faire en sorte que quelques femmes deviennent PDG de grandes entreprises, généraux cinq étoiles dans l’armée, cheffe du Fonds monétaire international. Mais d’autres mouvements sociaux sont également impliqués – par exemple, les courants antiracistes qui s’efforcent de placer des « visages noirs dans les hautes sphères », alors même que les conditions de vie se détériorent pour l’écrasante majorité des personnes noires. Il en va de même pour le « capitalisme vert ».
Nous sommes donc, comme vous le soutenez dans ce livre ainsi que dans The Old Is Dying and the New Cannot Be Born, dans un « interrègne » : pouvez-vous expliquer en quoi il consiste ? Il semble que les « phénomènes morbides », comme le dit Gramsci, s’accumulent ces dernières années — la montée du populisme d’extrême droite, le Covid, … — et que le « néolibéralisme progressiste » ne fera pas partie de la solution.
Je m’appuie ici sur la pensée d’Antonio Gramsci et sur l’idée que l’histoire du capitalisme est une série de différents régimes d’accumulation ponctués de crises. Ces crises ont été résolues, jusqu’à présent du moins, par l’invention et la mise en œuvre d’une nouvelle forme de capitalisme.
Il n’y a eu, à mon avis, qu’un petit nombre de ces crises majeures et générales, c’est-à-dire des crises de toutes les dimensions dont j’ai parlé, entrelacées et s’exacerbant les unes les autres.
Lorsque les efforts déployés par les régimes précédents pour atténuer les contradictions perdent de leur force et que la gravité de la crise devient apparente pour certaines masses critiques de personnes, on commence à assister à des défections massives du bon sens dominant, des partis politiques établis, des projets politiques dominants. Les dirigeants et les citoyens sont donc à la recherche d’idées originales. Lorsque cela se produit, les gens peuvent soit regarder en arrière, soit aller de l’avant.
Ce sont des périodes très chaotiques. Il n’y a pas de sens commun partagé, il n’y a pas d’hégémonie sûre mais une course folle entre des propositions rivales, des forces rivales, des partis rivaux, des blocs rivaux qui tentent de construire une nouvelle hégémonie ou une contre-hégémonie généralisée. Aujourd’hui, deux concurrents s’affrontent : le populisme réactionnaire d’un côté et le néolibéralisme progressiste, ou du moins ce qu’il en reste, de l’autre.
Aujourd’hui, deux concurrents s’affrontent : le populisme réactionnaire d’un côté et le néolibéralisme progressiste, ou du moins ce qu’il en reste, de l’autre.
Nancy Fraser
En France, c’est Le Pen contre Macron, par exemple. Pour nous, c’est Biden contre, si ce n’est Trump lui-même, le Trumpisme, et nous obtenons ces polarisations intenses où rien n’est suffisamment convaincant pour qu’un bloc l’emporte vraiment. Je pense que c’est la situation dans laquelle nous sommes actuellement et c’est effectivement une situation avec beaucoup de symptômes morbides.
Y a-t-il, malgré tout, des contre-propositions convaincantes de la gauche à l’œuvre aujourd’hui ?
Il y a un espoir dans le phénomène Sanders et dans tous les mouvements qui l’entourent, dans lesquels j’inclurais Black Lives Matter, Me Too, et ce nouveau mouvement de syndicalisation très intéressant qui essaie de syndiquer les travailleurs que les syndicats, dans le passé, considéraient comme inorganisables ou ne valant pas leur temps – les travailleurs de Starbucks, d’Amazon, d’Apple, dans la distribution ou la restauration rapide. Le problème pour moi est de savoir comment rassembler ces forces potentiellement émancipatrices qui sont maintenant dispersées et fragmentées. Sanders a essayé de les rassembler et l’a fait de manière impressionnante pendant un certain temps, mais cela s’est essoufflé.
Par conséquent, je pense qu’un populisme progressiste pourrait être une troisième alternative, même si je tiens à préciser que je ne me considère pas comme populiste mais comme socialiste démocratique. Je suis un peu en décalage par rapport à quelqu’un comme Chantal Mouffe dont j’admire le travail mais avec qui je ne suis pas toujours d’accord. Mon idée est que le populisme progressiste est une sorte de point d’entrée facilement accessible dans une politique potentiellement émancipatrice dans un moment comme celui-ci. Mais si les choses se passent bien, il devrait évoluer.
Le problème pour moi est de savoir comment rassembler ces forces potentiellement émancipatrices qui sont maintenant dispersées et fragmentées.
Nancy Fraser
Comme vous le dites, les mouvements verts devraient devenir trans-environnementaux : le capitalisme, structurellement et historiquement, est opposé à l’écologie, et l’innovation ne sauvera pas le capitalisme. Un système contre-hégémonique doit donc être construit pour rassembler toutes les luttes, qui ne peuvent et ne doivent pas être confinées à une seule des sphères que nous avons distinguées précédemment.
L’idée est en effet de dépasser l’idée d’un mouvement tendu vers un seul but, un mouvement écologiste autonome qui, d’une certaine manière, n’aurait pratiquement rien à voir avec les autres grandes luttes sociales de notre époque.
J’ai été influencé il y a de nombreuses années par le travail du penseur catalan Juan Martinez-Alier sur l’environnement. Ce dernier a écrit un livre intitulé L’écologisme des pauvres où il établit une distinction nette entre ce que nous pourrions appeler, d’une part, l’écologisme des riches, qui consiste en un effort de protection de la nature sauvage et qui n’est pas lié aux autres grandes questions, et, d’autre part, l’ « écologisme des pauvres », qui concerne les communautés qui luttent pour préserver leur habitat, mais d’une manière qui est profondément liée à leur reproduction sociale, à leur forme de vie en général.
Un autre phénomène fondamental est la nouvelle importance de la problématique du racisme environnemental. Les impacts du réchauffement planétaire ne sont pas répartis de manière égale entre tous les habitants de la planète, mais frappent avec une sévérité particulière les communautés racialisées dont les espaces de vie ont été traités comme des décharges toxiques pour toutes sortes d’ « externalités », comme on les a dénommées.
Il s’agit d’une question environnementale, mais aussi d’une question de justice sociale et d’une question de race, et vous ne pouvez pas séparer ces différents aspects. Les partisans d’un New Deal vert ont, dans une certaine mesure, saisi cet entremêlement. Ils essaient d’être trans-environnementaux. La question de savoir si leurs programmes exacts sont les bons est une autre question, et certaines de leurs spécificités pourraient ne pas être totalement adéquates. Mais l’intuition est bonne, notamment dans l’idée que l’effort de transition vers des sources d’énergie renouvelables et durables est potentiellement un grand créateur d’emplois. Dans un sens, ils essaient de répondre aux préoccupations des communautés de la classe ouvrière qui ont pu être hésitantes face aux politiques écologiques, craignant que cela ne signifie s’opposer au développement et donc coûter des emplois.
Je pense qu’il faut dépasser l’idée que l’écologie est en contradiction avec les efforts visant à améliorer la qualité et le niveau de vie des gens. Si vous traitez l’environnement comme une question à enjeu unique, vous pratiquerez nécessairement l’ « environnementalisme des riches ». Vous vous aliénerez nécessairement tous les mouvements sociaux des « pauvres », de la classe ouvrière, des personnes racisées et des mouvements féministes. Le climat n’est pas toujours au sommet de leur agenda, ou pas de la même manière : les Noirs aux États-Unis peuvent penser que la violence policière est leur problème le plus important, et, à vrai dire, qui peut dire le contraire ? Mon but est d’arrêter d’établir des distinctions aussi tranchées.
Il faut dépasser l’idée que l’écologie est en contradiction avec les efforts visant à améliorer la qualité et le niveau de vie des gens.
Nancy Fraser
En disant que l’éco-politique doit aussi être anticapitaliste, je dis qu’il faut aborder ces différentes préoccupations ensemble. La dynamique de cannibalisation inhérente au capitalisme est le fil conducteur qui relie toutes les questions que j’ai mentionnées.
Qu’est-ce que le socialisme ? Vous affirmez que nous devons politiser ce qui est considéré, dans le capitalisme, comme strictement économique : la production essentiellement. Mais vous affirmez aussi que les marchés ne disparaîtront pas. Comme vous le formulez : « pas de marchés au sommet ou à la base, mais des marchés dans l’ « entre-deux » » : qu’est-ce que cela signifie ?
Je m’inspire de certaines idées de Karl Polanyi, qui a fait remarquer que les marchés ont existé tout au long de l’histoire de l’humanité, sous toutes sortes de formes différentes, partout dans le monde.
Ce que nous voulons faire, c’est désactiver les caractéristiques destructrices des marchés capitalistes ou des marchés dans le capitalisme, sans détruire les marchés en général, qui sont des institutions humaines utiles. Deux choses sont à mon avis problématiques dans le capitalisme : les marchés ne se contentent pas de distribuer des biens entre les gens, ils servent également à allouer les principaux investissements sociétaux et, en ce sens, à dicter presque toute la trajectoire du développement sociétal.
Les combustibles fossiles en sont un bon exemple. Dès le début du XIXème siècle, les entrepreneurs motivés par le profit ont compris que le remplacement de l’énergie hydraulique gratuite par le charbon serait plus rentable pour eux à long terme, car ils pourraient concentrer davantage de travailleurs dans les villes, n’ayant plus besoin d’être à la campagne. Elles pouvaient donc faire respecter la discipline du travail plus efficacement et payer moins les travailleurs. Les coûts des différents intrants ont dicté cette énorme transition vers la production de combustibles fossiles. Aujourd’hui encore, le coût caché de la production fossile joue un rôle dans les calculs des coûts relatifs des différentes sources d’énergie.
Les calculs de rentabilité des marchés des intrants déterminent toute l’orientation du développement de la société. Les décisions sur ce qu’il faut produire, combien il faut produire, comment il faut produire, sur quelles formes de relations sociales nous privilégions ont été retirées des mains du corps collectif, des producteurs réels. Et ces décisions ont été confiées aux soi-disant marchés autorégulateurs, qui, soit dit en passant, sont une fiction.
Au sommet, donc, la question est de savoir ce qu’il faut faire avec le surplus social que nous produisons collectivement. Le « surplus » dont je parle est la richesse dont nous disposons et que le capitalisme a privatisée et remis à un petit nombre de personnes qui ne pensent qu’à leur propre profit. Nous devons récupérer notre surplus collectif en tant que richesse collectée et démocratiser la prise de décision sur ce qu’il faut en faire.
Désactiver les caractéristiques destructrices des marchés capitalistes ou des marchés dans le capitalisme, sans détruire les marchés en général, qui sont des institutions humaines utiles.
Nancy Fraser
Finalement, « à la base », pourquoi supprimer les marchés ? Et pourquoi en garder dans cet « entre-deux » que vous évoquez ?
Le fond du problème est cette grande question des besoins fondamentaux. L’un des slogans importants des campagnes de Bernie Sanders aux États-Unis était : les soins de santé sont un droit fondamental et il devrait en être de même pour le logement, l’accès à des aliments nutritifs et produits de manière durable, l’eau potable… Ces biens ne devraient pas être produits et vendus par des entreprises privées et à but lucratif. Ce sont des biens publics.
Nous ne devrions pas avoir de marchés, de marchandises pour ce qui constitue la base de nos sociétés et nous ne devrions pas avoir de direction de marché pour le développement sociétal et l’allocation des surplus au sommet de l’échelle. Cela laisse beaucoup d’espace entre les deux, et ici je vois cet espace intermédiaire comme un espace pour diverses formes d’expériences.
Il pourrait y avoir des petites entreprises privées, coopératives, toutes sortes de formes d’organisation différentes. L’essentiel est de ne pas permettre à la concurrence qui peut exister entre elles de s’intensifier au point que les gagnants empochent des bénéfices tels qu’ils commencent ensuite à empiéter sur le haut ou le bas de l’échelle. D’où l’importance de la réglementation, avec, par exemple, des taux élevés sur les bénéfices des entreprises privées.
C’est une façon très provisoire et exploratoire de penser le socialisme. Mais je pense que cette idée capture quelque chose d’essentiel et qu’elle est compatible avec l’idée générale consistant dans le fait que le socialisme ne consiste pas seulement à réorganiser le système économique, mais aussi à réorganiser la relation entre ce qui survit encore en tant que système économique et la famille, la vie communautaire, la reproduction naturelle et sociale et la constitution du pouvoir public.
Il s’ensuit que vous ne souscrivez pas à l’idée de décroissance telle qu’elle est souvent formulée. En fait, vous parlez, dans Capitalism : A Conversation in Critical Theory de « post-croissance » : ce que nous produisons, ce que signifie la croissance et, par extension, ce que signifie l’« industrie », par exemple, doivent être remis en question et ne peuvent être simplement balayés.
Il y a des penseurs de la décroissance qui en ont une conception très sophistiquée, et qui comprennent alors mon point de vue. Cependant, dans le discours plus large et moins élaboré de la décroissance, il me semble qu’il y a parfois une confusion sur ce que nous entendons par croissance et donc par décroissance. Parfois, l’idée est que nous devons simplement produire moins de choses, que nous devons réduire le « rendement matériel », comme diraient les scientifiques. Je ne suis pas sûre que ce soit exactement ce dont nous avons besoin.
Je dirais que la chose la plus importante que nous devons faire est de réduire significativement le capital. Ce qui doit croître dans le capitalisme, c’est le capital, c’est la valeur, qui est cette chose métaphysique, cette valeur mystérieuse, toujours en mouvement. La croissance du capital ne nécessite pas beaucoup de capacités physiques. Par conséquent, il se peut que nous soyons dans une situation où nous sous-produisons les choses auxquelles on pourrait attribuer ce que Marx appellerait une valeur d’usage : le logement, les médicaments, les aliments nutritifs, qui sont produits de manière durable.
Il y a des penseurs de la décroissance qui en ont une conception très sophistiquée, et qui comprennent mon point de vue. Mais dans un certain discours plus large et moins élaboré de la décroissance, il me semble qu’il y a parfois une confusion sur ce que nous entendons par croissance et donc par décroissance.
Nancy Fraser
Le capital croît, mais la quantité des besoins de base non satisfaits dans le monde est stupéfiante et augmente en partie à cause du réchauffement planétaire.
Je pense donc que le socialisme a besoin d’une politique écologique socialiste. Nous devons faire comprendre qu’il y a des choses dont nous avons besoin en plus grande quantité et qui nécessiteront une augmentation de la production. Ce que nous voulons absolument minimiser, voire éliminer, c’est la croissance de cette substance abstraite et métaphysique qu’est la valeur, qui constitue l’objectif de l’accumulation du capital.
Il s’agit de savoir comment nous produisons cette substance, sur quelle base énergétique, avec quelle relation à la nature. L’état actuel du monde capitaliste est tel que s’il devait y avoir une transition vers une forme démocratique souhaitable de socialisme, nous nous retrouverions avec d’énormes quantités de besoins non satisfaits et de dommages qui doivent être réparés de toute urgence. Cela va nécessiter un travail intense, de créativité et d’intelligence, et, oui, de production, mais sur une base complètement différente. Je pense donc que, parfois, le langage de la décroissance manque de finesse.

