« L’Europe est une succession de transgressions », une conversation avec Olivier Guez
Publié chez Grasset en février 2022, Le Grand Tour réunit les voix de vingt-sept écrivains européens, qui racontent le continent depuis leurs lieux familiers et leurs mythologies personnelles. Olivier Guez revient sur les prémisses, les ambitions et l’avenir de ce projet qu’il a conçu et dirigé.
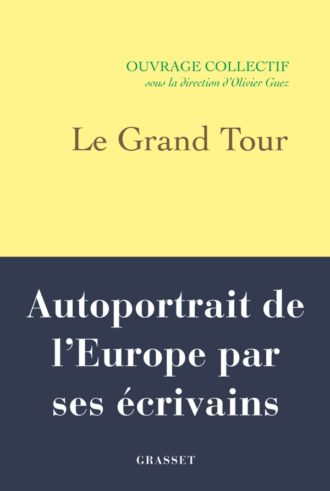
Comment est né le projet du Grand Tour ?
À l’automne 2020, je suis allé voir le Secrétaire d’État aux Affaires européennes, Clément Beaune. J’avais en tête un congrès sur la culture européenne, à mi-chemin entre les congrès anti-fascistes du milieu des années 1930 et le Congrès de La Haye en 1948. On sent depuis des années que l’Europe est de plus en plus cernée par la Russie, la Turquie d’Erdogan, un islamisme hostile, une Amérique qui regarde ailleurs. Les Européens avaient des questions et des difficultés à exprimer dès avant la crise ukrainienne.
Dans le cadre de la Présidence française de l’Union européenne, l’idée a émergé d’en faire un livre. J’ai alors pensé à cette idée du lieu. Il ne s’agissait pas de reproduire les Lieux de mémoire de Pierre Nora (Gallimard, 1993), mais plutôt de raconter des lieux de vie qui évoquent la culture et l’histoire européennes, en faisant confiance aux auteurs pour raconter un lieu de leur pays, et évoque la mémoire ou la culture européenne de manière personnelle. Il a fallu réunir un budget important, car les bons auteurs doivent être (bien) payés, les traducteurs aussi.
À la mi-juillet 2021, les vingt-sept noms étaient réunis. J’en connaissais certains, comme le Roumain Norman Manea dont je suis très proche, Maylis de Kerangal ou la Polonaise Agata Tuszyńska. Il y en a d’autres dont j’avais lu les livres et que j’admirais, comme Daniel Kehlmann, Sofia Oksanen, Jan Broken ou László Krasznahorkai. D’autres enfin que je connaissais de réputation, ou que les services culturels des ambassades m’ont aidé à repérer. Tous ont montré beaucoup d’enthousiasme. Les auteurs avaient deux mois pour écrire leurs textes, les traducteurs trois semaines et moi un petit mois pour éditer l’ensemble.
Qu’est-ce qui se dégage du recueil de ces textes, de cette géographie intime des lieux européens ?
L’irruption de la guerre en Ukraine est intéressante, car dans Le Grand Tour, qui a été écrit avant, on note clairement une démarcation entre l’Est et l’Ouest. L’empreinte de l’Histoire est beaucoup plus fraîche en Europe orientale. Tous les textes des anciens pays sous domination soviétique ont trait soit à l’extermination des juifs, soit à la mémoire encore brûlante du communisme, ce qui n’est pas du tout le cas des textes d’Europe de l’Ouest.
À la différence d’un conseil européen, où l’on entend d’abord les voix française et allemande, ici les voix sont représentées à part égale, et on entend davantage l’Europe de l’Est dont les textes sont très forts. Ce sont des textes dominés par la tristesse, la mélancolie, l’humour aussi. Devant le monstre de l’Histoire, les écrivains d’Europe centrale se sont toujours sauvés par l’ironie. Je pense notamment au texte de Jānis Joņevs (Lettonie), un texte très picaresque où l’on retrouve ce ton venu de la Mitteleuropa, le même que dans certains livres de Kundera ou dans les premiers films de Kusturica. C’est une distance à l’histoire qui permet de survivre.
L’irruption de la guerre en Ukraine est intéressante, car dans Le Grand Tour, qui a été écrit avant, on note clairement une démarcation entre l’Est et l’Ouest. L’empreinte de l’Histoire est beaucoup plus fraîche en Europe orientale.
Olivier Guez
À l’inverse, je ne vois pas de césure Nord-Sud, si ce n’est que les écrivains « sudistes » du recueil réfléchissent à certains thèmes : l’Italienne Rosella Postorino revient sur le fascisme, la Portugaise Lídia Jorge sur l’esclavage, le Maltais Immanuel Mifsud sur les migrants. L’Histoire a ici aussi une emprise.
Beaucoup d’auteurs revisitent les lieux communs européens, notamment ce qui fait l’identité du continent, ce qui marque les non-Européens quand ils viennent chez nous : la grand-place, la gare, la station balnéaire, les sites archéologiques, la sociabilité des cafés, les colonies d’artistes.
La guerre en Ukraine change la donne. Une causalité unique bouleverse l’Europe et les Européens de la même façon de la Finlande au Portugal : c’est une situation inédite depuis la chute du Mur, voire depuis la Seconde Guerre mondiale, créant une communauté de destins qui transcendent les césures entre l’Est et l’Ouest. Pour l’instant. Nous verrons combien de temps les Européens, notamment à l’Ouest, resteront solidaires des Ukrainiens. Si je recommençais ce projet aujourd’hui, je serais très curieux de voir ce que les auteurs écriraient. L’Ukraine aurait sans aucun doute une place chez presque tous. L’Histoire s’est remise en marche, et la littérature en sera l’écho.
Beaucoup de textes du Grand Tour se caractérisent par un rapport mélancolique au passé. Pour évoquer littérairement l’Europe, est-on condamné à regretter le monde d’hier ?
Milan Kundera dit qu’être Européen, c’est être nostalgique. Mais là, il me semble qu’un nouveau chapitre s’ouvre.
Au fond, depuis 1945 – et peut-être que cela a pris fin en 2022 –, l’Europe essaie de se remettre de la deuxième Guerre de Trente ans. Ce qu’on entend par « Europe » a disparu en 1914. Entre 14 et 45, les Européens se sont suicidés. Donc bien sûr, l’évocation de l’Europe implique toujours une nostalgie.
Si on relit Le Monde d’hier, en quoi consistait l’idée d’Europe ? Elle semble résider dans un certain cosmopolitisme, des échanges, une fluidité entre les hommes et les cultures, une histoire des arts pan-européenne. La meilleure définition que je connaisse est celle de Krzysztof Pomian, qui dit que l’Europe, c’est la culture de la transgression. Transgresser le paganisme avec le christianisme, transgresser le catholicisme avec le protestantisme, transgresser les dogmes religieux avec la Renaissance puis surtout les Lumières, transgresser avec les sciences, transgresser les cultures des autres à partir des grandes Découvertes : l’Europe est une succession de transgressions, jusqu’à l’apocalypse de 1914-1945.
Après les grands massacres, on a voulu se rassurer, en recommençant la reconstruction européenne avec un projet économique, technocratique et juridique. Cette reconstruction a été conçue précisément pour éviter l’affect. Je recommencerais par la culture, fait-on dire à Jean Monnet dans une phrase apocryphe : mais cela n’était justement pas possible. Il n’y avait plus de culture européenne après 1945. Elle était honteuse et avait abouti à Auschwitz, au néant absolu. Le projet de construction technocratique avait donc sa logique, et il était intelligent. Les vrais Européens, les cosmopolites, ne pouvaient évidemment qu’être déçus.
Le rapport à l’Europe passe aussi toujours par une forme de romantisme. Tous les pro-Européens ont cette vision presque adolescente d’une Europe sans passeports, d’artistes qui parlent 4 ou 5 langues, qui ont étudié à Munich, à Cracovie, à Vienne… Cette imagerie porte avec elle un certain nombre de clichés. Il ne s’agit pas non plus de l’idéaliser. Car cette Europe a aussi été la matrice des pires atrocités commises au vingtième siècle.
Le projet de construction technocratique avait donc sa logique, et il était intelligent. Les vrais Européens, les cosmopolites, ne pouvaient évidemment qu’être déçus.
Olivier Guez
En évoquant la tradition du Grand Tour de la fin du XVIIIe siècle, réactivez-vous une posture aristocratique face à l’Europe ?
Non. Du Grand Tour, je retiens l’idée d’initiation, d’un voyage à découverte d’une autre culture. Notre Grand Tour propose aux lecteurs de partir à la découverte de la littérature européenne contemporaine. Il s’adresse à tous les esprits curieux.
L’une des vertus et l’une des horreurs de la mondialisation des 30 dernières années, c’est notamment le développement des low costs et du tourisme de masse. Les Européens bougent énormément. Ils partent en week-end à Riga ou à Barcelone. L’accès à l’Europe n’est plus quelque chose d’aristocratique. Pourtant, cela reste parfois du domaine de l’ailleurs. De ce côté-là, les médias ont une importante responsabilité, dans la mesure où l’on présente encore l’Europe comme une terre étrangère. Pourquoi la météo s’arrête-t-elle aux frontières de la France ? Moi qui ai grandi à Strasbourg, il m’était plus utile de savoir quel temps il faisait à Stuttgart qu’à Toulouse. On a l’impression que l’Europe conserve cette dimension d’inaccessible, au-delà de frontières bien identifiées, alors que cela ne reflète pas la réalité du rapport à l’Europe pour un très grand nombre de personnes.
Ensuite, on confond toujours Union européenne et Europe. Quelque chose comme l’Eurovision a une dimension continentale, c’est une fête partout en Europe. Il en va de même pour les grandes compétitions de football : c’est comme ça qu’on apprend la géographie enfant, une géographie passionnée. L’Union européenne, au contraire, a mis de côté l’affect. Mais je pense que tout ça est en train de changer. La guerre change nos états d’esprit. Au fond, cette guerre dément toutes les inepties racontées par les souverainistes pendant des années.
Toutefois, je pense que l’UE ne s’est jamais remise du projet de départ, qui était vraiment un projet technocratique tel qu’on les concevait au milieu du XXe siècle. À Bruxelles, on peut voir, toucher l’idée de la technocratie, de la neutralité incarnée. L’Union a ensuite été marquée par la grande révolution néolibérale des années 1980. Dans les deux cas, il s’agit de gommer les différences, d’intégrer à tout prix. Mais tous les domaines où l’identité est en jeu ont été laissés de côté : culture, immigration, éducation, chaque État a quasiment gardé une souveraineté complète sur ces sujets. On refuse d’incarner. L’exemple des billets de banque est le plus flagrant : la devise reste « surtout, pas d’affect ! ». Mais je pense que cela a changé le 24 février 2022.
L’accès à l’Europe n’est plus quelque chose d’aristocratique. Pourtant, cela reste parfois du domaine de l’ailleurs. Mais moi qui ai grandi à Strasbourg, il m’était plus utile de savoir quel temps il faisait à Stuttgart qu’à Toulouse.
Olivier Guez
Quel rôle joue la littérature dans ce processus ?
La littérature, depuis plus longtemps que le cinéma, raconte par définition le continent. Elle raconte sa géographie, ses visages, ses destins, ses croisements. Peut-être plus que la peinture aussi, d’une certaine manière. La littérature européenne, avec le pas de côté opéré par Cervantès, a inventé l’ironie, comme l’a noté Kundera dans L’Art du roman.
C’est une donnée fondamentale. Un roman comme La Conscience de Zeno d’Italo Svevo dit un rapport au monde qui ne peut être qu’européen : pas lyrique, pas dramatique, pas religieux, pas dogmatique, mais fait d’une distance joyeuse et mélancolique à l’existence. C’est la grande invention de l’Europe, celle de l’anti-héros, alors que toutes les littératures étaient auparavant fondées sur des héros. C’est quelque chose dont on peut vraiment s’enorgueillir. Quelque part, c’est aussi Rabelais, Les Aventures du brave soldat Švejk de Hašek, L’Homme sans qualités de Musil. À cet égard, la littérature telle que nous la pratiquons est peut-être l’art le plus européen.
Comme toutes les cultures, la culture européenne a fonctionné grâce à des passeurs : essentiellement les juifs et les germaniques, qui vivaient éparpillés dans le centre du continent. Les premiers ont été exterminés – par les seconds –, les autres ont été rassemblés dans un État-nation. Car la construction européenne s’est paradoxalement appuyée sur une homogénéisation interne des nations européennes. La littérature s’en ressent, ce qui nous fait revenir à la question de la nostalgie. Au fond, c’est dans la littérature juive et germanique d’avant les années 1940 qu’on retrouve la dimension européenne, précisément parce que tout y est en circulation. Quand les grands romanciers austro-hongrois écrivent, on est essentiellement dans un territoire européen, dans une Europe circulaire. Les romans de Joseph Roth, des frères Israel Joshua et Isaac Bashevis Singer ou de Thomas Mann se déploient dans toute l’Europe continentale, comme Le Monde d’hier de Stefan Zweig. Dans les autres littératures, l’espace est souvent celui de la nation.
Prenons l’exemple de Gregor von Rezzori. Né en 1914 à Czernowitz. Son père est un aristocrate sicilien déchu. Il naît tout à la fin de l’Empire austro-hongrois. Il étudie en Roumanie, puis part à Berlin. Il fait du cheval dans le Tiergarten dans les années 1920. Jusqu’à ce qu’il épouse une aristocrate italienne, léguant finalement une fondation à son nom en Espagne. Ses mémoires, intitulés Sur mes traces, racontent tout une histoire du continent.
Avec un Jorge Semprun, dans une autre génération, on retrouve cette littérature faite de mouvement permanent. Après, il y a des ovnis, comme le livre de Robert Menasse, La Capitale. C’est Bruxelles. C’est l’espace communautaire, l’inverse de l’espace géographique. Mais c’est une expérience originale.
Mais le plus grand changement, c’est la disparition des passeurs. Le projet d’expansion économique et technocratique a pris le relais d’une Europe autodétruite, où les passeurs ont disparu dans les ruines. Je pense que c’est en train de changer.
Et vous, quelle a été votre initiation à l’Europe ?
Je suis un écrivain européen d’expression française. Tout d’abord parce que je suis né en Europe : Strasbourg, par sa géographie et son histoire, est d’abord une ville européenne. Comme Trieste. Ce sont des villes de frontière mythiques, assises entre deux ou trois mondes – un grand port, un grand fleuve.
Comme je suis né en 1974, j’étais enfant dans les années 1980, aux premières loges d’une des plus belles décennies de l’histoire européenne. Il régnait une euphorie permanente. Mes grands-parents habitaient en face du Conseil de l’Europe. On construisait de nouveaux bâtiments, on intensifiait les échanges – imaginez ce que ressent un enfant lorsque les chefs d’État italiens, allemands et français se retrouvent dans sa ville. L’Europe était partout, ce qui est vraiment particulier à Strasbourg.
J’avais passé quelques jours à Berlin-Est avec mon père en 1984, j’y étais allé en train de nuit. C’était mieux qu’un James Bond : en passant la frontière est-allemande, je voyais la Volkspolizei, avec ses uniformes, ses chiens, ses grandes bottes. Mon grand-père, d’origine tchèque, m’avait emmené à Prague en 1988. Il y avait une atmosphère fascinante dans ce qui était désormais une ville morte. Strasbourg, à équidistance de Milan, Prague et Paris, semblait naturellement s’ouvrir vers ces horizons.
Et l’automne 1989 fut une apothéose. Nous avons eu le sentiment d’une marche de l’histoire. Ma génération ne s’est jamais vraiment remise de la chute du Mur. L’ouverture du Rideau de Fer, c’est l’ouverture de terres d’aventures. Se dire qu’à 17-18 ans, tu as le droit d’aller à Prague, à Budapest, à Moscou peut-être, cela crée une euphorie immense après des années d’interdit. Des figures comme Jorge Semprun, Umberto Eco, Norman Manea, Claudio Magris ou Julia Kristeva étaient omniprésentes dans les médias : c’étaient des figures publiques. On fêtait l’Europe.
Des figures comme Jorge Semprun, Umberto Eco, Norman Manea, Claudio Magris ou Julia Kristeva étaient omniprésentes dans les médias : c’étaient des figures publiques. On fêtait l’Europe.
Olivier Guez
De façon plus personnelle encore, il y a eu la coupe d’Europe de football. Les clubs soviétiques, l’Étoile Rouge de Belgrade… L’Europe avait quelque chose d’incroyablement excitant. J’ai découvert la France après l’Europe. J’ai bénéficié d’Erasmus, des promenades en train, des choses classiques. Mais la matrice de cette découverte est la décennie européenne merveilleuse des années 1980.
Si je me considère un écrivain européen, c’est d’abord par ce rapport à l’espace. Ce n’est pas une prétention ou une certaine idée que j’aurais de moi-même ou de ce que j’ai écrit. C’est simplement l’idée que mon espace de référence, quoi que j’écrive, c’est le continent.
Les Américains ont forgé le concept Great American Novel. S’il nous est facile de dire que Kafka ou Proust ont écrit des grands romans européens, qu’en est-il aujourd’hui ?
Il manque des lieux de forum et de rencontre où les perspectives pourraient se croiser régulièrement. Cela manque vraiment. On continue, dans chaque pays européen, de lire plus de littérature anglo-saxonne que de littérature d’autres pays européens. Quel serait le grand roman européen des dernières décennies ? Houellebecq en a peut-être écrit : il donne l’état d’esprit de beaucoup d’Européens, mais en restant très français. Je crois que c’est ce qu’il nous manque aujourd’hui. Il y a bien sûr des thématiques européennes. Le dernier livre de Daniel Kehlmann se déroule pendant la guerre de Trente ans. On y rencontre des Suédois, le roi de Bohême : c’est évidemment un roman qui épouse l’espace européen. Sofi Oksanen, dans Purge et par son histoire (moitié estonienne, moitié finlandaise), raconte aussi un espace qui est européen par sa pluralité.
Mais on ne peut pas créer des artistes européens en claquant des doigts. Il ne peut y avoir d’artistes européens que s’ils ressentent l’Europe. Cela signifie une mobilité, une pluralité d’expériences. La langue est anecdotique, c’est plutôt une question de ressenti. Le ressenti d’un fleuve, d’une ville, d’une rumeur, cela s’accumule, mais cela ne se décrète pas. Les générations Erasmus, les couples pluri-culturelles, vont accoucher d’une autre forme de littérature, avec une présence plus importante du ressenti européen.
Il y a sans doute un travail réglementaire à mener pour accompagner cette mobilité : dans l’installation, la sécurité sociale des écrivains, les impôts, etc. Aujourd’hui, il est difficile pour un écrivain indépendant de déménager, de faire des séjours, des travaux dans différents pays. C’est une grande différence avec les États-Unis, ou avec l’ancienne Autriche-Hongrie. Il y a de fait un problème d’espace public européen. On voit là comment l’Europe institutionnelle, réglementaire, peut accompagner une Europe culturelle, chargée d’affect.
Volodymyr Zelensky, c’est un personnage de Kundera. Un ancien clown qui devient le président héroïque d’une nation en guerre. Il y a là quelque chose d’un roman d’Europe centrale.
Olivier Guez
La guerre est aux portes de l’Europe, l’Europe peut-être aux portes de la guerre. Qu’est-ce que cela change à la vie des écrivains ?
Il est difficile de prédire comment les œuvres des uns et des autres seront affectées. Je crois qu’on ressent ce que veut dire une communauté de destins, qu’on ressent une communauté dans les questions qui se posent, dans les urgences, dans les défis. Volodymyr Zelensky, c’est un personnage de Kundera. Un ancien clown qui devient le président héroïque d’une nation en guerre. Il y a là quelque chose d’un roman d’Europe centrale.
Quant à l’action en faveur des écrivains, je pense toujours à ce qu’a fait Philip Roth avec les écrivains d’Europe centrale et orientale, qu’il a aidés matériellement et psychologiquement. Je pense que nos générations vont être confrontées à cela : il va falloir être solidaires au sens fort du terme, accueillir des écrivains ukrainiens, mais aussi des écrivains dissidents russes et biélorusses. Berlin pourrait redevenir l’épicentre de la culture en Europe.
Il serait aussi souhaitable qu’on arrive à mettre en place un pendant européen au PEN-Club américain : une structure, dotée de moyens financiers, capable d’aider des confrères en difficulté, en exil. Tout est une question de changement d’échelle.

