La langue du désir comme langue cannibale
L’affaire du « cannibale de Rotenburg », qui défraya la chronique il y a une vingtaine d’années, resurgit aujourd’hui dans le nouveau roman de Senthuran Varatharajah. Rot (Hunger) raconte une « histoire d’amour » sans commune mesure et pousse à l’extrême une réflexion sur le désir comme « faim » de l’autre, sur la langue du désir comme « langue cannibale ».
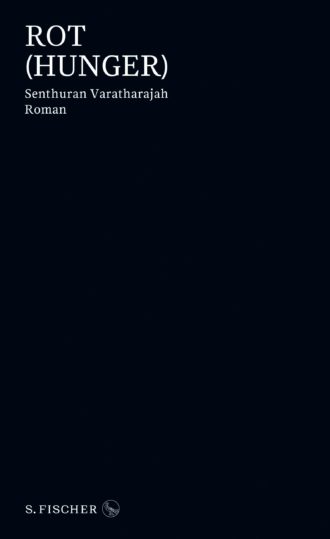
A comme Armin Meiwes, B comme Bernd Brandes. A et B constituent les deux parties du roman Rot (Hunger) – littéralement : Rouge (faim) –, deux parties qui entrelacent deux récits : celui de l’année qui suivit la fin d’une relation amoureuse d’un narrateur nommé Senthuran tout comme l’auteur et celui du 9 mars 2001 où Armin Meiwes rencontra Bernd Brandes afin de le disséquer et de le consommer comme ils en avaient convenu. Cette affaire a déjà inspiré bien des titres de heavy metal, des pièces de théâtre et autres récits, mais l’ouvrage de Senthuran Varatharajah la présente sous un angle nouveau : celle d’une « histoire d’amour » animée par une langue connue et courante, qui, poussée à l’extrême, se fait « cannibale ». Ich habe dich zum Fressen gern (« je t’aime à en mourir », fressen signifiant dévorer) ou (sich) verzehren (consommer, (se) consumer, brûler d’amour pour quelqu’un) en sont quelques exemples. Mais sont convoquées aussi des expressions en arabe, en tamoul (sa langue maternelle), en kurde et en turc (les langues parlées par l’ancienne amie du narrateur) à chaque fois que la volonté de s’unir à l’autre, de se l’approprier, de le faire sien revient à le manger. Car cette « histoire d’amour » est avant tout celle d’une langue érotique et destructrice, celle justement qui constitue le vecteur du roman.
Senthuran Varatharajah s’est visiblement informé des moindres détails de l’affaire de Rotenburg. Le narrateur de cette autofiction se rend sur les lieux, évoque ses tentatives infructueuses d’engager une correspondance avec A, condamné à perpétuité. Mais ce qui importe ici surtout, c’est qu’il s’est employé à une lecture minutieuse des échanges écrits entre le cannibale et sa future victime sur le forum Nullo, ainsi que des dires du premier suite à son arrestation. Son récit repose ainsi pour beaucoup sur leurs propres paroles : elles donnent à voir les émotions, sentiments et intentions de l’un et de l’autre, la manière dont ils comptaient procéder lors de leur seule et unique rencontre, leur désir d’absorber l’autre pour le premier, de disparaître entièrement dans l’autre pour le second. Ces paroles sont mises en italique, puis reprises et variées à la manière d’une litanie, conférant à cette histoire sordide une dimension poétique particulièrement troublante.
Troublante aussi, car certains verbes – comme verzehren, verschwinden (disparaître), verschmelzen (se fondre), vereinigen (unir) et leurs différentes significations suggérées dans le texte – peuvent tout aussi bien appartenir à l’histoire de A et B qu’à celle dont le narrateur est en train de faire le deuil. Pulsion de vie et pulsion de mort s’entremêlent dans les paroles citées, et connaissent des éclairages nouveaux selon qu’elles sont prononcées par l’un ou l’autre : « tu seras pleinement en moi », « une partie de moi demeure en toi ». A et B, le narrateur et ses interlocutrices passées et présentes formulent et reformulent leur faim de l’autre, chacun l’interprétant à sa façon : « Parce que la faim est une direction. Parce que toute faim nous trouve. » Jusqu’où vont les paroles qui attisent le désir ? À partir de quand basculent-elles dans une réalité qui dépasse l’entendement ? « Je ne connais pas cette langue », écrit le narrateur, mais peut-être est-ce aussi une parole de A ou de B, pourtant tous savent « qu’il leur faut passer par cette langue ». Et reprenant une phrase de son premier roman Vor der Zunahme der Zeichen (2016, littéralement : Face à la multiplication des signes), l’auteur écrit à plusieurs reprises ici aussi : « Il nous faut aller jusqu’au bout du sens. » Traverser cette langue tabou du désir et de l’anéantissement sans en craindre les antinomies – « il nous faut détruire les noms afin d’atteindre les noms », « il nous faut détruire les souvenirs afin d’atteindre les souvenirs » – est un des défis de ce texte.
Car aller jusqu’au bout signifie aussi briser les mots, les décomposer, les disséquer. Ainsi certains d’entre eux sont-ils coupés en fin de ligne de façon improbable, suggérant à la fois la fragilité des mots qui menacent de rompre à tout moment comme leur césure effective, leur brisure, leur écartèlement. Les mots disloqués et l’étrangeté qu’ils suscitent, auxquels on peut ajouter la mise en page inattendue mêlant des vers à la prose, ou encore la coupure nette du roman tout entier en deux parties symétriques : tout suggère à quel point la langue elle-même porte l’acte commis par A, à quel point également la langue renvoie toujours et encore la première histoire à la deuxième et inversement : « un jour se divise en deux ; comme une année qu/i est vaste, comme une année qui fut posée dans les deux mains, les mois : r/épartis selon leur poids, à gauche, et à droite. Jusqu’à ce qu’ils ne tiennent plus. »
Senthuran Varatharajah tire également profit des ambiguïtés de la langue, notamment celles qui lui viennent de son passé – né au Sri Lanka, il trouve dans l’histoire de sa migration en Allemagne alors qu’il était enfant la principale source d’inspiration de son premier roman. Ces ambiguïtés servent à nouveau son propos, car pour lui qui apprenait l’allemand, heute (« aujourd’hui ») s’orthographiait häute (du verbe häuten, « dépecer »), haut ab (« dégagez ») signifiait Haut ab (« enlève ta peau »). La langue est insidieuse et faite de malentendus que l’auteur n’a de cesse de pointer, mettant en scène les excès de leurs dérives jusqu’à l’horreur d’un crime anthropophage décrit aussi minutieusement qu’il fut perpétré.
Les lecteurs de Senthuran Varatharajah reconnaitront la poésie et la sensibilité de sa langue, ses réflexions sur la fugacité du sens et l’impossibilité de dire : « Il doit y avoir une langue qui ne montre rien, une langue qui ne cache rien », « un nom n’est un nom que s’il conserve ce qu’il brise. » Les multiples références bibliographiques, mentionnées par le narrateur au détour de certains paragraphes, rappellent aussi l’intérêt pour la philosophie et la religion (les deux matières étudiées par l’auteur lui-même) très présent dans le premier ouvrage. Dans Rot (Hunger), Senthuran Varatharajah sonde les enjeux tant philosophiques que religieux d’un acte anthropophage et les titres cités par le narrateur afin de mieux appréhender l’histoire de A et de B, laissent entrapercevoir les recherches menées en amont de l’ouvrage. Il puise ainsi à la pensée européenne afin de penser cet impensable qui eut pourtant lieu en Allemagne au début du XXIe siècle : entre autres, La pesanteur et la grâce de Simone Weil, la Théorie de la religion par Georges Bataille, Nous sommes tous des cannibales de Claude Lévi-Strauss, l’étude du Cannibalisme sexuel par Klaus M. Beier ou encore le second volume de la Dogmatique de Karl Barth intitulé « incarnation du Verbe ». L’aspect religieux s’avère d’une grande importance et le sacrifice consenti par B est célébré par A selon les gestes précis d’une lugubre eucharistie : « tu mangeras mon corps, tu boiras mon sang ».
C’est la couleur du sang qui donne son titre au roman. Une feuille d’un rouge intense est insérée entre la première et la deuxième partie, évoquant dans ses nuances une séparation nette au recto, une jonction au verso, rappelant ainsi les deux facettes inconciliables de toute union. À la fois intérieure et extérieure, la couleur rouge est tant celle de la lumière émise par la caméra de A qui filma une partie de la scène – « dans cette lumière le sang est doux » – que celle qui se trouve en A, « enfoui profondément et rouge, quelque part au fond de sa poitrine ». Explorant dans ses nuances ce rouge du for intérieur, Senthuran Varatharajah cherche inlassablement dans la langue les racines d’expériences inouïes pour tenter de les dire « jusqu’au bout du sens » en parfaite conscience de l’impossibilité de la tâche :
« dans la coupe
de mon nom,
je pose
deux mensonges
lentement
l’un sur l’autre ».

