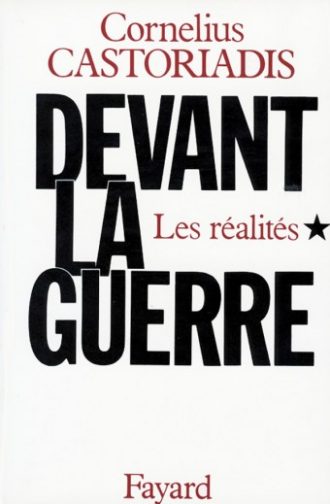Castoriadis devant la guerre en Ukraine
« Ce que je dis, c’est que cette situation n’est intelligible que dans la perspective de la confrontation. » Alors que les troupes de Poutine envahissent l'Ukraine, Raffaele Alberto Ventura a relu Devant la guerre de Cornelius Castoriadis.
Il se trouve seulement que, contrairement aux souhaits de certains intellectuels fatigués, l’histoire ne s’arrête pas.
Cornelius Castoriadis
Devant la guerre, publié en 1981, a la mauvaise réputation d’être un livre truffé de prévisions inexactes : dès sa parution, on reprocha à Cornelius Castoriadis son parti pris violemment antisoviétique, qui semblait virer à l’atlantisme, mais surtout sa vision d’une URSS toute-puissante alors que justement elle approchait de son déclin. L’ancien fondateur de Socialisme ou Barbarie voyait dans l’expansionnisme de l’appareil bureaucratique-militaire russe un facteur de risque géopolitique majeur, ouvrant à la possibilité d’une escalade vers la guerre – risque que la chute de l’empire soviétique, quelques années plus tard, parut anéantir. Or il semblerait qu’elle n’ait fait que le reporter. Tout juste quarante ans après, et dans l’année du centenaire de la naissance de Castoriadis, il est temps de rouvrir les pages de Devant la guerre pour nous aider à comprendre l’actualité ukrainienne. Qu’est-ce au fond ce décalage de quarante ans à l’échelle de l’histoire ?
La perspective d’une guerre mondiale
« Comprendre », dans les mots du philosophe, c’est la condition préalable pour ensuite chercher « une issue au piège dans lequel l’histoire semble nous enfermer ». Castoriadis ne se prenait pas pour le prophète d’une troisième guerre mondiale à venir, puisqu’il précisait dès les premières lignes de l’ouvrage ce que ses critiques ont délibérément ignoré :
Devant la guerre, en français, ne signifie pas avant la guerre, comme les sourds ne manqueront pas de l’entendre, et comme ils l’ont déjà entendu. Il ne s’agit pas, dans ce livre, de prévision ou de prospective, mais de l’analyse du monde contemporain, indispensable pour pouvoir s’y orienter.
Il s’agit donc d’identifier les tendances et les attentes qui structurent le champ géopolitique : « Ce que je dis, c’est que cette situation n’est intelligible que dans la perspective de la confrontation. » S’il y a une conviction centrale dans toute l’œuvre de Castoriadis, c’est justement qu’il n’y a pas de déterminisme historique, pas de destin inéluctable, puisque tout est à imaginer et instituer. Pour être encore plus clair : « Ce que je ne dis pas, c’est que la guerre – la guerre russo-américaine – aura lieu demain, dans trois ans ou dans treize. » Ce qui compte, ce sont les caractéristiques spécifiques du capitalisme d’État soviétique, ancrées dans son imaginaire social-historique :
La Russie ne veut pas la guerre ; elle veut la victoire. Elle poursuit inlassablement l’expansion de sa puissance, incarnée dans le renforcement continu de son potentiel militaire et traduite par des gains territoriaux indirects de divers types.
Dire que « nous nous trouvons, de nouveau, placés dans la perspective d’une guerre mondiale » ne signifie rien d’autre que cette perspective est celle qui motive les acteurs dans leurs choix, dans leurs investissements, dans leur craintes, dans leurs décisions : « la perspective de la guerre est derechef devenue un ingrédient décisif et qui contient, comme une de ses possibilités et probabilités effectives, la confrontation ouverte des deux super-puissances ». Si ceci était vrai il y a quarante ans, il n’a pas cessé d’être vrai depuis et l’est d’autant plus aujourd’hui : en renonçant à la perspective de la guerre, « facteur formateur des développements effectifs », il serait difficile d’expliquer grand chose. Poutine ne motive-t-il pas son opération militaire du fait du risque que soient installées des bases américaines sur le territoire d’un pays frontalier, bases qui seraient installées sous prétexte… d’une menace russe ? C’est l’œuf ou la poule, comme dans les dilemmes les plus tragiques de la théorie des jeux, que Castoriadis évoque dans son livre.
S’il y a une conviction centrale dans toute l’œuvre de Castoriadis, c’est justement qu’il n’y a pas de déterminisme historique, pas de destin inéluctable, puisque tout est à imaginer et instituer.
Raffaele Alberto Ventura
La militarisation de l’économie russe
Au cœur de l’argumentaire castoriadien était l’idée que l’URSS avait une économie à deux vitesses : une économie « civile » misérable et une économie « militaire » florissante, puisqu’elle assujettit d’autres nations. C’est une industrie performante, massive, clairement tournée vers l’offensive, plutôt qu’organisée autour de l’idée de défense : par exemple la marine de guerre russe, développée dans les années de la guerre froide, n’a de sens que « soit dans la perspective de support et de soutien d’opérations offensives locales, soit, évidemment, dans celle de la guerre totale ». Des pages et des pages sont consacrées à l’étude précise des forces sur le terrain, des « comptes de la quincaillerie militaire », dans ce qui ressemble plus à un rapport qu’au livre d’un philosophe.
De longues pages sont consacrées au mystère du fonctionnement et de la priorité donnée à cette économie de guerre. Elles sont le fruit de sa lecture attentive de l’actualité mais aussi de ses années à l’OCDE passées à étudier les comptes nationaux. L’économie soviétique « est constituée par l’écrémage systématique des ressources les meilleures de tous ordres – et, en premier lieu, évidemment, les ressources humaines – dans tous les domaines d’intérêt pour l’Appareil militaire. » Castoriadis avait donc bien conscience des facteurs qui devaient tôt ou tard amener à la chute du système soviétique.
Cette politique a été poursuivie, ces armements gigantesques accumulés avec une efficacité considérable, dans un pays où l’on n’arrive pas encore, et de loin, à satisfaire ce qu’il est convenu d’appeler les besoins « élémentaires » de la population, où la totalité de l’économie « civile » est dans un état lamentable, où l’agriculture – exportatrice nette pendant des millénaires – ne parvient pas à nourrir le population.
La thèse centrale de Castoriadis est que la Russie était en train de se transformer en « stratocratie » (stratos = armée) : « l’Armée comme corps social assumant, par le truchement de ses échelons supérieurs, la direction et l’orientation de fait de la société ». Analyse qui pourrait s’appliquer, il faut le rappeler, également aux États-Unis, qui dans les quarante dernières années ont perdus les caractères plus classiquement démocratiques-libéraux pour converger vers le modèle bureaucratique-impérialiste qui constitue la maladie du capitalisme.
Au cœur de l’argumentaire castoriadien était l’idée que l’URSS avait une économie à deux vitesses : une économie « civile » misérable et une économie « militaire » florissante, puisqu’elle assujettit d’autres nations.
Raffaele Alberto Ventura
La militarisation soviétique se déroulait à l’époque dans un contexte de crise : « Crise de l’énergie, inflation accélérée, ébranlement et blocage du cours jusqu’alors apparemment tranquille du capitalisme moderne. » À l’époque comme aujourd’hui, on ne peut comprendre l’accentuation des tensions internationales sans donner une lecture systémique :
Il y a sommation, ou mieux synergie, multiplication et exponentiation réciproque de ces événements et de leurs effets. C’est que, manifestations d’une crise profonde du système mondial de domination – après sa phase de relative stabilité entre 1953 et 1973 –, ils font retour sur elle pour l’aggraver.
Le régime soviétique « traverse une maladie chronique tépide dont il est incapable de sortir. Il est tout autant dans l’impossibilité d’engager des réformes que d’engendrer des réformateurs. » En effet, c’est une « impasse interne de la société bureaucratique russe » qui détermine sa « fuite en avant dans l’expansion impérialiste ». C’est l’échec de son modèle économique civil, son prétendu « socialisme », que l’URSS paye en concentrant ses forces sur l’économie militaire. Mais au fond cet échec n’est lui-même que la conséquence du choix, intrinsèque au prétendu socialisme, de nourrir prioritairement une caste de bureaucrates et de militaires — « l’Armée absorbe la meilleure part des ressources du pays », le parti est « fonctionnellement un parasite » — au lieu de redistribuer la richesse à la population pour qu’elle produise et consomme les biens dont elle a vraiment besoin. Selon le philosophe, qui fut aussi chef-économiste à l’OCDE, une différente allocation des ressources et de différentes priorités que « l’expansion quantitative et qualitative de la société militaire » auraient pu garantir au pays une économie plus prospère, égalitaire et donc pacifique.
Derrière le socialisme, l’idéologie impériale russe
Peut-on appliquer à la Russie de Poutine les analyses que Castoriadis avait produites pour l’URSS « socialiste » ? Oui et pour deux raisons. La première est que le philosophe a beaucoup insisté sur le caractère irréversible des transformations portées par les régimes pseudo-socialistes, ce qui implique une forte continuité entre la situation actuelle et celle d’il y a quarante ans. Le marxisme-léninisme a permis de faire émerger un certain imaginaire belliqueux, « représentation de ce monde en purs termes de rapports de Force ». La deuxième raison est que Castoriadis voyait bien que la crise de l’URSS aurait fait émerger une dimension plus profonde :
La seule « idéologie » qui reste, ou peut rester, vivante en Russie, c’est le chauvinisme grand-russien. Le seul imaginaire qui garde une efficace historique, c’est l’imaginaire nationaliste – ou impérial. Cet imaginaire n’a pas besoin du Parti – sauf comme masque et, surtout, truchement de propagande et d’action, de pénétration internationale. Son porteur organique, c’est l’Armée.
Castoriadis voyait donc déjà clairement les évolutions qui auraient suivi la chute de l’URSS, dont le triomphe d’un certain haut fonctionnaire du KGB qui gouverne le pays depuis vingt ans :
Tout fait penser qu’il ne faut plus parler de la Russie comme d’une société dominée par le Parti/État totalitaire, cette création de Lénine perfectionnée par Staline. Tout fait penser qu’il faudra considérer, de plus en plus, la société russe comme une société stratocratique, où le corps social de l’Armée est l’instance ultime de la domination effective (et non pas seulement le garant ultime de l’ordre établi, intérieurement et extérieurement)
La chute de l’URSS, cet événement majeur que l’on accuse Castoriadis de ne pas avoir anticipé puisqu’il insistait sur la menace soviétique, est déjà implicite dans sa lecture : « Depuis soixante ans, le Parti essaie d’organiser et de moderniser la société – il échoue lamentablement ». Car c’est l’Armée
le seul secteur et corps moderne de cette société bancale, le seul à être fonctionnellement efficace, et, de plus en plus, le seul à être « idéologiquement » (ou imaginairement) efficace car incarnation organique et « naturelle » de l’idéologie et de l’imaginaire nationaliste, grand-russien, « impérial », alors que l’idéologie du Parti devient de plus en plus insignifiante.
Si l’Armée russe est tellement plus efficace que le Parti communiste, si l’économie militaire est tellement plus performante que sa contrepartie civile, c’est qu’elle
s’est dégagée de l’emprise de fait du Parti, de ses interférences, de ses fausses statistiques, de ses nominations uniquement en fonction de l’appartenance à tel clan ou clique politique, etc.
Au fond la soi-disant idéologie « communiste » n’était à l’époque déjà plus rien d’autre qu’un prétexte pour les plans de carrière de bureaucrates au service du projet d’expansion de leur propre couche sociale :
Le national-communisme du Parti russe est le tisser ensemble du mode de domination et d’exploitation propre à l’Appareil bureaucratique avec ces significations imaginaires – Nation, Empire russes – ornementé de quelques restes de vocabulaire marxiste.
L’analyse de Castoriadis apparaît aujourd’hui plus actuelle que jamais, d’autant plus que le masque marxiste a été totalement liquidé : « La Russie est engagée, de façon constante, dans un processus d’expansion de sa domination, directe ou indirecte, dans lequel les phases de « détente » ne sont que des moments tactiques, ou des pauses « obligées » ». Et voici donc que les dernières décennies apparaissent finalement comme une longue pause obligée, le temps pour un système économique de reprendre ses forces après l’effondrement de son incarnation précédente.
L’analyse de Castoriadis apparaît aujourd’hui plus actuelle que jamais, d’autant plus que le masque marxiste a été totalement liquidé.
Raffaele Alberto Ventura
La théorie de la stratocratie
Au coeur de la théorie de Castoriadis, et donc de sa prévision, il y a l’idée que la Russie est condamnée à l’expansion par la structure même de son régime :
Il existe une opposition essentielle entre le régime russe et les régimes occidentaux. Ceux-ci se trouvent à une étape de leur évolution où leur fonctionnement n’exige plus une extension territoriale de la domination – et encore moins une domination territoriale directe – mais peut se satisfaire du maintien du statu quo. Si tel est le cas, c’est qu’au total ce statu quo est satisfaisant, pragmatiquement parlant, tant pour les couches dominantes que pour la majorité des populations des pays occidentaux.
En Russie, au contraire, « les forces et les inerties conduisent, irrésistiblement, à une politique d’expansion ». Puisque l’économie socialiste ne garantit pas la croissance, puisque la bureaucratie doit bien prélever de la plus-value, c’est une économie de prédation et d’extraction qui s’impose. Pour le dire autrement : « L’expansion extérieure est, dans cette situation, la seule « issue » du régime – et cela, pour toutes les couches dominantes confondues (pour le « parti civil » tout autant que pour la société militaire) ».
On pourra objecter que ce ne sont pas seulement les bureaucrates socialistes qui vivent un mode de vie impérial aux dépens de leurs colonies… Mais la différence avec le capitalisme occidental est de taille, puisque le système stratocratique semble conçu précisément pour empêcher la croissance, car qui dit croissance dit formation d’une société civile, et qui dit formation d’une société civile annonce le risque de revendications égalitaires qui mettraient en crise le système de pouvoir :
Un véritable « développement » de l’économie non militaire n’intéresse pas [aux dirigeants soviétiques]. Et cela, parce qu’un développement serait aussi, jusqu’à un certain point, développement de la société elle-même – de la société non militaire – qui pourrait tendre à diminuer son assujettissement au contrôle des organismes dominants.
En tout cas, la militarisation des sociétés socialistes est aussi une conséquence de leur échec. « Il y a une logique social-historique – soit, la cohérence sui generis qui s’affirme à travers l’incohérence et l’irrationalité du système bureaucratique. » C’est que Castoriadis appellera, dans sa relecture d’Hannah Arendt, « capitalisme bureaucratique total et totalitaire ». Ou pour le dire de façon plus brutale : « La Russie est vouée à préparer la guerre parce qu’elle ne sait et ne peut rien faire d’autre. » Ce qui constitue un véritable cercle vicieux : puisque la domination politique fonctionne de moins en moins, il faut perfectionner la répression. Encore une analogie avec les dégénérations récentes des sociétés capitalistes, faisant de plus en plus souvent recours à la répression policière jusque dans les rues de Paris. L’expansion soviétique, de son côté, se fait
au prix d’une militarisation de la société, d’un monstrueux gonflement de l’Armée à laquelle tout est sacrifié et qui, dans ces cas aussi, est le seul secteur de la société à fonctionner efficacement. Cuba et le Vietnam, comme sociétés militaires, sont des reproductions en miniature de la société militaire russe.
États-Unis et Russie
Selon le philosophe, il ne faut pas croire au « discours ridicule (la plupart du temps, non innocent) sur l’« encerclement » de la Russie, l’insécurité et l’angoisse des pauvres locataires du Kremlin » : si certains journalistes l’avaient su, ils auraient évité de prêter trop de foi au double discours de Poutine. Qu’est-ce qu’au fond que cet encerclement ? « C’est-à-dire le fait que la Terre est ronde », commente ironiquement Castoriadis.
La militarisation des sociétés socialistes est aussi une conséquence de leur échec.
Raffaele Alberto Ventura
Castoriadis a pu être accusé de servir une rhétorique belliqueuse de marque atlantiste. En effet, il déplore qu’ « à cette expansion militaire et territoriale, le camp occidental est incapable, pour des raisons profondes et durables, de s’opposer efficacement ». Il craint une « capitulation de fait sans bataille ». Il se demande « si, quand et sur quel point le « camp occidental » – en fait, le Gouvernement américain et le Pentagone – jugera (…) qu’une limite est atteinte ». Pourtant, ce n’est pas une offensive militaire qu’il encourage mais bel et bien un réveil des peuples, et du peuple russe en particulier, contre toute escalade militaire. Aujourd’hui encore, les plus grands espoirs nous viennent des manifestations pour la paix dans les rues des villes russes. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle Devant la guerre est loin d’être un livre anti-russe, puisque au contraire il dénonce dans l’exploitation du peuple russe par ses dirigeants la cause de la dynamique expansionniste. Mais les manifestations pacifistes ne pourront aboutir qu’en liquidant l’imaginaire social nationaliste qui gouverne la Russie :
L’imaginaire nationaliste est donc ici forme vide et travestissement : fiction plate, assemblage de bouts et de morceaux mal ficelés ensemble. La signification nation dans ce cas ne renvoie à aucun contenu substantif, elle se réfère à la simple agglomération d’un grand nombre d’individus maintenus ensemble par le carcan de fer du pouvoir d’État et à une liste de traits empiriques descriptifs.
Une riposte militaire américaine serait, au contraire, une catastrophe. Si Devant la guerre a pu paraître pendant quarante ans au pire un « livre raté » et au mieux un « livre daté », il a retrouvé aujourd’hui une actualité impressionnante. Les analyses qu’il propose sont convaincantes, les questions qu’il pose sont urgentes. Comme celle-ci :
La question est de savoir quand l’accumulation d’avantages « locaux » par les Russes sera soudain considérée par les Américains comme en train de passer au niveau du « global » – et ce qui arrivera alors.
Cette actualité n’est clairement pas une bonne nouvelle.