L’Europe sur l’étal du poissonnier, une conversation avec Jean-Marie Guéhenno
« L’Union européenne a installé la paix en Europe. Est-ce une utopie suffisante ? Non, cela revient effectivement à vendre de l’eau aux poissons. Tant que nous ne sommes pas sur l’étal du poissonnier, nous n’en voyons pas l’intérêt. »
Dans cet entretien exceptionnel, Jean-Marie Guéhenno revient sur son dernier livre.
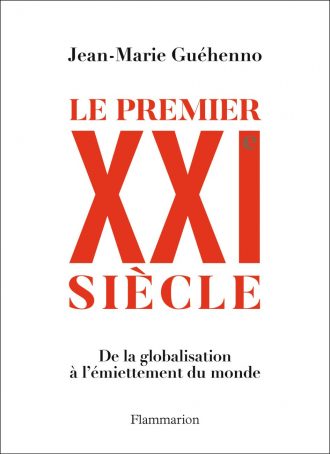
Dans un magnifique discours, David Foster Wallace raconte l’histoire de « deux jeunes poissons qui nagent et croisent le chemin d’un poisson plus âgé qui leur fait signe de la tête et leur dit, “Salut, les garçons. L’eau est bonne ?” Les deux jeunes poissons nagent encore un moment, puis l’un regarde l’autre et fait, “Tu sais ce que c’est, toi, l’eau ?” » – Dans votre livre vous posez, semble-t-il, une question comparable : « Qu’est-ce que vivre en paix » ? Qu’est-ce que la paix pour nous qui nous sommes tellement habitués à y vivre que l’on ne sait plus trop ce qu’elle signifie ? Au fond, savez-vous ce qu’est la paix ?
Cette idée que la paix n’est pas une évidence s’est imposée à moi dans les années où j’étais responsable du maintien de la paix à l’ONU et passais beaucoup de temps dans des pays en guerre. Je pense qu’il y a, dans les sociétés, un implicite qui joue le rôle de l’eau de cette belle métaphore. Dans les sociétés brisées par la guerre civile, cet implicite a disparu, et c’est ce qui rend nécessaire la présence de troupes de maintien de la paix. Au contraire, dans une société en paix, la peur du gendarme ne joue qu’à la marge, pour dissuader la minorité qui rejette l’ordre établi. La majorité des citoyens respecte la loi non par crainte d’aller en prison, mais parce qu’elle accepte spontanément les règles en vigueur. Si ce n’était pas le cas, la police serait vite débordée, et les 25 000 policiers de New York n’arriveraient pas à maintenir la paix dans une ville de huit millions d’habitants.
C’est ce que vous retenez de la notion de « capital social », pourriez-vous nous expliquer en quoi elle est si centrale dans votre démarche ?
Il y a bien des manières d’appréhender le capital social. Il peut être compris comme l’attribut des individus ayant fait de bonnes écoles, ayant de bonnes relations. Mais, en réalité, le capital social qui m’intéresse a une consistance bien plus profonde. Il s’agit de l’immense valeur ajoutée qui vient du fait que, la plupart du temps, nous nous faisons confiance. Il existe des exemples tout à fait banals pour le prouver : le restaurateur va nous servir avant de savoir si nous pouvons le payer. Nos sociétés se fondent sur la confiance, ce qui me frappe dans les dernières années est le fait que cet implicite se réduit progressivement.
Est-ce une tendance propre aux États-Unis comme à l’Europe ?
La réponse américaine à cet affaiblissement des liens implicites, qui commence à se répandre également en France, consiste à codifier tous les rapports sociaux. On l’observe – je le vois pour ma part à l’université – dans la manière dont on traite le sexe ou les minorités visibles. Tout doit faire l’objet de protocoles précis qui enlèvent aux rapports humains leur spontanéité. Dans les rapports entre sexes, cette spontanéité a longtemps été asymétrique, marquée par la domination des hommes, et c’est un progrès d’aller vers l’égalité, mais il vaudrait mieux que cette égalité s’enracine dans une culture nouvelle, plutôt que dans des codes. Cette juridisation est une vieille tradition aux États-Unis qui vient peut-être de l’hétérogénéité de la population américaine. Les États-Unis sont fondés sur un contrat, à la différence de l’Europe, dont la cohésion se fait par la mémoire. Et nous voyons par ailleurs qu’avec la diversification des mémoires, il y a une explosion de l’unité mémorielle propre à l’Europe qui pousse les Européens dans la direction américaine. Mais aux États-Unis, une telle unité n’a jamais existé.
Le capital social qui m’intéresse a une consistance bien plus profonde. Il s’agit de l’immense valeur ajoutée qui vient du fait que, la plupart du temps, nous nous faisons confiance.
jean-Marie Guéhenno
On pourrait également faire porter la question sur le caractère énigmatique de la banalité de la paix… Comment expliquez-vous qu’une idée mobilisatrice comme « l’Europe, c’est la paix » ait pu devenir un énoncé presque creux ?
L’Union européenne a longtemps eu pour principal argument de vente d’avoir installé la paix en Europe. Est-ce une utopie suffisante ? Non, lorsqu’elle est aussi évidente qu’elle peut l’être pour les jeunes d’aujourd’hui ; cela revient effectivement à vendre de l’eau aux poissons. Tant que nous ne sommes pas sur l’étal du poissonnier, nous n’en voyons pas l’intérêt.
La mémoire des tragédies passées a aidé les générations de l’après-guerre à penser un autre avenir. Mais dans notre paisible présent, nous ne sommes plus capables d’avoir un rêve, une utopie. C’est un des problèmes spécifiques de l’Europe. Elle ne se projette pas dans l’avenir. Elle est nostalgique, narcissique. L’Europe s’est construite sur l’histoire de ses guerres, en particulier à partir du désastre des deux Guerres mondiales. Les nouvelles générations d’Europe occidentale, qui n’ont pas vécu des événements aussi récents que l’année 1989, n’ont plus connaissance de ce que pouvait être la guerre. Je n’ai certes pas vécu la Seconde Guerre mondiale, mais mes parents l’avaient vécue, et l’idée de la guerre a hanté ma génération et s’est prolongée dans la Guerre froide avec la menace de l’holocauste nucléaire.
Dans votre livre vous montrez que l’erreur stratégique de l’Europe coïncide avec une mauvaise interprétation du tournant de 1989, pourriez-vous revenir sur ce point ?
Je crois très profondément que l’Europe n’a pas réussi à prendre le virage de l’après-Guerre froide. Elle n’a en effet pas été capable de réfléchir à ce qu’était sa relation avec le reste du monde, et cette interrogation est particulièrement difficile car elle pose la question de la relation entre le particulier et l’universel.
Si l’Europe n’est que la matrice d’un projet universel, une sorte de maquette de la paix universelle, cela n’a rien d’excitant, nous nous retrouvons simplement dans l’eau dans laquelle nous nageons. C’est ce qui explique que le projet européen soit devenu narcissique. L’Europe dit aux autres régions du monde « faites comme nous ». Et nous perdons – c’est une question que je développe dans mon livre – des notions aussi essentielles que celle de ‘frontière’. J’avais en cela un désaccord avec Régis Debray, que je rejoins de plus en plus : si l’Europe n’a rien qui la distingue du reste du monde, pourquoi l’Europe ? L’Europe est prise dans cette tension entre une visée universelle et un besoin de particulier.
Si l’Europe n’est que la matrice d’un projet universel, une sorte de maquette de la paix universelle, cela n’a rien d’excitant, nous nous retrouvons simplement dans l’eau dans laquelle nous nageons. C’est ce qui explique que le projet européen soit devenu narcissique.
jean-Marie Guéhenno
J’ai lu avec beaucoup d’intérêt la conversation que vous avez publiée entre Luuk van Middelaar et Pierre Manent, ainsi que le débat qu’elle a suscité, avec la réponse de Hans Kundnani. Je pense que l’universalisme européen n’a de chance de vivre que s’il reconnaît les circonstances très particulières – presque uniques – de sa naissance et de son développement. Vico, Herder, Isaiah Berlin l’avaient compris. Luuk van Middelaar me semble s’inscrire dans cette tradition et j’espère y appartenir. Hans Kundnani trouve que c’est une bonne chose que l’Europe ait longtemps évité de se définir par rapport à un autre. Je pense au contraire que c’est tout le problème : une communauté politique doit affirmer sa différence et ses limites. En même temps, il a raison de rejeter l’idée d’une Europe qui serait un système clos. C’est bien pourquoi l’Europe chrétienne de Pierre Manent ne me satisfait pas, parce que, mal interprétée, elle risque de nous faire glisser vers une vision à la Huntington des civilisations qui n’a jamais reflété la réalité des hybridations constantes qui font la richesse de l’histoire humaine. Cette vision me paraît aujourd’hui moins pertinente que jamais.
Pour moi, la spécificité européenne est historique : ce petit bout de terre à l’extrême ouest de l’Eurasie, peut-être à cause de son climat tempéré, a connu avant les autres une densité de population plus élevée, on s’est disputé la terre, bien rare – ce qui a conduit au cadastre, au droit de la propriété… – , à l’abolition du servage, parce que les êtres humains n’étaient pas des biens rares, mais aussi à la multiplication des guerres, à un enchaînement de violences exceptionnel, et finalement à la conquête du reste du monde par l’Europe.
Hans Kundnani souhaite que cette histoire soit connue y compris dans sa face sombre. Il a raison, mais il a tort si c’est pour demander aux Européens de s’excuser de leur histoire. Les Européens doivent connaître leur histoire non pour faire acte de contrition, mais pour comprendre à quel point leur expérience n’est pas transposable au reste du monde, et tempérer leur universalisme de modestie historique.
Ne pensez-vous pas que le propre d’un rapport réel entre le politique et la mémoire c’est le palimpseste, l’inquiétude, la dénégation ?
Nous n’allons pas annihiler notre mémoire, nous n’allons pas éliminer les « Indiens d’Europe », comme j’ai pu l’écrire, car nous sommes les Indiens d’Europe et c’est notre mémoire qui fait l’Union. C’est donc bien cela qui est compliqué dans la construction de l’Europe : nous ne pouvons pas nous priver de notre mémoire, mais cette mémoire, outre le fait qu’elle est celle de conflits entre pays européens, est associée à la brutalité des conquêtes coloniales, à la traite des noirs… Pourtant, l’Europe a unifié le monde, et si le monde se pense comme totalité, c’est bien grâce à l’Europe. Ce n’est pas une pensée chinoise ou des colloques savants qui ont imposé cette vision mais bien toute la violence d’un continent qui possédait une supériorité technologique sur le reste du monde et qui l’a alors exploité et conquis.
Cette prise de conscience conduit certains à remettre en cause l’universalisme européen parce qu’il serait celui des esclavagistes et des conquistadors. Oui, l’histoire européenne est une histoire remplie de crimes et elle nous oblige à réfléchir sur la construction d’une identité européenne. Mais l’histoire n’est pas un conte moral. Il n’y a pas de jugement moral de l’histoire. Par exemple, Colbert est aujourd’hui considéré par certains comme un criminel parce qu’il a rédigé le Code noir. Et ce personnage, que l’on célébrait parce qu’il a été l’un des constructeurs de l’État moderne, serait en réalité un affreux esclavagiste. C’est absolument vrai, mais en même temps, le Code noir était une manière de réguler les atrocités qui n’étaient pas perçues comme telles au XVIIème siècle. Je suis provocant bien sûr mais c’était, à l’époque, une sorte de progrès. Platon, Socrate et beaucoup d’autres philosophes vivaient également dans des sociétés esclavagistes sans pour autant militer pour l’abolition de l’esclavage. Mais ce n’est pas une raison de cesser de les lire.
Oui, l’histoire européenne est une histoire remplie de crimes et elle nous oblige à réfléchir sur la construction d’une identité européenne. Mais l’histoire n’est pas un conte moral.
jean-Marie Guéhenno
Découvrir l’histoire de l’Europe, c’est découvrir que certains éléments de notre histoire peuvent être considérés comme des crimes et étaient effectivement des crimes même s’ils n’étaient pas pensés comme tels. Il ne s’agit certainement pas de tomber dans un relativisme où l’esclavage pratiqué au XVIe siècle était acceptable. L’esclavage était bien une chose terrible et ce déjà au XVIe siècle. Est-ce que cela condamne pour autant ce siècle, ou l’Europe dans ce siècle ? Absolument pas, ce sont bien deux choses différentes. Le savoir historique n’a pas pour fonction de nous aider à juger le passé du haut du tribunal du présent, mais à l’inverse de nous contraindre à un regard modeste sur notre présent, en jetant un regard lucide sur le passé qui l’a précédé et qui nous a construit.
L’histoire est pleine de tours et de détours et si nous pouvons aujourd’hui condamner l’esclavage, c’est en nous haussant sur les épaules de tous ceux qui nous ont précédés. Nous ne sommes pas de plain-pied avec nos ascendants, notre histoire est comme un coquillage, accumulant les couches de nacre que le passé a déposées pour faire de nous ce que nous sommes aujourd’hui. C’est très difficile pour les Européens d’admettre et de penser cela, y compris pour moi d’ailleurs. Mais je pense que cet effort d’accepter son histoire est un élément de l’identité, d’une identité européenne, d’un projet européen et si nous nous privons de notre histoire, nous nous privons également de notre avenir. Il faut être capable de voir dans notre histoire ce que celle-ci a de particulier, car c’est cette particularité qui nous distingue du reste du monde.
L’Europe est le continent où il y a eu le plus de guerres, et ce principalement du fait de la concentration des peuples en Europe, même si je ne sais pas s’il faut adopter la théorie des climats de Montesquieu. L’Europe est cet empilement de peuples dans un espace restreint qui se sont entretués pendant des siècles en même temps qu’ils conquéraient violemment, à force de massacres, le reste du monde.
La paix n’est donc pas évidente, nous ne pouvons la prendre comme une donnée et si leçon il y a – même si l’histoire comme leçon est toujours à prendre avec précautions – c’est que l’on devrait avoir, plus que dans le reste du monde, le sentiment de la fragilité des sociétés. Et au fond, que des peuples aient conscience de leur fragilité est un atout. C’est seulement en pensant que l’air que nous respirons n’est pas une donnée mais quelque chose que nous nous efforçons de conserver chaque jour que nous échapperons à une complaisance satisfaite, que nous pourrons nous projeter dans l’avenir et rêver.
Pour la première fois depuis l’avènement des États-nations, nous avons l’impression de plus en plus précise que la réalité politique et géopolitique structurante au niveau mondial ne concerne plus vraiment l’espace européen. Le barycentre du monde a, au fond, quitté l’Europe qui se trouve par là « provincialisée ». Mais paradoxalement, on voit également un aggiornamento impressionnant dans la façon dont les institutions européennes, principalement, investissent le domaine géopolitique. Comment comprenez-vous ce mouvement paradoxal ?
Je crois que c’est un fait qu’avec la fin de la Guerre froide, l’Europe a perdu sa centralité stratégique. L’Europe n’était plus l’acteur principal depuis 1945 mais la bataille se jouait tout de même sur le théâtre européen. Avec la fin de la Guerre froide, l’Europe passe aux marges de la confrontation stratégique. Pour un continent qui se pense dans l’universel, être brusquement aux marges de la scène mondiale constitue un choc profond.
Face à ce choc, les réactions sont extrêmement diverses. La tentation de sortir de l’histoire existe et certains pensent que, si l’hypothèse catastrophique d’un conflit en Asie se concrétisait, l’Europe devrait tenter d’être comme l’Amérique latine dans la deuxième guerre mondiale, en retrait face à une guerre où la destruction serait sans commune mesure avec ce que l’humanité a pu connaître auparavant. Beaucoup pensent que la France, avec son éternel rêve de gloire, a la prétention d’être partout à la fois et que cette prétention est dangereuse car elle pourrait entraîner toute l’Union dans des conflits qui nous détruiraient et où nous ne sommes pas les maîtres du jeu. Les partisans du retrait ne manquent donc pas d’arguments pour prétendre que cette sortie de l’histoire serait une chance pour l’Europe, car l’histoire est tragique et violente. L’Europe a eu vingt siècles de violence. Si elle jouait un rôle moins central dans les violences de demain, ce ne serait pas si mal, et Jacques Delors avait peut-être tort de parler avec mépris de la « grosse Suisse » que pourrait devenir l’Europe.
Je pense cependant que, pour des raisons stratégiques, éthiques et propres à l’identité de l’Europe, ce rêve de retrait n’est pas une option réaliste, même si les Européens ne joueront plus les premiers rôles. Sur le plan stratégique, cette idée que l’on peut sortir du monde en catimini quand on est entouré par de grands fauves, tout en pensant que ces derniers nous laisseront en paix, implique une certaine naïveté. Par ailleurs, beaucoup d’États européens ne sont pas prêts à renforcer leur défense, notamment face à la Russie et ils comptent donc plus que jamais sur la garantie américaine. Mais demander aux États-Unis de les protéger contre la Russie tout en refusant de s’engager à leurs côtés en Asie n’est pas un contrat très intéressant pour l’allié américain.
Au-delà de ce raisonnement de stratégie classique, il y a des raisons existentielles, touchant à l’identité européenne, qui empêcheront sans doute l’Europe de choisir la voie du retrait. Les Européens ne peuvent pas se penser hors du monde sans renier leur histoire, et ce qui peu à peu a construit une identité européenne. Ce chemin que nous avons emprunté, qui a été parsemé de nombreux crimes, est aussi celui de l’universalisme européen, d’une pensée-monde. L’abandonner, ce serait aussi abandonner ce qui aujourd’hui fait le ciment de l’Europe, un équilibre rare entre une pensée de l’universel et l’affirmation du particulier et de l’individu. Le chacun pour soi d’une posture de retrait du monde toucherait très logiquement chaque pays européen : ce ne serait pas seulement l’Europe qui se retirerait du monde mais chaque pays européen qui se retirerait d’une perspective européenne. L’Europe perdrait alors la capacité de défendre ce qui fait sa spécificité et sa grandeur.
Pour des raisons stratégiques, éthiques et propres à l’identité de l’Europe, le rêve de retrait n’est pas une option réaliste, même si les Européens ne joueront plus les premiers rôles.
jean-Marie Guéhenno
L’équilibre européen entre la mémoire et le contrat nous distingue en effet non seulement des États-Unis mais également de la Chine. Au-delà de la compétition géostratégique entre Chine et États-Unis, la question est posée des sociétés que nous voulons construire. Si nous nous inscrivons dans la ligne européenne d’un individu qui s’épanouit dans le collectif et que nous essayons de trouver un équilibre à travers l’histoire entre cette extraordinaire libération qu’est la célébration de l’individu – qui vient des monothéismes et du christianisme en particulier – et l’idée que l’action de l’individu prend sa dimension éthique quand elle s’inscrit dans une dimension collective, nous ne pouvons pas nous replier sur nous-même.
Un avenir dont l’Europe serait absente serait un avenir appauvri : ou bien l’individu se détacherait du collectif – ce qui est la pente américaine – ou bien triompherait une vision du collectif portée par la tradition chinoise, telle que je la comprends à travers certains textes d’Anne Cheng et surtout de François Jullien. Dans cette tradition, bien antérieure au parti communiste chinois, on accède à l’universel à partir de la famille, et la priorité est donc donnée au collectif. Au contraire, le christianisme a opéré en Occident une rupture avec le monde antique, et a mis l’individu au centre de toutes choses. Nous voyons bien d’ailleurs, avec l’épidémie du Covid, combien l’harmonie asiatique – une expression que Ban Ki-moon, avec qui j’ai travaillé pendant deux ans, employait très fréquemment – prime sur l’affirmation de l’individu.
Dans le rapport entre l’Europe, la Chine et les États-Unis, il y a donc plus qu’une question de géopolitique, il y a une question de fond sur l’idée que l’on se fait de la société et de l’équilibre entre l’individu et le collectif. L’Europe n’a pas le luxe de pouvoir se retirer du monde.
Comment l’Europe peut-elle alors s’engager dans le monde ? Doit-elle revenir à l’atlantisme ou peut-elle trouver une forme de non-alignement, une sorte de « troisième voie » ?
Je ne pense pas que les Européens puissent trouver une forme d’équidistance entre d’un côté les États-Unis et de l’autre la Chine. Bien que la société américaine soit en crise, les États-Unis restent tout de même, par mille traits, nos proches cousins. Au contraire, la Chine, non seulement par sa tradition mais également par son régime politique actuel, nous demeure étrangère.
Dans mon livre, j’évoque les différents avenirs possibles de la Chine.
Je pense qu’il y a un avenir possible d’ossification. Je trouve très intéressant d’observer qu’au début de la pandémie, les apparatchiks du Parti communiste de Wuhan mentaient à leurs supérieurs et les bonnes décisions n’étaient donc pas prises, conséquence classique d’un système bureaucratique où les fonctionnaires cherchent à se protéger. Si Xi Jinping essaie de consolider son pouvoir en se reposant sur les apparatchiks du parti communiste, comme jadis les dirigeants de l’Union soviétique, – et même si les Chinois ont une vieille tradition commerciale qui les distingue de la Russie – tôt ou tard, la Chine perdra une bonne part de la tonicité qui impressionne le monde aujourd’hui. La manière dont le Parti communiste chinois essaie de mettre au pas les grandes entreprises de données chinoises, car il craint que la puissance de ces dernières ne finisse par menacer son propre pouvoir, va dans ce sens. Le moyen le plus logique de contrôler le pays serait alors le verrouillage du pouvoir par la bureaucratie et je pense que, les mêmes causes produisant les mêmes effets, et la nature humaine ayant quelques traits fondamentaux et universels, chaque apparatchik jouera son petit jeu personnel et dans un pays d’1,5 milliard d’habitants, où l’œil de Xi Jinping ne peut pas tout voir, tous les éléments d’une sclérose bureaucratique seront réunis.
Je ne pense pas que les Européens puissent trouver une forme d’équidistance entre d’un côté les États-Unis et de l’autre la Chine. Bien que la société américaine soit en crise, les États-Unis restent tout de même, par mille traits, nos proches cousins.
jean-Marie Guéhenno
L’autre option, c’est de contourner la difficulté en faisant de plus en plus confiance à des algorithmes et en leur déléguant le pouvoir. D’une certaine manière, ce serait le triomphe des machines sur les êtres humains et la Chine pourrait peut-être alors préserver son dynamisme. Pour revenir à des enjeux de civilisations, ce serait une situation où le collectif aurait gagné sur l’individu mais avec l’aide de moyens que ni Confucius ni Mencius n’avaient imaginés. C’est un avenir assez terrifiant où la flamme de l’individu, telle que l’occident l’a allumée, celle qui a permis la transformation du monde, avec son cortège de violences, mais aussi de créativité et d’imagination jamais satisfaite, pourrait s’éteindre ou du moins cesser d’être humaine. Je n’aime pas cela. C’est là, à mon sens, que les Européens doivent faire entendre leur voix.
Dans un monde hybride où les États n’ont pas disparu, où les jeux de puissance n’ont pas non plus cessé d’exister, mais où le nombre d’acteurs s’est multiplié, il y a un enjeu géopolitique pour l’Europe, mais le théâtre sur lequel se livre cette bataille est inédit : c’est celui du nouveau pouvoir que confère la maîtrise des données. L’Europe a raté le train de la première révolution des données, et les principales entreprises de données sont américaines ou chinoises. La priorité pour les Européens est donc de réfléchir à ce que représenteront les données dans la société de demain. C’est un défi technologique – les européens seront-ils capables d’être parmi les premiers dans le quantum computing ou dans l’intelligence artificielle ?- et un enjeu politico-institutionnel. L’Europe est très fière de sa directive RGPD qui protège les données privées plus efficacement que les normes en vigueur aux États-Unis – ce qui prouve encore une fois la puissance normative de l’Union. Mais cette directive soulève autant de questions qu’elle n’apporte de réponses . J’en parle plus en détail dans mon livre.
Le nouveau pouvoir des données va nous obliger à définir en termes juridiques l’équilibre que nous voulons établir entre l’individu et le collectif : le débat philosophique rejoint ici le débat politique. Sommes-nous propriétaires de nos propres données ? La question simplifie un problème complexe car les données sont presque toujours le produit de transactions. À qui appartiennent par exemple les données issues de la rencontre entre deux individus ? Les exemples se multiplient dans la vie quotidienne au fur et à mesure que nos vies se « digitalisent ». Chaque instant de notre vie laisse désormais une trace.
Nous nous focalisons sur l’aspect commercial des données. Mais il y a également un aspect d’intérêt public, ce qu’a montré par exemple la prévention liée au Covid. Si nous considérons uniquement le domaine de la santé, nous voyons bien que l’accumulation des données est bénéfique, car elle permet d’établir des corrélations qui font progresser la connaissance et que l’être humain ne serait pas capable d’établir. De ce point de vue, plus on collecte de données, mieux c’est.
Si nous considérons uniquement le domaine de la santé, l’accumulation de données est bénéfique, car elle permet d’établir des corrélations qui font progresser la connaissance et que l’être humain ne serait pas capable d’établir. De ce point de vue, plus on collecte de données, mieux c’est.
jean-Marie Guéhenno
À travers ces quelques exemples, nous voyons bien que l’approche par la réglementation de la propriété des données effleure seulement le problème. De même, les questions de concurrence, qui se posent notamment à propos d’Amazon et de son utilisation des données, laissent de côté des aspects fondamentaux. Pour comprendre le caractère révolutionnaire de l’âge des données, il faut le comparer à la fois à l’invention du livre imprimé et à la première révolution industrielle. Il redéfinit les conditions dans lesquelles se crée et se diffuse le savoir tout en redistribuant et en concentrant la richesse. La collecte et le traitement des données correspondent aujourd’hui, d’une certaine manière, à ce qu’était hier l’accumulation du capital physique. Nous nous nous posions alors la question de la propriété du capital. Devait-elle être publique ou privée ? Qui devait en avoir le contrôle ? Des questions voisines se posent pour les données, mais les données, à la différence des biens matériels, ne disparaissent pas après leur utilisation, elles ont des usages multiples, et à la différence des machines de l’âge industriel, où les machines ont démultiplié la force physique, l’intelligence artificielle va démultiplier nos capacités intellectuelles. L’âge des données va donc bouleverser l’organisation des sociétés beaucoup plus radicalement que la révolution industrielle.
L’enjeu pour l’Europe est de faire de son retard relatif un atout. Toutes les grandes entreprises de données sont américaines, ce qui est pour les Etats-Unis à la fois un avantage et un handicap. Les entreprises européennes sont loin derrière, mais l’Europe est un gisement extraordinaire de données, car elle reste un des endroits les plus riches de la planète. L’Union Européenne a donc plus de marge de manœuvre que les États-Unis pour inventer des solutions originales, et elle peut se permettre d’être audacieuse dans la façon dont elle va valoriser et protéger ce capital immatériel. C’est une question absolument vitale pour son avenir, et elle ne peut être traitée qu’au niveau européen.
Un des éléments forts de votre livre est l’idée qu’au fond, la politique sert à faire face aux problèmes les plus importants pour pouvoir ensuite les transformer. Et, alors que nous sommes dans une séquence électorale présidentielle, nous nous rendons compte que le débat politique ne pose pas les questions à ce niveau. Comment expliquer le décalage entre les transformations majeures, les questions essentielles qui sont face à nous et la difficulté qu’a le débat politique de se perdre sur des éléments superficiels ?
La politique traditionnelle repose sur l’idée que chaque parti propose un projet d’ensemble, une utopie totalisante. Mais les électeurs n’y croient plus, ils pressentent qu’aucun responsable politique n’est en mesure de gérer toutes les questions. Le monde est à géométrie variable. Il y a des questions qui relèvent de la ville, d’autres qui relèvent de la nation, d’autres de l’Europe, d’autres du monde, et d’autres d’un espace virtuel, mais les recettes du fédéralisme traditionnel ne fonctionnent plus, notamment à cause de la concurrence que le monde virtuel fait aux communautés géographiques.
Il y a donc un décalage entre les promesses de la politique traditionnelle et les réalités du monde d’aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle la politique se déporte aujourd’hui vers un défilé de symboles qui permettent de construire une identité à défaut de bâtir un projet. Le projet totalisant n’est plus crédible. C’est ce qui explique le succès des mouvements qui mobilisent sur un sujet spécifique – droits humains, genre, environnement… Ils satisfont le besoin de collectif qui, il y a vingt ans, aurait trouvé sa réponse dans l’adhésion à un parti. Les partis politiques perdent donc peu à peu leur rôle central, à l’exception peut-être des écologistes.
Il est possible que l’écologie, dans l’avenir, joue le rôle que le socialisme a joué dans le passé. La vision totalisante de tout projet écologique pourrait permettre de ressouder les communautés politiques autour d’un projet collectif. Mais pour que cela se produise– c’est un point que je développe dans mon livre et auquel je crois beaucoup – il faut que les écologistes cessent de nous promettre l’enfer comme les staliniens pouvaient nous promettre l’avenir radieux socialiste. Dès que l’on promet l’enfer ou le paradis, le débat démocratique s’arrête. Pour que l’écologie permette la renaissance du débat politique, il faudra que tout le monde soit écologiste : une vraie discussion politique pourra alors s’engager sur le degré de risque qu’une société est prête à accepter.
Il est possible que l’écologie, dans l’avenir, joue le rôle que le socialisme a joué dans le passé. La vision totalisante de tout projet écologique pourrait permettre de ressouder les communautés politiques autour d’un projet collectif.
jean-Marie Guéhenno
Cette question du partage du risque est la plus politique des questions, et elle permettra peut-être la réinvention de la politique : les arbitrages liés au risque, arbitrages entre le présent et l’avenir, entre son pays et un ensemble plus vaste n’ont pas de réponse technique. La science peut et doit donner son évaluation du risque, qu’il s’agisse d’une centrale nucléaire, d’OGM ou d’un vaccin, mais c’est à la société dans son ensemble, et donc à la politique, de trancher sur le niveau de risque acceptable. Les polémiques autour de la gestion du covid illustrent les dangers d’une confusion entre la légitimité du savoir et la légitimité démocratique, quand les politiques se cachent derrière la science, et les savants prétendent imposer des décisions qui ne doivent pas leur appartenir.
C’est une question que j’ai indirectement rencontrée lorsque je m’occupais du Timor-Leste pour l’ONU. Le Timor oriental est un pays très pauvre qui n’avait rien quand il a pris son indépendance de l’Indonésie mais qui possède néanmoins des ressources pétrolières et gazières. Les Norvégiens ont alors conseillé aux Timorais, à juste titre, de mettre de l’argent dans un fonds pour les générations futures. Mais ce fonds pouvait-il être géré comme celui de la Norvège ? Absolument pas. En Norvège, presque aucun enfant ne meurt avant l’âge de 5 ans. Au contraire, au Timor-Leste, la mortalité infantile était très élevée. Quelle mère timoraise accepterait de mettre les richesses de Timor dans un fonds souverain pour que, dans vingt ans, les Timorais puissent continuer à bénéficier de la rente pétrolière si elle craint que ses enfants soient morts dans vingt ans ? Le prix de l’avenir ne peut pas être le même en Norvège et au Timor Leste, et ce n’est pas une question que les scientifiques peuvent résoudre. C’est une question purement politique, qui ouvre des débats comparables à ceux que devrait susciter le changement climatique : quels sont les horizons temporel et géographique de nos solidarités ? L’écologie ne peut pas viser l’élimination des risques, mais seulement leur partage et leur maîtrise.
Malheureusement, nous raisonnons de moins en moins en termes de risques, nous rêvons d’une société sans risques. Mais une société qui fait de chaque vie individuelle un absolu cesse d’être une société. Cela ne signifie pas que nous devons accepter le sacrifice de chacun pour le collectif -ce serait une vision totalitaire -, mais cela veut dire qu’il y a un équilibre à trouver entre la sauvegarde de la vie individuelle et le projet collectif. Aujourd’hui, cet équilibre est rompu car si le moindre risque se présente, les politiques sont paralysés – c’est le fameux principe de précaution, traduction juridique de la fragilisation de l’idée de société. Ce refus de l’incertitude, ce désir de se retrouver dans une bulle qui nous enveloppe et nous protège rejoignent ce que j’évoquais plus haut à propos de notre désir d’harmonie, le rêve de collectif qui point chez des individus épuisés de vivre dans une société en miettes. Je parle dans mon livre d’une « tentation chinoise », une société où le refus du risque et la séduction d’un bonheur fabriqué – par les algorithmes de facebook ou par le parti communiste chinois- débouchent sur le contrôle total, et finalement sur la tyrannie. Comme les poissons ne savent pas ce que c’est que l’eau, nous oublions que l’incertitude est la condition de notre liberté.

