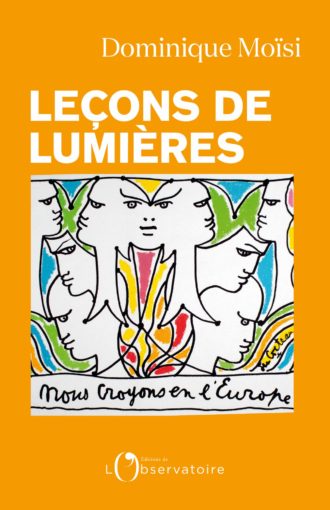« Nous pensons que nous serons demain ce que l’Amérique est aujourd’hui », une conversation avec Dominique Moïsi
Le contexte géopolitique a connu des revirements majeurs durant ces derniers mois : retrait d'Afghanistan, crise des sous-marins ou encore tensions croissantes entre les États-Unis et la Chine. Dominique Moïsi, chercheur à l'Institut Montaigne, revient dans cet entretien sur ces évènements et sur son propre parcours.
[Entretien réalisé le 28 septembre 2021]
Pour revenir sur la crise de l’annulation du « contrat du siècle » français par l’Australie, un des développements très récents est le soutien que commence à recevoir la France au niveau européen. Ursula von der Leyen puis le ministre de la Défense allemand ont apporté leur soutien à la France, alors même que l’Allemagne faisait partie des candidats malheureux à la vente de sous-marins à l’Australie quand la France avait initialement remporté le contrat.
On a l’impression que cette prise de position s’insère dans un contexte européen où les acteurs se positionnent plus clairement au sein du champ géopolitique. Nous avions publié un entretien avec Charles Michel dans lequel il indiquait que lorsque les États-Unis ont fait le choix de négocier avec les Talibans puis de proposer leur retrait, ils ont proposé « très peu de négociations avec les partenaires européens, pour ne pas dire aucune ».
La Commission et le Conseil deviennent-ils des acteurs géopolitiques ? Comment analyser ce soutien quelque peu inattendu ?
Il s’agit, je crois, d’évènements mineurs en eux-mêmes – parce qu’au fond, cette substitution des sous-marins nucléaires américains à des sous-marins classiques français est certes importante et humiliante pour la France, mais ce n’est pas un tournant dans l’histoire du monde. Cet événement a juste un effet de miroir grossissant, comme une loupe qui, soudain, éclaire une réalité dont nous avions l’intuition mais ne saisissions pas encore toute l’importance.
Là, je dirais qu’il y a plusieurs lectures possibles. La lecture classique est celle de la marginalisation de l’Europe, le fait que l’Amérique s’est réellement tournée vers l’Asie – c’est la confirmation du choix fait par l’Amérique d’Obama de quitter l’Europe pour donner la priorité à l’Asie. C’est la conclusion de trente années écoulées depuis la chute du Mur de Berlin. Depuis 1989, l’Europe n’est plus la première ligne de défense des États-Unis, puisque avec la disparition de l’URSS, l’Europe ne connaissait plus de danger immédiat à ses frontières.
Il me semble qu’il y a une deuxième lecture possible de l’évènement qui consisterait à dire que ce n’est pas seulement l’Europe qui est marginalisée mais que c’est bien le monde occidental dans son ensemble qui fait face à un processus de déclin accéléré. Je serais tenté de faire un parallèle entre 1989 et 2021. Au lendemain de 1989, il y a une illusion occidentale qui consiste à dire « nous avons gagné » alors que c’est l’URSS qui a perdu. Pour comprendre ce qui se passe aujourd’hui au niveau de l’indo-pacifique, il faudrait repartir de cette erreur de 1989 mais la redéfinir dans un contexte différent. La Chine pense qu’elle est en train de gagner, or ce n’est pas la Chine qui gagne mais l’Occident qui entre dans une phase de déclin accéléré. Voici la lecture stratégique que je ferais de l’évènement.
Il y a une lecture plus tactique qui consisterait à dire qu’en réalité, les Australiens n’ont pas trahi la France parce qu’on leur offrait des sous-marins nucléaires mais parce que les sous-marins qui leur étaient offerts étaient américains. La montée des tensions en Asie a fait que l’Australie s’est crue dans la nécessité de se doter d’un protecteur beaucoup plus visible, puissant et dissuasif vis-à-vis de la Chine et, à ce jeu, la France ne faisait pas le poids. Nous pourrions même penser que, si la France avait proposé des sous-marins à propulsion nucléaire, cela n’aurait rien changé.
Qu’il y ait une dimension culturelle, une « anglosphère » au sens des Anglo-Saxons d’hier chers au général de Gaulle, est certes toujours vrai.
Je crois qu’il est nécessaire d’analyser la position américaine. Le point de départ, c’est Biden en tant qu’héritier d’Obama. Mais, au fond, dans sa volonté d’envoyer un message fort à la Chine et un message fort aux membres du Quad en Asie, l’idée qu’il puisse en même temps s’agir d’une trahison faite à la France n’est peut-être même pas venue à l’esprit des Américains. Dans une de mes chroniques dans Les Échos, j’affirmais que le monde de 2021 ressemblait de plus en plus à l’Europe de 1913 avec la Chine dans le rôle de l’Allemagne de Guillaume II et la France comme victime collatérale de cette nouvelle Guerre froide entre la Chine et les États-Unis. Pour la première fois depuis fort longtemps, l’Amérique a un secrétaire d’État, Anthony Blinken, qui est francophone et dont la famille est en partie française. Et pourtant –pour peu qu’il en ait été informé – il ne lui est pas venu à l’esprit que l’affaire des sous-marins pouvait nuire à la France et que cette dernière n’allait pas accepter cette humiliation sans réagir. Cette crise illustre le fait que nous ne sommes définitivement plus au centre des préoccupations des États-Unis.
Je crois que les principales victimes de la rupture du « contrat du siècle », au-delà des Français, ce sont l’OTAN et l’Union européenne. L’OTAN aura du mal à s’en sortir dignement. Après la défaite militaire à Kaboul, la première défaite militaire de l’OTAN, il y a la démonstration de la vacuité de cette alliance où nous pouvons nous trahir, où nous ne communiquons pas. Je pense que Jean-Yves le Drian a raison quand il dit « Cela s’est fait dans notre dos ». Il se peut même que ni le ministre australien des Affaires Étrangères ni son homologue américain n’aient été au courant, qu’il s’agissait d’une diplomatie au sommet, secrète, et qu’il fallait qu’AUKUS naisse comme subitement pour que les Chinois n’aient pas le temps de le saboter. Il fallait prendre les Chinois par surprise et donc prendre aussi les Français par surprise.
Comment définir les relations entre les États-Unis et la France ? Sont-ce des alliés, des amis, des clients ? Quel cadre conceptuel peut-on imaginer depuis le retrait de Kaboul ?
J’aimerais revenir sur deux points pour répondre à votre question : la relation franco-américaine et la relation transatlantique.
La relation franco-américaine d’abord. J’ai suivi à Harvard les cours de Stanley Hoffman, qui était franco-américain, juif viennois et avait été à Sciences Po et fait son doctorat en France avant de partir à Harvard. Il disait toujours « Nous sommes deux pays en compétition l’un avec l’autre depuis le début ». Est-ce la Révolution américaine qui a inspiré la Révolution française ? L’Amérique aurait-elle existé sans les Lumières ? Quand la France est la grande nation, l’Amérique naît lentement à la puissance. Quand les États-Unis deviennent une superpuissance, la France n’est plus qu’une puissance moyenne aux ambitions pourtant mondiales.
Mais l’histoire qui pouvait exister entre nous est au point mort. C’est un passé que nous célébrons avec émotion. La Seconde Guerre mondiale ou le 6 juin donnent lieu à de grands évènements mais leur sens s’efface. Depuis cinquante ans déjà, les Américains n’ont plus cette relation privilégiée avec la France. Cet éloignement progressif s’illustre dans l’histoire récente, notamment avec la guerre en Irak, mais cela relève plus du théâtre que de la réelle tension.
Fondamentalement, les Américains se soucient peu de la France. En revanche, pendant longtemps, l’Amérique a été l’aune à partir de laquelle nous mesurions notre déclin, notre reste de grandeur. Mais aujourd’hui, dans la mesure où nous déclinons ensemble, ce rapport est également brisé. Vue de Washington, la colère française apparaît comme le caprice d’une dame qui a été très belle mais qui l’est moins, du fait de l’âge, une sorte de Castafiore qui hurle après sa beauté perdue.
Ce choc pourrait induire des revirements idéologiques de certains diplomates et hauts fonctionnaires, de la même façon que certains diplomates ont cessé d’être atlantistes après la guerre en Irak. Est-ce que nous pourrions imaginer un changement de ce type parmi les individus qui forment la matière première de la politique étrangère française comme européenne ?
L’hypothèse que nous allons connaître un spectaculaire renversement d’alliances traverse la tête de certains. Je suis sûr qu’il y a des diplomates qui aimeraient que nous tirions les leçons de ce qui vient de se passer, qui se disent que, si l’hésitation entre les États-Unis et la Chine était hier impossible, cette « trahison » de l’Amérique rebat les cartes. Mais je ne pense pas que ce renversement d’alliances adviendra. Si nous faisons de la realpolitik, si nous dépassons les émotions, les sentiments d’humiliation, l’Amérique ne nous menace pas, sauf de son dédain et de son indifférence. Au contraire, la Russie est à nos portes et la Chine se comporte de plus en plus comme le faisait l’Allemagne de Guillaume II.
L’Occident sur le déclin ne doit pas ajouter à ses malheurs la division de ses membres. C’est là une situation paradoxale. Face à la montée de la Chine, nous aurions besoin d’un Occident fort et pas seulement d’une Europe forte. Or l’Occident est considérablement affaibli. Le phénomène Trump n’était pas une parenthèse.
J’ai lu attentivement l’entretien qu’Emmanuel Macron a donné au Grand Continent et je partage l’essentiel de ce qu’il vous a dit. Son ambition est légitime. Ce n’est pas qu’elle soit noble ou non : elle est conforme à ce qu’est la réalité. Mais nos partenaires vont-ils nous suivre ? Rien n’est moins sûr. De la même manière que les Australiens n’ont pas hésité entre Washington et Paris en matière de sous-marins, les pays de l’Est et du Centre de l’Europe n’hésiteront pas entre Washington et Bruxelles ou Paris.
Il faut entrer dans le détail des choses. À Kaboul, quand la catastrophe s’accélère, les Français et les Allemands ont deux réactions différentes. Les Français refusent de rétablir les relations diplomatiques avec les Talibans tant que leurs demandes n’ont pas été respectées. Les Allemands, au contraire, sont tentés par la réouverture de leur ambassade. Sur une question centrale comme celle-ci, au cœur de l’identité politique des Européens, nous ne sommes pas capables d’avoir une réaction commune.
Je ne sais pas quel sera le résultat des élections en Allemagne ce dimanche mais je ne suis pas sûr qu’un chancelier fort, charismatique, pour qui la diplomatie est une priorité, sorte des urnes. Nous risquons donc d’avoir une Allemagne trop faible, et la France ne pourra alors pas mener à bien son projet européen. La seule bonne nouvelle qui existe aujourd’hui est que l’Italie est dirigée par un dirigeant d’une très grande qualité, mais cela ne suffit pas. Le couple franco-italien ne peut se substituer au couple franco-allemand et l’Italie ne peut se substituer au Royaume-Uni sur le plan de la défense.
Il y a là un phénomène très étudié, et à juste titre. Nous travaillons, à l’Institut Montaigne, depuis le Brexit, à l’établissement et au maintien de politiques de défense commune entre le Royaume-Uni et la France au-delà du Brexit. Ce qui vient de se passer n’annule pas la nécessité de l’existence de liens étroits entre Paris et Londres mais rend cependant cette opération particulièrement difficile, comme en témoignent les formules sur l’opportunisme anglais.
La France devra-t-elle jouer le rôle de « lanceur d’alertes » pour réveiller les Européens et maintenir l’étroitesse des relations transatlantiques ?
C’est juste. J’avais usé dans un papier de l’expression de « lanceur d’alerte », mais je n’avais pas pu développer. Une comparaison m’était venue à l’esprit. J’imaginais la France avoir un rôle similaire à celui du Vatican, un rôle d’indignation. Ce qui importe alors, c’est la cohérence entre le message et le messager. Or Emmanuel Macron semble tout indiqué pour exprimer cette indignation. Il doit rappeler à nos alliés que si nous quittons la logique du pacta sunt servanda pour adhérer à une interprétation très étendue du clausala rebus sic stantibus, nous naviguerons sur des eaux dangereuses.
Il faut aussi indiquer aux Russes qu’ils se trompent stratégiquement, que la Chine est le seul pays qui les menace du point de vue de l’étendue de leur territoire et qu’ils vont dans la mauvaise direction, puis dire aux Chinois que les parallèles avec la Première Guerre mondiale existent. Il s’agit, en somme, de tenir un discours global de rationalité, fidèle à ses principes et le tenir d’autant plus librement que nous sommes conscients de nos faiblesses.
Bien sûr, c’est une tâche difficile car un dirigeant doit satisfaire son opinion publique, et en l’occurrence Emmanuel Macron cherche également à contenter cette partie de la droite française – aux visions faussement gaullistes ou aux intérêts économiques bien compris – qui souhaite faire table rase de tout ce qui nous sépare de la Russie.
Le livre de Jean-Marie Guéhenno Le premier XXIe siècle est paru récemment. C’est un des livres les plus intéressants paru en français sur les relations internationales depuis L’ensauvagement : le retour de la barbarie au XXIe siècle de Thérèse Delpech. Jean-Marie Guéhenno pose le même type de questions et y apporte des réponses auxquelles je ne souscris pas toujours. Il a, au fond, un regard mélancolique et une vision très noire du monde. Il ne croit notamment plus du tout en l’Union et décrit un fonctionnement complètement erratique de l’Union européenne.
Sur ces questions, je suis partagé entre deux approches. Une partie de moi pense qu’il est trop tard et que le monde occidental est entré dans une phase de déclin accéléré irrémédiable. Notre colère est à la hauteur de notre inquiétude. Nous pensons que nous serons demain ce que l’Amérique est aujourd’hui. Elle n’est pas le bon modèle à suivre mais le mauvais modèle qui nous entraîne dans sa chute, et il n’y a pas grand-chose à faire pour s’en sortir.
Mais mon regard de grand-père me rattrape, et je veux, à la marge, essayer de sauver ce qui peut l’être encore, c’était l’objectif de mon discours de réception du prix Spinoza paru en tant que Leçon de Lumières. Il est frappant que cet ouvrage n’ait pas eu de succès. Il propose une vision volontariste de l’Europe dans laquelle les gens ne se reconnaissent pas.
Je voudrais à présent revenir sur votre parcours. Ursula von der Leyen a qualifié sa Commission de « géopolitique » et ce concept est récemment devenu central dans les discours à la fois sur l’Europe.
Or vous avez été un des premiers à parler de « géopolitique européenne ». Pourquoi avez-vous fait cours au Collège d’Europe, au campus de Natolin, entre 2001 et 2008 sur la notion de géopolitique européenne à une époque où ce concept était absent du paysage politique et médiatique ? Que voyez-vous dans la transformation d’un terme rare en un terme très usité ?
Je me suis intéressé à ce que nous appelions les « relations internationales » à un moment où ce n’était pas très répandu. Je suis ensuite allé étudier à Harvard sur des questions de géopolitique puis de government et, à l’époque, j’étais considéré comme une curiosité excentrique. Nous étions en pleine guerre du Vietnam, dans l’après mai 68 et ce qui passionne les Américains d’Harvard, ce qui passionne les Français qui viennent à Harvard c’est la « troisième voie », le modèle yougoslave, le rôle des syndicats et la compréhension de mai 68. Quelqu’un qui s’intéressait à la diplomatie et à l’histoire de la diplomatie était complètement anachronique.
Dans les spécialistes de ce que nous appelons aujourd’hui la géopolitique, il y a deux catégories. Il y a ceux qui sont fascinés par la guerre et ceux qui la détestent et qui l’étudient pour mieux connaître l’ennemi. J’appartiens à cette seconde catégorie par mon histoire personnelle, comme fils de survivant d’Auschwitz.
L’expression « géopolitique européenne » fait écho à mon histoire. Lorsque je suis arrivé comme étudiant à Harvard en 1971, j’ai rencontré pour la première fois de ma vie des Allemands, et eux-mêmes n’avaient jamais rencontré de fils de survivant. Alors, lorsque au début des années 2000, Jacques Delors me propose d’enseigner au Collège d’Europe pour préparer l’entrée de l’Europe centrale dans l’Union, j’accepte avec enthousiasme.
Il s’agissait d’appliquer la notion de géopolitique à l’Europe. Ces années à Natolin ont été essentielles pour ma compréhension de l’Union. Mon livre sur La Géopolitique de l’émotion a été accéléré par ce que j’y ai vécu. J’avais en face de moi des étudiants serbes, croates, bosniaques qui sortaient de la guerre, qui avaient connu des victimes dans leur famille respective. Un soir, pour les préparer au cours, je leur avais montré un très long film de la BBC, Warriors, à propos de la guerre qu’ils avaient vécue. Je me suis rendu compte, quand la lumière s’est rallumée, que les étudiants étaient en pleurs, que j’étais allé trop loin. J’ai alors demandé aux étudiants serbes de défendre la position croate et inversement. Ce jeu de rôle m’a permis de comprendre que c’était comme cela que nous pouvions fabriquer des Européens.
Ce que vous entendiez dans le terme de géopolitique est assez différent de son emploi d’aujourd’hui. En tant que spécialiste des relations internationales, comment expliquez-vous que ce terme ait eu autant de succès récemment ?
Mon livre La Géopolitique de l’émotion a été un des livres de géopolitique écrit par un français les plus traduits récemment dans le monde. Il a touché ses lecteurs, même si en France il a été accepté lentement. Il n’était pas considéré comme assez scientifique : pensez-vous, analyser les émotions ! Il s’agissait, selon ses détracteurs, de journalisme astucieux. Mais au fond, ces réactions ne m’ont pas vraiment blessé. Je pensais bien avoir raison et j’étais convaincu que peu à peu, on en viendrait à utiliser ce type d’approche. Nous ne pouvons pas analyser le monde sans y intégrer les émotions.
Par la suite, dans La géopolitique des séries télévisées, je pars de l’étude du 11 septembre 2001. Soudain la géopolitique devient majeure car, « si tu ne viens pas à la géopolitique, la géopolitique vient à toi » comme disait, en d’autres termes, Lagardère dans Le Bossu de Paul Féval. La géopolitique envahit nos cuisines, mais cette fois de manière directe. J’ai trouvé fascinant, dans les commentaires qui viennent d’être déclassifiés de Oussama Ben Laden, qu’il fût persuadé que l’effet des images du 11 septembre serait le même que celui de l’offensive du Têt en 68 au sud du Vietnam. C’est l’inverse qui s’est en réalité produit parce que les individus qui mouraient dans les tours étaient pour l’essentiel des Américains.
La géopolitique entre donc brutalement dans la conscience des individus. Ma présence à l’Institut Montaigne est le produit de cela. Le Président et le Directeur de l’Institut Montaigne se sont rendu compte qu’ils ne pouvaient plus continuer à analyser la France, l’économie, la société s’ils n’intégraient pas une dimension internationale.
Pour conclure, dans votre dernier article s’intitulant « La nouvelle guerre froide a commencé », vous expliquez comment l’optimisme chinois a progressivement été remplacé par une forme de méfiance. Mais vous disiez également, au début de cet entretien, que la Chine faisait peut-être aujourd’hui la même erreur que les Européens faisaient en 1989. L’optimisme est-il remplacé par la crainte ou par une forme d’hubris ?
Pierre Hassner, à la fin des années 1980, affirmait qu’entre les États-Unis de Reagan et l’URSS de Gorbatchev, il y avait un processus de décadence compétitive. Ne peut-on pas dire la même chose aujourd’hui entre la Chine et l’Amérique, entre les systèmes autoritaires et les systèmes démocratiques ?
Pierre Manent et Pascal Bruckner ont écrit un long papier, à la mode si j’ose dire, dans Le Figaro début septembre dans lequel ils disaient « Le pire ennemi de l’Occident, c’est l’Occident ». Mais ne peut-on pas dire, de la même manière, que le pire ennemi de la Chine et de la Russie, c’est eux-mêmes ? Le renforcement du despotisme et l’aventurisme ne vont-ils pas accélérer le ralentissement de la croissance ? Cette formule est un peu malheureuse mais il s’agit bien, d’une certaine manière, d’accélération du ralentissement.
Je termine sur une note inquiète. Nous pouvons dire que la guerre a changé, mais ce sont tout de même des bateaux qui se croisent en mer de Chine, ce sont des avions qui volent dans le ciel, ce sont des sous-marins qui ont des missiles et à un moment donné, la guerre a sa logique propre, qui n’obéit qu’à elle-même. Nous pouvons dire que tout a changé, mais en réalité, les fondamentaux de la nature humaine sont les mêmes et le concept de l’escalade est toujours présent. Personne ne peut sciemment choisir la guerre à l’heure du nucléaire, à l’heure de l’interdépendance économique, mais la guerre par accident peut se produire. Nous ne pouvons pas exclure cette hypothèse.