Fabio Deotto, L’Altro mondo, Bompiani, juin 2021
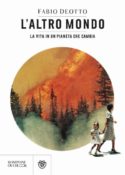
Aux Maldives, les plages disparaissent, à Miami, les rues sont reconstruites un mètre plus haut, la Louisiane s’enfonce à perte de vue, à Franciacorta, le vin devient chaque année plus difficile à produire, et tandis qu’à Venise l’eau salée consume un patrimoine artistique inestimable, d’autres villes se vident de leurs voitures et se remplissent d’animaux.
Au cours de la dernière décennie, la crise climatique est passée du statut de problème des générations futures à celui de préoccupation urgente des générations actuelles. Pourtant, bien que le monde dans lequel nous vivons ait changé sans équivoque et soit désormais très éloigné de celui dans lequel nous avons grandi, nous continuons à le considérer comme inchangé. La faute en revient aux nombreux angles morts qui entravent notre perception de la réalité.
Ce livre jette un nouveau regard sur les histoires réelles de personnes déjà contraintes de faire face à une planète plus chaude, tout en explorant les ballasts cognitifs et culturels qui rendent si difficile l’acceptation du changement en cours. Le résultat est un reportage narratif qui nous aide à voir le nouveau monde dans lequel nous apprenons à vivre.
Joaquim Manuel Magalhães,Canoagem (Aviron), Relógio D’Água, Lisbonne, mai 2021

Joaquim Manuel Magalhães (1945), essayiste, poète et professeur émérite de littérature anglo-américaine, est l’un des poètes portugais contemporains les plus reconnus, lauréat de nombreux prix de poésie et d’essai.
Dans ce nouveau livre, il poursuit son parcours de poète exigeant et inconfortable, étranger aux écoles et aux généalogies, transversal, « insituable ». Le volume sort en même temps et chez le même éditeur qu’une publication de João Miguel Fernandes Jorge, son partenaire de vie.
Boycott nécessaire. Je m’inventais,
insipide créature à la plage.
Un gang sobre accumule une légende.
Coin de pâtisserie, un texte relié
qu’il ne feuilletait pas, la tranche
entre le pouce et l’index. La révolte des conduites
l’érige en opprimé dans son refus.
Il s’habitue à repousser le rancissement et la croyance.
Monotonie du balcon dans le diagramme théâtre,
la ruelle navale, le bric-à-brac et la surface de stockage
sœur par sa largeur du côté militaire de l’emporium.
Une éducatrice enseignait la langue du quotidien.
Mais moi, moi je ne m’assimile pas. Je n’en sus aucune,
la capacité de lire,
la communication personnelle ne m’émouvaient pas.
Dimanche, elle polissait une mercerie.
*
« Connaissez-vous Pasolini ? » « Un rendez-vous dans la ruelle
du côté du tram ? Prenez garde car c’est cher. »
Les garçons lui proposent une tactique débridée.
La boucle d’oreille sur l’oreille droite
n’autorisait pas l’affrètement de vêtements ou de leçons.
Où cette tignasse oppressante aiguisait-elle ?
Latent, le détenu se noyait dans son hectare sectaire,
pour un empêchement, il ne savoure pas la blessure.
(Le brasier vert-de-gris)
João Miguel Fernandes Jorge, Rodeado De Ilha (Entouré par l’Île), Relógio D’Água, Lisbonne, mai 2021

Rodeado De Ilha rassemble des essais et des textes de fiction, dans un registre polyphonique caractéristique de cet auteur. Des histoires courtes se combinent avec la réflexion sur l’art et des notes de voyage dédiées aux espaces électifs de son écriture, tels que les Açores et Madère.
João Miguel Fernandes Jorge (1943) est poète, prosateur et critique artistique. Selon l’écrivain et critique Joaquim Manuel Magalhães, le dérangement généré dans la lecture de sa poésie provient de notre formation occidentale, qui rend “difficile de renoncer à un réel vers lequel les mots ne pointent pas” (“certains ont trouvé que dire bateau n’ est pas traîner un bateau jusqu’au mot, ou dire aux autres qu’un bateau est là, mais révéler un endroit où un bateau n’est pas, où sa mémoire est devenue une chanson de phonèmes dans laquelle le bateau disparaît et l’homme découvre la solitude qui est dire bateau sans que le bateau existe. Ce travail silencieux pour capturer l’absence traverse le travail de João Miguel Fernandes Jorge.” (Joaquim Manuel Magalhães, Os Dois Crepúsculos. A Regra do Jogo, Lisbonne 1981, pp. 224-225).
« Mais la maison n’est même pas grande. C’est beaucoup plus une maison échouée dans la force des eaux de la mer de l’île, la mer de Santa Bárbara. Mer vert lisse, vert fort, avec de nombreuses vaches derrière, couchées, sur les collines de l’île. La maison, grande et vieille, est l’économie des passions, elle dit qui est le père des trois, l’un après l’autre : l’aîné, celui du milieu et le plus jeune. « Celui-ci est le plus vieux », dit tout de suite le père quand, un par un il les présente, « ils n’ont pas de continuité, mais ils sont chargés de précieux surplus ; nous avons économisé avec celui du milieu. » Dans la maison tout le monde dort recouvert d’un drap blanc bien lavé. Un drap comme celui-ci sert de voile au bateau qui se trouve dans la pierre du port. Il sert de couverture pour le plus jeune quand le cheval s’enfuit dans un vol sans trajectoire en remontant, remontant Pedreira, les pics de Montoso et d’Esperança. Un cheval sellé, avec une bride polie, qui part du bord de mer de Santa Barbara, le sel de l’eau dans la narine douce, pour briser d’un pas blessé l’épais brouillard des mille mètres de haut de l’île. C’est souvent la mère qui descend le drap de couchage blanc et aussi la voile et aussi la couverture de chevalier. Mais de la maison on doit parler et en parler ici.
Peu importe comment vous y parvenez. Ils sont toujours dans la maison, même quand ils ne le sont pas. On dit même sur l’île, et la fille du conseil paroissial (appelé Celsa) qui a la clé pour ouvrir l’église à ceux qui arrivent de l’extérieur et est celle qui propage le plus cette histoire, qu’on ne sait pas avec certitude quand ils sont absents ou présents dans la maison. « Il y a toujours du monde là-bas. Ils viennent en nageant. La femme, je ne comprends même pas pourquoi elle me salue à peine, vient par l’air. Je ne sais pas de quelle terre du continent elle est originaire. Je sais seulement qu’elle conduit une Fiat Balilla décapotable des années 1920, une relique, un rouge suisse, qui atteint à peine trente à l’heure, elle fait une figure dans cette vieille chose, mais du reste ils ont seulement des vélos, tous sans boite de vitesses, qu’ils verrouillent avec leurs pieds. Et le cheval, quelle belle figure fait le garçon, mais il est le seul à le monter, toujours avec un drap de lin en guise de de couverture attaché aux épaules. » (« L’économie des passions »).
Maylis de Kerangal, Canoës, Gallimard, « Verticales »

« J’ai conçu Canoës comme un roman en pièces détachées : une novella centrale, “Mustang”, et autour, tels des satellites, sept récits. Tous sont connectés, tous se parlent entre eux, et partent d’un même désir : sonder la nature de la voix humaine, sa matérialité, ses pouvoirs, et composer une sorte de monde vocal, empli d’échos, de vibrations, de traces rémanentes. Chaque voix est saisie dans un moment de trouble, quand son timbre s’use ou mue, se distingue ou se confond, parfois se détraque ou se brise, quand une messagerie ou un micro vient filtrer leur parole, les enregistrer ou les effacer. J’ai voulu intercepter une fréquence, capter un souffle, tenir une note tout au long d’un livre qui fait la part belle à une tribu de femmes — des femmes de tout âge, solitaires, rêveuses, volubiles, hantées ou marginales. Elles occupent tout l’espace. Surtout, j’ai eu envie d’aller chercher ma voix parmi les leurs, de la faire entendre au plus juste, de trouver un “je”, au plus proche. »
Zośka Papużanka, Kąkol [Ivraie], Marginesy

Un retour aux vacances passées à la campagne, à la nature, à l’enfance — difficile, marqué par un conflit intergénérationnel inexpliqué de personnes obligées de rester ensemble. Une narratrice adolescente porte un regard sur un monde divisé entre son père, distant et dominé par son père, et sa mère, personnage idéal et hors du commun — mais rejetée par la famille de son mari, incapable de se trouver. L’enfant ne peut s’expliquer la relation dans laquelle il a été jeté — et tente de trouver sa propre place, de rejeter la culpabilité.
C’est une histoire de mémoire. Les herbes, les feuilles, les graminées placées entre les pages du livre peuvent signifier quelque chose que nous voulons garder, ou quelque chose que nous voulons oublier. C’est un livre sur l’amitié, qui tente de concilier le monde d’un enfant de la ville et les vacances d’un enfant de la campagne. Sur la recherche de quelqu’un qui essaie très fort d’être comme nous, même s’il ne l’est pas. Ivraie cherche enfin une réponse à la plus vieille des questions : qu’est-ce que le bien et qu’est-ce que le mal ? Sommes-nous marqués par le mal ou le choisissons-nous consciemment ? Un enfant peut-il être mauvais ?
Ce livre sent l’herbe sèche, le lait et l’écorce d’arbre. Ça fait mal comme première expérience de l’injustice. Il est charmant et effrayant, faux et vrai – comme tout conte de fées.
Cela vaut la peine de se lancer dans ce voyage de contes de fées. Cela vaut la peine de traverser le maquis des événements, le buisson de l’histoire, les inévitables vicissitudes de la vie. Dans ce réalisme magique, il y a une vie intense qui se déroule, de laquelle « nous devons arracher les mauvaises herbes » et nous rappeler d’où nous venons et pourquoi nous avons été créés.
Tamás Beregi, Egyszer egy kutya (Il était une fois un chien), Budapest, Helikon, 2021

La vie de Bertram, un jeune homme blasé, retrouve un sens lorsqu’il adopte Lulu, le charmant chien de refuge qui a deux yeux différents. Grâce à Lulu, Bertram retrouve la beauté du monde et son inspiration et il réalise un vieux projet en écrivan enfin l’oeuvre révée. Alors que son livre sur l’éternel retour et sur l’immortalité connaîtra un énorme succès, il doit faire face au fait que la vie de son chien est menacée. Mais Lulu ne devra pas mourir, Bertram est prêt à tout pour l’empêcher…
Une histoire de chien drôle et mélancolique qui raconte les petits bonheurs et les grandes questions vitales de la relation du chien et de son maître tout en donnant un aperçu ironique d’une ville et d’un pays bien connus. À travers le voyage aventureux de Bertram en Extrême-Orient, son pèlerinage dans le Grand Nord, ses souvenirs d’enfance singuliers et le tournant que prend sa vie avec Lulu, cette histoire douce-amère et poignante raconte comment (ne pas) devenir adulte.
Le livre est illustré par les dessins du graphiste japonais Kumi Obata.
Car tout se répète et tout varie à l’infini, mon bon maître,
tout printemps,
tout jeu,
tout bonheur,
tout chagrin,
tout automne, tout hiver et tout mourir
et tout est nouvelle rencontre
Mehis Heinsaar, Võlurite juures (Chez les magiciens), Tallinn, Paradiis, mai 2021

Fantastique, onirique, surréaliste, poétique, humoristique… on ne sait quel adjectif choisir pour qualifier l’œuvre protéiforme et d’une folle inventivité de Mehis Heinsaar (né en 1973), nouvelliste acclamé en Estonie, mais encore trop peu connu hors des frontières de son pays (malgré trois livres parus en français). Ce volume d’œuvres choisies consacre s’il en était besoin son statut de classique. Outre 34 nouvelles déjà parues dans ses précédents recueils, on y trouve également trois textes inédits. Mehis Heinsaar déploie dans ces récits une exceptionnelle capacité d’imagination, une aptitude à transformer le réel de mille façons toujours surprenantes. Ses textes décrivent des univers improbables à la réalité mouvante, où les vivants ne restent jamais longtemps ce qu’ils semblent être. L’un des ressorts principaux de ses histoires est la métamorphose, la transformation intérieure ou extérieure qui fait accéder ses personnages à un autre mode d’existence : un homme exprime ses émotions en dégageant des nuées de papillons, un autre se divise en deux à chaque croisement de rues, faute de parvenir à choisir une direction précise, une chaussure abandonnée se met à pousser comme une plante qui prend la forme d’un être humain, un employé de bureau gris et terne devient chaque printemps un joyeux luron, séducteur et funambule, qui traverse l’Europe pour aller donner un spectacle dans la ville de Langres. L’œuvre de Mehis Heinsaar est traversée par le rêve d’une vie meilleure et du dépassement de soi. Avec ces destins en apparence irréels, il nous parle aussi et surtout de notre propre existence et de notre rapport au monde réel, il nous encourage à oser vivre autrement et à ne pas nous laisser happer par la routine de notre vie. Comme il le déclare lui-même, ses nouvelles s’apparentent à des contes de fées écrits pour les adultes à l’intérieur de qui vit encore un enfant qui rêve.
« Anselm, ayant compris grâce à son rêve que toute sa vie ultérieure, comparée à cette journée si légère, n’avait été qu’un absurde théâtre d’ombres, plongea dans un tel état de chaos mental qu’il perdit soudain le contrôle de lui-même. Un étage de ses sentiments se rendit visible sous la forme d’une explosion de papillons de diverses espèces, de sorte que son corps fut bientôt entièrement soustrait aux regards […], et dans ces milliers de lépidoptères se trouvaient déposées les joies, les peines et les pensées de ses jours passés et à venir. »
Aldis Bukšs, Brāļi (Frères), Dienas Grāmata, 2020

Helsinki, Londres, Tartu, Balvi, Alūksne, Nord-Latgalie, Sud-Estonie — le sommaire de Brāļi (Frères), le nouveau polar du Letton Aldis Bukšs semble tiré d’un atlas, et l’on se dit que le désir de faire dérouler sous nos yeux, et par tous les temps, ces lieux et ces paysages aux marges septentrionales de l’Europe fut sans doute intentionnellement ou non à la source de ce livre.
Edgars Tārauds est un gentil garçon originaire de Latgalie, la région extrême-orientale de la Lettonie, frontalière de la Russie et de la Biélorussie. Son diplôme de géographie en poche, « comme plusieurs milliers de jeunes de son âge », il part tenter sa chance dans ce Londres hospitalier des premières années du XXIe siècle, entre Élargissement et Brexit, et s’embauche dans une usine de transformation de volaille. Bientôt, son colocataire lituanien, l’habile Darius, déjà bien introduit, lui ouvre les portes du Gardens of Babylon, un night-club huppé de Kensington que gère un certain Nasir. Edgars y tient dignement le bar jusqu’au jour où, un jeu de poker malheureux l’accable d’une dette dont il ne peut se défaire qu’en acceptant de faire « la mule » entre Londres et Helsinki. À sa descente d’avion, il se fait cueillir avec sa cargaison de cocaïne, et la justice finlandaise, implacable et cependant étonnamment cordiale à ses yeux d’Européen de l’Est, lui inflige une peine qui lui vaudra trois ans et demi de prison ferme. À sa libération, il apprend que son frère Kristaps qui était resté au pays a mystérieusement disparu dans les forêts qui enjambent la frontière letto-estonienne. Ce frère nourrit depuis l’enfance une passion pour les mežabrāļi (« frères de la forêt »), les maquisards baltes qui menèrent jusqu’à la fin des années cinquante des actions de guérilla contre l’occupation soviétique, et il s’est fait une spécialité d’explorer les bunkers forestiers, emblématiques de ces mouvements. Or c’est justement aux abords d’un de ces anciens refuges que sa trace se perd. Aurait-il été enlevé ? Par qui ? Pour quoi ? Serait-il mêlé d’une façon ou d’une autre au trafic de migrants dont profitent des réseaux de contrebande dévoyés, dans ces territoires misérables où la transgression frontalière est l’une des seules activités vraiment lucratives. Edgars a le sentiment que la police estonienne se désintéresse de l’affaire, et, sans argent, sans vêtements de rechange, et avec des papiers périmés, il prend lui-même l’enquête en main.
Paru en fin d’année dernière, le second roman d’Aldis Bukšs (1985) a été lancé tambour battant, publié simultanément en letton et en « latgalien » – principale langue régionale de Lettonie qui jouit d’un effet de mode –, il est proclamé « premier roman policier jamais écrit en langue latgalienne ». Au-delà de ce geste qui peut sembler anecdotique hors du pays, le roman offre à l’amateur de polar un certain nombre d’ingrédients dont on le sait friand : une intrigue emmêlée, mais tenue d’une main ferme, un ancrage crédible et sensible dans un contexte social et économique contemporain, des personnages mobiles, capables de s’émanciper des archétypes — mais aussi de l’amour, des poursuites en voiture et du sang sur la neige. On trouve chez Aldis Bukšs ce regard, qu’on pourrait qualifier d’eastwoodien sur les êtres et les choses, qui sied si bien au genre. Il n’y a pas grand-chose à attendre de l’âme humaine, mais si la justice défaille, l’homme n’a d’autre choix que d’agir, surtout lorsque l’essentiel est en jeu : les liens familiaux, aussi calamiteux soient-ils, le pays où l’on vit, « puisqu’on n’en a pas d’autres ». Il y a aussi ce miroitement métaphorique autour des figures jumelles de la frontière et de la fraternité assez subtilement déclinées pour projeter sur l’intrigue policière une lueur de mythe. « Jusqu’où serais-tu prêt à aller pour retrouver un frère disparu qui de surcroît te déteste ? »
Turo Kuningas, Kutvonen In Space, WSOY, mars 2021

Dans ce roman, Turo Kuningas mêle son goût pour le surréalisme à une tentative postmoderne d’évoquer les débats autour des réseaux sociaux, du divertissement, du féminisme et de l’intersectionnalité. Son héros, Kutvonen, est un personnage labile, pas tout à fait le même d’un chapitre à l’autre, évoluant au gré des envies satiriques de l’auteur et au gré des formes littéraires qui se succèdent dans le vaste collage que constitue le livre : séances de thérapie, entretiens et monologues reprenant le principe du courant de conscience forment un ensemble kaléidoscopique visant à embrasser nombre de traits saillants du monde moderne.
En résumé, Kutvonen est un scénariste plus ou moins graphomane pour une série comique finlandaise à succès. Il cherche à imposer un personnage de lutteuse ultraféministe, Hiilari Klittor, mais se heurte aux conceptions du producteur sur les ressorts comiques du personnage. Par ailleurs, les tribulations de Kutvonen ne se limitent pas à la sphère professionnelle puisqu’il se retrouve bientôt confronté à des histoires de soucoupes volantes…
« Presque tous les chapitres se terminent si loin de leur point de départ qu’on ne se rappelle plus vraiment comment on en est arrivé là. » (Arttu Seppänen, Helsingin Sanomat)
Lucie Faulerová, Smrtholka (Ma Camarde), Torst, 2020

L’héroïne du second roman de Lucie Faulerová doit faire face à plusieurs événements familiaux tragiques qui peuvent sembler incompréhensibles, et tente d’en trouver la cause. Toutefois, pour pouvoir avancer, il lui faudra regarder en arrière. Dans une prose très rythmée et d’une extraordinaire pureté stylistique, une jeune fille touchée par une tragédie familiale, aux prises avec sa propre conscience, nous présente trois frères et sœurs inexplicablement abandonnés par leur mère et frappés par la maladie : une cellule familiale fermée mais qui, grâce à leur père et à leurs liens de fraternité, peut offrir une issue à ceux qui sont prêts à l’accepter. Il semble alors que la bataille la plus dure doive être livrée dans l’esprit même de l’héroïne, pour accepter l’amour offert et venir à bout des démons intérieurs du rejet et de la culpabilité. Bien que l’intrigue esquissée n’incite guère à l’optimisme et malgré le cadre dramatique du récit, l’auteur parvient à manier un humour qui caractérise les personnages, leurs relations ou encore les diverses méthodes suggérées pour se découvrir soi-même et mener une vie idéale.
Ce livre a reçu le prix de littérature de l’Union européenne – mai 2021
Antonio Iturbe, La playa infinita (La Plage infinie), Seix Barral, 2021
Un voyage fascinant à travers les mille et une histoires cachées dans La Barceloneta, une lettre d’amour à un quartier et, par extension, à la ville de Barcelone.
Iturbe est un physicien spécialisé dans les neutrinos qui, après plus de deux décennies à l’étranger, revient régler ses dettes sentimentales à la Barceloneta, le quartier où il a grandi. En se promenant à nouveau dans ses rues, il découvre qu’entre les appartements touristiques, les franchises multinationales et la disparition progressive des voisins, il ne reste que des vestiges de sa mémoire et il doit, avec l’aide d’un ami d’enfance appelé González, sauver son propre passé, tout en découvrant le sort de certains de ses compagnons de génération.
La playa infinita est un roman qui fonctionne comme un guide sentimental du mode de vie et des rues de Barcelone dans la dernière moitié du XXe siècle ; une lettre d’amour mélancolique à un quartier et, par extension, à une ville qui ne reviendra jamais. Et une justification du pouvoir de l’imagination, de la littérature et de la fiction pour compléter un portrait du dernier demi-siècle de l’histoire espagnole.


