Le Prophète et la pandémie, discussion avec Gilles Kepel
À l'occasion de la sortie de son dernier livre chez Gallimard, chronique de l'année 2020 écrite « en temps réel » au cours de cette année terrible, Pierre Ramond s'est entretenu avec Gilles Kepel.
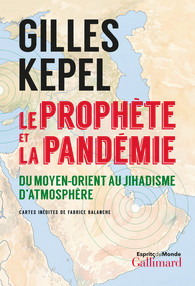
Vous écrivez dans les remerciements que vous avez rédigé ce nouveau livre « quasiment en temps réel tandis que se déroulaient les événements qu’il décrit » et tenté « leur mise en perspective ». À partir de quand avez-vous la sensation de la nécessité d’une chronique de l’année 2020 ? Écrivez-vous plus vite parce que l’histoire s’est déroulée plus vite en 2020 ? Quelle relation ce nouveau livre entretient-il avec le précédent, Sortir du Chaos ?
J’ai été, comme tout le monde, interrogé par le fait que nos conditions d’existence aient été à ce point bouleversées, que la Chine soit désormais en compétition décisive avec les Etats-Unis pour devenir l’hégémon mondial, et qu’un système autoritaire montre sa capacité à gérer ce type de crise, tandis que ces derniers, avec leur libéralisme dérégulé, vont s’en trouver les victimes par excellence.
Au moment où nous faisons cet entretien, le cap des 500.000 morts vient d’être passé outre-Atlantique et Joe Biden de rappeler que ce nombre est plus élevé que celui de l’ensemble des décès américains au cours des trois grandes guerres du XXème siècles (les deux guerres mondiales, et celle du Vietnam).
Il m’a donc semblé que je pouvais, à propos du domaine qui m’a occupé pendant quarante années de ma vie, étudier les conséquences de ces transformations, et cela d’autant que je constatais l’émergence d’une nouvelle phase djihadiste qui me semblait structurellement différente des précédentes que j’avais analysées dans Sortir du Chaos.
[L’année 2020] va permettre l’émergence d’une nouvelle configuration jihadiste, qui s’efforce de tirer les leçons des échecs passés et de s’adapter à la nouvelle conjoncture induite par la pandémie.
Gilles kepel
L’écriture de Sortir du Chaos s’était faite « sous contrainte ». J’avais été condamné à mort le 13 juin 2016 par Larossi Abballa, un djihadiste sorti de prison qui avait tué à coups de couteaux le policier Jean Baptiste Salvaing, du commissariat des Mureaux ainsi que son épouse à leur domicile – c’est pourquoi Emmanuel Macron a choisi ce lieu symbolique pour son fameux « discours des Mureaux » le 2 octobre 2020 incriminant le « séparatisme islamiste ». Ce djihadiste après avoir commis son attentat a filmé un selfie posté sur Facebook Live en temps réel en expliquant qu’il était sur le point de devenir un martyr et en appelant ses frères, à son imitation, à tuer un certain nombre de personnes. J’avais l’honneur douteux de figurer en tête de liste. J’ai donc été placé pendant un an et demi sous protection policière. N’étant pas une « haute personnalité », j’avais droit à un véhicule de petite dimension très usagé, où les amortisseurs appartenaient au domaine du souvenir… A cela s’ajoutait le stress car, même si je n’avais aucune considération pour les jihadistes, on pouvait toujours craindre une attaque. La combinaison de tout cela s’est traduite par des crises de sciatique éprouvantes qui m’ont obligé à passer le plus clair de cette période couché avec des coussins dans le dos et sous les genoux. Ne pouvant rien faire d’autre, j’ai donc utilisé mes cuisses comme un lutrin pour mon ordinateur portable et ai écrit quasiment d’une traite Sortir du Chaos… grâce à la sentence des terroristes islamistes.
Cela m’a permis de synthétiser et de réorganiser en rétrospective des travaux précédents et les sortant de la temporalité dans laquelle ils avaient été insérés au moment de leur publication – notamment Jihad (2000), Passion arabe (2013) et Passion française (2014), ainsi que Terreur dans l’Hexagone (2015) – pour construire une narrativité sur un demi-siècle de l’évolution du monde arabo-musulman. Je me suis ainsi efforcé de mettre en perspective les trois phases du jihadisme, dans une construction dialectique hégélienne en quelque sorte. Le moment de l’affirmation dans les décennies 1980-90, avec les succès en Afghanistan, puis ses séquelles infructueuses en Algérie, Égypte, Bosnie et Tchétchénie ; celui de la négation avec Al Qaïda entre 1998 et 2005 environ, caractérisé la structuration d’une organisation pyramidale de type léniniste, combinant la terreur spectaculaire avec la guerre médiatique par l’usage de la télévision satellitaire ; et enfin le moment du dépassement qui aboutira à Daesh, nébuleuse improbable qui doit sa double paternité aux « deux Abou Moussab » – Al-Zarqaoui, qui a théorisé la réorientation anti-chiite du djihad et Al-Souri, qui a critiqué le 11 septembre 2001 comme une forme d’hubris, a théorisé un jihadisme en réseaux (sociaux) entre les banlieues de l’Europe et les rives Est et Sud de la Méditerranée, qui prend son essor à partir de 2005 et s’effondre avec le « califat » entre 2017 et 2019.
Cet échec est dû à la mobilisation massive de moyens militaires et de renseignement occidentaux, depuis les bombardements par la coalition jusqu’à l’investissement gigantesque dans la cybersécurité (avec ses conséquences, par-delà la lutte contre le jihadisme, dans la restriction des « libertés individuelles numériques »).
C’est dans ce contexte qu’advient l’année-charnière 2020. Elle va permettre l’émergence d’une nouvelle configuration jihadiste, qui s’efforce de tirer les leçons des échecs passés et de s’adapter à la nouvelle conjoncture induite par la pandémie. Précédemment, on avait mis des années chaque fois à comprendre la logique de chacun des « moments » successifs dans la dialectique du jihad – entre la fin de 1979 et 2019. Ainsi, quand le modèle de Daech se déploie pour la première fois avec les meurtres en série commis par Mohammed Merah en mars 2012, le patron du renseignement français Bernard Squarcini n’y voit que l’action d’un « loup solitaire ». Cette erreur fatale d’analyse explique pourquoi la logique de Daesh a mis tant de temps à être comprise puis combattue finalement avec succès un lustre plus tard, mais au prix de nombreux massacres entre temps – notamment sur le territoire français, sans compter le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.
A l’inverse, il me semble – sur la base de la mise en perspective des quatre décennies écoulées – que l’on peut penser quasiment en temps réel la nouvelle forme du phénomène, qu’ont illustrée les attentats de cet automne 2020, et que je propose de nommer le « jihadisme d’atmosphère ». J’espère avoir réussi à en isoler un certain nombre de caractéristiques pertinentes. On ne les connait pas encore toutes. Et il est trop tôt pour savoir s’il s’agit d’une quatrième étape s’inscrivant dans la dialectique précédente ou de l’amorce d’un mouvement dialectique radicalement nouveau, car nous ne disposons pas du recul nécessaire. Mais je suis interpellé par les congruences entre le mode de diffusion de ce jihadisme-ci et celui de la pandémie de covid-19 – c’est-à-dire la propagation de type viral. Il s’agit à ce stade d’une intuition heuristique, et il me paraît fécond d’en débattre, que ce soit pour la valider ou l’invalider, en recueillant et comparant les données – notamment sur le terrain numérique, un peu à la manière dont les épidémiologistes imputent les hypothèses depuis le foyer de Wuhan jusqu’aux divers « variants » d’aujourd’hui.
Je me suis trouvé au moment opportun pour relever et classifier des phénomènes – un processus que je n’aurais jamais pu mener à bien si je n’avais pas écrit précédemment Sortir du chaos, dans la continuité duquel ce nouveau volume s’inscrit.
gILLES kEPEL
J’avais rencontré un problème comparable de temporalité et de perspective en 2000, en publiant mon livre Jihad – sous-titré « Expansion et déclin de l’islamisme ». J’avais observé que, après le succès en Afghanistan avec la défaite soviétique en février 1989, les séquelles du phénomène de l’Algérie et la Bosnie à la Tchétchénie et l’Égypte avaient abouti à l’échec politique comme militaire. Mais je n’avais pas à l’époque récolté les données pour comprendre que Ben Laden et Zawahiri faisaient, si je puis dire, le même raisonnement que moi, en constatant l’insuccès final de ce premier « moment » du Jihad universel, mais qu’ils en tiraient les leçons pour le réorienter dans ce qui en serait la deuxième phase. Même si étaient déjà advenus les attentats d’août 1998 en Tanzanie et au Kenya contre les ambassades américaines, mais je n’avais pas été capable d’en tirer la leçon et en anticiper les conséquences, parce que je n’avais pas encore eu accès au texte de Zawahiri Cavaliers sous la bannière du Prophète, qui constitue en rétrospective le manifeste d’Al Qaïda J’avais donc été très critiqué après le 11 septembre 2001, car on me reprochait d’avoir annoncé le déclin du jihadisme. Je ne pense pas avoir commis une erreur structurelle : c’est sur la base de ce même constat en effet, en en tirant les leçons, qu’Al Qaïda élabore sa propre stratégie successive et alternative pour surmonter cet échec. « La chouette de Minerve ne prend son envol qu’au crépuscule » – pour poursuivre dans la foulée hegelienne ! Ainsi ce n’est qu’en rétrospective que j’ai pu articuler le deuxième moment de la dialectique jihadiste avec le premier, mais cela n’invalide pas le constat factuel en lui-même. Vingt ans après, c’est l’expérience accumulée qui me permet, par comparaison et différenciation, de construire l’hypothèse du « jihadisme d’atmosphère » – et de la proposer au débat public dans la simultanéité de la survenue du phénomène, pour la tester. On verra ainsi si elle s’avère féconde ou se révèle stérile.
Quand vous vient l’idée d’écrire Le Prophète et la Pandémie ?
J’ai eu l’idée du nouveau livre en discutant au téléphone avec Fabrice Balanche au printemps 2020, durant le premier confinement généralisé. J’avais beaucoup apprécié ses cartes pour Sortir du Chaos, et au départ je me suis dit que cette pandémie inouïe allait bouleverser les lignes au Moyen-Orient telles que ce dernier ouvrage en avait proposé une lecture, et qu’il serait important de cartographier cela en temps réel. Quand on a pu circuler de nouveau, je me suis installé dans le Midi où je vis partiellement désormais, avec sous les yeux la Méditerranée qui constituait l’épicentre de ce maelstrom, et j’ai commencé à écrire début juillet. Les événements se sont alors précipités, tandis que je m’étais mis en mode « aperception » pour les observer et les interpréter à chaud. Trois semaines plus tard est survenue la réislamisation de Sainte Sophie par Erdogan. Puis le mois suivant le processus des Accords d’Abraham a commencé. Les pièces que j’avais commencé à récolter se sont insérées naturellement dans le puzzle. Je me suis trouvé au moment opportun pour relever et classifier des phénomènes – un processus que je n’aurais jamais pu mener à bien si je n’avais pas écrit précédemment Sortir du chaos, dans la continuité duquel ce nouveau volume s’inscrit.
La réislamisation de Sainte-Sophie est simultanément le moyen de prédilection utilisé par Erdogan pour s’affirmer comme leader dans l’espace musulman mondial.
gILLES kEPEL
J’ai bénéficié d’une source tout à fait remarquable que je crédite dans le livre, le site Al Monitor, une équipe d’excellents journalistes sur le terrain, au Moyen-Orient, au Liban, en Israël, en Palestine, dans la zone d’Idlib, en Iran, en Turquie, et partout dans la région, qui font une analyse très fine de la situation, qu’on ne trouve absolument nulle part ailleurs dans la presse généraliste, ce qui m’a permis avec l’aide de Sarah Jicquel, qui était mon assistante à la chaire Moyen-Orient Méditerranée de l’École Normale Supérieure, de classer tout ce qui paraissait, d’accumuler une masse de données pour l’année 2020, que l’on retrouve dans la chronologie à la fin de l’ouvrage.
J’aimerais revenir sur certains éléments que vous abordez dans le livre, en commençant par la réislamisation de Sainte Sophie par le président turc, que vous venez d’évoquer comme un des éléments qui vous a conforté dans la volonté d’écrire ce livre.
De nombreux lecteurs m’ont confié m’ont dit qu’ils n’avaient pas compris spontanément l’importance ni la signification de ce phénomène, qu’ils l’avaient « vu passer » sans faire le lien avec son inscription en diachronie ni en synchronie. C’est là précisément je crois que réside l’intérêt et la spécificité de la recherche universitaire pour informer le débat public. Ce coup de force polysémique se produit au moment où Erdogan envoie ses navires pour disputer à la Grèce et à Chypre leur Zone Économique Exclusive, ce qui était pourtant la contrepartie explicite, dans le traité de Lausanne, du contrôle par la Turquie de toute l’Anatolie. Or j’observe que cette réislamisation intervient justement le 24 juillet, jour anniversaire du Traité de Lausanne de 1923, par lequel Atatürk, vainqueur militaire, parvient à chasser les Grecs, les Arméniens et les Européens, qui, par le traité de Sèvres de 1920, avait morcelé l’Anatolie. Ainsi, Erdogan se réclame de l’Atatürk militaire et nationaliste, s’inscrit dans sa foulée, ce qui lui permet de tordre le bras à l’Atatürk laïc qui avait sécularisé Haghia Sophia en 1935 en transformant en « cadeau à l’humanité » la mosquée qu’en avait faite la conquête ottomane de 1453.

La réislamisation de Sainte-Sophie est simultanément le moyen de prédilection utilisé par Erdogan pour s’affirmer comme leader dans l’espace musulman mondial. Les dirigeants saoudiens, contrairement à l’Iran où la théocratie au pouvoir n’a pas voulu pour des raisons de légitimation politico-religieuse exercer de mesures prophylactiques dans les pèlerinages aux lieux saints du chiisme, ont limité considérablement le Hajj à La Mecque, et on voit sur les photos de 2020 l’esplanade de la Ka’ba vide (l’événement rassemble en année ordinaire entre deux et trois millions de fidèles), et les photos et vidéos d’Haghia Sophia où une foule se presse autour d’Erdogan en prière aux cris d’Allah Akbar tranchaient nettement avec celles de la Mecque. C’est Erdogan qui donnait à voir – au moins temporairement – le pouvoir politique de l’islam dont il s’arrogeait ainsi le leadership.
Ce coup d’éclat est comparable – d’un point de vue épistémologique – à la fatwa de Khomeyni du 14 février 1989 condamnant à mort Salman Rushdie, qui permettait d’obnubiler le vrai événement géopolitique qui adviendrait le lendemain 15 février : le retrait soviétique de Kaboul sous les coups du jihad sunnite trained and equipped par la CIA. Khomeiny se pose alors aux yeux des masses musulmanes comme celui qui défend le Prophète contre le blasphème – donc le dirigeant praeclarus de l’islam universel … alors que les Saoudiens ont financé le jihad qui permet d’expulser l’armée rouge mécréante de la « terre d’islam » afghane, prélude à l’effondrement de l’URSS le 9 novembre suivant avec la chute du mur de Berlin. On est dans une configuration homothétique entre ces deux leaders, d’autant plus qu’Erdogan prolonge sa gestuelle de la même matière que Khomeyni, en incriminant les caricatures de Mahomet republiées inopportunément par Charlie Hebdo le 3 septembre, pour s’affirmer comme l’entrepreneur de colère principal de « l’islam » offensé et humilié contre la France « islamophobe ». A tel point que cela va rendre inaudible le procès des massacres jihadistes de janvier 2015 en France au siège de Charlie Hebdo et à l’HyperCacher de la porte de Vincennes, qui aurait dû être un Nuremberg du jihadisme.
Un autre élément frappant de l’année 2020 est le rapprochement entre Israël et les Émirats arabes unis, qui laisse présager une reconfiguration profonde des alliances dans la région.
La pandémie a également conduit à une accélération des processus qui ont abouti à l’Entente d’Abraham, qui débute par l’accord de paix et de reconnaissance mutuelle entre Israël et les Émirats. Cela faisait une bonne décennie que j’assistais, durant des conférences dans des châteaux du désert émiratis, à l’apparition de ministres israéliens par visioconférence depuis Jérusalem, sur le thème : « nous avons certes eu des malentendus, mais on a surtout un ennemi commun : l’Iran ». Ce rapprochement a été précipité par les conséquences de la Covid-19 sur le marché des hydrocarbures. Le 06 mars, l’OPEP+ se réunit à Vienne. Les Russes décident d’augmenter la production pour éliminer les producteurs américains de shale oil du marché, qui n’est pas rentable à moins de 45$ le baril, tandis que le pétrole en Arabie ou en Libye est extrait à un coût de 3$. Cependant ni la Russie ni l’Arabie Saoudite n’avaient correctement anticipé l’arrêt de l’économie mondiale dans les semaines suivantes, qui va amplifier ce mouvement de baisse « politique » des cours, et qui culmine le 20 avril, quand le baril descend au prix négatif jamais vu de -36$ parce que tout est plein, les pipelines, les oléoducs, les barges, qu’il n’y a plus un centimètre cube où stocker du pétrole.
Cela a été un facteur décisif pour concrétiser l’Entente d’Abraham : depuis un lustre environ, les Emiratis et les Saoudiens avaient engagé une réflexion sérieuse au sommet sur une alternative au modèle « rente pétrolière cum wahhabisme ». Le projet de développement-phare de Mohammed Ben Salman est NEOM, ville futuriste située dans le quart nord-ouest de l’Arabie, frontalier de la Jordanie et de l’Égypte, mais aussi à quelques dizaines de km d’Eilat. On devrait y développer l’hydrogène vert, pour lequel il faut de gros investissements financiers, mais aussi des technologies de pointe. Les fonds sont du côté saoudien, la high tech est apportée par Israël. La combinaison de ces deux facteurs, si elle advient en effet, changera la région en elle-même et dans son rapport au monde. Mais c’est un défi gigantesque, et une remise en cause majeure des lignes de faille tant internes que régionales. À ce stade, il est difficile de pronostiquer si les multiples paramètres et variables de ce bouleversement vont s’aligner : les impondérables sont très nombreux.
Vous décrivez ce que vous appelez l’axe fréro-chiite, évoqué pour la première fois p. 26, comme « l’une des principales alliances qui marquent l’an 2020 », puis développé tout au long du livre. Cela fait partie des nouveaux concepts que vous proposez et qui pourrait s’imposer dans le débat public. Êtes-vous le seul à le formuler à présent ? Quand l’idée vous est-elle venue de définir ainsi l’étonnante congruence des intérêts turcs, qataris et iraniens de la sorte ?
Je crois avoir mis le concept d’« axe fréro-chiite » en circulation (en tous cas je ne l’ai pas remarqué ailleurs). Je suppose que c’est sa formulation paradoxale qui a suscité l’attention. Il remet en cause en effet un certain nombre de topoï, depuis l’immarcescible « nationalisme arabe » jusqu’à l’adamantin « bloc sunnite ». La dernière carte de Fabrice Balanche pour Sortir du Chaos figurait le « croissant chiite » face à ses rivaux. En réalité même dans cette carte de 2018 Fabrice esquissait déjà dans le monde sunnite deux blocs, les « alliés des États-Unis » et les autres. La ligne de fracture se creuse après le renversement du président Frère musulman égyptien Mohammed Morsi en juillet 2013, grâce à l’armée financée par les Saoudiens et les Émiratis, entre ceux qui soutiennent les Frères et ceux qui leur sont opposés.
L’Entente d’Abraham pourrait permettre, dans la perspective des élections de la 24 ème Knesset le 23 mars 2021, à Netanyahu de surseoir à nouveau à sa comparution en justice.
Gilles Kepel
Par ailleurs les révolutionnaires iraniens de 1979 ont beaucoup lu les Frères Musulmans – on l’a trop peu souligné, car on était obsédé par l’antagonisme entre sunnites et chiites. Le khomeynisme est très inspiré d’Hassan el Banna, fondateur de la confrérie, et l’actuel Guide Suprême iranien Ali Khamenei a traduit des textes de Sayyid Qotb, l’idéologue du frérisme radical, en persan. Mon collègue Alexandre Kazerouni [maître de conférences à l’Ecole Normale Supérieure] a retrouvé le timbre-poste émis en 1984 par la République Islamique figurant Qutb derrière les barreaux, avant son supplice de 1966 en martyr du nassérisme. Cette convergence entre l’islam politique des Frères et celui des ayatollahs est bien perceptible dans le chiisme arabe irakien : l’un des doctrinaires les plus révérés par les Frères était l’ayatollah Baqir al-Hakim, qui écrivit Notre Économie [islamiste]. Le fait qu’il soit chiite n’était pas considéré comme dirimant.
Quelles sont, de l’autre côté, les conséquences de l’Entente d’Abraham sur la vie politique en Israël ?
L’Entente d’Abraham pourrait permettre, dans la perspective des élections de la 24 ème Knesset le 23 mars 2021, à Netanyahu de surseoir à nouveau à sa comparution en justice. À ce jour, l’ultime effet de cette alliance est la reconnaissance d’Israël par le Maroc, le 10 décembre 2020. Or on compte environ 800000 Juifs-Marocains citoyens israéliens. Ils votent habituellement pour les partis de la droite religieuse, mais Netanyahu espère qu’ils vont lui donner massivement leur suffrage intuitu personae, pour le remercier de leur permettre de ressouder les fragments épars de leur identité. Si cela se produit, « Bibi » peut demeurer Premier Ministre… Autre événement qui a frappé l’imagination : le National Security Advisor de Netanyahu, Meir Ben Shabbat, dont les parents et les frères sont nés au Maroc, est allé faire payer ses respects au souverain alaouite Mohammed VI en dialecte marocain ! Le judaïsme marocain est un phénomène spécifique : la plupart de la communauté est issue de Berbères judaïsés, un phénomène exceptionnel dans le judaïsme, qui explique leur attachement à cette nation, dont on ne retrouve pas l’équivalent chez les Israéliens originaires d’autres pays.
Ensuite, Mansour Abbas, le leader de la faction islamiste de la liste Arabe unie, qui détenait 15 sièges (sur 120) à la 23 ème Knesset, n’a pas écarté de soutenir Netanyahou – premier homme politique arabe israélien acceptant de quitter la politique de protestation pour se joindre éventuellement à une majorité gouvernementale… tandis que le Premier Ministre fait à présent le tour électoral des villes arabes, alors qu’il a construit sa carrière sur une forte arabophobie. En outre, les Arabes israéliens se voient ouvrir des possibilités d’emploi inouïes aux Émirats.

Enfin, l’élément le plus stupéfiant est celui de la bande de Gaza. Aujourd’hui, le Qatar apporte chaque mois 30 millions de dollars en liquide à l’aéroport Ben Gourion. Le Shin Beth l’escorte puis les services égyptiens, et cette aide financière est alors récupérée et distribuée par le Hamas. En somme, Israël accepte que Qatar subventionne Hamas, son meilleur ennemi, pour éviter une explosion sociale ingérable dans un territoire surpeuplé. Ainsi le président israélien Reuven Rivlin a accueilli l’ambassadeur qatari en charge de la reconstruction de Gaza, Mohammed al Emadi, à sa résidence à Jérusalem pour lui exprimer officiellement ses remerciements…
Vous glissez une critique acerbe page 32 « l’expertise occidentale, et notamment française, s’est effondrée faute d’investissements dans l’Université pour y former des arabisants ». Vous expliquez même qu’un problème fondamental est que les termes « islamisme » ou « séparatisme » n’ont pas d’équivalent en arabe, ou du moins n’ont pas été suffisamment expliqué. Ainsi en arabe, la loi sur le séparatisme « islamiste » est traduit en arabe par la loi sur le séparatisme « islamique ». Il y aurait donc une double carence : carence de compréhension de l’autre, carence d’explication de soi. J’aurais plusieurs questions à ce propos : quel est l’état des études arabes en France, comment pourrait-on valoriser l’étude de l’arabe, aux niveaux secondaire et supérieur ? Pourriez-vous revenir sur les principales évolutions que vous avez constatées ?
Après la colonisation, les études arabes se sont effondrées en France puisqu’à l’époque l’arabe était aussi une langue d’administration en Afrique du Nord. Celles-ci ont été ultérieurement diabolisées, en raison de l’exploitation coloniale au service de laquelle elles étaient utilisées. Parallèlement elles sont tombées en désuétude du fait de l’illusion développementaliste des années 1960-70 qui considérait que seuls quelques vieillards parlaient encore arabe, et que la croissance économique allait se faire par l’utilisation accrue de l’anglais et du français.
Par la suite, quand j’ai commencé mes propres études en ce domaine en 1974, il y a eu un timide regain d’intérêt pour cette langue, du fait de la guerre d’octobre 1973, qui avait redonné une primeur aux monarchies du Golfe, à l’Islam, et ressuscité une curiosité pour comprendre les ressorts de ces phénomènes, dont le jihad. Quelques années plus tard, quand j’étais élève à Sciences Po entre 1978 et 1980, j’ai eu pour professeur Rémy Leveau, qui avait lui-même été un administrateur postcolonial – organisant les premières élections marocaines de l’indépendance, sujet ultérieur de sa thèse et de son livre séminal Le fellah marocain défenseur du trône.. Il y démontre montre comment le pouvoir marocain s’est appuyé sur les classes rurales pour contrer les élites urbaines anti monarchistes. Lui-même n’étant pas arabisant, il était très conscient de la nécessité pour la jeune génération de connaître l’arabe, et il a joué un rôle cardinal pour favoriser ces études. Il avait beaucoup d’entregent, de contacts dans la haute administration où il a occupé diverses fonctions. Quand il est décédé en 2005, il n’y avait plus personne qui pouvait jouer comme lui ce rôle de grand entrepreneur universitaire. Je m’étais consacré exclusivement à la recherche et à l’enseignement, et n’ai jamais fait d’administration donc je n’avais pas les contacts idoines. Après son décès, le DEA puis le master sur le Moyen Orient contemporain qu’il avait créés à Sciences Po ont pu continuer sur leur lancée – cette filière a été l’une des plus performantes du monde. Mais bientôt ont commencé des débats assez violents, notamment à partir de 2005 (l’année de son décès, le 2 mars) et à la suite des émeutes en banlieue, sur les modèles interprétatifs de l’islamisme puis du jihadisme. Celui qui a raflé la mise dans la décennie suivante est Olivier Roy, stratégiquement positionné à l’Institut Universitaire Européen de Florence, ce qui lui a permis de contrôler les fonds de l’UE, qui sont les plus importants, pour la recherche désormais, à travers les ERC (European Research Council). Son fameux apophtegme « ça ne sert à rien de connaître l’arabe pour comprendre ce qui se passe en banlieue » a été accepté avec enthousiasme par les fonctionnaires non arabisants et généralistes qui se trouvaient ainsi confortés dans leur ignorance linguistique. Comme il n’y avait plus de spécialistes ou très peu, cette vue a été confortée. De même, la doctrine dominante dans l’université et la haute administration a été celle de « l’islamisation de la radicalisation » du même – signifiant que la « radicalisation » était un phénomène structurel et son « islamisation » un épiphénomène conjoncturel sans grande pertinence cognitive. Tout cela s’est conjugué dans l’effondrement des études arabes, leur sous-financement – malgré la survenue des « printemps arabes » qui ont de ce fait été analysés comme une variation sur la chute du bloc soviétique… on connaît le résultat.
L’enseignement [de l’arabe] est pris entre l’enclume de l’islamisation et le marteau de l’assimilation.
Gilles Kepel
Cette même année 2010, en décembre, le master Moyen-Orient a été fermé à Sciences Po. L’affaire Merah en 2012 a été vue comme l’action d’un « loup solitaire » et les fonds publics ont subventionné des charlatans « experts en déradicalisation ». Lorsque j’ai présenté en 2015 à Bruxelles une demande d’ERC avec en tête le projet d’écrire ce qui deviendrait Sortir du Chaos – aujourd’hui traduit dans la plupart des langues majeures et enseigné comme textbook un peu partout – j’ai été retoqué au premier tour pour incompétence notoire… assorti d’une interdiction de représenter des projets dans les années suivantes pour cause de nullité crasse. Le précédent ERC dans ce domaine avait été attribué à l’un des principaux tenants de l’islamo-gauchisme universitaire, désormais devenu après sa retraite influenceur pro-islamiste sur Twitter et entrepreneur de colère contre mes collègues et moi-même qui nous efforçons de maintenir une distance critique par rapport à nos objets d’étude… Fort heureusement, j’ai été accueilli par l’Université Paris Sciences et Lettres et nous avons pu recréer une nouvelle chaire Moyen-Orient Méditerranée à l’École Normale Supérieure. Mais c’est un travail de Sisyphe car le temps perdu est difficile à rattraper, et le bassin des arabisants de qualité s’est réduit comme peau de chagrin.
Vous avez parlé des premières années du supérieur, à Sciences Po, à PSL, mais on pourrait aussi penser qu’il est nécessaire de valoriser l’enseignement de la langue arabe dans le secondaire, où il est encore peu développé, ce qui permettrait à la fois de former des cohortes d’arabisants et de valoriser les compétences linguistiques de ceux dont c’est la langue maternelle ?
Pour l’enseignement secondaire, ça va en apparence mieux. Il y a à présent cinq ou six postes à l’agrégation d’arabe et quinze mille élèves étudient l’arabe en collège et lycée en France. Cela peut sembler faible, mais cet enseignement est pris entre l’enclume de l’islamisation et le marteau de l’assimilation. Un certain nombre de chefs d’établissement ne veulent pas créer de classe d’arabe car cela donnerait l’impression que la population scolaire a une forte composante immigrée et ferait « fuir » les classes moyennes. De l’autre côté, un certain nombre d’imams interdisent aux enfants d’aller apprendre l’arabe dans l’école des mécréants, puisque c’est la langue sacrée de l’Islam, mais aussi parce que les cours d’arabe sont payants et contribuent à la trésorerie de ces associations liées aux mosquées. L’enseignement de l’arabe a du mal à dépasser ces deux difficultés auxquelles l’inspection générale d’arabe, dont les travaux me semblent très bien orientés, est sensible.
Il faut surtout transformer l’image de l’enseignement de l’arabe. Or l’extrême droite considère que dès lors qu’on valorisera l’arabe, il s’agira de la dernière étape du processus d’islamisation de la France. Personnellement cela fait quarante ans que j’utilise l’arabe… et mon athéisme n’en a jamais vacillé. Enfin, la connaissance de cette langue est essentielle pour comprendre la richesse des cultures maghrébines et moyen-orientales, très présentes en France et qui ne se réduisent pas au préchi-précha salafiste ni à l’islam politique. Cette dimension de l’identité française, de l’alimentation aux usages, en passant par l’argot et les arts, est forte. Aujourd’hui, on balance entre le déni et l’exacerbation. Il faut sortir de ce dilemme. Jean Michel Blanquer avait voulu refaire de l’arabe une langue d’élite, de culture, mais encore faut-il qu’il y ait les soutiens matériels et intellectuels et les perspectives de carrière. Les meilleurs élèves voient probablement mal quel avenir leur ouvre l’apprentissage de l’arabe…
Au niveau de la recherche doctorale, vous avez dirigé un nombre important de thèses de terrain dans les monarchies du Golfe. Comment une telle aventure de recherche a-t-elle été rendue possible ? Est-il encore possible de faire des thèses dans ces pays ?
On a commencé à aller au début des années 2000 en Arabie saoudite qui était auparavant complètement fermée. Finalement, tout s’est bien passé. J’avais négocié à l’époque avec le prince Turki qui avait été le patron des services secrets saoudiens et qui était le dirigeant de la fondation Fayçal pour les études islamiques et sociales. Grâce à cela, nous avons pu mener toute une série de thèses sur la région. Le prince considérait que l’image de l’Arabie saoudite était tellement catastrophique après le 11 septembre 2001 que toute production de sciences sociales ne pourra être pire que ce qui était écrit sans accès au terrain. J’ai utilisé cette opportunité pour faire avancer la recherche. Et jusqu’en 2012-2013, nous avions des dizaines de thèses sur la région. Depuis, le mouvement s’est tari.
Pour conclure, j’ai une question à vous poser sur la citation latine que vous avez mise en exergue de votre ouvrage, en dessous du mot qui dédie ce livre à la mémoire de votre père. Il s’agit d’une référence assez pointue, qui rappelle vos premières amours humanistes. « Contempsit caros, dum nos amat ille, parentes / Hanc patriam reputans esse, Ravenna, suam. », extrait d’une nouvelle de Borgès, au sein du recueil l’Aleph. Pourquoi l’avoir choisie et que signifie-t-elle pour vous ?
Ce sont quatre vers de Paul Diacre cités par le maître argentin, j’en ai conservé deux. Le barbare Droctulf vient mettre le siège de Ravenne, puis il est fasciné par la ville, car il n’a jamais rien vu de tel, il passe dans le camp des assiégés, et comme il connait les assiégeants, il les met en déroute mais non sans être tué par l’un d’eux.
Ce n’est pas parce qu’on est fils ou fille d’une Algérienne ou d’un Tchèque qu’on est structuré pour l’éternité par son déterminisme atavique.
Gilles Kepel
Borges note que les habitants de Ravenne écrivent ces vers sur sa tombe, « dans une langue qu’il n’aurait pas comprise ». C’est l’épitaphe virtuelle de mon père. Je lui avais dédié de son vivant Sortir du chaos et après son décès Le Prophète et la Pandémie. C’était l’occasion de revenir sur son identité tchèque qui ne m’a pas vraiment intéressé par le passé et m’intrigue aujourd’hui beaucoup plus par les traces qu’elle a laissées en moi, bien que je n’en connaisse pas la langue !
J’ai tenté une traduction pour un livre que j’écris actuellement autour de mon père et de son propre père, arrivé à Paris de Prague en 1908 pour traduire en tchèque Apollinaire :
« Il rejeta, en nous aimant, ses chers parents
Et proclama Ravenne comme patrie sienne ».
J’y vois en miroir, notre itinéraire familial. J’ai retrouvé une lettre de mon père à son propre père, datant de février 1945. Il a 17 ans et est alors élève au lycée français de Londres, délocalisé en Cumbria à cause du Blitz. Il lui explique que les seules choses qu’il aime, ce sont le théâtre et la France, qu’il veut devenir acteur et Français. Son père lui répond que ce n’est pas sérieux, qu’il faut devenir médecin ou ingénieur, mais est au fond ravi : il traduisait Apollinaire en tchèque ; mon père, lui, traduira Vaclav Havel en français, adapter Le brave soldat Sveik de Jaroslav Hasek pour le théâtre.
Pour cela sans doute, fils de métèque par ma lignée paternelle, j’abhorre les logiques séparatistes qui considèrent que les individus sont essentialisés par leur race, leur couleur de peau, leur religion ou leur genre. Ce n’est pas parce qu’on est fils ou fille d’une Algérienne ou d’un Tchèque qu’on est structuré pour l’éternité par son déterminisme atavique. L’aventure de la vie, c’est l’acquis qui retravaille incessamment l’inné. Je vois dans certains processus aujourd’hui une régression à ce sujet qui m’afflige – au soir de ma carrière universitaire. L’épitaphe de mon père est une manière de le signifier, mais discrètement car… je n’ai pas traduit le latin de l’exergue. Je ne souhaite pas importuner outre mesure mes lecteurs avec ma subjectivité.

