À l’issue d’un long tour de scrutin, l’élection de Joe Biden à la présidence des États-Unis d’Amérique apporte une certitude : on n’entendra guère le prochain locataire de la Maison Blanche parler de l’Afrique comme de « shithole countries », comme le faisait son prédécesseur.
Bien sûr, lu en ces termes, le changement ne semble pas vraiment révolutionnaire. Et pourtant, il ne faut pas s’étonner que les éléments de discontinuité dans la politique africaine de Washington soient basés sur une dimension rhétorique, formelle plutôt que substantielle, quelle que soit la couleur de l’administration en place.
Ligne de continuité
En fait, au cours des vingt dernières années, la politique étrangère américaine en Afrique s’est développée selon une ligne de continuité transversale, qui a transcendé les rangs politiques et est restée largement inchangée malgré les alternances politiques au sommet de l’État.
Une continuité qui s’est clairement manifestée sous les présidences de George W. Bush et de Barack Obama, traduite par une série de priorités sensiblement inchangées : interventions antiterroristes, politiques de coopération au développement – célèbres sont les programmes présidentiels lancés par Bush (President’s Emergency Plan for AIDS Relief, PEPFAR) et Obama (Young African Leaders Initiative ; Feed the Future ; Power Africa) – et plans d’aide humanitaire.
Les variations du score se sont essentiellement limitées au ton et au style utilisés, notamment dans le domaine de la sécurité. De la rhétorique néoconservatrice de la guerre mondiale contre le terrorisme, à l’entreprise, le long d’un arc de crise qui unit idéalement l’Afrique de l’Ouest à la Corne de l’Afrique, des Overseas Contingency Operations d’Obama ; de la référence explicite à un islam radical responsable d’actes de terrorisme, à la tentative de construire une nouvelle relation avec le monde islamique, sanctionnée lors du discours d’Obama à l’Université du Caire en 2009 ; de l’exportation de la démocratie à de nouvelles approches de coopération basées sur l’exaltation de modèles de gouvernance vertueuse.
Mais en fait, peu de choses ont changé. Sous les administrations Obama, on a paradoxalement assisté à un processus de militarisation accrue de la présence américaine en Afrique, par le renforcement de l’empreinte militaire et du Commandement Afrique (Africom), au Sahel – la construction d’une base de drones à Agadez, au Niger, remonte à 2015 – et dans la Corne de l’Afrique, où la pression sur les insurgés djihadistes d’al-Shabaab a été accrue par l’utilisation de drones et de bombardements chirurgicaux, qui n’ont pas épargné les victimes civiles.
Pendant les quatre années de l’administration Trump, le manque d’intérêt des États-Unis pour l’Afrique semblait évident. Pour preuve, les paroles et les actes d’un président qui a exclu le continent de ses visites institutionnelles et n’a reçu que quelques délégations africaines à la Maison Blanche, laissant au secrétaire d’État adjoint aux affaires africaines, Tibor Nagy, la lourde tâche de maintenir le fil des relations avec l’Afrique.
Les pressions exercées par M. Trump et des membres de son administration pour réduire la présence et l’engagement financier des États-Unis en Afrique ont envoyé un signal encore plus éloquent à cet égard, mais la résistance du Congrès a permis de maintenir les principales initiatives sur le continent.
Contrecarrer l’influence sino-russe en Afrique
La Nouvelle stratégie pour l’Afrique, présentée fin 2018, a été le pilier de la politique étrangère américaine dans la macro-région.
Le fil conducteur du document est la volonté stratégique de contrebalancer la présence chinoise et russe en Afrique par le renforcement des relations commerciales avec le continent, dans le cadre d’une concurrence mondiale où les États africains sont « objectivés », considérés comme des acteurs passifs au centre de dynamiques et d’intérêts stratégiques rivaux.
Cette dimension de la présence américaine en Afrique a été rendue explicite par le conseiller à la sécurité nationale de l’époque, John Bolton, selon lequel « les grandes puissances mondiales, la Chine et la Russie, développent délibérément et agressivement leurs investissements dans la région afin d’obtenir un avantage concurrentiel sur les États-Unis ». Dans un discours prononcé à la Heritage Foundation, M. Bolton a souligné que la Chine a eu recours à « des pots-de-vin, des accords opaques, une utilisation stratégique de la dette pour maintenir les États africains captifs de la volonté et des exigences chinoises ».
Et la Russie a tenté « d’accroître son influence dans la région par des accords économiques corrompus […] en développant des relations politiques et économiques sans tenir compte des principes de gouvernance transparente et responsable et de l’État de droit ». La menace pour les intérêts américains en matière de sécurité nationale réside essentiellement dans l’activisme de Moscou et de Pékin, qui saperait l’indépendance des nations africaines et, par conséquent, les possibilités d’investissement des États-Unis sur le continent.
Initiatives économiques et objectifs stratégiques
Pour soutenir les objectifs stratégiques de renforcement des relations commerciales et d’investissement des États-Unis en Afrique, face au déclin constant enregistré ces dernières années – en 2018, l’Afrique représentait 1,6 % du commerce mondial des États-Unis et 0,8 % des investissements étrangers directs, soit environ la moitié du pic de 2010 – l’administration Trump a lancé le programme gouvernemental Prosper Africa.
L’initiative vise à fournir un soutien technique aux activités des acteurs privés américains, en mobilisant des ressources et en harmonisant les initiatives déjà en place. Il est conforme à l’African Growth and Opportunity Act (Agoa) – introduit par Clinton en 2000, renforcé par Bush, prolongé de 10 ans par Obama en 2015 et maintenu en vie par Trump – qui permet aux produits africains d’accéder librement aux marchés américains.
Malgré le lancement de l’initiative, les proclamations de Trump – généralement hostile aux traités multilatéraux considérés comme désavantageux pour l’Amérique, et sa préférence pour les partenariats bilatéraux – se sont reflétées dans les négociations pour la conclusion d’un accord commercial avec le gouvernement kenyan, qui a reçu une grande attention et un grand intérêt dans la région.
L’aide au développement, un pilier de la politique américaine
En ce qui concerne la dimension de l’aide au développement, le bilan des États-Unis est resté inchangé au cours des quatre dernières années, malgré l’apparition de Trump. Les initiatives phares introduites par les administrations précédentes ont été confirmées, et Washington – grâce au rôle incontestablement central joué par l’Agence pour le développement international (USAID) – reste le premier donateur en Afrique.
Au cours des trois premières années de l’administration Trump, l’Afrique a reçu environ 7 milliards d’aide par an, malgré les propositions répétées de réductions par le gouvernement.
En illustrant les priorités des États-Unis en Afrique, en particulier, M. Bolton a souligné la ligne de conduite de l’administration en matière d’aide : réduire les fonds destinés à corrompre les gouvernements africains et orienter l’aide vers les États dotés de processus de gouvernance démocratique et de pratiques commerciales transparentes, en imposant des conditions aux flux d’aide.
La réduction des dépenses publiques d’aide au continent, préconisée par le président pour l’année fiscale 2020, a été rejetée par le Congrès, qui a en fait approuvé une augmentation de 1 % par rapport à 2019.
Crise africaine, perspectives pour le Moyen-Orient
D’un point de vue politico-diplomatique, l’approche de l’administration Trump dans certains dossiers africains a été étroitement liée à la politique du Moyen-Orient et au système américain d’alliances dans la région (Israël, Égypte, Arabie saoudite).
Le retrait du Soudan de la liste des États soutenant le terrorisme (SST), en échange du paiement d’une compensation aux victimes des attaques terroristes contre les ambassades américaines à Nairobi et à Dar es Salaam en 1998 – Khartoum était considéré comme politiquement responsable, puisque le régime d’Omar al-Bashir avait accueilli Al-Qaïda et Ben Laden en territoire soudanais dans les années 1990 – et, surtout, la normalisation des relations avec Israël, en ont apporté la preuve plastique.
Tout aussi éloquente a été la position adoptée par le gouvernement dans le conflit sur l’exploitation des eaux du Nil. Les États-Unis, qui ont accueilli à Washington les négociations entre l’Égypte, le Soudan et l’Éthiopie pour parvenir à un accord sur le calendrier de remplissage du Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (Gerd), ont assumé un rôle perçu par Addis-Abeba comme partiel, favorable à l’allié égyptien.
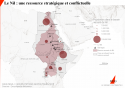
La récente déclaration de Trump, qui après avoir annoncé la réduction du financement de l’Éthiopie de 264 millions de dollars, craignait la possibilité d’une intervention militaire de l’Égypte en Ethiopie pour protéger son intérêt national, a accentué les caractéristiques d’une politique étrangère agressive visant à orienter l’évolution de la crise dans une direction fonctionnelle à la poursuite des objectifs stratégiques américains.
Sécurité et lutte contre le terrorisme au Sahel et dans la Corne d’Afrique
Si l’on considère les initiatives de sécurité menées par les États-Unis sur le continent, la pression exercée par M. Trump et son administration en faveur d’un désengagement partiel a été en partie entravée par le Congrès. En 2017, une embuscade tendue par des miliciens affiliés à l’État islamique du Grand Sahara (ISGS) dans le sud-ouest du Niger a entraîné la mort de plusieurs dizaines de soldats américains, ainsi que de plusieurs dizaines de soldats nigérians.
Les événements de Tongo Tongo ont rendu visible pour l’opinion publique américaine la présence de contingents américains au Sahel, jusqu’alors moins évidente que sur les théâtres de crise du Moyen-Orient et de l’Asie centrale. En même temps, ils ont donné à l’administration l’occasion de remettre en cause la contribution américaine à la lutte contre les groupes armés djihadistes, dans un domaine où le soutien logistique – en termes de renseignement, de surveillance et de reconnaissance, d’approvisionnement aérien, de transport stratégique – assuré aux forces militaires françaises de l‘opération Barkhane est fondamental.

En janvier 2020, le secrétaire d’État à la Défense de l’époque, Mark Esper, a précisé aux Alliés la volonté américaine de réduire l’engagement militaire au Sahel (et, plus récemment, en Somalie) dans le cadre d’une réorganisation plus générale des troupes américaines à l’étranger, qui devrait permettre de concentrer les efforts militaires et les ressources économiques dans des régions du monde considérées comme stratégiquement plus importantes pour contrebalancer l’influence croissante de Pékin et de Moscou.
Mais en fait, la résistance des hiérarchies militaires et des membres du Congrès a jusqu’à présent freiné les projets de désengagement du gouvernement. Lors d’une audition au Congrès, le général Stephen Townsend, chef du commandement de l’Africom, a averti le gouvernement des risques d’un affaiblissement des efforts de lutte contre les groupes armés au Sahel en cas de retrait du soutien militaire américain à la France.
À ce jour, l’Africom compte environ 6 000 unités sur le continent, dont 500 forces spéciales en Somalie, soit un peu moins de 7 200 hommes en 2018. La capacité du dispositif n’a pas subi de coupes drastiques, et la présence américaine en Afrique reste articulée à travers un réseau capillaire de bases temporaires et permanentes.
Le multilatéralisme en crise et les conséquences pour l’Afrique
America First de Donald Trump, décliné en politique étrangère par une remise en cause systématique du multilatéralisme, a eu un impact majeur sur l’Afrique. Le retrait des États-Unis de l’accord de Paris sur le climat a sérieusement affaibli les perspectives d’une lutte efficace contre le changement climatique, avec des conséquences potentiellement désastreuses pour les États africains confrontés à des crises environnementales récurrentes et à des phénomènes météorologiques extrêmes.
De même, la décision de M. Trump de retirer son soutien financier à l’Organisation mondiale de la santé (OMS), accusé d’adopter des positions pro-chinoises, aura de graves répercussions sur le continent, caractérisé par la propagation d’épidémies endémiques et la fragilité des systèmes de santé, ce qui compromettra la capacité de l’agence des Nations unies à fournir un soutien aux gouvernements africains.
Enfin, la decision de Washington de ne pas soutenir Ngozi Okonjo-Iweala, candidate nigériane à la direction générale de l’Organisation mondiale du commerce (OMC), et la paralysie des mécanismes de fonctionnement de l’organisme causée par la décision américaine, est due à l’hostilité plus générale du président Trump envers une organisation considérée comme hostile aux États-Unis et nuisible aux intérêts commerciaux américains.
Quelles perspectives pour la politique africaine de Biden ?
Il est peu probable que l’élection de M. Biden entraîne un changement substantiel de la politique africaine de Washington, conformément à une continuité structurelle largement attribuable au consensus parlementaire bipartite qui en fait une question étrangère à la confrontation politique.
Il faut s’attendre à ce que les principales initiatives économiques et commerciales en vigueur, ainsi que les plans d’aide humanitaire et de développement, restent inchangés, et qu’une présence militaire significative soit confirmée, notamment dans les scénarios de crise jugés plus sensibles, du Sahel à la Corne de l’Afrique.
L’Afrique pourra bénéficier d’une adhésion renouvelée du gouvernement américain aux principes du multilatéralisme – du climat à la santé, du commerce au maintien de la paix – qui devra être sanctionnée par le rétablissement de la participation américaine aux accords de Paris, l’adoption d’une nouvelle approche constructive au sein des instances internationales et le soutien à la nouvelle zone africaine de libre-échange (ZLEC).

Dans le contexte de la concurrence stratégique avec la Chine en Afrique, il faut s’attendre à ce qu’une confrontation frontale puisse être remplacée par une confrontation moins conflictuelle et, à certains égards, plus coopérative. La promotion des pratiques démocratiques et du respect des droits de l’homme sur le continent devrait être une priorité pour la diplomatie américaine, et le retour à un style présidentiel plus conventionnel devrait jeter les bases de la construction de nouveaux partenariats avec les États africains et les organismes régionaux.

