Claude Lévi-Strauss (1908-2009) a été vivement critiqué pour sa distinction entre « sociétés froides » et « sociétés chaudes », avancée dans ses entretiens avec Georges Charbonnier en 1961, parce qu’elle reconduisait l’opposition entre « sociétés primitives » restées en-dehors de l’histoire et « sociétés civilisées » qui ont contribué à l’histoire de l’humanité. Pourtant, un regard rétrospectif sur le contexte historique de l’anthropologie structurale permet d’en réactualiser la signification dans le contexte de l’« ethnologie du froid » dans les sociétés européennes proposée par Pascal Lamy.
On peut parler d’une anthropologie européenne de Claude Lévi-Strauss en un double sens. D’abord au sens où Lévi-Strauss a toujours insisté pour que l’Europe soit représentée à côté de l’Amérique, l’Afrique, l’Océanie et l’Asie dans les recherches du Laboratoire d’anthropologie sociale qu’il a fondé en 1960 au Collège de France. C’est pourquoi il confia la direction adjointe du laboratoire à Isac Chiva (1925-2012), qui avait fui les pogroms contre les Juifs en Roumanie pour travailler sur l’ethnologie des sociétés européennes dans le cadre du Musée des arts et traditions populaires. Les deux revues du Laboratoire d’anthropologie sociale, L’Homme, fondé par Lévi-Strauss en 1961, et Études rurales, fondée par Isac Chiva la même année, reflètent bien cette bi-partition entre l’Europe et le reste du monde qui structure l’espace des musées d’ethnographie mais qui, dans le cadre d’un laboratoire d’anthropologie sociale, est plutôt l’occasion d’une méthode comparée qui éclaire réciproquement les sociétés les unes par les autres.
Mais l’anthropologie de Lévi-Strauss est aussi européenne au sens où cet homme, auquel on a souvent reproché d’être un Américain du Nouveau Monde égaré dans l’Ancien Monde, était au contraire profondément européen. Né à Bruxelles, influencé par le socialisme belge de Emile Vandervelde et Henri de Man, Lévi-Strauss a dû faire le détour par l’Amérique (du Sud d’abord, du Nord ensuite) pour comprendre la catastrophe qui a ravagé l’Europe au milieu du vingtième siècle, et dont il fut une victime indirecte. Alors que son ami Roman Jakobson lui proposait un poste bien rémunéré à Harvard lorsque Claude Lévi-Strauss devait se contenter de postes sous-équipés et marginaux à Paris, celui-ci maintint avec constance et fermeté son souhait de rester en France pour reconstruire l’anthropologie sociale, qui ne survivait plus alors que dans les universités britanniques. L’anthropologie structurale résulte du désir de Claude Lévi-Strauss de panser les plaies d’une Europe déchirée en reprenant l’idéal scientifique des Lumières à travers la politique de la pitié formulée par Jean-Jacques Rousseau.
Lévi-Strauss a dû faire le détour par l’Amérique (du Sud d’abord, du Nord ensuite) pour comprendre la catastrophe qui a ravagé l’Europe au milieu du vingtième siècle, et dont il fut une victime indirecte.
Frédéric Keck
Ce double sens de l’anthropologie européenne éclaire alors l’expression « sociétés froides ». Si Lévi-Strauss semblait ainsi reprendre la notion durkheimienne de « solidarité mécanique », en comparant les sociétés dont s’occupe l’ethnologie à des horloges absorbant les événements dans les régularités de leurs mécanismes, cette notion doit aussi s’entendre dans le nouveau contexte de la guerre froide. Lévi-Strauss revient des Etats-Unis profondément désillusionné sur la capacité d’émancipation du capitalisme américain – comme en atteste son article intitulé « La technique du bonheur » paru dans Esprit en 1947 – mais il ne cède pas à l’ivresse d’un horizon révolutionnaire promis par le système communiste. Fidèle à l’enseignement de Jakobson, il considère l’Europe comme un terrain où l’Est et l’Ouest se rencontrent dans des récits et dans des langues qui doivent être comparés pour en faire rejaillir l’esprit commun dans des espaces de conservation.
Ce que l’on peut appeler la cryopolitique américaine – des technologies visant à refroidir les entités vivantes pour en différer la disparition – par opposition à la biopolitique européenne – des technologies visant à faire vivre les populations en sacrifiant celles qui ne sont pas dignes de vivre – fut appliqué par Lévi-Strauss à tout ce qui pouvait être conservé du passé des sociétés humaines : fiches, artefacts, enregistrements… La guerre froide n’est pas pour Lévi-Strauss un conflit entre capitalisme et communisme mais un moment de refroidissement des échantillons humains qui ont circulé au cours du siècle précédent pour échauffer les passions nationalistes. Les sociétés dont s’occupe l’ethnologie peuvent être considérées comme « froides » à travers le regard éloigné non parce qu’elles sont hors de l’histoire mais parce qu’elles ont été refroidies par l’histoire, transformées en artefacts que l’ethnologie a pour tâche de conserver pour dégager la diversité des relations qu’elles contiennent.
La guerre froide n’est pas pour Lévi-Strauss un conflit entre capitalisme et communisme mais un moment de refroidissement des échantillons humains qui ont circulé au cours du siècle précédent pour échauffer les passions nationalistes.
Frédéric Keck
Je voudrais appuyer cette hypothèse par la lecture de deux textes célèbres que Lévi-Strauss a consacrés à l’Europe au début et à la fin de sa carrière scientifique : « Le Père Noël supplicié » (1952) et « La leçon de sagesse des vaches folles » (1996).
Lévi-Strauss publie « Le Père Noël supplicié » dans Les temps modernes, revue qui vient d’être fondée par Jean-Paul Sartre ; d’où sans doute la tonalité étonnamment anti-capitaliste de ce texte souvent lu par les étudiants français comme une introduction à la pensée de Lévi-Strauss. Celui-ci part en effet d’un événement qui eut lieu à Dijon le 24 décembre 1951 : l’Église catholique a pendu et brûlé l’effigie du Père Noël sur le parvis de la cathédrale pour lutter contre le symbole païen de la culture de consommation de masse introduite par les Américains à la Libération. Lévi-Strauss retrouve ici le ton ironique qu’il avait adopté quatre ans plus tôt dans « La technique du bonheur » :
Depuis trois ans environ, c’est-à-dire depuis que l’activité économique est redevenue à peu près normale, la célébration de Noël a pris en France une ampleur inconnue avant guerre. Il est certain que ce développement, tant par son importance matérielle que par les formes sous lesquelles il se produit, est un résultat direct de l’influence et du prestige des États-Unis d’Amérique. Ainsi, on a vu simultanément apparaître les grands sapins dressés aux carrefours ou sur les artères principales, illuminés la nuit ; les papiers d’emballage historiés pour cadeaux de Noël ; les cartes de vœux à vignette, avec l’usage de les exposer pendant la semaine fatidique sur la cheminée du récipiendaire ; les quêtes de l’Armée du Salut suspendant ses chaudrons en guise de sébiles sur les places et les rues ; enfin les personnages déguisés en Père Noël pour recevoir les suppliques des enfants dans les grands magasins. Tous ces usages qui paraissaient, il y a quelques années encore, puérils et baroques au Français visitant les États-Unis, et comme l’un des signes les plus évidents de l’incompatibilité foncière entre les deux mentalités, se sont implantés et acclimatés en France avec une aisance et une généralité qui sont une leçon à méditer pour l’historien des civilisations. »
Lévi-Strauss observe alors que la coutume américaine de célébrer Noël avec un vieillard en costume rouge offrant des cadeaux aux enfants n’aurait pas pu prendre en Europe si elle ne rejoignait pas une tendance diffuse dans les sociétés européennes, et ascendante sous la modernité, à accompagner la fête chrétienne de rituels empruntés à un fond païen. Si le Père Noël est une invention récente qui transforme des éléments traditionnels, la question est alors : pourquoi tant d’effervescence autour de ce qui n’est qu’une transformation logique ?

De très vieux éléments sont donc brassés et rebrassés, d’autres sont introduits, on trouve des formules inédites pour perpétuer, transformer ou revivifier des usages anciens. Il n’y a rien de spécifiquement neuf dans ce qu’on aimerait appeler, sans jeu de mots, la renaissance de Noël. Pourquoi donc suscite-t-elle une pareille émotion et pourquoi est-ce autour du personnage du Père Noël que se concentre l’animosité de certains ?
C’est ici que Lévi-Strauss utilise le « regard éloigné » pour refroidir la chaleur de la crise. Il compare le Père Noël aux katchinas des Indiens du Sud-Ouest des États-Unis, car ce sont dans les deux cas des divinités réservées à une classe d’âge, celle des enfants, qui permettent de leur imposer un ordre en leur promettant récompenses et punitions lorsque la divinité viendra. Il s’agit moins d’une mystification, dit Lévi-Strauss, que d’une transaction par laquelle une classe d’âges – les adultes – accorde des droits à une autre classe d’âge – les enfants – pour contenir leurs désirs par des croyances en l’au-delà. Alors même qu’il semble employer le vocabulaire marxiste de la lutte des classes, entre dominants et dominés, Lévi-Strauss reprend ici plutôt le vocabulaire socialiste de la solidarité entre les générations – élaboré par le socialisme belge et par l’école durkheimienne à travers l’idéal d’une organisation solidaire des échanges réciproques.
Lévi-Strauss ajoute alors un dernier élément d’analyse en revenant à l’exemple des katchinas : ces divinités des enfants sont les âmes des enfants morts qui ont accepté de rester dans l’au-delà à condition d’être célébrés par des masques et des chants. La lutte des classes est ici en quelque sorte redoublée : la relation entre adultes et enfants renvoie à une relation entre vivants et morts qui la surdétermine, les enfants jouant le rôle des morts et inversant ainsi la relation apparente de domination. À travers le rituel des katchinas, mais aussi donc du Père Noël qui en constitue une transformation, les adultes se voient du point de vue des morts à travers les droits qu’ils accordent aux enfants.
Nous croyons que cette interprétation peut être étendue à tous les rites d’initiation et même à toutes les occasions où la société se divise en deux groupes. La « non-initiation » n’est pas purement un état de privation, défini par l’ignorance, l’illusion, ou autres connotations négatives. Le rapport entre initiés et non-initiés a un contenu positif. C’est un rapport [p. 1583] complémentaire entre deux groupes dont l’un représente les morts et l’autre les vivants. Au cours même du rituel, les rôles sont d’ailleurs souvent intervertis, et à plusieurs reprises, car la dualité engendre une réciprocité de perspectives qui, comme dans le cas des miroirs se faisant face, peut se répéter à l’infini : si les non-initiés sont les morts, ce sont aussi des super-initiés ; et si, comme cela arrive souvent aussi, ce sont les initiés qui personnifient les fantômes des morts pour épouvanter les novices, c’est à ceux-ci qu’il appartiendra, dans un stade ultérieur du rituel, de les disperser et de prévenir leur retour. Sans pousser plus avant ces considérations qui nous éloigneraient de notre propos, il suffira de se rappeler que, dans la mesure où les rites et les croyances liées au Père Noël relèvent d’une sociologie initiatique (et cela n’est pas douteux), ils mettent en évidence, derrière l’opposition entre enfants et adultes, une opposition plus profonde entre morts et vivants. »
Cette analyse synchronique, par comparaison entre des sociétés qui n’ont pas eu de contacts entre elles mais empruntent à un même fond de structures inconscientes, est suivie par une analyse diachronique, qui suit les transformations d’un motif au cours du temps dans une même société. Remarquant que saint-Nicolas est un jeune abbé qui ouvre une période de liesse populaire alors que le Père Noël est un vieillard qui ouvre un repas familial, Lévi-Strauss souligne que la jeunesse comme classe d’âge intermédiaire entre les enfants et les adultes a disparu, ce qui explique selon lui que les émotions populaires se retournent contre le rituel de Noël faute d’être intégrées par lui :
« Écartons tout de suite un ordre de considérations qui ne sont pas essentielles au débat mais qui risquent d’entretenir la confusion. La « jeunesse » a largement disparu, en tant que classe d’âge, de la société contemporaine (bien qu’on assiste depuis quelques années à certaines tentatives de reconstitution dont il est trop tôt pour savoir ce qu’elles donneront). Un rituel qui se distribuait jadis entre trois groupes de protagonistes : petits enfants, jeunesse, adultes, n’en implique plus aujourd’hui que deux (au moins en ce qui concerne Noël) : les adultes et les enfants. La « déraison » de Noël a donc largement perdu son point d’appui ; elle s’est déplacée, et en même temps atténuée : dans le groupe des adultes elle survit seulement, pendant le Réveillon au cabaret et, durant la nuit de la Saint Sylvestre, sur Time Square. »

Constatant une division entre des fêtes où les enfants sont menaçants et d’autres où ils sont chéris, comme Halloween et Christmas aux États-Unis, ou le Réveillon et Noël en France, Lévi-Strauss remarque que l’enfant occupe la place de l’étranger, cet autre qui n’a pas encore de place dans le système social mais qui pourrait le revitaliser ou le perturber. Les cadeaux faits aux enfants sont en fait des cadeaux faits aux morts pour conserver la structure sociale et la « douceur de vivre ».
Interrogeons-nous sur le soin tendre que nous prenons du Père Noël, sur les précautions et les sacrifices que nous consentons pour maintenir son prestige intact auprès des enfants. N’est-ce pas qu’au fond de nous veille toujours le désir de croire, aussi peu que ce soit, en une générosité sans contrôle, une gentillesse sans arrière-pensée ; en un bref intervalle durant lequel sont suspendus [sic] toute crainte, toute envie et toute amertume ? Sans doute ne pouvons-nous partager pleinement l’illusion ; mais ce qui justifie nos efforts, c’est qu’entretenue chez d’autres, elle nous procure au moins l’occasion de nous réchauffer à la flamme allumée dans ces jeunes âmes. La croyance où nous gardons nos enfants que leurs jouets viennent de l’au-delà apporte un alibi au secret mouvement qui nous incite, en fait, à les offrir à l’au-delà sous prétexte de les donner aux enfants. Par ce moyen, les cadeaux de Noël restent un sacrifice véritable à la douceur de vivre, laquelle consiste d’abord à ne pas mourir. »
On voit ici que Lévi-Strauss « refroidit » la passion manifestée par les journalistes autour du Père Noël supplicié en affirmant qu’il ne s’agit pas d’un sacrifice de l’épouvantail américain par l’Église catholique mais d’un sacrifice du désir d’immortalité que les humains célèbrent en offrant des cadeaux à leurs enfants. Une société apparemment « chaude » comme la France de la « guerre froide », partagée entre capitalisme et communisme, entre modernité et tradition, entre paganisme et christianisme, est donc en fait, si on la compare aux sociétés amérindiennes, « froide », c’est-à-dire qu’elle vise à conserver son organisation sociale pour mieux vivre en commun.
Une société apparemment « chaude » comme la France de la « guerre froide », partagée entre capitalisme et communisme, entre modernité et tradition, entre paganisme et christianisme, est donc en fait, si on la compare aux sociétés amérindiennes, « froide », c’est-à-dire qu’elle vise à conserver son organisation sociale pour mieux vivre en commun.
Frédéric Keck
C’est une opération similaire que Lévi-Strauss effectue quarante-cinq ans plus tard lorsque l’Europe est confrontée à la crise des « vaches folles ». Cette fois c’est le capitalisme anglais et non plus américain qui est en cause – deux formes de ce que les Français appellent souvent de façon vague « le libéralisme anglo-saxon ». Le 24 novembre 1996, Claude Lévi-Strauss publie dans le journal italien La Repubblica un texte intitulé « La mucca è pazza e un po’ cannibale ». Le ministère de la santé du gouvernement anglais vient de révéler que les cas de maladie de Creutzfeldt-Jakob découverts sur de jeunes adultes étaient liés à la consommation de viande de bovins atteints d’encéphalopathie spongiforme, et que la propagation dans le cheptel bovin de cette maladie, connue depuis deux siècles chez les moutons sous le nom de « tremblante », était due à la consommation de farines animales, une pratique courant dans l’élevage industriel en Europe depuis un siècle mais que le ministère de l’agriculture anglais avait dérégulé en abaissant la température de réchauffement de ces farines animales. L’émotion suscitée par cette révélation fut intense : la consommation de viande de bœuf chuta rapidement, des experts européens prédirent que cette maladie à incubation lente allait tuer des dizaines de milliers de personnes, et des agences d’évaluation des risques se mirent en place pour limiter les effets de cette catastrophe annoncée. Le texte de Lévi-Strauss donne à ces émotions soudaines une rationalité anthropologique en replaçant dans le temps long la transformation des bovins en « cannibales ». Il est traduit en français en 2001 dans la revue Etudes rurales sous le titre « La leçon de sagesse des vaches folles », lorsque la crise est retombée, le nombre de victimes considérablement réduit, et la consommation de viande revenue à la normale. Il a été récemment réédité sous le titre Nous sommes tous des cannibales avec l’ensemble des articles publiés par Lévi-Strauss dans La Repubblica entre 1989 et 2000.
Comme en écho au « Père Noël supplicié », Lévi-Strauss commence « La leçon de sagesse des vaches folles » en racontant des histoires pour les enfants, c’est-à-dire, dans le vocabulaire de l’ethnologie, des mythes. Lévi-Strauss rappelle que les mythes amérindiens et judéo-chrétiens commencent également par un temps originaire où les humains et les animaux n’étaient pas séparés pour expliquer par une catastrophe originelle (Eve mangeant la pomme tendue par le serpent dans la Genèse, ou des conflits entre un père et son fils en Amazonie) que les humains aient besoin de tuer les autres animaux pour se nourrir de leur chair. Cette inflexion dans la référence aux enfants dans l’anthropologie européenne de Lévi-Strauss est à souligner : alors que l’analyse du Père Noël laissait de côté les non-humains (les rennes, les lutins, le bœuf et l’âne dans la crèche…) pour se concentrer sur les relations entre humains médiatisées par les objets donnés, selon un schème récurrent dans les analyses structurales des systèmes de parenté menées depuis 1940, l’analyse des vaches folles met au centre les relations entre humains et non-humains, selon une nouvelle orientation prise dès le début des années 1950 dans l’analyse des classifications mythologiques. Les enfants ne sont plus les représentant des morts dans des sociétés hantées par le problème de l’égalité, mais les témoins d’une relation empathique aux animaux dans des sociétés hantées par la mise à mort.
Pour les Amérindiens et la plupart des peuples restés longtemps sans écriture, le temps des mythes fut celui où les hommes et les animaux n’étaient pas réellement distincts les uns des autres et pouvaient communiquer entre eux. Faire débuter les temps historiques à la tour de Babel, quand les hommes perdirent l’usage d’une langue commune et cessèrent de se comprendre, leur eût paru traduire une vision singulièrement étriquée des choses. Cette fin d’une harmonie primitive se produisit selon eux sur une scène beaucoup plus vaste ; elle affligea non pas les seuls humains, mais tous les êtres vivants. Aujourd’hui encore, on dirait que nous restons confusément conscients de cette solidarité première entre toutes les formes de vie. Rien ne nous semble plus urgent que d’imprimer, dès la naissance ou presque, le sentiment de cette continuité dans l’esprit de nos jeunes enfants. Nous les entourons de simulacres d’animaux en caoutchouc ou en peluche, et les premiers livres d’images que nous leur mettons sous les yeux leur montrent, bien avant qu’ils ne les rencontrent, l’ours, l’éléphant, le cheval, l’âne, le chien, le chat, le coq, la poule, la souris, le lapin, etc. ; comme s’il fallait, dès l’âge le plus tendre, leur donner la nostalgie d’une unité qu’ils sauront vite révolue. »
La différence entre les sociétés amérindiennes et les sociétés judéo-chrétiennes, cependant, c’est que les premières admettent le cannibalisme comme une forme de nécessité, toutes les relations entre humains et non-humains étant perçues comme des variations des pratiques par lesquelles les Amazoniens mangent leurs ennemis ou leurs ancêtres, alors que les secondes le condamnent par un interdit logique et moral selon lequel on ne peut se manger soi-même. Lévi-Strauss rappelle que l’agent pathogène qui cause la maladie des vaches folles, le prion, a pu être identifié grâce aux recherches de Carlton Gajdusek sur les pratiques cannibales en jeu dans la transmission du kuru chez les Foré de Papouasie Nouvelle-Guinée, reprises par Stanley Prusiner qui a identifié la structure moléculaire de cet agent pathogène d’un genre nouveau : une protéine du cerveau capable d’une conversion qui entraîne une réaction en chaîne transformant le cerveau en « éponge » – d’où le nom technique de la maladie : Encéphaloptahie Spongiforme Subaigue Transmissible. La peur des « vaches cannibales », forcées par le système industriels à manger leurs congénères au milieu d’animaux d’autres espèces, renvoit donc à une peur du cannibalisme partagée par toutes les sociétés, mais que les sociétés amazoniennes ont su davantage intégrer dans leurs mythes et dans leurs rituels.
Le lien entre l’alimentation carnée et un cannibalisme élargi jusqu’à lui donner une connotation universelle a donc, dans la pensée, des racines très profondes. Il ressort au premier plan avec l’épidémie des vaches folles puisque à la crainte de contracter une maladie mortelle s’ajoute l’horreur que nous inspire traditionnellement le cannibalisme étendu maintenant aux bovins. Conditionnés dès la petite enfance, nous restons certes des carnivores et nous nous rabattons sur des viandes de substitution. Il n’en reste pas moins que la consommation de viande a baissé de façon spectaculaire. Mais combien sommes-nous, bien avant ces événements, qui ne pouvions passer devant l’étal d’un boucher sans éprouver du malaise, le voyant par anticipation dans l’optique de futurs siècles ? Car un jour viendra où l’idée que, pour se nourrir, les hommes du passé élevaient et massacraient des êtres vivants et exposaient complaisamment leur chair en lambeaux dans des vitrines, inspirera sans doute la même répulsion qu’aux voyageurs du XVIe ou du XVIIe siècle, les repas cannibales des sauvages américains, océaniens ou africains. »
Cette vision du monde est décrite par Lévi-Strauss comme prophétique car elle conduit à voir les animaux comme contribuant à la « surveillance » du système positif par leur position intermédiaire entre les machines et les humains.
Frédéric Keck
Ayant fait ce diagnostic de la crise des vaches folles, Lévi-Strauss en propose, dans la tradition médicale de la sociologie française, une solution politique. d’Auguste Comte. Lévi-Strauss a en effet découvert dans les années 1990, par le hasard d’un bouquiniste, le Comte du Système de politique positive, alors qu’il ne connaissait jusque là que le Comte du Cours de philosophie positive, qu’il avait enseigné au Brésil et dont il avait gardé l’image réductrice qu’en donnait alors Paul Arbousse-Bastide. Or ce second Comte, revenant sur l’ensemble de son système après la crise politique de 1848 et sa rencontre avec Clotilde de Vaux, le modifie en profondeur d’une façon qui le rend beaucoup plus intéressant pour les anthropologues. Comte interprète en particulier sa crise psychiatrique de 1826 comme une descente trop rapide vers le fétichisme qui lui permet de remonter graduellement vers le positivisme, confirmant ainsi expérimentalement la loi des trois états et s’offrant ainsi en modèle pour les peuples et les individus qui devront également connaître ce développement. C’est à partir de cette expérience du fétichisme – qui reste fictive, mais Comte définit précisément le fétichisme comme le stade fictif de l’état théologique, celui où l’esprit humain projette sur les choses les forces qu’il sent en lui – que Comte réorganise son système politique en mettant Paris et l’Europe au centre du monde positiviste. Il réhabilite notamment l’Italie catholique contre l’Allemagne et l’Angleterre protestantes, en confiant à un nouveau Dante la rédaction d’un poème de l’humanité, comme Lévi-Strauss le rappelle dans sa chronique italienne du 21 juin 1994, « Auguste Comte et l’Italie ». Mais il propose aussi de réorganiser les relations entre humains et animaux en distinguant des animaux transformés en « laboratoires nutritifs » par un élevage industriel et d’autres considérés comme des compagnons nourris de viande de façon à en faire des « serviteurs de l’humanité ». Cette vision du monde est décrite par Lévi-Strauss comme prophétique car elle conduit à voir les animaux comme contribuant à la « surveillance » du système positif par leur position intermédiaire entre les machines et les humains.
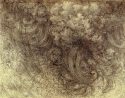
Certains, comme le chien et le chat, sont carnivores. D’autres, du fait de leur nature d’herbivores, n’ont pas un niveau intellectuel suffisant qui les rende utilisables. Comte préconise de les transformer en carnassiers, chose nullement impossible à ses yeux puisqu’en Norvège, quand le fourrage manque, on nourrit le bétail avec du poisson séché. Ainsi amènera-t-on certains herbivores au plus haut degré de perfection que comporte la nature animale. Rendus plus actifs et plus intelligents par leur nouveau régime alimentaire, ils seront mieux portés à se dévouer à leurs maîtres, à se conduire en serviteurs de l’humanité. On pourra leur confier la principale surveillance des sources d’énergie et des machines, rendant ainsi les hommes disponibles pour d’autres tâches. Utopie certes, reconnaît Comte, mais pas plus que la transmutation des métaux qui est pourtant à l’origine de la chimie moderne. En appliquant l’idée de transmutation aux animaux, on ne fait qu’étendre l’utopie de l’ordre matériel à l’ordre vital. »
Ce que n’avait pas prévu Comte, dit Lévi-Strauss, c’est que ces herbivores transformés en carnivores transmettent aux humains des maladies industrielles et non des informations utiles, autrement dit, qu’il y a dans la transmutation des animaux en cannibales un vice caché qu’il reste à élucider.
La transmutation d’herbivores en carnassiers est, elle aussi, prophétique, le drame des vaches folles le prouve, mais dans ce cas les choses ne se sont pas passées de la façon prévue par Comte. Si nous avons transformé des herbivores en carnassiers, cette transformation n’est d’abord pas aussi originale, peut-être, que nous croyons. On a pu soutenir que les ruminants ne sont pas de vrais herbivores car ils se nourrissent surtout des micro-organismes qui, eux, se nourrissent des végétaux par fermentation dans un estomac spécialement adapté. Surtout, cette transformation ne fut pas menée au profit des auxiliaires actifs de l’homme, mais aux dépens de ces animaux qualifiés par Comte de laboratoires nutritifs : erreur fatale contre laquelle il avait lui-même mis en garde, car, disait-il, « l’excès d’animalité leur serait nuisible ». Nuisible pas seulement à eux mais à nous : n’est-ce pas en leur conférant un excès d’animalité (dû à leur transformation, bien plus qu’en carnivores, en cannibales) que nous avons, involontairement certes, changé nos « laboratoires nutritifs » en laboratoires mortifères ? »
L’utopie d’Auguste Comte est un hybride étrange entre le fétichisme des sociétés sauvages et le positivisme des sociétés industrialisées, et son positivisme ne fait aucune place à la négativité des pathogènes qu’il voit comme de simples variations physiologiques. C’est pourquoi Lévi-Strauss prend plus résolument le point de vue des sociétés sauvages en proposant une utopie plus radicale que celle de Comte : à l’avenir, les agronomes et les chimistes produiront des protéines à partir des plantes et des minéraux, les animaux seront libérés de l’élevage industriel et chassés pour leur viande consommée de façon exceptionnelle.
Les agronomes se chargeront d’accroître la teneur en protéines des plantes alimentaires, les chimistes de produire en quantité industrielle des protéines de synthèse. Mais même si l’encéphalopathie spongiforme (nom savant de la maladie de la vache folle et d’autres apparentées) s’installe de façon durable, gageons que l’appétit de viande ne disparaîtra pas pour autant. Sa satisfaction deviendra seulement une occasion rare, coûteuse et pleine de risque. (Le Japon connaît quelque chose de semblable avec le fugu, poisson tétrodon d’une saveur exquise, dit-on, mais qui, imparfaitement vidé, peut être un poison mortel.) La viande figurera au menu dans des circonstances exceptionnelles. On la consommera avec le même mélange de révérence pieuse et d’anxiété, qui, selon les anciens voyageurs, imprégnait les repas cannibales de certains peuples. Dans les deux cas, il s’agit à la fois de communier avec les ancêtres et de s’incorporer à ses risques et périls la substance dangereuse d’êtres vivants qui furent ou sont devenus des ennemis. »
Remarquons que Lévi-Strauss prend ici sur la crise européenne un regard éloigné non pas seulement depuis les sociétés amazoniennes ou mélanésiennes qu’il connaît bien par les recherches des ethnologues du Laboratoire d’anthropologie sociale, mais aussi depuis la société japonaise où il a effectué une série de voyages dans les années 1970. Au Japon, en effet, le fond animiste commun à toutes les sociétés humaines, qui reconnaît profondément la nécessité symbolique du cannibalisme, n’est pas recouvert comme dans la plupart des sociétés humaines par des cosmologies analogistes ou naturalistes, pour reprendre les termes de Philippe Descola, mais il se donne à voir dans les pratiques des artisans, les règles de la gastronomie ou la culture des jardins. Lévi-Strauss résiste ainsi à la thèse selon laquelle la crise des vaches folles montrerait le nivellement des relations entre les vivants par une mondialisation capitaliste : au contraire, du fait de la diversité des relations entre animaux humains et non-humains qu’elle conduit à imaginer par variation des points de vue, cette crise permet de retrouver une véritable diversité naturelle et culturelle.
« On ne peut donc pas affirmer que l’expansion d’une civilisation qui se prétend mondiale uniformisera la planète. En s’entassant, comme on le voit à présent, dans des mégalopoles aussi grandes que des provinces, une population naguère mieux répartie évacuera d’autres espaces. Définitivement désertés par leurs habitants, ces espaces retourneraient à des conditions archaïques ; çà et là, les plus étranges genres de vie s’y feraient une place. Au lieu d’aller vers la monotonie, l’évolution de l’humanité accentuerait les contrastes, en créerait même de nouveaux, rétablissant le règne de la diversité. Rompant des habitudes millénaires, telle est la leçon de sagesse que nous aurons peut-être, un jour, apprise des vaches folles. »
Lévi-Strauss résiste ainsi à la thèse selon laquelle la crise des vaches folles montrerait le nivellement des relations entre les vivants par une mondialisation capitaliste : au contraire, du fait de la diversité des relations entre animaux humains et non-humains qu’elle conduit à imaginer par variation des points de vue, cette crise permet de retrouver une véritable diversité naturelle et culturelle.
Frédéric Keck
Cette « leçon de sagesse » peut alors être rapprochée de celle qui conclut « Le Père Noël supplicié ». Le point commun à ces deux textes, rédigés à presque un demi-siècle de distance, est de refuser l’interprétation de crises dans les relations entre humains et non-humains (les morts et les étrangers dans le premier texte, les animaux dans le second) à travers le concept de sacrifice. Une telle interprétation était tentante en Europe depuis la Révolution Française, qui avait conduit un grand nombre d’observateurs, imprégnés par la tradition catholique ou protestante, à redouter ou espérer un nouveau « sacrifice » par lequel la Providence manifesterait son intervention divine. Or ni le supplice du Père Noël n’est décrit par Lévi-Strauss comme un sacrifice, ni l’abattage massif des vaches soupçonnées de transmettre l’encéphalopathie spongiforme ; tout au plus Lévi-Strauss concède-t-il que ces événements sacrifient le désir d’immortalité qui est caractéristique de l’espèce humaine en acceptant la nécessité de la mort dans les relations entre les adultes et les enfants ou entre les humains et les animaux. Une telle interprétation de deux crises majeures de l’Europe au cours du dernier siècle, l’une dans le contexte du Plan Marshall qui la rend dépendante du capitalisme américain, l’autre dans le contexte de la dérégulation économique qui devait aligner la construction européenne sur le libéralisme économique anglais, résonne avec le débat qui secoue l’Europe au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale, et dont nous ne cessons de percevoir les échos assourdis : faut-il considérer la destruction des juifs d’Europe comme un sacrifice (Holocauste) ou comme une catastrophe (Shoah). En choisissant résolument la seconde option, Lévi-Strauss refroidit l’échauffement des Européens à penser chaque événement comme une intervention divine, et élabore une méthode, le structuralisme comme art de la comparaison et de la variation, pour suivre et anticiper les effets des catastrophes qui affectent l’humanité.
Crédits
Entretiens avec Georges Charbonnier, Paris, Plon, 1961.
Nous sommes tous des cannibales, Paris, Seuil, 2013.
Correspondance avec Roman Jakobson (1942-1982), préfacé, édité et annoté par Emmanuelle Loyer et Patrice Maniglier, Paris, Seuil, 2018.
« La technique du bonheur », Anthropologie structurale zéro, préfacé et édité par Vincent Debaene, Paris, Seuil, 2019.
« Le Père Noël supplicié » : http://classiques.uqac.ca/classiques/levi_strauss_claude/pere_noel_supplicie/pere_noel_supplicie_texte.html
« La leçon de sagesse des vaches folles » : https://journals.openedition.org/etudesrurales/27


