Le travailleur d’hier et de demain. Pour un renouveau du travail en Amérique
À quoi ressemble la pensée de l'économiste organique du trumpisme ?
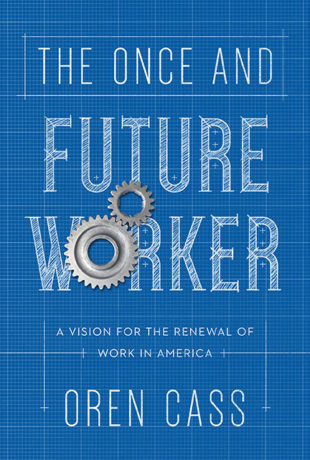
Lorsqu’une politique nous semble bancale et erratique, comme celle de Trump, cela peut signifier qu’elle n’est pas conforme à la logique, et c’est dans ce sens que vont les discours qui insiste sur la personne de Donald Trump, bouffon à l’esprit pauvre. Cela peut aussi signifier que ce sont nos catégories qui ne lui sont pas adéquates, et nous empêchent de saisir sa cohérence.
Prenons le cas du programme économique et social du président américain. On sait que ses discours en faveur d’une réindustrialisation du pays lui ont gagné des voix décisives dans les anciennes régions industrielles. On sait que son ancien conseiller Steve Bannon se glorifie d’avoir « fait des Républicains le parti des travailleurs ». Ailleurs, dans le monde, des politiques économiques hétérodoxes sont menées par des gouvernements de droite nationaliste, en Hongrie, en Pologne, au Royaume-Uni. Or ces mesures hétérodoxes sont toujours associées à des mesures favorables au capital et aux plus riches, notamment en matière fiscale, ce qui laisse l’impression d’un amateurisme démagogique qui distribuerait des miettes au peuple pour le tromper.
C’est justement cette impression que permet de surmonter l’ouvrage d’Oren Cass. Depuis sa participation à la campagne présidentielle de Mitt Romney en 2012, par ses articles dont ce livre est la synthèse, il s’est visiblement donné pour but de donner de nouvelles bases intellectuelles aux Républicains. Ce qu’il arrive ici à nous faire sentir avec subtilité, c’est que le programme de Trump ne doit pas tant s’expliquer comme le produit d’un cerveau malade que comme celui d’une idéologie conservatrice en recomposition.
Cass donne aux éléments disparates de sa politique une cohérence nouvelle. Avec une clarté remarquable, sans sophistications techniques ni rhétorique facile, il analyse la crise sociale que traversent les classes populaires américaines, en montrant comment une idéologie partagée par les Républicains comme les Démocrates pendant des décennies l’a laissée s’aggraver, et en proposant pour la surmonter une nouvelle ligne politique. Il s’agit en somme d’abstraire du trumpisme les éléments d’un cadre idéologique nouveau susceptible de structurer pour la décennie à venir le parti républicain, voire la droite occidentale.
« le Président Donald Trump s’est engouffré dans cette fissure [entre conservateurs et libertariens] dans sa formidable [stunning] course à la Maison blanche, ignorant les débats économiques classiques sur le rôle de l’Etat pour insister sur la manière dont les marchés avaient desservi de vastes pans de la société. L’Hypothèse du travail [cf infra] cherche à comprendre ces échecs du marché, et nos propositions politiques cherchent à y remédier par un programme cohérent. Dans certains cas, nos propositions vont dans le même sens que celles de Trump, en les poussant bien plus loin. Dans d’autres cas, l’analyse défendra, comme Trump, que le statu quo est intenable, mais en proposera un diagnostic et donc des solutions différentes. »
Le travailleur d’hier et de demain. Pour un renouveau du travail en Amérique — Oren Cass, Page 9
L’hypothèse du travail
Cass part de la critique de l’approche dominante de la prospérité, qu’il caractérise comme l’”hypothèse du gâteau”. Selon cette approche, une nation serait prospère dans la mesure du niveau de consommation de sa population. Pour atteindre la prospérité, il conviendrait donc d’obtenir le revenu national le plus grand possible (c’est-à-dire d’accroître le PIB par la croissance), puis de le redistribuer convenablement, comme les parts d’un gâteau — c’est le rôle des aides sociales.
L’histoire de la société américaine de ces dernières décennies contredit frontalement ce principe, selon l’auteur. Le PIB a augmenté, les aides sociales aussi, mais cela n’a en rien empêché une crise sociale profonde. Celle-ci se manifeste d’abord par une baisse du taux d’activité — la part de la population adulte qui participe au marché du travail. Elle a aussi pour symptôme la hausse significative de la mortalité liée à la drogue et aux suicides, ce qu’on a appelé les « morts du désespoir 1 », responsables d’une baisse inquiétante de l’espérance de vie de la population. Le dernier signe de cette crise est politique, avec la popularité de personnages atypiques comme Trump chez les Républicains et Sanders chez les Démocrates.
À l’hypothèse du gâteau, Cass oppose donc son propre principe directeur qu’il appelle l’”hypothèse du travail” (working hypothesis, litt. “hypothèse de travail”). Celle-ci s’oppose à la précédente sur trois points cruciaux. Tout d’abord, la production prime sur la consommation, c’est-à-dire qu’il est plus important pour les citoyens d’avoir un travail productif et respecté que de consommer plus de babioles grâce à des aides d’État ou des importations à bas prix. Cass insiste ici sur les ravages subjectifs du chômage ou de l’emploi précaire, et l’estime de soi permise au contraire par l’occupation d’un emploi productif stable. C’est l’emploi qui permet de gagner le respect d’autrui, c’est l’emploi qui finance la fondation d’une famille.
Cela nous amène déjà au point suivant : la communauté prime sur l’individu. Cass oppose aux individus abstraits des statistiques économiques et des théoriciens de l’inégalité les « structures sociales ». Quand il faut spécifier ce concept, il recourt toujours à une paire : « communauté » et « famille ». Par communauté, il entend la vie de quartier des villes moyennes industrielles, meurtrie par les transformations économiques de ces dernières décennies ; et par famille, il entend la famille stable, à deux parents, capable de transmettre aux enfants le goût du travail afin qu’ils s’insèrent à leur tour dans la communauté.
Selon lui, non seulement ces structures sociales sont plus importantes que la croissance de la consommation, mais elles en sont la condition : c’est l’épanouissement des individus dans leur communauté qui leur donne la confiance en eux-mêmes nécessaire pour innover. En voulant promouvoir la croissance à tout prix, la classe politique des dernières décennies aurait donc en fait sapé son fondement, ce qui expliquerait que la croissance du XXIe siècle, bien que réelle, soit sensiblement plus faible qu’au siècle précédent. Les marchés seraient donc essentiellement hétéronomes, demandant à être réinsérés dans des structures sociales plus fondamentales. Livrés à eux-mêmes, ils perdent leur propre force.
Son troisième différend avec l’hypothèse du gâteau concerne la multiplicité des modes de vie. En identifiant la prospérité à un indicateur unique, les élites défendraient en fait l’imposition sans merci de leur propre mode de vie à toute la population, comme la vie dans une métropole, l’écologie comme priorité absolue ou la promotion des seuls emplois hautement qualifiés. À cela, Cass oppose ce qu’il nomme un « pluralisme productif ». C’est là un habile renversement du problème du libéralisme : en proposant de réguler le marché au nom de la « santé des communautés », Cass semble s’éloigner de la tradition libérale des Républicains pour se rapprocher de leur versant réactionnaire. Il tente cependant de la rejoindre de la manière que nous venons d’indiquer, en défendant que chacun doit avoir le droit de contribuer à la production nationale par son travail, même s’il vit dans une petite ville, s’il n’a pas poursuivi des études longues, ou si cela demande d’assouplir la régulation environnementale.
On le voit, ces trois points — production plutôt que consommation, communauté plutôt qu’individu, et pluralisme productif plutôt que modèle unique — sont liés. Le travail stable constitue en lui-même une communauté de collègues, et permet d’en fonder une autre, celle de la famille. Chaque communauté, vivant des fruits de son effort, peut alors poursuivre son propre idéal. La tendance contemporaine serait au contraire à l’atomisation de la société en une multitude de consommateurs isolés, exclus du marché du travail lorsqu’ils ne sont pas capables d’imiter leurs élites.
De cette analyse, Cass déduit une série de propositions :
- Dans l’éducation, cesser de promouvoir exclusivement l’université. L’apprentissage, qui forme les jeunes à des métiers utiles, doit être revalorisé. Dans la culture, encourager un changement de regard sur le travail. Chaque travail mérite le respect et a un rôle à jouer dans la communauté.
- Dans la régulation de la production, être moins contraignant en matière environnementale et de conditions de travail, pour encourager la création d’emplois. Dans le même but, abolir les syndicats de branche et favoriser ceux d’entreprise, en leur donnant plus de pouvoir pour changer la régulation à l’échelle de la firme.
- En matière migratoire, empêcher l’arrivée de travailleurs peu qualifiés qui feraient concurrence aux nationaux, et privilégier l’immigration les travailleurs étrangers qualifiés.
- En matière fiscale, rendre le travail plus attractif en le subventionnant directement. Remplacer les nombreuses (sic) aides sociales par un complément de revenu du travail.
- En matière commerciale, prendre en compte les effets du libre-échange sur les travailleurs américains. Obliger les entreprises américaines à se relocaliser aux Etats-Unis et encourager les entreprises étrangères à y implanter leur production.
On le voit, les éléments conservateurs habituels comme la dérégulation sous différentes formes se trouvent combinés à des propositions plus hétérodoxes, en matière fiscale, commerciale, éducative. Sur plusieurs points, ce programme se rapproche de celui de Trump. Mais cela ne doit pas nous empêcher de lui consacrer l’attention qu’il mérite.
Chiffres convaincants et chiffres absents
Cet examen doit d’abord souligner la qualité générale de l’argumentation, toujours pertinente sans se perdre dans des détails techniques. On peut d’abord saluer les grands indicateurs retenus comme synthèse de la crise sociale américaine. Il s’agit de la baisse de la participation au marché du travail, qui témoigne du nombre d’individus isolés qui n’ont plus la capacité ou la volonté de s’insérer dans les structures sociales, et qui ne saurait être occultée par la faiblesse du chômage, qui ne concerne que les individus en recherche active d’emploi. À cette donnée s’ajoute celle des « morts du désespoir », qui concernent souvent les mêmes individus et qui montrent la profondeur dramatique des conséquences de l’écart entre le marché du travail et la population.
L’ouvrage est également convaincant lorsqu’il répond, dans le chapitre 4, aux pessimistes qui rendent une automatisation inexorable responsable de la raréfaction des emplois. D’une part la hausse de la productivité, permettant d’obtenir autant avec moins de travailleurs, n’entraîne pas nécessairement du chômage ; par le passé, elle n’a pas empêché les travailleurs libérés des anciennes tâches de retrouver du travail, car les emplois ont changé de nature, la production s’est diversifiée et a augmenté en qualité. D’autre part, cette hausse de la productivité elle-même est plus faible que par le passé, ce qui limite d’autant le problème.
Il faut aussi relever que malgré ses sources abondantes, l’ouvrage outrepasse parfois la rigueur scientifique : sur le sujet du salaire minimum (chapitre 8) et de l’effet des travailleurs migrants sur les travailleurs nationaux (chapitre 7), il met de côté des pans entier de la littérature qui ne vont pas dans son sens 2 et donne l’illusion du consensus chez les économistes.
L’usage des données est également discutable dans la critique des aides sociales que l’auteur recommande de démanteler, au chapitre 11. Il dénonce de façon argumentée leur inefficacité. Mais il est difficile de les rendre responsables de la faible participation au marché du travail, car elles sont inférieures à la plupart des autres pays développés 3, y compris des pays où le taux d’activité est beaucoup plus élevé ou équivalent (comme la France par exemple). L’assistanat n’est donc pas le grand problème américain, à moins de supposer que les Américains soient plus fainéants que les autres. En réalité, par rapport aux autres pays riches, les Etats-Unis se distinguent d’une part par de faibles dépenses sociales par habitant et d’autre part par l’inefficacité de ces dépenses dans la réduction de la pauvreté et des inégalités. Une des causes de cette inefficacité est sans doute la privatisation des dépenses sociales, en particulier dans la santé. Les dépenses y sont décorrélées des résultats : les Américains dépensent plus que tout autre pays de l’OCDE dans la santé mais ont une espérance de vie bien inférieure. Au contraire de la thèse de Cass, le système d’aide américain semble donc souffrir avant tout d’un sous-investissement et d’une sur-privatisation.
L’oubli du pouvoir
Mais le livre a, pensons-nous, un défaut plus profond, qui touche à son principe même. Lorsqu’il s’en prend à l’idéologie des économistes, dont les deux piliers sont l’individu et la consommation, en défendant pour sa part le développement de structures sociales plurielles menacées par le marché à outrance, Cass rejoint les critiques de gauche du néolibéralisme, elles-mêmes fondées sur les sciences sociales critiques. Ce qui fait son originalité, c’est la réinterprétation de cette thèse dans un sens conservateur, en retenant comme structures sociales primordiales la communauté et la famille.
Mais cette conception des structures sociales est partielle. L’exclusion économique est bien un problème social, lorsqu’elle prive les individus de la possibilité de contribuer à la vie économique, ou lorsque la précarité les empêche de fonder une famille. Mais ce n’est pas le seul de tous les maux, et le retenir comme seul axe de la critique sociale revient à se plier devant les communautés telles qu’elles sont et à écarter tout projet de leur transformation. Intégration ou exclusion, tels sont les deux seuls rapports sociaux que Cass semble envisager comme constitutifs des « structures » qu’il évoque. Tout groupe humain, qu’il s’agisse de la famille, du quartier, de l’usine, serait alors un ensemble compact, cimenté par des valeurs communes.
Ce que Cass occulte, c’est que l’intégration dans un collectif peut se faire selon plusieurs modalités, selon la position qu’on y occupe. En un mot, il ignore, comme le concept de communauté y invite souvent, les rapports de pouvoir qui traversent les groupes dont il s’occupe. L’insistance sur les communautés, si elle fait son originalité, est aussi, croyons-nous, son point faible.
On pourrait développer ce point à propos de la famille. Cass exprime une certaine sympathie pour une famille où seul le père travaille (p. 32-35), et selon lui les mesures prises par les démocrates pour favoriser l’insertion des femmes sur le marché du travail ont pour seul but un gain de PIB. L’idée que la femme au foyer soit en position dominée au sein du couple ne semble pas lui traverser l’esprit, et l’émancipation semble rabattue sur l’individualisme.
Mais son objet premier est le travail, et c’est là que son oubli du pouvoir est le plus frappant. Il ignore complètement la question du pouvoir et des inégalités sur le marché du travail. C’est assez visible dans ses raisonnements sur le salaire minimum et la régulation des conditions de travail. Oren Cass suppose que patrons et travailleurs peuvent s’entendre sur ces sujets, mais cela ne serait vrai que si le jeu était équilibré entre eux. Ce n’est pas le cas. Le rapport de forces est souvent au détriment du travailleur, qui a peu d’emplois alternatifs, et au profit de l’employeur qui peut trouver aisément son remplaçant.
L’ouvrage ne se lasse pas de rappeler qu’un emploi stable est le fondement authentique du bonheur. C’est d’ailleurs cohérent avec son insistance sur la famille, puisqu’on on a montré depuis longtemps que stabilité de l’emploi et stabilité privée vont de pair 4. Pourtant, Oren Cass n’évoque pas une seconde la protection de l’emploi. Il propose de protéger les entreprises américaines contre la concurrence étrangère, mais pas de garantir les emplois des Américains contre les licenciements, disposition pourtant commune dans les pays européens.
Plus généralement, les efforts demandés le sont soit à l’État, soit au travailleur, mais jamais à l’employeur. Au lieu de demander aux entreprises d’augmenter les salaires, il préfère défendre un complément payé par les fonds publics. Au lieu d’exiger des entreprises qu’elles forment leurs employés au cours de leur carrière, c’est au système national d’éducation qu’il demande de favoriser l’apprentissage. En somme, les employeurs et leur pouvoir sont à peine mentionnés dans un livre consacré au travail.
Pourtant, la recherche contemporaine montre que si le travail peu qualifié ne paie pas aujourd’hui aux États-Unis et dans les pays riches, si la dignité des travailleurs est mise en cause, ce n’est pas sans rapport avec le pouvoir des employeurs. L’appauvrissement des conditions du travail et la faible croissance des salaires (ainsi que le ralentissement du rythme des promotions) agit comme une barrière à l’entrée sur le marché du travail, et pourrait expliquer la baisse tendancielle du taux d’activité aux Etats-Unis. À cause de l’arrivée de nouveaux géants concentrant l’emploi sur certaines zones et de l’affaiblissement des institutions censées protéger les travailleurs, ils sont de plus en plus démunis.
Une variable au cœur des débats économiques récents, mais que Cass ne cite pas, est la part des salaires dans le revenu total, qui représente la fraction de la production qui revient aux travailleurs. Le déclin de cet indicateur depuis les années 1980 aux Etats-Unis est souvent interprété comme un basculement du rapport de forces en faveur du capital. C’est bien ici du partage du gâteau qu’il s’agit, mais en tant que résultat d’une structure sociale conflictuelle.
Le remède est donc peut-être dans le renforcement des institutions qui défendent les travailleurs, par exemple les syndicats. Contrairement aux assertions d’Oren Cass, ceux-ci ont très peu de pouvoir aux Etats-unis. Le nombre de travailleurs syndiqués aux Etats-Unis chute depuis trente ans et contrairement à la France, les non-syndiqués n’y bénéficient pas des accords négociés par les syndicats. Depuis la loi Taft-Hartley de 1947, la marge d’action des syndicats aux Etats-Unis est rigoureusement limitée, en matière de recrutement, de grèves et d’engagement politique, chaque État ayant de plus le droit de réduire plus encore le pouvoir des syndicats. L’échec en 1981 de la grève des contrôleurs aériens américains et le licenciement de la plupart d’entre eux a sonné le glas des mouvements de revendication aux Etats-Unis.
Une autre voie serait le renforcement des minimums garantis par l’Etat, à savoir le salaire minimum et la régulation des conditions de travail, qui profitent aux travailleurs les plus vulnérables. Les travailleurs américains sont par exemple parmi ceux qui travaillent le plus longtemps (mais ne sont pas forcément plus productifs). Il y a même beaucoup de raisons de penser que les Américains travaillent plus qu’ils ne le souhaitent.
Enfin, si c’est la concentration du pouvoir aux mains de quelques employeurs qui est la source du problème, il faut peut-être envisager une véritable politique d’antitrust sur les marchés du travail. Casser les monopsones dans certains régions (en obligeant certaines entreprises à déménager ou bien en augmentant localement le salaire minimum) pourrait avoir une influence significative sur le bien-être des travailleurs. Ces idées sont portées en ce moment même au Congrès par de jeunes économistes prometteurs tels que Ioana Marinescu.
Conclusion
Au mépris d’un large pan de la recherche contemporaine, Cass suppose donc que la firme est harmonieuse, comme les autres communautés qu’il mentionne d’ailleurs. Si sa stratégie politique est offensive, dirigée contre l’hypothèse du gâteau et ses défenseurs de l’establishment, elle n’est donc pas à proprement parler une stratégie de lutte sociale des classes populaires contre les classes dominantes. L’adversaire social que désigne Cass, ce n’est pas le patron, mais le “cadre urbain typique” (p. 9) qui impose à la nation ses priorités, la promotion de l’université et la lutte contre la pollution. Il évoque aussi des « capitalistes qui, au volant de leur Prius, se rendent à leur réunion de quartier dans leur banlieue chic » (p. 35) – caractérisés donc par leur style de vie bien plus que par leur pouvoir au sein de la communauté productive. Cette nouvelle idéologie conservatrice propose donc au capital et au travail de s’allier contre les « diplômés obsédés par l’ouverture » (p. 27) – les bobos, pourrait-on traduire. C’est peut-être ce qui fait son succès planétaire. Reste à savoir comment le lui contester, pour ceux qui veulent le lui contester.
Sources
- Selon le mot popularisé par Anne Case et Angus Deaton.
- Même les économistes qui y sont le plus opposés, comme David Neumark, reconnaissent que l’effet du salaire minimum sur l’emploi est proche de zéro. Sur l’impact des travailleurs migrants sur les salaires des natifs, rien n’est clair non plus.
- 18.7 % du PIB américain contre 20.1 % pour la moyenne des pays de l’OCDE et 31.2 % en France par exemple
- En voici une autre preuve récente.

