Quelle est l’origine de l’intérêt que vous portez à ce thème extrêmement difficile ?
C’est, en premier lieu, un intérêt intellectuel. Avant d’aborder la question, je n’avais pas de lien particulier avec le Rwanda ni avec le génocide des Tutsi. Depuis ma jeunesse, je m’intéresse aux questions des violences de masse. Mon approche voudrait se situer au croisement de deux champs de recherche : les études africaines et les genocide studies, les études des violences de masses. Cette même approche se ressent dans mon parcours de jeune étudiant : lorsque j’ai commencé à traiter la question rwandaise, pendant mon master, je n’ai pas voulu traiter la question du génocide. J’y suis arrivé plus tard. Il est ainsi possible de retracer mon évolution personnelle dans mon travail actuel : je n’inscris pas l’événement uniquement dans une brève temporalité, mais dans un temps long.
Pourquoi vous a-t-il semblé pertinent de produire un ouvrage de synthèse sur la question, plutôt qu’une monographie plus longue ?
C’est un livre de commande : les éditions de La Découverte m’ont demandé d’écrire un ouvrage de synthèse sur le génocide des Tutsi.
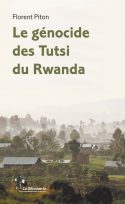
Ceci montre qu’il y a une évolution. Bien qu’il existe encore un déficit de connaissance et, parfois, de reconnaissance vis-à-vis de la question rwandaise, les éditeurs s’y intéressent, et le public aussi.
Ma position est particulière : étant encore en thèse de doctorat, je me suis lancé dans une synthèse à la place de commencer par une étude très limitée.
La recherche sur le génocide des Tutsi est une question portée surtout par une jeune génération.
Florent Piton
Je pense que cela montre que la recherche sur le génocide des Tutsi est une question portée surtout par une jeune génération, dont je fais partie et dont je ne suis, désormais, pas le seul représentant. Évidemment, cela ne veut pas dire qu’il faut refouler tout ce que les autres ont fait avant : mais on assiste aujourd’hui à un véritable renouvellement.
Le renouvellement de l’approche suscite une reformulation des questions. Est-ce que le génocide, en tant que champ conceptuel ne limite pas votre champ de travail vis-à-vis de l’étude des nouveaux conflits qui émergent, notamment à Kinshasa ?
En premier lieu, j’aimerais indiquer le fait que ce livre n’est pas une histoire du Rwanda. C’est un livre sur les Tutsi du Rwanda. Je ne fais ni d’histoire politique rwandaise, ni d’histoire culturelle. Il s’agit donc de l’histoire du génocide des Tutsi, envisagée à partir d’un temps long qui excède les strictes limites temporelles assignées à l’événement génocidaire, entre avril et juillet 1994.
Je ne marche pas sur une ligne de crête ; puisque, en Histoire, on évite d’abord toute approche téléologique. En ce sens, il ne s’agissait pas d’imaginer un récit historique où le génocide devait être une conséquence logique écrite à l’avance. De même, il faut néanmoins rester prudents et ne pas non plus présenter le génocide comme quelque chose qui a eu lieu uniquement à la fin. En ce sens, je ne peux pas traiter les années 1950 en faisant semblant d’oublier que, in fine, il y a eu un génocide. Ainsi, il devient assez difficile de comprendre le génocide des Tutsi sans que l’on croise les temporalités : en ce sens, certaines choses se jouent dans un temps très court, et d’autres dans une temporalité plus longue. Mon secret pour éviter toute forme de téléologie est de faire semblant de « ne pas savoir » : c’est-à-dire de croiser les temporalités et les échelles géographiques.
Dans quelle mesure les grands auteurs des études sur les génocides vous ont-ils aidé à considérer le présent en cherchant ses racines dans un passé qui n’avait pas été entièrement raconté ?
Avant de commencer à rédiger Le génocide des Tutsi du Rwanda, j’ai lu – enfin – les œuvres de Saul Fridländer sur la Shoah 1 qui constituent un modèle de narration de l’histoire de génocides. L’histoire du temps long, où les juifs sont désignés en tant que cibles – temporalité que j’ai évoquée – est nécessaire pour comprendre l’événement Shoah, qui s’inscrit dans une temporalité plus courte. Dans ce contexte, la mise en place de la solution finale, c’est-à-dire l’extermination des Juifs, est considérée plus tardivement. En terme d’écriture, je tends personnellement vers ce modèle de narration.
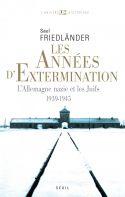
En considérant la longue durée dont vous parlez et le moment génocidaire proprement dit, serait-il possible d’entreprendre une comparaison avec le système nazi ? En termes de guerre psychologique, de mobilisation des moyens, de mécanismes d’organisation du génocide… Nous pourrions partir, par exemple, de la conférence de Wannsee…
Je ne sais pas s’il y a eu, au Rwanda, un phénomène comparable – même si une forme de structure s’est progressivement installée, qui finira par être engagée dans le génocide. Cependant, la mise en place des éléments d’une telle structure n’entraînent pas forcément l’idéalisation du génocide : on se retrouverait encore une fois sur la « ligne de crête » préalablement décrite. Néanmoins, ces éléments vont être incontestablement mobilisés par la suite dans le génocide. Prenons le cas de l’autodéfense civile : la mobilisation préalable d’hommes (l’ensemble des Hutu) et d’armées pour l’organisation d’une ligne arrière va devenir, progressivement, le fer de lance du génocide. Cela exemplifie ma manière de penser les grands éléments de structure. On soulève ici une question épineuse, celle de la planification : en affirmant, justement, l’existence d’une planification du génocide, en termes de structure mais aussi d’idéologie. Or, dans mon livre, je n’utilise pas ce terme : je préfère parler de germination, dans le respect de mon approche prudente, qui vise à éviter et réfuter toute forme de téléologie.
Néanmoins, je comprends pleinement le besoin, sur un plan politique et militant, d’utiliser ce terme de « planification. » En l’enlevant, on abolit toute intentionnalité, ce qui pourrait aboutir à un discours négationniste. Ce terme est donc nécessaire, bien que l’historien ait plus de difficulté à l’utiliser dans un discours qui se veut scientifique.
En s’inscrivant toujours dans la tentative de comparaison entre les deux génocides : quelle place a occupé, dans le cadre de l’accentuation des violences, la volonté de s’approprier une grande partie des biens des Tutsi ?
Si je devais établir une comparaison avec un autre génocide, je dirais que le génocide rwandais est plus proche du génocide arménien : notamment, du fait que l’on n’ait pas spécialement établi, dans les deux cas, des centre de mise à mort.
La question des biens est une question assez difficile. Il y a effectivement eu des pratiques de pillages. Pour autant, cela ne devrait pas nous conduire à une lecture de la pratique génocidaire comme étant basée sur un accaparement de biens : il s’agit d’un élément, mais ce n’est pas le seul. Prenons l’exemple des vaches au Rwanda : un bien extrêmement important, d’un point de vue économique et symbolique. Durant le génocide, les vaches sont directement tuées – et pas volées, afin de nourrir les repas au caractère, disons, orgiaque. Ceci invalide l’hypothèse que vous mentionnez, en termes d’enrichissement économique ; en mettant d’avantage l’accent sur un facteur fondamental du génocide : l’idéologie.
Nous ne pouvons pas faire l’économie du facteur idéologique. Les vaches sont associées aux Tutsi, qui sont considérés comme des éleveurs : ainsi, tuer les vaches signifie éliminer tout ce qui pourrait rappeler l’ancienne présence des Tutsi. C’est ma manière de lire la logique des biens.
Justement, en rebondissant ce sur point : est-ce qu’il existe, dans cette haine que vous décrivez au sein de la société, la trace d’un ressentiment des paysans vis-à-vis d’une société de pasteurs ?
Je ne formulerais pas les choses ainsi. Ce qui est sûr, et qui date d’ailleurs de l’époque coloniale, est la création d’une catégorie « Tutsi. » Catégorie qui est représentée, certes, par l’éleveur et le possesseur de vaches, bien que ce ne soit pas le seul élément qui la caractérise. Le Tutsi est considéré comme faisant partie d’une race différente : aux caractéristiques morphologiques et morales différentes – le « Tutsi » est, typiquement, un menteur, un sournois.
C’est aussi quelqu’un qui exploite la masse des travailleurs Hutu, qui se serait en revanche libérée après l’indépendance du Rwanda. Les Tutsi représentent la menace d’un retour à l’exploitation féodale.
La haine contre les Tutsi est un type de racisme particulier, qui n’est pas fondé sur l’infériorisation de l’autre.
FLorent Piton
En ce sens, il s’agit plutôt d’un imaginaire raciste qui emprunte des critères physiques et sociaux pour créer la catégorie Tutsi : le Tutsi, comme le juif, n’est pas un ennemi faible ; c’est un ennemi puissant, et c’est pour cela qu’il faut s’en débarrasser. C’est un type de racisme qui n’est pas fondé sur l’infériorisation de l’autre.
Quelle a été la réaction – et l’action – des grandes institutions productrices d’idéologie, comme les églises et l’armée ?
Les comportements des religieux ont pris différentes formes. Un groupe de sœurs, par exemple, a activement protégé les Tutsi ; elles ont été tuées. De l’autre côté, un nombre considérable de prêtres a participé au génocide, sans rien faire pour l’empêcher : en ce sens, on pourrait véritablement parler d’une participation de l’Église, participation qui s’inscrit dans la longue histoire de l’Église au Rwanda, pays très christianisé, où la pratique religieuse est très importante. Ainsi, certains des massacres du génocide ont eu lieu dans des lieux de culte, avec l’aval des curés en charge des bâtiments ecclésiaux.
Et pour ce qui concerne l’armée ?
L’armée a joué un rôle important. Bien que le génocide ait été commis en grande partie par les civils, c’est-à-dire par des voisins sur leurs propres voisins, ce n’est pas un génocide populaire : sans l’État, il n’aurait pas été possible. L’appareil étatique et l’armée ont donc été les principaux vecteurs de mobilisation des civils.
Dans les premiers jours, s’est jouée une lutte d’influence au sein même de la hiérarchie de l’armée. Tous les acteurs n’étaient pas engagés dès le 7 avril 1994, jour marquant le début du génocide. Le chef d’état-major, un modéré, a fini par être évincé et remplacé par un extrémiste.
Que signifie être modéré à ce moment-là ?
Parmi les forces politiques présentes dans les cours des années 1990, certains partis politiques ont fait de l’hutuisme l’un des axes majeurs de leur discours. Les forces modérées se sont faites les avocats d’une démocratisation inclusive, regardant aussi en direction de la minorité Tutsi. Des clivages qui se retrouvent parmi les militaires et dans toutes les sphères sociales. Il faudrait alors s’intéresser au processus d’élimination de ceux qui se sont opposés au massacre.
Quel rôle a joué la destruction de l’avion dans lequel se trouvait le président Habyarimana le 6 avril 1994 ? Et connaît-on les responsables de cet attentat ?
On ne peut pas affirmer de manière définitive par qui et pourquoi cet avion a été abattu.
En tout cas, connaître les responsables de la destruction de l’avion ne pourrait probablement pas nous porter à réécrire radicalement le génocide des Tutsi, quand bien même le FPR aurait provoqué l’attentat. Tel récit fait partie des tentatives de retournement des responsabilités, voulant être remise sur les Tutsi, et selon lesquelles le FPR aurait considéré les Tutsi, de l’intérieur, en tant que victimes collatérales, subordonnées à l’objectif premier, la prise du pouvoir.
Ceci participe d’une logique révisionniste et négationniste. Certes, j’aimerais bien savoir qui a abattu l’avion, mais cela ne conduirait pas à la réécriture de l’ouvrage… L’explication fondamentale du génocide n’est pas la chute de l’avion, mais le racisme et les structures que je viens d’évoquer.
Savoir qui a abattu l’avion cela ne conduirait pas à la réécriture de l’ouvrage… L’explication fondamentale du génocide n’est pas la chute de l’avion, mais le racisme et les structures que je viens d’évoquer.
Florent Piton
Quel a été rôle de la France ?
Le rôle de la France a une histoire, qui remonte au moins au 1990. Au début de la guerre, la France envoya une mission militaire, officiellement dédiée à la protection des ressortissants mais qui fournira de fait un appui – symbolique – à l’armée rwandaise, dans sa lutte contre le FPR.
Dans les mois suivant, des détachements d’assistance militaires sont envoyés afin de former l’armée rwandaise. Il y a eu des accusations autour de ces opérations, dénoncées comme étant des opérations de soutien à un régime dont les Tutsi constituaient la cible principale. L’idée est donc que la France s’est engagée sur une très mauvaise pente…
Or, au début du génocide, en 1994, les missions françaises ne sont pas présentes au Rwanda. Certains expliquent qu’il y a toujours des militaires français présents dans le pays, mais de manière non officielle. De même, la mission française envoyée afin d’évacuer les ressortissants a été vivement critiquée, puisque l’évacuation a été sélective, la famille du Président ayant été amenée en France dès les première heures, alors qu’on a été réticent à évacuer les enfants de la Première ministre – qui était une modérée de l’opposition. Le personnel Tutsi de l’ambassade a été également abandonné.
La période qui suit est ambiguë. D’un côté, la France est le seul pays qui à accueillir une délégation du gouvernement intérimaire, le 27 avril, à Paris : des responsables politiques notoirement extrémistes sont reçus dans la capitale française. D’un autre côté, Alain Juppé commence à parler du génocide et à expliquer les évènements en cours au Rwanda dès le mois de juin. C’est une époque de cohabitation : une situation qui a fait qu’à la fois le gouvernement français – RPR – et la présidence de la République – à gauche – ont été impliqués dans cette affaire.
La recomposition politique à laquelle nous avons assisté récemment en France explique peut-être cette nouvelle façon d’aborder le génocide. Quoi que l’on pense de cette nouvelle génération politique, elle va peut-être permettre de faire avancer le dossier du Rwanda.
La recomposition politique à laquelle nous avons assisté récemment en France explique peut-être cette nouvelle façon d’aborder le génocide. Quoi que l’on pense de cette nouvelle génération politique, elle va peut-être permettre de faire avancer le dossier du Rwanda.
Florent Piton
Quelle a été la position française quant à sa dimension idéologique ? Était-elle ignorante ou négligente face à la situation ?
Je pense qu’on peut parler d’aveuglement. Il existait une grille de lecture présente dans les milieux dirigeants, notamment à l’Élysée. Dans ce milieu, l’idée dominante était que le FPR était un mouvement provenant de l’Ouganda, des anglophones, constituant ainsi une menace pour la francophonie. C’est ce qui paraissait le plus important.
Une autre idée était que le FPR représentait une minorité – la minorité Tutsi – et que le président était légitime, car il représentait la majorité Hutu. C’est donc une grille de lecture ethno-raciale qui a été retenue. L’attitude d’Hubert Védrine est très révélatrice à cet égard. Il publia un article dans Le Point, en 1996, « Hutus et Tutsis, à chacun son pays », dans lequel il disait qu’il faudrait faire preuve « d’audace » géopolitique dans l’Afrique des Grands Lacs, et créer un pays pour les Hutu et un pays pour les Tutsi, au mépris de l’histoire de la région. Cela est symptomatique de la vision des milieux élyséens de l’époque : une époque qui a réduit la géopolitique à la dimension ethnique comme dans le cas de l’ex-Yougoslavie. L’idée a été celle de répliquer le modèle au Rwanda. C’est une grille de lecture qui hérite notamment du racisme qui s’est structuré lors de l’époque coloniale.
La proposition d’Hubert Védrine avait déjà été énoncée au début des années 1960 par certains mouvements racistes revendiquant les droits des Hutu contre la minorité Tutsi. L’idée était de mettre en place une structure fédérale. Ainsi, en 1996, Hubert Védrine ne propose rien de nouveau.
Pour le rôle de la France, je n’utilise pas le terme de complicité, plutôt celui de responsabilité et d’ambiguïté.
Florent Piton
En revanche, je n’utilise pas le terme de complicité. Je parle plutôt de responsabilité et d’ambiguïté. Je ne suis pas d’accord avec certains mouvements militants qui accusent les Français d’avoir tué de manière directe des Tutsi. Pour une critique forte à l’égard de la politique française au Rwanda, il n’y a pas besoin de franchir ce pas.



