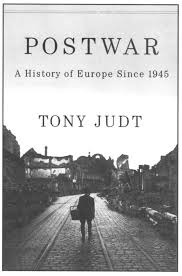Postwar
Branko Milanovic retranscrit dans cet article émouvant qui est une critique de Postwar de Tony Judt sa mémoire d'une histoire restée sans auteur
Presque partout dans la littérature qui analyse le Brexit et l’arrivée de Trump au pouvoir, on retrouve constamment le thème de la chute de l’époque dorée de la fin de la guerre froide, de la nostalgie d’un temps où la victoire inexorable de la démocratie et de l’économie néolibérale était certaine et où le capitalisme libéral représentait le sommet des réussites humaines.
Ce genre de récits m’a toujours mis mal à l’aise. C’est en partie parce que je n’y ai jamais cru et parce que mon expérience personnelle a été assez différente. Plutôt que de croire à la fin de l’Histoire, j’ai vu la fin de la guerre froide comme un événement ambivalent : bon pour de nombreuses personnes à qui il a apporté la libération nationale et la promesse de meilleures conditions de vie, mais traumatique pour d’autres à qui il a offert la montée d’un nationalisme féroce, guerres, chômage et un effondrement catastrophique du revenu.
Je sais que cette conception a été influencée par la certitude que, une fois que le mur de Berlin était tombé, la guerre civile en Yougoslavie était inévitable (je me rappelle un dîner plutôt sombre avec ma mère ce jour de novembre) et par l’expérience directe de la misère soudaine qui a envahi la Russie au début des années 90 lorsque j’y ai voyagé pour la Banque mondiale [où B. Milanovic était lead economist de 1993 à 2001, ndlr]. J’étais donc conscient que mon malaise avec le triomphalisme pouvait être expliqué par ces circonstances rarement combinées. C’était peut-être un malaise idiosyncrasique.
Les années 70 étaient celles de la prospérité en Yougoslavie et la partie périphérique de l’Europe jouait à l’époque, grâce à la politique de non-alignement de Tito, un rôle politique à l’échelle mondiale.
BRANKO MILANOVIC
Mais en lisant d’autres livres et notamment le livre tant vanté de Tony Judt, je me suis rendu compte que le malaise était plus profond. Dans le déluge de la littérature écrite ou publiée après la fin de la guerre froide, je ne pouvais tout simplement rien trouver qui rendait compte de mes propres expériences dans la Yougoslavie des années soixante et soixante-dix. J’avais beau faire tous les efforts du monde, je ne trouvais rien dans mes souvenirs qui ressemble à la collectivisation, aux assassinats, procès politiques, files d’attente sans fin pour avoir du pain, libre-penseurs emprisonnés ni aux autres histoires qui sont couramment publiées dans les magazines littéraires. C’est d’autant plus étrange que j’étais politiquement très précoce ; sans exagérer je pense que j’étais plus tourné vers la politique que la plupart de mes pairs en Yougoslavie à l’époque.
Pourtant, mes souvenirs des années 60 et 70 sont différents. Je me rappelle de long dîners où l’on parlait de politique, des femmes et des nationalités, de longues vacances d’été, des voyages à l’étranger, d’indolents couchers de soleil, des concerts jusqu’au bout de la nuit, d’épiques parties de foot, des filles en minijupes, l’odeur du nouvel appartement dans lequel ma famille emménageait, l’excitation au contact des nouveaux livres et de l’achat de mon hebdomadaire préféré avant qu’il ne soit en rayon… Je ne trouve rien de tout cela chez Judt, Svetlana Alexievitch ni aucun autre auteur. Je sais que certains de ces souvenirs sont peut-être empreints de nostalgies, mais malgré tous mes efforts ce sont eux que je retrouve toujours comme souvenirs dominants. Je me rappelle suffisamment de détails de chacun d’entre eux pour ne pas croire que ma nostalgie les aurait “fabriqués” d’une quelconque façon. Ils ont eu lieu, tout simplement, et je ne peux pas dire le contraire.
J’ai ainsi réalisé que tous ces autres souvenirs issus de l’Europe de l’Est et du communisme qui apparaissent dans les écrits et à la télé d’aujourd’hui, n’ont presque rien en commun avec moi. Et pourtant, j’ai bien vécu sous ce régime là pendant trente ans !
Je sais que mon histoire n’est peut-être pas représentative, notamment parce que les années 70 étaient celles de la prospérité en Yougoslavie et parce que la partie périphérique de l’Europe jouait à l’époque, grâce à la politique de non-alignement de Tito, un rôle politique à l’échelle mondiale qu’elle n’avait jamais eu en deux millénaires ; pourtant, après avoir ingéré tout cela, je crois qu’on peut également avoir le droit de raconter une autre version de ces histoires de “sous-développement” et de communisme, qui ne soit pas pré-mâchée. Ou devrait-on délibérément détruire nos propres souvenirs ?
Je me souviens que j’étais sur la plage en train de lire quelque chose à propos de la conférence d’Helsinki et je me disais, reliant ces deux événements, qu’il n’y aurait plus de guerres en Europe de mon vivant et que l’impérialisme avait été battu.
Branko Milanovic
Cependant, il est bien difficile de dire de tels souvenirs. L’Histoire, comme on nous l’a appris, est écrite par les vainqueurs, et les histoires qui ne s’inscrivent pas bien dans le récit-cadre sont rejetées. C’est tout spécialement le cas, comme je m’en suis aperçu, aux États-Unis qui avaient créé durant la Guerre Froide une formidable machinerie de propagande publique et secrète. Celle-ci ne pouvait pas être facilement arrêtée. Les récits qu’elle produit ne peuvent pas entrer en contradiction avec le récit dominant, car personne n’y croirait ni n’achèterait de tels livres. Il existe une réécriture active et presque quotidienne de l’Histoire à laquelle participent beaucoup de personnes de l’Europe de l’Est : certaines ont bien les souvenirs en question, d’autres se forcent à y croire, le plus souvent avec succès. D’autres encore restent seules avec leurs souvenirs particuliers qui se perdront pour toujours après leur mort. La victoire sera ainsi complète.
Quand j’étais en 2006 à Leipzig [ex-RDA] pour assister à la Coupe du Monde, j’ai été frappé, dans la vitrine d’une modeste échoppe, par la photo de l’ancienne équipe de foot de l’Allemagne de l’Est en 1974 qui, dans le championnat alors situé en Allemagne de l’Ouest, gagna contre elle 1 à 0. Aucun de ces joueurs ne devint riche et célèbre. Ils étaient juste des gars de chez eux. Je considérais cela comme une petite, poignante – et, dans une certaine mesure, pathétique – tentative pour sauvegarder une certaine mémoire et dire : “Nous aussi, nous avons accompli quelque chose ces quarante dernières années ; nous aussi avons existé ; tout n’était pas absurde, “méchant et brutal”.
En pensant aujourd’hui à ces années-là d’un point de vue politique, un moment particulier se détache pour moi, peut-être assez étrangement. C’était l’été 1975. La conférence d’Helsinki sur la paix et la stabilité en Europe venait d’avoir lieu, clôturant un chapitre de la Seconde Guerre Mondiale. Elle eut lieu seulement quelques mois après la libération de Saïgon. Je me souviens que j’étais sur la plage en train de lire quelque chose à propos de la conférence d’Helsinki et je me disais, reliant ces deux événements, qu’il n’y aurait plus de guerres en Europe de mon vivant et que l’impérialisme avait été battu. Combien j’avais tort, sur l’un comme sur l’autre.