Sibir
Le 20 décembre 2023, au cœur du Massif du Mont Blanc, le Prix Grand Continent sera remis à un grand récit européen contemporain, dont il financera la traduction et la diffusion en cinq langues. À cette occasion, nous vous offrons des extraits des cinq finalistes de ce prix européen. Aujourd'hui, ce sont des bonnes feuilles de Sibir. Sabrina Janesch y raconte l’histoire d’une famille ballottée par les vicissitudes de la Seconde Guerre mondiale entre la Galicie, où elle était établie depuis le XVIIIe siècle, le Wartheland, un territoire annexé au Reich national-socialiste après l’invasion de la Pologne, le Kazakhstan et la Lande de Lunebourg située au nord de l’Allemagne. Cette fresque familiale creuse les béances et les vides mémoriels de l'Allemagne contemporaine, et interroge le poids du passé, qu'il soit présent ou disparu.
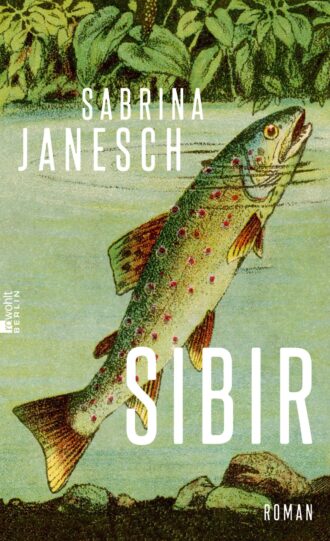
p. 51-56
On faisait souvent état, dans la périphérie de Mühlheide, des phénomènes météorologiques de Sibérie ; il était question de rafales de neige, de tornades et de brusques chutes de température. Aucune tempête, cependant — là-dessus, on était unanime —, aucune tempête n’avait été d’une telle ampleur ni aussi cataclysmique que celle de l’année 1945. Elle avait culbuté les déportés, jetant les uns à terre, faisant tourbillonner les autres. Aucun n’avait pressenti ce qui les attendait, et ma grand-mère Emma Ambacher moins que tout autre — là-dessus aussi, on était unanime.
Après l’arrêt du train au beau milieu de la steppe, les soldats ouvrirent les portes des wagons restants et évacuèrent les gens vers la petite baraque en planches, sur le talus ferroviaire. Après coup, on leur balança, aveuglément, leurs sacs et baluchons. Cela déclencha le rire d’Emma Ambacher, un rire pur, cristallin, toutes les personnes du convoi se retournèrent brusquement et la dévisagèrent avec de grands yeux. L’exténuation pouvait revêtir diverses formes — on le savait désormais ; amusement et enfantillages en faisaient partie. Emma se tut brusquement, comme si elle s’était effrayée elle-même. La gaieté s’affaissa, son visage se décomposa, et elle se baissa vers Josef pour le serrer si fort entre ses bras qu’il en suffoqua presque.
Selon les calculs de Harla, le jour de leur arrivée était un dimanche. Josef se rappelait encore bien le dernier dimanche qu’il avait passé en compagnie de son frère au Warthegau. Vêtus de leurs beaux pantalons, les ventres lestés de pommes de terre sautées, ils avaient fait la course dans la prairie. Leur mère les avait attendus à la maison, dans sa robe fleurie du dimanche, sur laquelle scintillait sa broche préférée : un papillon en argent, serti de perles et de cristaux de Bohême. Une fois, mon père raconta qu’au moment de la déportation, sa mère ne portait pas la robe fleurie du dimanche, mais celle en toile grossière de coton, dont la teinte bleu gris était recouverte par la poussière et la saleté du train. Mais sur celle-ci aussi, la broche scintillait — la mère ne l’avait retirée que lorsque Wawa l’y avait enjointe, Dieu seul sait pourquoi.
Son petit frère lui manquait, le souvenir de sa mort l’avait rempli d’horreur ; il évitait, depuis lors, de réveiller cette douleur. À chaque fois qu’un baluchon venait s’écraser à terre dans un bruit sourd, Josef tressaillait et se pressait contre sa mère. Contrairement aux adultes, il ne regardait pas, sans mot dire, les maigres affaires souillées, mais vers l’immensité qui s’étendait autour d’eux. Il n’y trouvait rien à quoi rattacher son regard, rien pour apaiser le cœur.
À peine le train s’était-il remis en marche que le monde extérieur disparut derrière un rideau opaque de neige. Avant de partir, les soldats avaient encore désigné le nord, crié Buran et puis encore ceci : Nowa Karlowka. Dawaj !
Josef ne savait pas ce que cela signifiait, Nowa Karlowka, s’il s’agissait d’un nouveau danger, de quelque chose qui s’avançait sur la steppe dans le sillage de la tempête de neige et les engloutirait dans sa gueule grande ouverte — c’était ce que s’imaginait Josef, car, une chose était sûre, cet étrange paysage dépouillé avait généré des animaux gigantesques. Le grand-père avait couru après le train et s’était écrié, d’abord en allemand, puis en polonais, avant de finalement se rabattre sur les quelques mots qu’il connaissait en russe : où aller, quoi faire ? Où ? Quoi ?
Mais le train s’en allait et les soldats se contentèrent de tirer dans le ciel quelques salves avec leurs fusils Tokarev. Nowa Karlowka — ces paroles résonnaient encore lorsque les douilles crépitèrent au sol. Josef qui avait perdu sa réserve d’étoiles de paille, partie avec le train, se pencha et ramassa quelques douilles soigneusement triées. Nowa Karlowka, murmura-t-il en regardant dans la direction indiquée par les soldats. Il sentit que sa mère prenait sa main. Il la pressa dans la sienne. Nord, Nord-Est : c’est de là qu’elle viendrait, la gueule de dragon.
Si quelque chose s’avançait vers eux, la tempête de neige le masquait encore. Le vent était devenu si fort que les familles pressaient leur dos contre les planches de la baraque, les enfants en leur milieu et à l’extérieur, les hommes accroupis au sol, moitié à découvert. C’est là, pris en tenaille entre sa mère et sa tante Antonia que Josef les perçut pour la première fois : les voix qu’ils entendaient retentir depuis le lointain.
Plus tard, les adultes ne seraient pas certains d’avoir vraiment entendu quelque chose, peut-être s’étaient-ils quand même trompés, tant ils étaient chancelants et désorientés, peu après leur arrivée. Seul mon père maintenait, encore des décennies plus tard, avoir entendu pour la première fois les voix de la steppe à cette époque-là, dans la tempête, le Buran — certes moins nettement et vigoureusement que plus tard. La seule qui aurait peut-être pu lui donner raison n’était plus là. Sa mère, en effet, les avait entendues, elle aussi : quelque chose qui retentissait comme une calèche, des voix humaines et même, une fois, l’ombre de rires.
Il y a quelqu’un, tout là-bas.
Maintenant, les grands-parents et les autres, eux aussi, avaient entendu quelque chose.
Il y quelqu’un qui circule, là, tout près — il faut le rejoindre !
Ils criaient dans la tempête, ils s’égosillaient, mais personne ne leur répondait. Ils pensaient parfois que la voiture était déjà loin, mais quelques instants plus tard, ils entendaient à nouveau le cliquetis et une rumeur lointaine. Personne ne quittait la baraque ; le groupe, comme figé par le froid glacial, restait là, les yeux fixés sur les rafales. C’est alors que sa mère enveloppa sa tête dans son foulard de laine, pressa à nouveau brièvement la main de son fils et s’avança dans la tempête.
Il y a quelqu’un ? Il y a quelqu’un ?
Josef voulait courir après elle, mais avant même d’avoir pu mettre ses jambes en mouvement et avancer d’un pas titubant, sa grand-mère le retint par le bras.
Elle ne reviendra pas, dit l’un des vieillards, ce qui lui valut une claque du grand-père, si forte que sa casquette vola.
S’il y avait quelqu’un, on serait sauvés, dit la grand-mère dans les mugissements de la tempête.
Remis au cœur du massif du Mont Blanc, à 3466 mètres d’altitude, le Prix Grand Continent est le premier prix littéraire qui reconnaît chaque année un grand récit européen.
Depuis combien de temps ma mère était-elle partie ? Josef croyait toujours entendre, en sourdine, ses « il y a quelqu’un ». L’impulsion qui le poussait à lui courir après le déchirait littéralement, elle était irrésistible. Le sol de la steppe, sous ses semelles, semblait s’être réveillé, quelque chose se mettait en branle. Il continuait de percevoir la pression des doigts de sa mère, la chaleur de son corps à travers la toile de coton bleu gris. La bourrasque qui s’agitait devant et tout autour d’eux mettait à mal son sens du temps et de l’orientation. Il se mit donc à compter, un chiffre à chaque battement de cœur.
Lorsqu’il atteignit cinq cents, il songea que la tempête avait certainement assailli le monde entier et emporté ses étoiles de paille — qu’importe, sur le chemin du retour, ils n’auraient qu’à suivre les rails. Il faillit éclater de rire. Les rails, bien sûr ! Il fallait qu’il le raconte à sa mère. Lorsqu’il atteignit huit cent quatre-vingt-dix, il n’y tint plus, il s’arracha des bras de sa grand-mère et s’élança en boitant, aussi vite qu’il put, dans la steppe.
Maman !
Le vent lui arracha le mot de la bouche, et même les « il y a quelqu’un » de sa mère s’étaient éteints. Josef se retourna, dans la direction d’où il venait ; il fut aussitôt jeté, pressé à terre. Impossible de dire où exactement se trouvait la baraque avec sa tante et ses grands-parents. Les mains tendues de chaque côté, Josef explorait à tâtons son environnement. Il se trouvait dans une sorte de fossé, le vent soufflait au-dessus de sa tête. Il n’était plus possible de crier, mais il pouvait chuchoter, cela permettait de ne pas ouvrir la bouche trop grand et d’y laisser pénétrer une moins grande quantité de neige.
Et pendant qu’il était tapi là et chuchotait, il lui semblait que sa mère, cette fois, lui répondait, mais le sommeil le gagnait et il était inattentif. Il entendit à nouveau la calèche, mais cette fois un peu plus proche, il distingua des voix, une langue bizarre — puis à nouveau sa mère, qui lui parlait tout doucement, serrait sa main, essuyait la neige de son visage. À trois reprises, Josef pressa la main de sa mère, deux pressions longues, une pression brève, c’était leur code secret qui signifiait quelque chose comme : je vais bien, je suis heureux, nous sommes ensemble. À la troisième pression, Josef s’aperçut à quel point la main de sa mère était rêche, à quel point elle le serrait plus vigoureusement que d’habitude, mais avant même de pouvoir y réfléchir plus longuement, il fut soulevé de terre. C’était son grand-père qui le hissait hors du fossé, Josef était suspendu à sa main tel un poisson flasque.
La tempête était passée, la plaine plongée dans le blanc s’étendait devant eux. Aucune trace d’Emma Ambacher ; les grands-parents et la tante partirent à sa recherche, pataugeant dans la neige, ils criaient son nom, en vain. Le visage de Wawa avait un air abasourdi, son regard papillonnait d’un endroit à l’autre.
Il faut trouver un abri pour la nuit. Ensuite, nous reprendrons les recherches, dit mon grand-père.
Mais c’est maintenant qu’il faut chercher, dit Josef. Personne ne l’écoutait. À l’horizon, quelques maisons s’étaient ramassées, des filaments de fumée s’échappaient des toits vers le ciel.

p. 83-86
Mon père avait du mal à se souvenir de la première nuit dans la steppe, il parlait rarement et le cas échéant, à contrecœur, de son arrivée chez ses premiers hôtes. Hôtes : il n’employait même pas ce terme quand il était question de la famille Quapp, bien qu’elle ait indubitablement contribué à leur survie à tous.
Peut-être cela tenait-il à l’étrange expression que Henri Quapp, debout dans l’entrée de sa maison en argile, avait dans le regard lorsqu’il se nomma avant de présenter sa femme Lisbeth ainsi que ses deux enfants Karl et Irene. Une expression de peur, disait mon père, ou de malaise. Pourtant, ils étaient allemands, eux aussi, en exil, eux aussi, tout comme les autres peuplades représentées à Nowa Karlowka, mais à cette époque, mon père ne pouvait pas encore concevoir ce que cela signifiait. C’est seulement bien plus tard qu’il s’aperçut que les Circassiens, Arméniens, Ukrainiens, Polonais, Estoniens, Finnois, Tchéchènes, Coréens ou Kalmouks qui vivaient à Nowa Karlowka étaient originaires des quatre coins de l’Empire soviétique, même des plus improbables, et qu’on les avait rameutés, bien des années auparavant, pour les mettre dans la steppe. Rien de tout cela n’avait été consenti librement, la communauté villageoise disparate avait été créée sous la contrainte, brutalement, et ils étaient tous, les uns autant que les autres, captifs, retenus non par des murs, mais par le vide.
Captifs et étrangers. Tous des étrangers, hormis les Kazakhs, mais ils habitaient un peu plus loin à l’extérieur, dans une cité qu’ils appelaient Aul, un terme kazakh qui désignait un village, un camp. Et eux-mêmes, à peine avaient-ils franchi le gué et foulé les ruelles du village, qu’ils se déplaçaient dans Nowa Karlowka comme des étrangers. Eux, les seuls à être chez eux dans la steppe et le vent, paraissaient encore plus empotés, encore plus déplacés dans un cadre qui n’était pas kazakh, mais soviétique, conçu sur une planète éloignée du nom de Moscou.
Le village, pour tous ceux qui y pénétraient ou qui l’habitaient, c’était l’étranger, rien de ce village n’apparaissait véritable ou essentiel, personne ne le considérait avec amour ou mélancolie, du moins pas à cette époque. J’ai souvent entendu mon père prononcer ces paroles, la plupart du temps, plein d’amour et de mélancolie.
D’où venez-vous ? demanda Josef, l’air déconcerté, alors que sa grand-mère le poussait vers l’entrée de la maison en argile.
De la Volga, murmura Heinrich Quapp, un mot que Josef avait déjà entendu, à la maison. Quelque chose se crispa au fond de lui, le mot était lié à ceux de mère, père, frère. Il ferma alors les yeux et pressa ses poings contre eux. L’homme dut croire que cette réaction tenait à sa réponse, car il fit un pas de côté pour laisser entrer le groupe.
Seul Harla paraissait s’être ravisé en dernière minute, il se lança après le Kazakh Schämschi Sarsenbayev, gesticula dans tous les sens en répétant sans arrêt : Emma, Emma. Après quelques instants, il paraissait s’être fait comprendre, car ils partirent ensemble, avec le chameau, dans la steppe, en suivant la direction d’où le convoi de Sibérie venait d’arriver.
Immédiatement derrière Heinrich Quapp se tenait sa femme, Lisbeth. Maigre, la bouche cernée de profonds sillons, elle dévisageait Wawa qui balayait d’un regard hésitant l’intérieur de la maison. Elle s’avança vers elle. Finalement, la grand-mère déposa quelque chose dans la main de Lisbeth Quapp, quelque chose qui était enveloppé dans un tissu foncé, Josef l’avait parfaitement vu. Bouleversé, il chuchota : Wawa, qu’est-ce que c’était ? Dis-moi, Wawa, qu’est-ce que c’était ?
Il s’accrochait à son bras et tirait dessus, mais Antonia Ambacher le repoussa. Lisbeth Quapp, quant à elle, rangea ce qu’on venait de lui tendre dans la poche de son tablier, comme si de rien n’était.
Combien êtes-vous ?
Douze.
C’est beaucoup.
Nous étions bien plus nombreux.
D’où ?
Warthegau. L’ancienne Galicie.
Demain matin, il va falloir que je vous déclare.
Les uns après les autres, les membres du convoi de Sibérie établirent leur campement dans la maison en argile. Elle était constituée d’une pièce oblongue, divisée par une cloison à mi-hauteur, et d’un plafond bas, fait de brindilles et de mottes d’herbe. Les nouveaux venus et leurs baluchons ne tardèrent pas à remplir une grande partie du logis ; la tante plaça Josef de telle manière qu’il pouvait tout juste s’étendre. Un peu malgré elle, Lisbeth Quapp apporta une galette de blé qu’elle morcela pour la distribuer à ses invités.
Lorsque le grand-père fut enfin de retour, quelques-uns s’étaient déjà endormis. Plusieurs heures s’étaient écoulées depuis qu’il était parti avec les Kazakhs et le chameau à la recherche de sa fille ; il était trempé, gelé et avait les lèvres bleues.
Elle n’est pas là, murmura-t-il à Wawa. Josef et sa tante l’entendirent tout de même. Nulle part, Teresia. Comme si elle n’avait jamais existé.


