Die Verwandelten
« Je suis celle qui raconte cette histoire. Elle ressemble à un gant retourné. Quelqu’un a dû l’enlever dans la précipitation, peut-être en fuite. Il gît sur la neige, à l’envers. » Troisième volet d’un cycle de romans sur la guerre, la fuite et les déplacements forcés, Die Verwandelten (Les Métamorphosées) de l’écrivaine allemande Ulrike Draesner fait entendre des voix de femmes captivantes à travers trois générations, toutes liées les unes aux autres par les violences du 20e siècle.
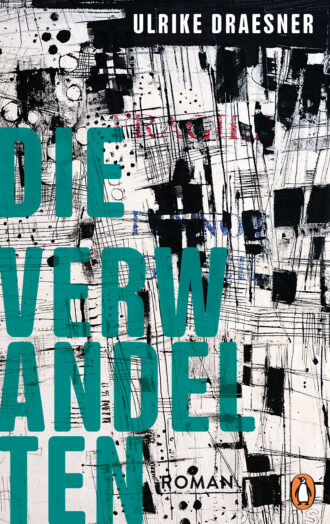
C’est Kinga qui ouvre l’histoire, ou plutôt devrait-on dire la boîte de Pandore. Kinga est avocate dans l’Allemagne d’aujourd’hui, elle s’intéresse en particulier aux questions d’héritage, de mères porteuses, et donne au début du roman une conférence sur les « Lebensborn », des associations créées par l’Allemagne nazie pour promouvoir les naissances, en d’autres termes des couveuses de la race aryenne. Sa mère, qui vient de décéder, y est née en 1937 dans des circonstances qui lui sont encore inconnues. Une rencontre faite suite à cette conférence va lui permettre de commencer à tirer les fils ténus de son histoire familiale nébuleuse : Kinga est comme bien des enfants nés dans les années 1960 une « enfant du brouillard », tant les détails de son passé familial semblent voués à demeurer flous.
Suivant le principe selon lequel « quand quelqu’un parle, la lumière se fait », le récit est pris en charge par plusieurs voix de femmes à différentes époques de leurs vies. Ce faisant, le roman ne procède nullement de façon chronologique. Il convoque telle ou telle voix à telle ou telle époque selon les besoins du récit. La structure complexe qui en résulte donne à voir les imbrications étroites entre les époques et les lieux. Chaque chapitre relate un pan de cette histoire familiale, dévoile une nouvelle perspective, chacun venant compléter le récit à sa façon, tant que faire se peut. Car, si chaque prise de parole apporte un peu de lumière, chacune d’entre elle est aussi une source d’interrogations nouvelles. Entraîné d’une époque à une autre et dans d’incessants va-et-vient entre l’Allemagne et la Pologne, le lecteur se doit de reconstituer ces histoires de mères et de filles, autant de destins contrariés par les aléas de l’Histoire.
Un arbre généalogique déployé sur la page de garde indique à la place des noms des personnages : « déplacée », « déplacé », « disparue », « vit où elle veut », « métamorphosée », « assassiné », « poursuivie »… Au fil du récit, toutes ces mentions à la fois lourdes de sens et extrêmement vagues vont finir par prendre un nom, mentionné ensuite sur l’arbre chronologique de la fin du roman : elles vont sortir du brouillard, prendre corps et trouver une voix. Ainsi, Alissa, la mère de Kinga, raconte-t-elle son enfance dans une famille d’adoption, un couple bavarois fortuné très engagé dans le parti national-socialiste, et livre le peu qu’elle sait ou devine de sa propre mère. Plus tard, la voix de Gerda, sa mère adoptive, se fera entendre, comme celle d’Adele, sa mère biologique, chacune apportant ses propres intérêts et enjeux, ses tourments et regrets, tout comme ses incompréhensions et oublis. À travers ces récits qui se superposent, s’entrecroisent, s’éclairent mutuellement, c’est avant tout l’entremêlement de l’intime et du politique qui est mis en avant. La fille d’une domestique polonaise est donnée à un couple nazi sans enfant, une mère allemande de Silésie et sa fille fuient à la fin de la guerre, subissent les violences de soldats allemands et russes avant de rentrer en Silésie, la mère est alors déplacée dans l’Est de l’Allemagne tandis que sa fille reste en Silésie sous une nouvelle identité.
C’est là que le titre du roman prend tout son sens car ces femmes, toutes tirées d’histoires réelles, sont d’une façon ou d’une autre des « métamorphosées » et ce, non seulement pour les besoins de la fiction. Reni, qui a grandi en Silésie avec ses parents allemands, prend une identité polonaise à son retour à Breslau devenue Wrocław : elle s’invente alors une histoire de toute pièce. Sa fille Dorota, née au début des années 1960, fera à l’inverse le choix de partir vivre en Allemagne et d’enfouir son identité polonaise, mais elle porte jusque dans son prénom le nom polonais du fleuve Oder, Odra, qui joue un rôle prépondérant dans le roman. Alissa, une fois adoptée en Bavière au début des années 1940, devient pour des raisons de politique raciale Gerhild et se doit d’oublier son passé polonais, la fille de Kinga adoptée à la fin du 20e siècle devient autre elle aussi et hérite de ce passé familial entre l’Allemagne et la Pologne. Mais, « métamorphosées », ces femmes le sont tout autant dans leurs corps, victimes qu’elles sont de la guerre et de la cruauté des soldats, à l’instar de tant de figures féminines chez Ovide métamorphosées après les viols qu’elles ont subis. Néanmoins, quels que soient les motifs de leurs métamorphoses, ces femmes chez Ovide comme chez Ulrike Draesner gardent en elles le souvenir des violences passées.
Le passé de fait n’en finit pas de resurgir – comme ce tableau de Menzel authentique ou non transmis dans le roman par une série de hasards de génération en génération –, rendant tout changement d’identité et les espoirs qui l’accompagnent tout bonnement illusoires. Alissa devenue Gerhild, séparée de sa mère alors qu’elle était enfant pour des raisons qu’elle ignore, séparera plus tard sans raison apparente sa propre fille des grands-parents que celle-ci aime tant. Reni devenue Walla, tente de surmonter son passé et de reconstruire sa vie avec un colonel polonais, mais son destin se brise à nouveau, cinq ans après la fin de la guerre, au retour tardif des camps de la femme juive de celui-ci. Les violences perpétrées durant la guerre ne cessent de faire peser leur ombre sur ces générations de femmes : « Comment s’arrête une guerre pour une fille qui ne l’a pas vécue, qui a seulement dû grandir avec elle, bien qu’elle soit déjà terminée – parce que celles qui étaient grandes, comme on disait, étaient restées petites justement du fait de cette guerre ? »
Les relations entre mères et filles sont sans cesse rompues, parfois recomposées, recollées, rafistolées tant bien que mal à l’image des bouts de ficelle qui relient les personnages des arbres généalogiques au début et à la fin du livre. Mais l’altération et la rupture suggérées dès la page de titre, où le mot « les Métamorphosées » se brise sur quatre lignes, prédominent le récit tout entier. Et c’est dans le roman avant tout le travail sur la langue qui va témoigner de ces cassures. Selon les époques et les expériences vécues par les différentes femmes, la langue est fluide, tâtonnante, hachée, interrompue. Les femmes racontent, cherchent leurs mots, reviennent sur des épisodes qu’elles enrichissent, reprennent sous un autre angle, elles traquent des souvenirs, cherchent des mots contre l’oubli ou contre le silence, même si celui-ci souvent l’emporte. Mais la langue figure également une évolution personnelle ou historique, ainsi, dans les paroles de Gerda, le mot REICH ressort toujours en majuscules, jusque dans le mot stREICHeln (caresser) ou das REICHt (ça suffit). Sous la plume de Ulrike Draesner, la langue peut se faire douleur, étouffement, deuil. La langue est malmenée, elle est symptôme d’un mal profond, mais elle peut se révéler aussi garante de souvenirs enfouis. C’est ce que traduisent les poèmes qui introduisent la plupart des chapitres, des poèmes intitulés « chant des femmes abusées » ou « chant des enfants abusées ». Ils rappellent les chœurs des tragédies grecs et, d’un point de vue formel, suggèrent avec leurs phrases entrecoupées, leurs mots parfois rayés, superposés, effacés ou disparus ainsi que leurs lignes blanches, autant de palimpsestes. Présence absente des souvenirs dans la langue, ils figurent les limites du dicible.
Dans Les métamorphosées, Ulrike Draesner met ainsi en lumière un vaste pan de l’histoire européenne avec une grande créativité poétique. Car c’est avant tout la langue qui s’est métamorphosée sans cesse pour porter ces récits jusqu’à nous.

