Brise marine
« Comment se libère-t-on d’un mensonge ? » Meeresbrise, dernier roman de l’écrivaine autrichienne Carolina Schutti, est l’histoire enchanteresse d’un désenchantement. Une jeune narratrice s’éveille peu à peu de la fiction à la fois merveilleuse et malheureuse dans laquelle elle a grandi et fait l’épreuve de son « entrée dans le monde ».
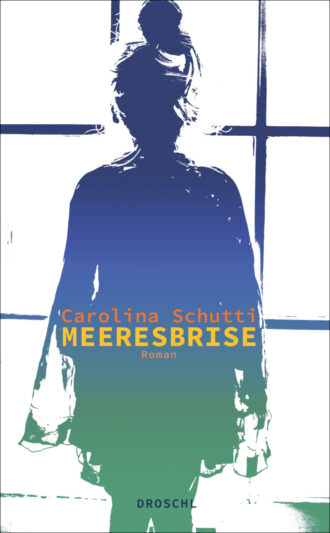
Une mère élève seule ses deux filles dans un village à la fin des années 1980. Depuis que le père de l’une est parti, et que celui de l’autre s’est jeté d’un pont, la mère vit d’aides sociales, de téléphone rose et de la revente d’articles de seconde main. Les filles sont bercées des contes de fées que la mère leur lit ou invente, créant un monde dans lequel elle est reine et ses filles deux princesses, où l’argent lui vient d’un roi. Les riches vêtements dont elle les affuble ne sont que des affaires d’occasion dépareillées, jamais à leur taille, l’allure digne qu’elle leur demande d’arborer doit déjouer tout sentiment de honte. Telles Raiponce du haut de sa tour, les sœurs, souvent enfermées dans l’appartement, attendent le prince charmant. Elles enrichissent ce monde fictif en rivalisant d’imagination, d’idées de jeux et d’histoires qui métamorphosent le monde vide et pauvre dans lequel elles grandissent avec bonheur, sans avoir la moindre conscience du désespoir qu’il représente. Et quand celui-ci transparaît au gré d’un récit de la mère sur l’un des deux pères, il est vite chassé : « pour la prochaine fois, on voudrait un conte de fées ».
Le monde dans lequel les deux sœurs évoluent est sans nom : la mère, nous, ma sœur, nos pères, la petite fille, la dame, personne n’est jamais nommé, bien que chacun possède une individualité propre comme des caractéristiques identifiables, autant de personnages dans la fiction qu’est leur existence. Et, à l’exception d’un fermier plein de générosité et de bienveillance envers elles, et plus tard d’un groupe d’adolescents qui les considèrent comme des proies faciles, ce monde est entièrement féminin. Les pères disparus – « nos pères ne sont que des mots » – se trouvent réduits à quelques souvenirs de violence dont les filles s’échangent l’héritage selon leur humeur, au point de ne plus savoir quel récit leur appartient. Et peu importe puisque tout peut être recréé – comme elles recréent dans la forêt voisine leur village en miniature à partir de feuilles, de fleurs et de branches –, tout peut être réinventé, y compris le passé et le présent. La sœur aînée, qui est aussi la narratrice, sera la seule à comprendre qu’elle peut aussi s’inventer un avenir.
Dans la première partie « palimpseste » qui constitue la quasi-totalité du roman, se succèdent des fragments de longueur inégale, de quelques pages à une seule ligne, qui donnent à voir la fragilité de l’univers construit de toute pièce par la mère, qui souhaite protéger ses filles sans se rendre compte qu’elle ne fait que les rendre plus vulnérables. En grandissant, et notamment au moment de leur entrée à l’école, les deux sœurs se voient confrontées à un monde qui leur est totalement inconnu, un monde dans lequel les enfants ont un cercle d’amis, vont à l’école et s’adonnent à toutes sortes d’activités, possèdent une panoplie de jouets et portent des vêtements neufs et propres. Mais surtout, ce monde leur renvoie une image d’elles-mêmes aux antipodes des fabulations maternelles : les princesses sont en réalité des « monstres » sans aucun respect pour les autres, leur comportement est inadéquat en toute circonstance, leur langage vulgaire, leur présence et leur odeur dérangeantes, leur monde absolument vide.
Il est difficile d’être toujours à l’écart.
un aimant mal polarisé
une goutte d’huile sur l’eau
une guêpe esseulée devant une ruche
Pourtant ce monde radicalement autre qui la rejette fascine la sœur aînée, il attise toujours plus sa curiosité. Avide de savoir, elle affiche depuis toujours une prédilection particulière pour les mots, au-delà de ceux que véhiculent les contes et les légendes. Un dictionnaire pour enfants, trouvé par hasard sur une poubelle et que les sœurs feuillettent à l’envi, s’avère un livre magique pour les princesses imaginaires. Elles y apprennent des noms de fleurs, d’arbres et de champignons, elles passent en revue et se délectent de listes de mots, cherchent vainement ceux qui constituent leur quotidien. L’aîné s’emploie à compléter le dictionnaire, elle ajoute ou réécrit certaines de ses entrées jusqu’à ce qu’aucune page ne reste indemne. Il n’étonnera donc pas qu’elle se montre pleine d’admiration pour son institutrice, une jeune femme qui, elle aussi, élève seule sa fille et qui représente pour la narratrice à la fois l’incarnation du savoir, la mère idéale, la femme qu’elle aimerait devenir. Car, s’il existe toujours de nouveaux mots à découvrir, et par conséquent d’autres horizons, d’autres paysages – comme la mer dont a parlé l’institutrice, qui l’intrigue et l’attire tant –, il est peut-être aussi une autre existence pour elle.
Or, aspirer à un ailleurs, entrer dans le monde implique de se délivrer de celui que la mère a échafaudé. Et se libérer signifie trahir : trahir l’amour maternel, trahir cette femme « qui n’a rien d’autre que nous », trahir le « nous » qui l’unit à sa sœur en une relation fusionnelle, trahir le monde dans lequel elles évoluent depuis leur plus tendre enfance :
J’ai dit à notre mère que je ne voulais plus entendre ses contes de fées mal racontés. J’ai dit à notre mère qu’elle n’avait pas le droit de nous enfermer dans l’appartement. J’ai dit à notre mère que je savais depuis longtemps que nous n’étions pas des princesses. […] Ma sœur s’assoit sur les genoux de la mère. Sa tête dépasse celle de la mère. Elle la laisse tresser ses cheveux, alors qu’elle déteste cela, en me souriant d’un air moqueur, son sourire tel une arme.
Carolina Schutti est l’auteure de plusieurs romans et recueils de poèmes, dont certains ont été traduits en plus d’une dizaine de langues. Elle fait partie en 2015 des lauréats du « Prix de littérature de l’Union Européenne » pour son roman einmal muss ich über weiches Gras gelaufen sein (« un jour, j’ai dû marcher sur de l’herbe tendre ») qui retrace lui aussi l’histoire d’une femme en marge de la société et qui fut remarqué pour la finesse de ses images, le pouvoir évocateur de sa prose et l’importance donnée à la langue dans la constitution d’une identité.
Avec Meeresbrise, Carolina Schutti signe un roman à la fois beau, subtil et d’une grande rigueur formelle. Le pouvoir enchanteur des mots trompe et détrompe, il crée un monde protecteur et en révèle la vulnérabilité, mais l’essentiel réside en ceci qu’il appelle à inventer toujours. « Brise marine », ce nom que la sœur aînée trouvait poétique et qui signifiait pour elle quelque chose de si précieux, se révèle être celui d’un savon bon marché à l’odeur douteuse. Mais il évoque aussi plus tard la mer, l’inaccessible objet de ses désirs que sa mère essaye de lui faire oublier avec violence. À défaut de voir la mer, la narratrice en explore les profondeurs dans le moindre détail grâce au livre de Jules Verne que son institutrice lui prête et qu’elle apprend par cœur avant que sa mère ne le lui confisque. Son imagination engourdie par les images de contes de fées l’empêche de poursuivre l’histoire elle-même, une autre raison de partir. Car la mer et sa brise symbolisent son envie d’évasion vers un monde inconnu, et pourtant bien réel, dont elle a été exclue jusqu’alors. « Brise marine », c’est également ainsi que s’intitule la seconde partie du roman. Le seul et bref paragraphe qui la constitue met en abyme, d’une façon aussi belle que surprenante, ce jeu de dupes que la jeune fille parvient habilement à déjouer pour peut-être, enfin, s’inventer.

