« En diplomatie, l’histoire peut être un argument dans les négociations », une conversation avec Gérard Araud
« Quand je voyage à l’étranger, je constate qu’il y a en France une véritable obsession de l'histoire. Pourquoi notre identité est-elle à ce point historique ? » Dans son dernier ouvrage, Gérard Araud se fait historien : l'ancien ambassadeur revient sur les occasions diplomatiques manquées de l'Europe de l'entre-deux guerres — de Versailles à Munich.
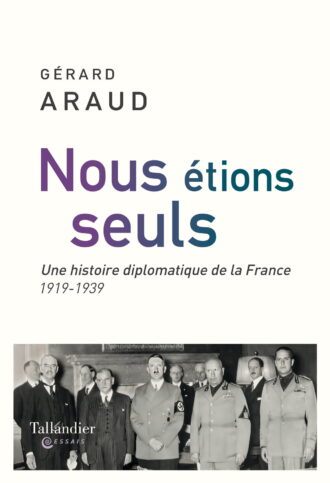
On constate une évolution entre votre autobiographie, Passeport Diplomatique, un essai biographique sur Kissinger, Kissinger, le diplomate du siècle, un essai de réflexions diplomatiques, Histoires diplomatiques, et puis ce livre, qui est un livre d’histoire à proprement parler. Comment est-ce que vous en êtes venus progressivement à écrire un livre d’histoire ?
Tout d’abord par plaisir. Je suis un historien manqué ! En effet, j’appartiens à une génération où vos parents décidaient de ce que vous faisiez comme études. Ils m’ont envoyé étudier les sciences, en dépit de ma passion pour l’histoire. Aujourd’hui, cela fait près de 60 ans que je lis des livres d’histoire. C’est tout simplement ma passion.
Deuxièmement, j’ai été très marqué par les récits de la guerre que me faisaient mes parents. Je suis né huit ans après la guerre ; alors quand j’étais enfant, dans les dîners de famille, on en parlait encore comme d’une expérience traumatique majeure. Toute cette période avait été marquée par l’effondrement, l’occupation, l’humiliation, la peur, la faim et la tragédie. Plus précisément, j’ai été marqué par ce moment où mon père m’a expliqué qu’enfant, il avait vu sa mère sangloter en écoutant le discours du maréchal Pétain le 17 juin 1940 tandis que son père était au front. C’est une émotion qu’il m’a transmise.
Dans ce livre, je poursuis un cheminement entamé dans mon livre précédent, où j’avais étudié dix événements d’histoire diplomatique française, dont le traité de Versailles et Munich. Cela avait suscité de nombreuses questions que j’avais envie de creuser, et m’avait donné envie d’avoir une vision plus globale de la période.
Sur ces bases personnelles, j’ai par ailleurs toujours été convaincu, depuis mon entrée au Quai d’Orsay, que mai-juin 1940 était le « trou noir » de notre histoire, c’est à dire un élément toujours présent, dont on ne parle jamais, mais qui a une influence silencieuse sur notre vision du monde. C’est que j’essaie d’expliquer dans l’introduction du livre.
Nous avons eu l’impression, en lisant votre livre, que l’un de vos objectifs était de montrer qu’il fallait éviter de considérer tout appel à la paix comme la répétition des accords de Munich. Écrire un livre d’histoire est-il aussi une invitation à complexifier les références historiques qui dominent le débat politique contemporain ?
Mon projet est avant tout historique. Avec tout le respect que j’ai pour les historiens professionnels, je leur reprocherais de refuser de donner un point de vue clair sur les événements qu’ils étudient. Avec l’arrogance de l’ignorance, je me suis dit que j’allais essayer d’écrire un livre avec un point de vue. Comment expliquer le désastre de mai 1940 ? Comment est-on allé de la victoire la plus glorieuse de notre histoire, la plus coûteuse aussi, celle de novembre 1918, au désastre de mai-juin 1940 ?
J’essaie de répondre à cette question de façon très personnelle. Pour moi, deux raisons culminent. D’une part, la diplomatie britannique a failli, en faisant une mauvaise lecture du rapport de force entre l’Allemagne et la France après le Traité de Versailles. D’autre part, la France, pour des raisons qu’on peut d’ailleurs comprendre, a choisi dans l’entre-deux guerres une stratégie militaire purement défensive, qui se révèle in fine être un désastre. Chaque fois qu’Hitler prend une initiative, le chef d’état-major des armées offre comme solution deux possibilités : soit céder, soit décréter la mobilisation générale ; or avec les gouvernements faibles de la Troisième République, cette dernière option était inenvisageable.
La France, pour des raisons qu’on peut d’ailleurs comprendre, a choisi dans l’entre-deux guerres une stratégie militaire purement défensive, qui se révèle in fine être un désastre.
Gérard Araud
Par ailleurs, j’ai entendu un nombre innombrable de fois ce cliché de Munich que l’on utilise à toute occasion. Dès qu’on veut négocier, on nous compare à Chamberlain ou Daladier. Je voulais tordre le coup à ce cliché, qui a fait une réapparition triomphale à l’occasion de la guerre en Ukraine. Pour vous donner un exemple de l’influence de ce cliché de Munich, j’aimerais vous raconter une anecdote. J’avais une relation assez étroite avec le sénateur McCain, avec qui nous passions parfois une demi-heure à refaire la bataille de Diên Biên Phu. Il connaissait tout par cœur. C’était un interventionniste, et à chaque fois qu’il me voyait, il me disait « bonjour Daladier, comment allez-vous ? ».
Comment concevez-vous le lien entre histoire et diplomatie ?
Quand je voyage à l’étranger, je constate qu’il y a en France une véritable obsession de l’histoire. Pourquoi notre identité est-elle à ce point historique ? Nous sommes un des rares pays où des références à l’histoire apparaissent naturellement dans la conversation. Cette obsession est certes charmante, parce qu’elle est à l’origine de nos excellentes écoles d’historiens. Mais en même temps, je pense qu’elle conduit à des parallèles trop rapides. De manière paradoxale, je dirais que je suis un passionné d’histoire, mais un passionné qui, lorsqu’il réfléchit aux relations internationales, n’utilise quasiment jamais de parallèles historiques. Je déteste le « point Godwin », car si vous arrivez sans cesse à Hitler, c’est que vous essayez de penser le monde uniquement en partant du trou noir de l’histoire. En effet, si Poutine, c’est Hitler, il n’y a plus rien à faire, sinon espérer qu’il se suicide dans le Kremlin, dans le cas hypothétique où nos armées pénétreraient Moscou.
Pour toutes ces raisons, il faut voir le monde tel que l’autre côté le voit, et donc connaître l’interprétation de l’histoire de l’autre. Pour comprendre le conflit ukrainien, il faut se demander d’une part comment les Ukrainiens voient leur histoire, et notamment leurs relations avec la Russie, et d’autre part comment les Russes conçoivent l’Ukraine.
Je vous donne un autre exemple. En Israël, avant 1967, la France, c’était la France qui avait libéré Dreyfus, la France de la Résistance. Ensuite, après 1967, du fait de la rupture et de la glaciation des relations entre Israël et la France, d’’un seul coup, la France est devenue pour Israël la France antisémite qui avait poursuivi Dreyfus. Ce n’était plus la France de la Résistance, mais celle de Vichy. En un mot, l’histoire évolue car elle est une construction intellectuelle.
En tant que diplomate, l’histoire peut être un argument dans les négociations. Mais c’est avant tout un outil de compréhension de l’autre. Quand on parle de Russie en France, l’imaginaire mobilisé est celui de Dostoïevski, Tchaïkovski, de l’alliance pendant les deux guerres mondiales. En Pologne, la Russie évoque quarante ans de domination communiste. Il faut l’avoir à l’esprit. Il est inutile d’aller dire aux Polonais que Tolstoï est génial. Par conséquent, la connaissance de l’histoire et de sa perception facilite le travail du diplomate, car il évite les écueils.
En tant que diplomate, l’histoire peut être un argument dans les négociations. Mais c’est avant tout un outil de compréhension de l’autre.
Gérard Araud
Ce sont aussi pour ces raisons que j’aime lire les historiens étrangers qui travaillent sur l’histoire de France. Cela permet de découvrir à quel point nos historiens portent des préjugés, des convictions, une vision du pays. Dale K. Van Kley vient de mourir ; c’était un très grand historien américain du XVIIIème siècle. On se rend compte en le lisant que les historiens français qui écrivent sur le XVIIIème siècle sont soit monarchistes, soit jacobins. Lui voit dans le parlement de Paris, non pas une opposition égoïste de privilégiés, mais une véritable potentialité libérale, une institution qui a tenté de faire contrepoids à l’absolutisme religieux.
Vous avez dit que votre livre est une exploration d’un traumatisme français dont on parle peu et que vous qualifiez de « trou noir » de l’histoire de France. À quel point est-ce que le souvenir de ce traumatisme a pu avoir des conséquences concrètes et des manifestations contemporaines ?
La première conséquence concrète est l’idée, depuis 2003, que les Français sont lâches. Depuis notre opposition à la guerre en Irak s’est enracinée l’idée, en s’appuyant sur la campagne de mai-juin 1940, que les Français sont lâches. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cette idée est répandue. Parfois, quand j’écris un message sur Twitter, il m’arrive de voir en réponse des centaines de tweets venant de toute l’Europe orientale pour dire que les Français sont lâches, avec un petit drapeau blanc. Cette idée est d’autant plus ahurissante que nous sommes un des pays les plus militaires du monde. Il n’y a pas de quoi en être fier ou honteux, mais c’est un fait.
Deuxièmement, nous avons un complexe d’illégitimité vis-à-vis de notre siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce sentiment d’illégitimité se trouve aux tréfonds de tout diplomate français. Ce traumatisme explique l’amour du gaullisme comme volonté de surmonter le traumatisme par la mise en place de la force nucléaire.
Tout cela conduit les diplomates français à essayer d’avoir des idées sur tout, et à concevoir l’Europe comme un instrument et non une finalité. Et cela, les autres Européens le savent très bien.
Depuis notre opposition à la guerre en Irak s’est enracinée l’idée, en s’appuyant sur la campagne de mai-juin 1940, que les Français sont lâches. Cette idée est d’autant plus ahurissante que nous sommes un des pays les plus militaires du monde.
Gérard Araud
Il y a un Traité autour duquel tourne votre livre : le Traité de Versailles, qui est presque un personnage à part entière de votre récit. Comment comprendre le succès historiographique et diplomatique de la thèse selon laquelle les termes du traité de Versailles ont été trop durs, ce qui, de façon presque un peu mécanique, aurait causé l’essor du nazisme ? Vous parlez notamment du rôle du Keynes dans la diffusion de cette interprétation.
Il faut bien dire que le premier responsable est Keynes. Nous avons la malchance de l’avoir contre nous. Son livre, Les Conséquences économiques de la paix de 1919, est éblouissant, bien écrit, une véritable œuvre de littérature qui, en quelques années, est traduite en douze langues et rééditée. Le livre est utilisé comme prétexte par les sénateurs américains pour ne pas ratifier le Traité.
Les Anglais et les Américains pouvaient se permettre d’être généreux : les uns sont à 6000 km, et les autres sont protégés par la mer. J’’insiste beaucoup là-dessus parce qu’en juin 1940, s’il n’y avait pas eu la Manche, les Allemands rentraient dans Londres avant Paris. Entre Dunkerque et Londres, il n’y avait plus une unité restante de l’armée britannique.
Ils ne le comprennent pas, car pour les Américains et les Anglais, les Français étaient des géants au sortir de la Grande Guerre. Ainsi, quand en 1919 les Anglais reprennent leur politique d’équilibre européen, ils considèrent que le risque principal vient de la France, qui serait trop puissante. C’est une erreur de lecture, car la France a été saignée à blanc tandis que le territoire allemand a été préservé. D’un point de vue démographique, les Allemands sont 60 millions après le Traité, tandis que les Français sont 40 millions. De ce point de vue-là, il est évident que le vrai vainqueur de la Première Guerre mondiale, c’est l’Allemagne. Ils ont perdu militairement, mais gagné politiquement. L’Empire russe a disparu. L’Autriche-Hongrie a disparu au profit de petits États très faibles. La Mitteleuropa s’offre alors à l’Allemagne.
Pour les Américains et les Anglais, les Français étaient des géants au sortir de la Grande Guerre. C’est une erreur de lecture, car la France a été saignée à blanc tandis que le territoire allemand a été préservé.
Gérard Araud
Comment comprendre le positionnement retenu par Jacques Bainville, que vous citez, dans son propre livre sur le Traité de Versailles, Les conséquences politiques de la paix ?
Le problème de l’analyse de Jacques Bainville est qu’il ne propose rien, sinon de maintenir les Allemands sous pression par la force. La France essaiera cette solution avec Poincaré et l’occupation de la Ruhr, mais ne peut pas le faire toute seule. Je cite dans le livre le discours d’Edouard Herriot qui explique pourquoi la France a cédé sur la Ruhr en 1924 : il explique qu’on ne peut pas tendre en permanence la volonté du pays, et qu’il faut aussi du repos pour que le peuple reprenne des forces, que les femmes fassent des enfants. Pour moi, la bonne politique est celle d’Aristide Briand, qui va échouer à cause de la crise de 1929.
De façon plus générale, il n’y a pas de chemin direct de 1919 à 1939. Je cite à cet égard l’historienne Margaret McMillan et son livre Les artisans de la paix : Comment Lloyd George, Clemenceau et Wilson ont redessiné la carte du monde ; elle considère également que la ligne directe va de 1929 à 1939.
Le parallèle entre la République de Weimar et la Troisième République française est très intéressant. Ces deux régimes émergent dans la défaite, et toutes les élites traditionnelles sont hostiles à leur mise en place : les élites françaises sont monarchistes au début de la Troisième République, de même que les élites allemandes au début de la République de Weimar. Les dernières élections que les monarchistes manquent de gagner en France ont lieu en 1885, soit quatorze ans encore après le début de la Troisième République. Si on fait le même calcul, vous ajoutez quatorze ans à 1919 et on se retrouve en 1933/1934. La République de Weimar n’a pas eu suffisamment de temps !
Le parallèle entre la République de Weimar et la Troisième République française est très intéressant. Ces deux régimes émergent dans la défaite, et toutes les élites traditionnelles sont hostiles à leur mise en place
Gérard Araud
À propos d’Aristide Briand, certains disent que le pari consistant à réintégrer l’Allemagne via la Société des Nations à l’ordre multilatéral était peu réaliste. Êtes-vous en désaccord avec cette lecture ?
Aristide Briand était face à une aporie. La politique de la France ne pouvait être qu’une politique du statu quo territorial ; or la politique allemande visait à renverser l’ordre territorial établi. Face à cette tension, Briand tentait d’être réaliste. Il disait que, puisque la France devait quitter la Rhénanie en 1935, autant en partir plus tôt pour monnayer ce départ.
De même, dès 1917, Briand était prêt à rencontrer les Allemands en Suisse pour tenter de mettre fin à cette guerre affreuse. Dans les années 1920, il comprend que le rapport de force qui est à ce moment-là favorable à la France ne le restera pas. Il considère qu’il faut établir un nouveau rapport qui ne soit pas un rapport seulement de force, mais aussi un rapport diplomatique, un rapport multilatéral.
En somme, il adopte une stratégie beaucoup plus conciliante que celle de Poincaré ! Briand disait à propos de Poincaré que lorsqu’il va au marché avec une vache, il revient toujours avec sa vache, sans jamais la vendre.
La politique de la France ne pouvait être qu’une politique du statu quo territorial ; or la politique allemande visait à renverser l’ordre territorial établi.
Gérard Araud
Vous mentionnez aussi un élément important, la stratégie militaire de la France, qui conduit à mai 1940. Pourriez-vous revenir sur ce point ?
D’abord, il faut comprendre que la France compte 40 millions d’habitants et l’Allemagne 65 millions, en réalité 75 millions après l’Anschluss. L’industrie allemande est deux fois plus importante. Cela fait qu’en 1939, la France mobilise 4 millions d’hommes, les Allemands 9 millions. Ensuite, le soutien britannique est beaucoup plus faible. En mai 1940, les Britanniques envoient en tout et pour tout 11 divisions, alors qu’il y en avait 85 en 1918.
Par ailleurs, deux stratégies militaires sont envisagées. D’une part, Joffre et Foch disent qu’il faut pouvoir d’encaisser le premier choc allemand avant de lancer la contre-offensive. De l’autre, Pétain souhaite juste protéger le territoire national. Joffre s’y oppose en disant que la muraille de Chine n’a jamais défendu la Chine. Joffre et Foch meurent : Foch en 1929, Joffre en 1931. Le maréchal Pétain demeure et remporte le débat.
Je suis en train d’écrire une préface aux mémoires de Vladimir d’Ormesson, grand journaliste du Figaro qui avait été envoyé comme ambassadeur auprès du Saint-Siège en mai 40. Il va entrer dans la clandestinité en 1942 pour résister et pourtant raconte qu’il avait dans les années 1930 une confiance quasiment mystique dans le maréchal Pétain. Il évoque le visage marmoréen, la tenue extraordinaire de l’homme, la beauté du maréchal. Le statut de Pétain dans les années 30 est tout à fait exceptionnel. Quand le maréchal Franchet d’Esperey meurt en 1942, on dit à Pétain : vous êtes désormais le seul maréchal vivant. Il répond : « Vous savez, il y a longtemps que je suis le seul maréchal ».
Vous dites que les dirigeants britanniques auraient commis une erreur d’analyse dans leur appréciation de l’état des forces politiques en Europe. Vous décrivez une forme de myopie qui aurait entamé les ressorts de leur diplomatie. Comment l’expliquez-vous ? S’agissait-il, selon-vous, d’un biais idéologique ?
Il y a beaucoup d’éléments qui entrent en compte. D’abord les Britanniques regrettent selon moi fondamentalement d’être rentrés dans la guerre de 1914-1918, qui est, jusque-là, la plus grande catastrophe de l’histoire de l’humanité. Pour les Français, la question ne se posait pas parce que les Allemands envahissaient la France. Les Britanniques en concluent que, puisque la guerre était absurde, ce sont les Français qui les y ont entraînés.
Ensuite, en ce qui concerne le Traité de Versailles, à cause de Keynes et de Lloyd Georges, les Britanniques sont rapidement convaincus que l’Allemagne est victime d’une injustice. Ils en concluent que pour garantir la paix, il faut affaiblir la France et réparer les injustices commises à l’égard des Allemands. Je cite dans le livre le conseiller de l’ambassade britannique à Berlin qui dit en 1924 qu’on a eu tort de laisser l’armée française en Allemagne. L’Ambassadeur britannique ajoute que l’armée française est trop puissante ! Il y a même une forme une francophobie chez les Britanniques. On lit des choses terribles dans la correspondance britannique de l’époque : les Français sont sales, les Français sont petits, les Français sont malhonnêtes, les Français sont « juifs » …
Vous mentionnez et faites le portrait de nombreux diplomates de l’époque. Quelles étaient les qualités et les manques de la diplomatie française dans l’entre-deux-guerres ?
Une des malédictions des diplomates est que, contrairement à ce que tout le monde pense, ils ne font pas la politique étrangère. Depuis que j’ai été envoyé comme ambassadeur en Israël pour améliorer les relations avec Israël, tout le monde m’a considéré comme sioniste. Pourtant, j’ai simplement mis en œuvre la politique du gouvernement ! Si cette politique avait été de geler les relations, je les aurais gelées. Durant l’entre-deux-guerres, on a l’impression que les Français sont lucides et voient le danger venir, tout en étant incapables par eux-mêmes d’y faire face, en raison probablement du traumatisme de la Première Guerre Mondiale.
Une des malédictions des diplomates est que, contrairement à ce que tout le monde pense, ils ne font pas la politique étrangère. Durant l’entre-deux-guerres, on a l’impression que les Français sont lucides et voient le danger venir, tout en étant incapables par eux-mêmes d’y faire face.
Gérard Araud
Il ne faut pas sous-estimer l’ampleur de ce traumatisme. Dans mon enfance, j’habitais à Marseille dans un immeuble où vivait un poilu qui avait été gazé à l’âge de 18 ans en 1918 et qui 50 ans plus tard en portait encore les séquelles. Il ne pouvait pas se coucher dans son lit, et quand il montait au premier étage par l’escalier, on entendait son souffle au quatrième étage. Pour tous les gens des années 1950, quand on parlait de « la Guerre », c’était la première.
Vous évoquez la stratégie de Louis Barthou consistant à mettre en place un réseau d’alliances pour contrer la montée en puissance de l’Allemagne. Est-ce que vous pensez qu’une telle stratégie aurait pu fonctionner ?
Tout d’abord, les Britanniques n’en voulaient pas. Or, en 1919, la France décide de ne rien faire sans les Britanniques. Avant d’occuper la Ruhr en janvier 1923, Poincaré met un an à se décider car il ne veut pas rompre avec l’Angleterre. Il le dit d’ailleurs à un ministre : si on l’oblige à rompre avec les Anglais, il démissionnera. Donc à partir de là, il est difficile d’imaginer une autre stratégie. Moi, je suis convaincu que Barthou aurait été de toute façon marginalisé et n’aurait pas vraiment changé l’histoire s’il n’avait pas été assassiné.
Dans la conclusion, vous écrivez : « Je souhaite ardemment que le désastre de la bataille de France continue de hanter nos mémoires pour nous contraindre à ne jamais baisser la garde ». En quoi consisterait concrètement aujourd’hui le fait de ne pas baisser la garde ? Est-ce l’augmentation du budget militaire français, par exemple ?
Augmenter de façon quantitative le budget militaire est important, mais il est également nécessaire de progresser en stratégie. En 1939, Gamelin avait décidé refaire la bataille de Verdun. Le plan de Gamelin était semblable à celui de Joffre en 1914, à ceci près que le plan de Joffre reposait sur la vitesse des soldats et des chevaux. Trente après, avec l’accélération de la vitesse des troupes grâce aux chars, le plan devient impossible à tenir.
Il faut donc avoir des moyens, mais aussi savoir identifier les dangers, c’est-à-dire avoir un débat stratégique, qui n’existe pas en France. Sous la Cinquième République, on manque d’un débat politique et stratégique. En conséquence, les Français sont toujours prêts à faire la guerre précédente. J’ai peur que certains aujourd’hui se préparent à la prochaine guerre en Ukraine ! Notre prochaine guerre à nous Français, vu notre géographie, ce ne sera pas la prochaine guerre en Ukraine.
Je suppose que ce que vous évoquez, ce sont les nouveaux types de conflictualité. Quels sont les nouveaux types de conflits auxquels il faudrait se préparer ? Et en quoi la dissuasion change-t-elle l’équation ?
En ce moment, je travaille beaucoup sur les relations entre la Chine et les États-Unis, parce que je trouve ça assez inquiétant, avant tout à cause des Américains. Je me dis parfois qu’il pourrait y avoir un accident Sarajevo entre les deux. Puis je me raisonne, et me dis qu’un tel accident n’est pas possible, à cause de la dissuasion nucléaire. Les deux sont retenus par la dissuasion nucléaire.
De même, nous ne laisserons pas les Ukrainiens envahir la Russie. La question peut se poser, en revanche, pour la Crimée. À quel moment les Russes considéreront qu’il s’agit de leur intérêt vital ? Ils ne vont pas déclencher l’arme nucléaire pour le Donetsk, mais la question de la Crimée est plus épineuse.
À quel moment les Russes considéreront qu’il s’agit de leur intérêt vital ? Ils ne vont pas déclencher l’arme nucléaire pour le Donetsk, mais la question de la Crimée est plus épineuse.
Gérard Araud
Par ailleurs, il est clair qu’il existe de nouvelles conflictualités : notamment les combats dans le cyberespace et le développement de l’usage de l’intelligence artificielle. Des livres déjà publiés racontent une guerre conduite par intelligence artificielle, avec des avions sans pilotes ; la guerre est finie en quelques secondes. C’est de la science-fiction bien sûr. Néanmoins, il me semble vrai qu’aujourd’hui on ait plus besoin d’ingénieurs que de bataillons, étant donnée notre géographie. On ne va pas être envahis par nos voisins ! Ce sont plutôt ces nouvelles conflictualités qui nous concernent.
Que pensez-vous de la comparaison selon laquelle l’époque contemporaine est proche des années 1930 ?
On pourrait aussi dire que nous sommes dans une période similaire à celle qui a précédé la Première guerre mondiale. Nous pouvons faire beaucoup de parallèles historiques qui sont, je le rappelle, avant tout des jeux intellectuels.
Un parallèle historique me fait réfléchir en ce moment. Quand le Japon entre en guerre contre les États-Unis en 1941, c’est aussi parce que le Japon subit un embargo sur les hydrocarbures, qui serait levé à condition que le Japon quitte la Chine. Malgré l’analyse des officiels japonais qui considèrent qu’ils risquent de perdre une telle guerre, ils finissent par la lancer.
Aujourd’hui, quand les Américains interdisent l’exportation de micro-processeurs avancés à la Chine, cela revient à dire à la Chine que les États-Unis souhaitent les empêcher d’être une économie avancée. C’est du même ordre que l’embargo sur les hydrocarbures sur le Japon. C’est un choix d’hostilité et de confrontation. On peut alors se demander : mais que vont faire les Chinois ?
Les parallèles historiques aident dans le raisonnement, mais il ne faut pas en être prisonnier et garder à l’esprit leurs limites.
Est-ce que vous pensez que les divisions internes aux États-Unis vont continuer à peser lourdement sur la politique étrangère du pays, et quelles conséquences peut-on tirer de ces divisions pour nous Européens ?
Le pays est plus polarisé que jamais. Le Parti républicain a poursuivi sa dérive vers l’extrême droite. Vous avez un parti démocrate divisé avec entre gauche et centre, avec le phénomène du wokisme qui pose problème à la classe moyenne démocrate blanche. Biden était une manière d’éviter de vider l’abcès. Du côté des Républicains, vous avez le choix entre Trump et Desantis, gouverneur de Floride, qui fait du Trump bis, dans ce que je qualifierais de « délire identitaire ». Les États-Unis sont extrêmement divisés, avec une population radicalisée. Le résultat de l’élection de 2024 sera capital pour la politique étrangère. Si Trump est réélu, c’est la fin du soutien à l’Ukraine, peut-être même la fin de l’OTAN.
Dans le livre, vous décrivez l’anticommunisme d’un certain nombre de dirigeants comme une des causes de leur « aveuglement ». Iriez-vous jusqu’à faire un parallèle entre l’anticommunisme que vous décrivez et la politique antichinoise des États-Unis aujourd’hui ?
Les Américains, du fait de leur géographie, n’ont jamais eu à faire de la géopolitique traditionnelle. Ils n’ont jamais eu peur de leurs voisins. Ils ont dépecé le Mexique, et le Canada n’a jamais fait de mal à personne ; donc ils n’ont jamais eu peur. C’est un pays dont l’unité est idéologique – un peu comme la France, d’ailleurs. Il n’a pas d’unité géographie ou ethnique. C’est donc un pays idéologique, porteur d’un messianisme. Cela les conduit à mettre en œuvre une politique étrangère messianique.
Les Américains, du fait de leur géographie, n’ont jamais eu à faire de la géopolitique traditionnelle. C’est un pays dont l’unité est idéologique ; cela les conduit à mettre en œuvre une politique étrangère messianique.
Gérard Araud
Au lieu de considérer que la Chine a recouvré la puissance qui était la sienne auparavant, ils considèrent que la Chine est pleine de noirs desseins. Ils n’arrivent à comprendre que c’était inévitable, que les relations internationales sont compétitives, et que la Chine va être puissante.
Par conséquent, les Américains considèrent tout à fait normal que des navires américains soient à 200 miles des côtes chinoises, à 5 000 miles des côtes américaines. Imaginez si les Chinois, par hasard, étaient en train de patrouiller entre Cuba et la Floride ou s’il y avait un état-major chinois à Mexico. Ce serait la guerre ! Les Américains ne l’accepteraient pas parce que pour eux ce n’est pas une question de géopolitique, c’est défense de la démocratie, la défense de l’ordre international – qui n’est en termes de realpolitik que leur suprématie.
À la lecture de votre ouvrage, on s’interroge : quelle est votre vision de l’histoire ? Pensez-vous que celle-ci est linéaire, qu’elle va vers un progrès, ou qu’elle est cyclique ?
Ma vision, si j’ose dire, de l’histoire, de la vie et de la politique est à l’ombre d’Auschwitz. Pour moi, le mal est dans l’homme. On ne peut pas expliquer Auschwitz pour des raisons économiques, psychologiques, sociales. C’est une éruption du mal absolu dans l’histoire de l’humanité, qui est déjà un long chemin d’atrocités. L’homme est le seul animal qui prend plaisir à faire souffrir son semblable. Auschwitz arrive dans le pays qui, à l’époque, était le plus civilisé. Il y avait tout, l’art, l’architecture, la littérature, le cinéma. L’histoire est donc une répétition de la formule de Hobbes, homo lupus homini.
Pour poursuivre sur cette question, une des citations en exergue de votre livre est de Karl Marx : « les hommes font leur propre histoire, mais ils ne la font ni à leur gré, ni sous les conditions de leur choix, mais dans les circonstances qu’ils rencontrent et dans les conditions qui leur sont imposées ». Est-ce que ce livre est aussi un appel à la modestie quant au rôle joué par les individus dans le cours de l’histoire ?
Le 2 décembre de Louis Napoléon Bonaparte, dont est tirée la citation, est un chef d’œuvre. Je sais bien qu’on ne lit plus beaucoup Karl Marx, mais je suis de la génération marxiste. Cet ouvrage, c’est l’articulation entre les forces structurelles, la question des conditions objectives et l’homme. Si Napoléon Bonaparte était né en 1715, personne ne le connaîtrait. La Révolution a offert à ce nobliau corse une occasion qui ne se serait jamais offerte en un temps différent. Hitler, c’est la crise de 1929, dans une Allemagne pleine de rancœur et travaillée par l’antisémitisme. Si Hitler était arrivé en 1848, il n’aurait pas eu le destin qu’il a connu.
À mes yeux, l’homme peut donc faire l’histoire. Je donne toujours comme exemple la conversion de Constantin au christianisme. Le christianisme au début du IVème siècle n’était pas du tout voué à triompher. C’est la conversion de Constantin qui rend le monde chrétien. Ensuite, l’appareil d’État répressif s’engage derrière et progressivement on voit le paganisme reculer.

