Peut-on dissocier l’œuvre de l’auteur ? une conversation avec Gisèle Sapiro
Dans Peut-on dissocier l’œuvre de l’auteur ?, essai d’intervention paru au Seuil, la sociologue Gisèle Sapiro entend proposer, à travers l’analyse des arguments mobilisés lors de différentes « affaires » touchant à la question des rapports entre morale de l’auteur et morale de l’œuvre, une mise en perspective philosophique et socio-historique des enjeux que celles-ci recouvrent. Nous en avons discuté avec elle.
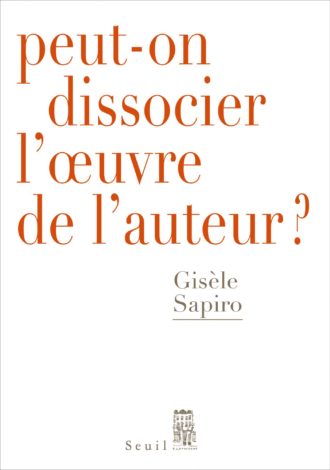
Malgré la confusion extrême qui entoure la question d’une prétendue « cancel culture », vous estimez que ces polémiques peuvent être salutaires. Pourquoi ? La « cancel culture » ne mobilise-t-elle pas une grande partie de fantasmes de mouvances conservatrices qui tendent à dénoncer une censure inexistante dans les faits ?
Je ne parlais pas des attaques contre la prétendue « cancel culture », mais de la question de la séparation ou non de l’œuvre et de l’auteur qui est l’objet du livre. Je trouve salutaire qu’on pose la question des rapports entre morale de l’œuvre et moralité de l’auteur, qui est plutôt restée taboue jusqu’ici, et que les groupes minorés et les personnes violentées rendent publique leur résistance à la violence symbolique et physique. Que cela implique des formes – assez contrôlées et peu dangereuses – de violence en retour, comme le déboulonnage de statues ou les manifestations visant à empêcher des événements culturels ou conférences, n’est pas surprenant et mérite discussion plutôt que condamnation. Ces débats ont un effet d’anamnèse au niveau de la conscience individuelle et collective et permettent de rendre explicites et de dénoncer les mécanismes de la violence symbolique qui s’exerce à l’égard de membres de ces groupes et qui légitime la violence physique. Une telle discussion permet en outre de faire émerger d’autres questions telles que la sous-représentation des personnes racialisées dans le monde de la culture en France (je pense à l’exemple du théâtre, débattu lors des protestations contre la performance Exhibit B de Brett Bailey). Justement, contre les pourfendeurs de la Cancel Culture, je rappelle que la critique n’est pas la censure, elle est précisément au fondement du régime de liberté d’expression qui doit permettre à des opinions contraires de se confronter. Je rappelle aussi que le boycott est un droit et qu’il n’a rien à voir avec la censure. En même temps, comme je le montre, les cas sont très divers et méritent d’être analysés séparément. Et s’il y a bien des liens entre morale de l’œuvre et moralité de l’auteur, ils ne sont pas toujours transparents ; en outre, l’œuvre ne peut s’y réduire.
Comment avez-vous choisi les cas sur lesquels vous vous appuyez ?
D’abord, je dois préciser qu’il ne s’agit pas d’une enquête sociologique : il n’y a pas d’échantillonnage, et je ne propose pas d’étude complète des affaires, ce qui aurait impliqué une autre méthodologie. La première partie de l’ouvrage est théorique, sur les types de rapport que l’on peut envisager entre l’auteur et l’œuvre, pour déconstruire ces deux notions. La deuxième partie porte davantage sur les affaires : j’ai regroupé deux affaires « exemplaires » sur le principe de l’abus d’autorité (l’affaire Matzneff et l’affaire Polanski), tandis que le chapitre 5 est construit sur une réflexion autour de l’idéologie, avec les cas de Günter Grass et de Hans Robert Jauss qui ont pris des positions condamnables ou qui ont eu des comportements répréhensibles dans leur jeunesse. J’ai pensé que ces cas pouvaient nous aider à réfléchir aux types de rapport possibles entre l’auteur et l’œuvre : même lorsque l’auteur est revenu sur ses positions de jeunesse, l’œuvre recèle des traces du rapport que l’auteur entretient avec ce passé, comme le sentiment de culpabilité qui imprègne l’œuvre de Grass. Ce n’est bien sûr pas la même chose que d’interroger le cas Maurras, pour lequel l’idéologie est claire de bout en bout, ou le cas Heidegger, qui n’a jamais rien renié après la Seconde Guerre mondiale. Le cas Handke est traité à part. J’ai pensé que cette diversité de cas pouvait nous permettre de mieux saisir la relation entre l’œuvre et l’auteur, pour mieux comprendre l’œuvre elle-même.
De nombreux débats récents (et un peu répétitifs) s’interrogeaient sur la pertinence de l’édition d’œuvres aux discours controversés, haineux et antisémites. Vous revenez dans votre ouvrage sur différents cas, notamment la réédition des Décombres de Lucien Rebatet (dans la collection « Bouquins » sous le titre Le Dossier Rebatet), celle des pamphlets antisémites de Céline par Gallimard, ou encore celle d’écrits « autobiographiques » de l’essayiste Charles Maurras. Or, vous semblez distinguer ces différents cas. Vous laissez notamment entendre que la publication des écrits antisémites de Céline (qui n’a finalement pas eu lieu) constituait surtout une opération mercantile à laquelle le dossier critique servait d’alibi. Le cas du Dossier Rebatet semble plus complexe : vous saluez ainsi le travail réalisé par les historiens Bénédicte Vergez-Chaignon et Pascal Ory, tout en soulignant qu’il n’est pas du tout anodin de publier ce qui fut le best-seller de l’Occupation dans la collection « Bouquins », qualifiée par Jean d’Ormesson de « bibliothèque idéale de l’honnête homme » (ce qui rappelle que l’identité de la collection est également un enjeu). Pouvez-vous revenir sur la distinction que vous faites entre ces différents cas ? Une contextualisation critique poussée suffit-elle à désamorcer toute réticence ?
Je pense que les éditeurs comme tous les intermédiaires culturels ont une responsabilité, et que rééditer ces pamphlets dans le contexte de la montée de l’extrême droite est une entreprise lucrative dont les effets peuvent être dangereux, car on voit bien qu’il ne s’agit pas d’un cas isolé comme l’était le journal de Drieu La Rochelle, publié en 1992 chez Gallimard dans la collection « Témoins », dans une édition critique qui posait la question même de savoir s’il fallait ou non publier. Il s’agissait d’un inédit et d’un journal qui révélait des aspects méconnus et haineux de la personnalité en apparence policée de Drieu, donc apportait une contribution à la connaissance de la période. Il en va de même du Dossier Rebatet, qui contient un inédit, nombre de documents dont des lettres, les pièces du procès, et un appareil critique très solide et imposant, qui surplombe le texte. En outre, Rebatet n’a pas du tout le statut de Céline dans la littérature française, il est peu lu et peu enseigné, et pas considéré comme un grand écrivain. Le projet initial de réédition des pamphlets de Céline chez Gallimard n’était pas du même ordre et l’édition québécoise ne l’est pas non plus, elle est faite par un célinien, littéraire, qui n’est pas historien de la période et qui privilégie une approche littéraire qui contribue à réintégrer les pamphlets dans « l’œuvre » de Céline, alors que Céline lui-même les en avait dissociés. Le gain de connaissance est faible, ces pamphlets sont disponibles en ligne, et on dispose déjà d’une remarquable analyse de leurs sources journalistiques d’extrême droite par Alice Kaplan 1. Cette entreprise lucrative – car je ne soupçonne absolument pas l’éditeur de connivence idéologique quelconque, pour le cas de Gallimard – menée au nom de la liberté d’expression présente à mes yeux le danger de banaliser, voire de légitimer ce que j’appelle des « discours de stigmatisation » (plutôt que des propos haineux), en intégrant ces textes au patrimoine national.
La publication de tels textes par des maisons d’édition fortement dotées en capitaux symbolique et économique, comme Gallimard, pose la question du rôle des intermédiaires culturels dans la légitimation de textes véhiculant des idées racistes, antisémites, ou plus largement condamnables (on peut y inclure les textes de Gabriel Matzneff que vous évoquez, vantant ses expériences pédocriminelles). N’y a-t-il pas une responsabilité propre aux intermédiaires culturels qui est également en jeu (on peut penser à la connivence entre Matzneff et une partie du milieu littéraire parisien) ? Cette responsabilité peut-elle trouver une forme de traduction juridique ?
La responsabilité pénale de l’éditeur existe déjà, elle est codifiée dans la loi : l’éditeur ou l’éditrice est premier responsable de ce que sa maison publie devant la loi, l’auteur n’étant que son complice. Effectivement, les pamphlets de Céline comme les écrits pédophiles de Matzneff tombent sous le coup des lois restreignant la liberté d’expression : la loi Pleven de 1972 contre le racisme, dont on fête les 50 ans, et l’interdiction de faire l’apologie d’un crime. Matzneff et ses éditeurs ne doivent qu’à une forme de tolérance à l’égard de la « littérature » et de protections bien placées le fait d’avoir échappé à des poursuites. Gallimard a exercé sa responsabilité morale – un peu tard – en retirant les journaux de Matzneff de la vente après avoir lu le livre de Vanessa Springora, disant qu’il avait été touché par la souffrance qui s’y exprime. Ce retrait a coïncidé aussi avec l’ouverture d’une enquête pour viol sur une mineure de moins de 15 ans par le Parquet, car même si l’affaire est prescrite, l’enquête cherche à identifier d’autres victimes.
Mais il ne s’agit de dire que les éditeurs doivent nécessairement se soumettre à loi. La justice du Second Empire a censuré Les Fleurs du mal de Baudelaire et celle de la Ve République Le Château de Cène de Bernard Noël. Dans mon livre La Responsabilité de l’écrivain (Seuil, 2011), j’ai montré que c’est en revendiquant une éthique de responsabilité distincte de la responsabilité pénale que les écrivains ont lutté pour l’extension de la liberté d’expression, avec l’appui de leurs éditeurs, même si Jean-Yves Mollier critique l’habitus de prudence des éditeurs français 2.
La responsabilité pénale existe donc, mais mon propos concerne davantage la responsabilité morale, éthique et intellectuelle des éditeurs et éditrices ou des agents et agentes : tous les agents et toutes les agentes auprès de qui j’ai mené des entretiens m’ont affirmé qu’ils et elles ne pourraient pas publier des livres qu’ils et elles ne seraient pas en capacité de défendre, par exemple dans le cas de propos racistes ou sexistes.
Les partisans de la publication de tels ouvrages affirment aussi qu’il faut compter sur l’intelligence critique du lecteur et sur sa capacité à faire la part des choses. Qu’en pensez-vous ?
Je n’ai aucun doute sur l’intelligence critique des lecteurs et lectrices. Et j’entends tout à fait ces arguments, je pense que le débat n’est pas simple et mérite d’être rendu public, avec les arguments de part et d’autre. Mais le problème pour moi n’est pas tant l’influence que ces textes pourraient avoir sur les lecteurs et lectrices que les usages qui pourraient en être faits par les idéologues d’extrême droite pour légitimer leurs discours de stigmatisation contre des groupes minorés et vulnérables, dans un contexte où l’extrême droite rallie plus d’un tiers des intentions de vote. Cela risque de favoriser la levée des censures sur les discours racistes et antisémites qui existent encore dans l’espace public. Et les idéologues d’extrême droite comme Eric Zemmour ou Richard Millet qui protestent contre les restrictions à la liberté d’expression pourraient s’en servir pour soutenir leurs revendications en faveur de la levée de ces restrictions concernant les discours dits de haine contre des personnes à raison de leurs origines ethniques ou religieuse, de leur sexe, ou encore de leurs préférences sexuelles, sans compter l’opération de légitimation que représente la publication d’un texte par une maison d’édition à fort capital symbolique, comme Gallimard.
Quelle est la place de l’intérêt économique dans la publication d’auteurs « sulfureux », scandaleux ?
Comme je ne soupçonne pas les éditeurs concernés de connivence idéologique, je ne peux m’expliquer ces projets de réédition que par la quête de profit. Car sinon, pourquoi rééditer ces écrits alors qu’on refuse de rééditer l’œuvre beaucoup plus intéressante de Julien Benda ?
Le contexte constitue-t-il pour vous un argument déterminant ? L’historien Serge Klarsfeld, interrogé en 2011 sur une republication hypothétique des écrits antisémites de Céline, affirmait : « Je serai contre une publication des pamphlets. Si nous étions dans un monde pacifié, il n’y aurait pas de problèmes. Mais ces textes sont trop nocifs. Les republier serait dangereux ». Or, il est clair que le contexte n’a fait qu’empirer de ce point de vue depuis dix ans…
Un éditeur qui publie un texte le fait toujours dans un contexte déterminé, en essayant de toucher un public. C’est pourquoi l’argument évoqué par Gallimard ou Pierre Assouline avec qui j’ai débattu de cela, selon lequel il faut les rééditer pour qu’on comprenne ce qu’était l’antisémitisme, est ambigu. Car d’une part il existe des études sur l’antisémitisme et le racisme, qui analysent la rhétorique de ces textes. D’autre part, une telle réédition pourrait être instrumentalisée pour légitimer des discours de stigmatisation aujourd’hui comme je le disais.
Par ailleurs, certains présentent la publication de ces textes comme une forme d’alarme, de rappel face à la montée actuelle de l’extrême droite, sans s’attacher au fait que la plupart des acquéreurs de ce genre d’ouvrages font déjà partie d’un public d’extrême droite…
Oui, cet argument me paraît assez fallacieux : tout le monde sait ce qu’il y a dans les pamphlets de Céline. Il suffit d’ailleurs de les chercher sur internet si l’on veut avoir accès au contenu. Encore une fois, il ne s’agit pas de l’indisponibilité de ces textes.
La question se pose aujourd’hui de la meilleure manière de lutter contre les idées d’extrême-droite. Dans un texte paru en 1997 dans Le Monde, ironiquement intitulé « Sept règles pour aider à la diffusion des idées racistes en France » 3, le philosophe Jacques Rancière exprimait ses doutes sur l’efficacité des campagnes de dénonciation indignée du Front national. Il y évoquait notamment le fait que de telles campagnes avaient pour effet de donner paradoxalement aux propos racistes une publicité inespérée tout en leur donnant la palme du martyre. Le contexte n’est plus le même (il a empiré), mais que pensez-vous de cette position, eu égard aux affaires évoquées plus haut ?
C’est un texte très intéressant et juste dans ce qu’il dit du traitement médiatique des propos racistes. Je suis néanmoins gênée par un passage : « vous pourriez considérer comme anodin le besoin où est M. Le Pen de faire remarquer ce que tout le monde voit à l’œil nu, que le gardien de l’équipe de France a la peau bien noire. Vous manqueriez ainsi l’effet essentiel : prouver qu’on fait aux racistes un crime de dire une chose que tout le monde voit à l’œil nu. » Le fait de « voir », c’est-à-dire de « distinguer » comme une propriété pertinente, c’est-à-dire « discriminer », la couleur de peau est en soi une attitude raciste, car on ne discrimine pas les gens par leur couleur de cheveux ou d’yeux (cela a existé sous le nazisme). Pourquoi remarquerait-on la couleur de peau d’une personne plus que d’autres de ses propriétés : sa taille ? son poids ? Et surtout pourquoi la catégoriserait-on selon ce critère ? Là commence le racisme, dès que cela devient une propriété « visible », « discriminante ».
Quant à la position à tenir, si je suis d’accord avec ce que dit Rancière du traitement médiatique des propos racistes à l’extrême-droite, et de l’écho amplificateur qu’il leur donne, ne pas en parler du tout risque de banaliser ces propos. C’est ce qu’il dit de l’usage qui en est fait pour légitimer des catégories comme celle de « descendants d’immigrés » ou pour marteler l’idée que l’immigration serait un problème qui est le plus juste. Par contre, il y aurait je pense d’autres manières de contrer les discours racistes, en montrant les conséquences qu’ils ont sur les populations concernées.
Lors de l’affaire Matzneff, certains ont défendu l’idée selon laquelle si l’on se refuse à publier les ouvrages de Matzneff, il faut en faire de même pour Lolita de Nabokov : sur quelle base leur répondre (au-delà de la différence de talent évidente) ? S’agit-il de la distinction entre apologie et représentation que vous évoquez dans le livre ? Et si c’est le cas, quels critères (juridiques, esthétiques, etc.) permettent-ils de distinguer l’une de l’autre ? Cette distinction peut-elle s’opérer en se fondant uniquement sur une critique interne de l’œuvre ? Enfin, on peut noter, qu’au-delà des intentions de l’auteur, une œuvre peut très bien être lue au premier degré.
La distinction entre apologie et représentation s’est établie à la suite des luttes pour la liberté d’expression. Ce n’est pas parce qu’on décrit un meurtre qu’on appelle au meurtre : Balzac, par exemple, dans sa défense du réalisme, disait que ne pas vouloir représenter le « mal » alors qu’il existe relevait de l’hypocrisie bourgeoise. Cette distinction nécessite bien sûr une analyse interne de l’œuvre. Mais il est aujourd’hui admis, y compris à la 17e chambre du tribunal de Paris qui regroupe les procès littéraires en Île-de-France, que l’univers fictionnel marque une séparation entre l’auteur et l’œuvre. C’est la première différence entre Lolita et les écrits de Matzneff, qui ne sont pas de la fiction mais des écrits autobiographiques, quasiment sur le vif (sous forme de journal), et des essais qui font l’apologie ouverte de la pédocriminalité.
Certes, comme je l’analyse dans le cas de Houellebecq, cette séparation entre l’auteur et l’œuvre est discutable, car il y a toujours un lien entre la morale de l’œuvre et la moralité de son auteur. En outre, le roman à thèse peut relever d’une forme d’apologie. Or Houellebecq joue toujours sur le double niveau de lecture, premier et deuxième degré. Alors que dans Lolita, le point de vue exprimé révèle une conscience trouble, comme dans Rose bonbon de Nicolas Jones-Gorlin, qui est aussi narré du point de vue d’un pédophile – avec l’enchâssement final du récit à la première personne présenté comme un témoignage recueilli par une journaliste, qui selon mon hypothèse a été une solution pour échapper à des poursuites. On peut citer aussi Les Bienveillantes de Jonathan Littell qui raconte la Shoah du point de vue d’un officier nazi, procédé qui a divisé la critique : s’agissait-il du point de vue « crédible » sinon « fiable » de l’unique témoin possible de l’extermination des juifs, ou d’une forme de complaisance dans la description de l’horreur ? Mais l’analyse ne peut s’en tenir à la seule perspective narrative, il faut la mettre en relation avec d’autres éléments pour en donner la signification, qui d’ailleurs peut demeurer ambiguë, c’est une des caractéristiques des grandes œuvres de la modernité.
Il relève de la responsabilité des éditeurs de filtrer les œuvres en fonction de critères qui ne sont jamais purement esthétiques car ils mêlent des considérations commerciales et souvent aussi éthiques ou idéologiques, et de la responsabilité de la critique d’expliciter ces enjeux et de critiquer les œuvres moralement ambiguës le cas échéant. À cet égard, la critique que fait Emmanuel Bouju de l’ouvrage de Littell dans les Annales (2010) 4 est remarquable : il montre, en analysant le dispositif narratif, comment le projet esthétique échoue, provoquant un effet révélateur sur la dimension semi-sensationnaliste, semi-complaisante de l’œuvre. Des historiens sont également intervenus dans cette affaire, sur la manière dont les témoignages sont utilisés. Florent Brayard, dans un article de Libération (2006) 5, a par exemple mis en évidence les ajouts de Littell allant dans le sens du sensationnel et d’une forme d’atteinte à la dignité des victimes.
Vous semblez dessiner un continuum entre deux pôles parmi les adhérents à l’identification entre l’auteur et l’œuvre, la « cancel culture » d’un côté et de l’autre, une position qui consiste à limiter cette identification tout en faisant entendre les voix des victimes. Mais, dans le discours médiatique ambiant (notamment à droite et à l’extrême-droite), l’expression « cancel culture » n’est-elle pas utilisée de manière beaucoup plus vaste pour amalgamer des positions différentes et moins radicales qu’elles ne sont présentées ? N’est-elle pas surtout un moyen de disqualifier des mouvements (ou des courants de pensée) plus larges, antiracistes ou féministes notamment ? Peut-on historiciser ces critiques et en relativiser la nouveauté (elles semblent faire écho par exemple aux polémiques sur le « politiquement correct » des années 1980) ?
Oui, bien sûr, mais mon livre ne porte pas sur les détracteurs de la « Cancel Culture » et leur histoire, il est centré sur les arguments autour des « affaires » sur la question des rapports entre l’œuvre et l’auteur. Et celles et ceux qui préconisent la dissociation entre l’œuvre et l’auteur et le primat de la valeur esthétique de l’œuvre ne sont pas tous des opposants à la déconstruction, je ne voudrais pas ajouter de la confusion à la confusion et pratiquer l’amalgame alors que je fais tout ce travail d’analyse pour distinguer les questions. Je rappelle dans le livre que cette dissociation entre l’œuvre et l’auteur est le fruit de 150 ans de lutte pour l’autonomie de la création et pour la liberté d’expression en France, et que la réduction des œuvres à leur seule dimension morale suscite des réactions d’indignation et d’inquiétude qui ne sont pas illégitimes au pôle esthète du champ de production culturelle. Et ce n’est pas parce qu’on soutient la liberté d’expression absolue qu’on souscrit aux discours racistes, antisémites, sexistes ou pédophiles.
Mais effectivement, parmi les détracteurs les plus féroces de la « cancel culture », on trouve des individus moins soucieux de l’autonomie de l’art que du maintien de leur propre domination symbolique et de leur pouvoir d’imposer leurs valeurs. Et on trouve aussi des conservateurs et des néo-réactionnaires qui utilisent ce débat pour tenter de disqualifier les revendications LGBT et les luttes féministes, et pour certains (mais pas pour tout.e.s) les discours antiracistes également. De même que certains l’utilisent pour disqualifier la déconstruction, les théories féministes, ou le concept de genre.
Et bien sûr on pourrait historiciser chacun de ces discours : l’anti-political correctness des années 1980, le discours anti-mai 68, le discours antiféministe, mais aussi les listes noires d’universitaires « liberal » dressées aux Etats-Unis dans les années 1960-1970, ou le maccarthysme, que certains détracteurs de la « Cancel culture » accusent les féministes de pratiquer alors même que nombre d’entre eux appellent au recensement et à la sanction des prétendus « islamo-gauchistes » au sein de l’Université. Si ce n’est pas une pratique maccarthyste, je ne sais pas ce que c’est !
Pour rebondir sur le cas français, de telles polémiques ne font-elles pas partie plus largement d’une mise en cause de certaines pensées critiques (mise en cause qui a elle aussi une histoire) voire des libertés académiques ? Le sociologue Eric Fassin rappelle ainsi qu’aux Etats-Unis, la querelle sur le « politiquement correct » a d’abord visé le monde universitaire 6.
Oui, tout à fait, même si les opposants à ces mouvements ne remettent pas tous en cause la déconstruction. Le débat sur la déconstruction a surgi en partie en réponse à l’accusation selon laquelle ces mouvements seraient une importation des Etats-Unis, et seraient étrangers à la tradition française, ce qui n’est pas entièrement faux, si l’on considère l’histoire de la reconnaissance de l’autonomie de la création, qui n’a pas son équivalent aux Etats-Unis. Il a fallu rappeler, comme l’a fait Steven Kaplan dans Le Monde 7, que ces mouvements s’étaient largement nourris des écrits de penseurs français, Foucault, Derrida, Deleuze, et que donc ils n’étaient pas si étrangers que cela à la culture française. Certes, les appropriations et usages que l’on fait d’auteurs doivent être distingués de leurs écrits et de leurs intentions supposées.
Mais encore une fois, ce débat a servi de tremplin pour les pourfendeurs des savoirs critiques en général et de la déconstruction en particulier.
De nombreuses intellectuels et intellectuelles ou militants et militantes féministes opposent à cette dénonciation d’une prétendue « cancel culture » l’effacement très réel par lequel des femmes (et notamment des femmes artistes) ont été rejetées dans l’« oublioir » (pour reprendre un mot de Césaire) 8. Vous revenez sur ce point en conclusion lorsque vous appelez à déconstruire les mécanismes de constitution des canons (littéraires, philosophiques), qui en ont exclu les femmes et les minorités racisées.
Oui, c’est un point central du débat : on s’émeut de relativiser la place de tel ou tel auteur du canon, alors qu’on ignore le phénomène massif d’exclusion et d’effacement des femmes et des minorités racialisées, pour des raisons qui n’avaient rien d’esthétique. Il faudrait mener des enquêtes, comme le fait Titiou Lecoq, sur ce double phénomène d’exclusion et d’effacement. Ce sont d’ailleurs deux choses qu’il faut distinguer.
L’exclusion consiste à barrer l’accès à la consécration, à l’instar de l’Académie Goncourt, qui a primé la première femme en 1945, soit plus de quatre décennies après sa création (c’était Elsa Triolet) ; de l’Académie française qui a coopté la première écrivaine, Marguerite Yourcenar, en 1981 ; ou du prix Nobel qui n’a récompensé que 7 femmes jusqu’en 1990. D’ailleurs, au moment de la création du prix Goncourt, comme il n’y avait aucun homme dans le jury non plus, le prix Femina a été créé, très explicitement, contre la misogynie de l’Académie Goncourt. En 1910, celle-ci a recruté Judith Gautier, mais le jury continuait à ne pas couronner de femmes. Il s’agit donc d’une forme d’exclusion des rangs les plus élevés de la consécration.
L’effacement consiste à exclure de la reconnaissance posthume des créatrices qui étaient reconnues en leur temps, comme Natalia Goncharova, qu’on redécouvre aujourd’hui, ou Irène Némirovsky dont j’avais découvert l’existence bien avant sa redécouverte, dans un livre de Jennifer Milligan de 1996, The Forgotten Generation 9, qui analyse la manière dont les écrivaines françaises de l’entre-deux-guerres ont été exclues du canon littéraire français après 1945. Milligan montre qu’après la guerre, les anthologies les excluent au profit des Anglo-américaines (Virginia Woolf et d’autres).
Il en va de même pour les minorités racialisées : on redécouvre aujourd’hui le sociologue afro-étasunien W.E.B. Du Bois, qui était largement reconnu au début du XXe siècle.
De même, la professionnalisation des sociologues étasuniens dans l’entre-deux-guerres est passée par l’exclusion du travail social, où se trouvaient la majorité des femmes.
En ce moment, je travaille sur l’histoire de l’International Sociological Association, où les femmes étaient très rares dans les comités de direction des sections thématiques avant les années 1970, et où elles restent peu nombreuses jusque dans les années 1980, à part dans des domaines comme l’éducation ou le réseau Women, Gender, and Society.
Par conséquent, on voit que bien que ces mécanismes d’exclusion et d’effacement ne sont pas fondés sur des critères esthétiques ou intellectuels. On peut donc critiquer le canon, comme l’ont fait les féministes et le mouvement pour les droits civiques.
Toute position « esthète », tout en prétendant faire abstraction des enjeux politiques de la création, n’est-elle pas vouée in fine à avoir une signification politique ? C’est ce paradoxe (ou cette contradiction) que souligne une tribune de militantes féministes d’origine juive au sujet de Polanski. Cette tribune (publiée sur Mediapart), que vous citez dans le livre et dont vous semblez partager le point de vue, affirme ainsi, au sujet du César de la meilleure réalisation attribué au cinéaste franco-polonais pour le film J’Accuse : « […] Peut-on aimer Tess et Rosemary’s Baby ? Assurément. Mais ne couronnons pas ces films le jour où la société commence à peine, et avec douleur, à prendre au sérieux la voix des femmes et enfants victimes de violences sexuelles. Là est le cœur de notre lutte » 10. La revendication d’une position « esthète » ne constitue-t-elle pas finalement une naïveté (et parfois une naïveté intéressée) ?
Cela me semble plus complexe. J’ai trop travaillé sur l’histoire de la revendication de l’autonomie esthétique pour la réduire à une naïveté.
Certes, on peut dire que Flaubert et Baudelaire s’en servaient aussi pour faire passer des représentations interdites ou des messages subversifs dans l’espace public. C’est la thèse de Dominick LaCapra sur Madame Bovary 11. En analysant le roman en détail dans La Responsabilité de l’écrivain 12, je montre qu’il demeure ambigu et ne peut être réduit à la thèse qu’on lui prête. Il faut se rappeler que Flaubert voulait faire un livre « sur rien », que l’intrigue est plus le prétexte de l’écriture que le contraire, qu’elle est une double parodie du réalisme et du romantisme. Ce qui n’empêche bien sûr pas de le lire au premier degré et comme un roman à thèse comme l’ont fait à la fois le procureur Pinard et l’avocat de Flaubert, en l’interprétant dans des directions opposées : le premier comme un roman magnifiant l’adultère, le second comme un roman démontrant les effets nocifs des mauvaises lectures sur une jeune femme d’origine modeste. Or c’est cette deuxième interprétation qu’a privilégiée le tribunal, tout en blâmant Flaubert pour son procédé réaliste, qui aurait dévoyé son projet de ses objectifs moraux…
Il y a des conjonctures autoritaires où, comme sous le Second Empire, le maintien de l’autonomie de l’art est une lutte et un acte politique en soi. Il ne faut pas l’oublier, surtout aujourd’hui.
En même temps, j’ai montré, dans La Guerre des écrivains 13, que sous l’Occupation, la revendication d’autonomie de l’art par La Nouvelle Revue Française, dont Drieu La Rochelle avait repris la direction, servait l’occupant qui visait à normaliser la vie culturelle sous son joug et à illustrer la collaboration franco-allemande, dont la revue devait être la vitrine « chic ». C’est pourquoi il faut toujours contextualiser les arguments mobilisés dans les débats.
Ce à quoi j’invitais aussi dans ces deux livres, c’était de mettre en relation les discours et les pratiques : La NRF prétend à l’autonomie mais exclut en même temps des collaborateurs parce qu’ils sont juifs ou communistes. On a retrouvé dans les archives l’éditorial que Drieu avait prévu de donner lors de la reparution de la revue, un texte d’une violence inouïe et complètement engagé idéologiquement. Ce sont les services de l’ambassade allemande qui lui ont demandé de revoir sa copie et de livrer un édito purement littéraire et dépolitisé.
Votre livre laisse entendre que la question de la séparation de l’œuvre et de l’auteur (et des conséquences à en tirer) ne se pose pas de la même manière selon qu’il s’agit de publier un auteur, de le commémorer, de l’enseigner ou de le consacrer (par un prix par exemple). Vous évoquez ainsi les polémiques qui ont entouré l’insertion en 2011 et en 2018 de Louis-Ferdinand Céline et Charles Maurras au Livre des commémorations nationales. Plus largement, on peut se demander si c’est bien le rôle de l’État de commémorer tel écrivain ou telle écrivaine. Est-ce qu’on rend service à l’œuvre de Victor Hugo par exemple en en faisant une sorte de « grand écrivain républicain », en apposant une sorte de consensus institutionnel un peu mou autour de son œuvre ?
Les polémiques autour de l’insertion de Céline et de Maurras au Livre des commémorations nationales ont révélé l’ambiguïté de la politique de patrimonialisation de l’Etat en matière culturelle. Les Etats-nations se sont construits en sacrant les écrivains et artistes en héros culturels (voir le livre d’Anne-Marie Thiesse, La Fabrique de l’Écrivain national) 14. Ils sont venus rejoindre les « grands hommes » de la nation, devenant des sortes de « saints » laïcs. Or les héros, les saints, sont canonisés pour leur exemplarité. On ne célèbre pas telle ou telle œuvre mais l’homme (ce sont pour la plupart des hommes) qui en est l’auteur. Même si l’on remplace la notion de « célébration » par celle de « commémoration », c’est toujours la naissance ou la mort de la personne qui en est l’objet, de même que les statues dressées à son effigie. L’Etat distingue ainsi ceux qui méritent un tel honneur de celles et ceux qui ne méritent pas cette considération. Là encore, femmes et minorités racialisées étaient exclues jusqu’à une date récente, ce qui contribuait à les invisibiliser et à naturaliser cette exclusion en la ratifiant.
Les membres du Comité des commémorations nationales ont démissionné en disant que la commémoration permettait de nourrir le débat historique (par exemple sur l’importance de Maurras dans l’histoire nationale). Mais les commémorations ne peuvent pas se substituer au travail des historiens, qui n’ont d’ailleurs pas attendu la commémoration pour travailler sur l’Action française. Il y a au moins 4 ou 5 travaux de référence sur la question, qui ne sont pas non plus centrés sur la figure de Maurras 15. L’enseignement n’a rien à voir avec ces célébrations qui sont des sortes d’opérations de coup de projecteur qui favorisent les rééditions, les publications, les événements, les débats médiatiques, etc. Cela a son intérêt par rapport au débat public mais ça implique une responsabilité importante de la part de l’Etat. Personnellement, je pense qu’il faudrait réviser complètement ces procédures de consécration, même si je ne voudrais pas que ça conduise à marginaliser la littérature et les arts encore plus qu’ils ne le sont aujourd’hui. Cette focalisation sur la biographie des auteurs contribue en effet à populariser leur figure dans l’espace public, et donc leur œuvre. C’est d’ailleurs aussi pour cela que l’on peut difficilement dissocier les deux.
Récemment, on a assisté à l’émergence du mouvement « #metoo théâtre », dont les militant.e.s se sont particulièrement illustré.e.s dans un affrontement avec le metteur en scène Wajdi Mouawad, directeur du théâtre de la Colline, en raison de sa programmation de Bertrand Cantat et du metteur en scène Jean-Pierre Baro (visé pour une plainte pour viol classée sans suite). Mouawad met en avant sa volonté de « ne pas se substituer à la justice ». Pensez-vous que les institutions théâtrales publiques, subventionnées, ont un devoir de vigilance lié au fort pouvoir de légitimation et de consécration artistique dont elles disposent (Roselyne Bachelot s’est exprimée en défaveur de la programmation de Cantat et Baro) ? Un tel débat aurait-il eu lieu au sein du théâtre privé ?
Je pense qu’il aurait pu tout à fait avoir lieu dans un théâtre privé, puisqu’il y a des groupes féministes qui s’opposent complètement à ce que Cantat ait une présence dans l’espace public. Et en même temps, l’affaire paraissait aggravée par le fait que c’est un théâtre subventionné, et c’est pour cela d’ailleurs que Roselyne Bachelot a exprimé un regret. Cette affaire est intéressante parce qu’elle révèle plusieurs problématiques. Elle révèle le fait que l’Etat veut garantir une certaine autonomie de la scène artistique tout en la subventionnant, et donc en nommant des créateurs auxquels l’Etat reconnaît cette autonomie. Et je pense que c’est pour ça que Roselyne Bachelot n’a fait qu’exprimer des regrets, puisqu’après tout l’Etat a aussi le pouvoir d’ingérence et de dire : on retire et on interdit, ce qu’elle n’a pas fait. C’était une manière d’exprimer une position morale, sans aller jusqu’à exercer son pouvoir de censure.
Après, le débat sur le cas de Cantat pose la question de savoir si, lorsqu’on a purgé sa peine, on a le droit à la réinsertion ou non, et quel type de réinsertion. L’argument des féministes, c’est de dire : oui, il a le droit de travailler mais pas en se montrant sur scène, ce qu’il a fini par abandonner. Dans ce cas il s’agissait de musique, mais là-aussi, ça a été matière à mobilisation. Par ailleurs, Mouawad, c’est aussi un ami de Cantat et il essaie de le protéger, donc il y a beaucoup de choses imbriquées dans cette affaire. Il y a aussi une dimension de provocation.
Ce qui selon moi est le plus important, c’est que la discussion ait lieu, c’est-à-dire que les points de vue s’expriment sur cette affaire, qui est d’une certaine manière insoluble. Lorsqu’on écoute Nadine Trintignant, on est forcément de son côté, on comprend qu’elle ne veuille plus entendre parler de Cantat, et on entend aussi le point de vue des défenseurs de Cantat sur l’argument de la double peine, etc. Je pense que le débat est le plus important, parce que le débat met au centre la question de la violence contre les femmes. Et c’est ça qui est important. On ne fera pas revenir à la vie Marie Trintignant, mais on peut rappeler qu’il lui a porté vingt-trois coups avant qu’elle ne meurt, que même si cette mort était non intentionnelle, elle est la conséquence directe de cette violence, et que ça pose donc la question de sa présence, qui peut effectivement déranger certains. Si l’on ne disait rien, cela serait comme une sorte d’offense à la mémoire de toutes les victimes de ces violences.
Les affaires Matzneff et Polanski soulèvent la question de l’usage du statut d’auteur pour commettre des actes répréhensibles (et notamment exercer une emprise sur des mineur.e.s). Vous citez Vanessa Springora : « Par son statut d’écrivain, Gabriel Matzneff redoublait son entreprise de prédation par une exploitation littéraire de cette séduction et de possession des jeunes filles et jeunes garçons » 16. La question de la violence symbolique est ici en jeu, comme l’a rappelé Laure Murat 17. Vous semblez préconiser des réflexions autour de normes éthiques liées aux professions artistiques, voire de principes déontologiques, dans une forme de désacralisation de l’auteur, ou de l’artiste, dans notre société. Quelle forme de telles réflexions pourraient-elles prendre ? Les champs littéraire, cinématographique, artistique, y sont-ils prêts ?
Dans les arts collectifs, comme dans la mode, où les corps sont en jeu et où les très jeunes filles, qu’elles soient mineures ou non, étaient traitées comme du bétail à usage des puissants – les affaires qui sortent en ce moment le révèlent au grand jour -, lesquels exploitaient leurs rêves de carrière, avec l’assentiment de l’entourage et de la société toute entière qui éduque les femmes à se soumettre aux désirs masculins, il me semble qu’une réflexion collective est nécessaire pour conscientiser ces abus d’autorité et formes d’exploitation et mettre en place des mécanismes de vigilance collective. Dans des milieux aussi structurés par la concentration de pouvoir et la relation de pouvoir, où les carrières sont fortement dépendantes des relations interpersonnelles, seules des règles déontologiques peuvent contrer ces abus. La Société des réalisateurs de films a commencé à en mettre en place. Malheureusement, ce qu’on voit, c’est que les sanctions en France sont moins fonction de la faute commise que de la notoriété : les moins connus sont les plus sanctionnés. Mais on peut tout de même espérer que cela ait un effet dissuasif.
L’existence de ces règles dans les arts collectifs peut avoir des répercussions dans les arts individuels comme la littérature ou les arts plastiques, où les cas comme Matzneff (et on attend le jugement de l’affaire Claude Levesque) ne relèvent pas de pratiques instituées, même si le milieu peut en être complice.
Est-ce que vous pouvez revenir sur la notion « d’inconscient épistémique » ? Sans revenir sur la polémique autour d’Heidegger qui n’en finit pas, est-ce qu’on peut souscrire totalement à la position d’Emmanuel Faye qui invite dans son livre à déclassifier son œuvre du canon philosophique pour la ranger aux rayons des archives du nazisme ? Si un auteur comme Jean-Luc Nancy a pu se servir des écrits d’Heidegger, c’est bien qu’on peut l’utiliser autrement. De même, toutes les études d’histoire de la réception se réclament des travaux d’Hans Robert Jauss (dont vous évoquez le passé trouble dans votre livre) sans que cela pose particulièrement de problème. Qu’en pensez-vous ?
Je trouve très intéressante l’analyse d’Ottmar Ette 18 (même si je n’ai pas fait moi-même l’enquête et que je ne fais que montrer les types d’analyse possibles), qui détecte dans la stratégie de Jauss, à la fois sa stratégie rhétorique et sa stratégie de construction d’école, des traces de son habitus d’ancien officier nazi et de son rapport à son passé. Pour moi, cela ouvre des portes très intéressantes à l’herméneutique. Je peux donner un autre exemple développé par Jeffrey Mehlman 19, lorsqu’il analyse le poème de Paul Valéry, Le Cimetière marin, et qu’il rappelle que Paul Valéry a disséqué des crânes dans le cadre de sa formation à la craniométrie auprès de Vacher de Lapouge. Il s’agit d’un éclairage externe à l’œuvre qui est très révélateur. Il le lit à la lumière de l’article célèbre de Valéry, « La Crise de l’esprit » (1919), et de sa conception de la supériorité occidentale. Là on touche vraiment à l’inconscient épistémique. Concernant Heidegger, je souscris à l’analyse de Bourdieu 20, qui résiste toujours aujourd’hui même après la publication des Cahiers noirs dont il n’avait pas connaissance. Lorsqu’on relit son Ontologie politique, tout y est : il parle de la double lecture et du fait que les mots d’ordre de la révolution conservatrice allemande – je dirais les « opérateurs axiologiques » -, y compris l’antisémitisme, sont reconnaissables dans l’œuvre de Heidegger, tout en étant métamorphosés par les concepts philosophiques. C’est ce qu’il appelle un effet de champ. Et c’est pour cette raison qu’on ne peut pas non plus complètement exclure Heidegger du canon : certes l’idéologie est là, mais en même temps, sa philosophie ne s’y réduit pas. Pour comprendre comment l’œuvre de Heidegger est possible et pourquoi elle reçoit une telle consécration, il faut l’étudier, mais pas seulement sur le plan philosophique. Je pense néanmoins qu’il faut réévaluer sa place : en France, on lui donne énormément d’importance. Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas s’approprier ses idées autrement. Il y a bien des penseurs de gauche qui utilisent Carl Schmitt et il y a une gauche américaine qui a utilisé Heidegger. Mais je pense que ce travail d’anamnèse est indispensable.
Sources
- A. Y. Kaplan, Relevé des sources et citations dans « Bagatelles pour un massacre », Tusson, Du Lérot, 1987.
- Jean-Yves Mollier, Une autre histoire de l’édition française, Paris, La Fabrique, 2015.
- Jacques Rancière, « Sept règles pour aider à la diffusion des idées racistes en France », Le Monde, 21 mars 1997.
- Emmanuel Bouju, « Exercice des mémoires possibles et littérature” à-présent”. La transcription de l’histoire dans le roman contemporain », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 2010/2 (65e année). pp. 417 à 438.
- Florent Brayard, « Littell, pas si “bienveillant” », Libération, 1er novembre 2006.
- Eric Fassin, « Political correctness en version originale et en version française. Un malentendu révélateur », Vingtième Siècle, revue d’histoire, n°43, juillet-septembre 1994.
- Steven Kaplan, « Si Frédérique Vidal repère des sorcières, il faut évidemment qu’elle les chasse », Le Monde, 2 mars 2021.
- Cf par exemple l’essai de Titiou Lecoq, Les Grandes Oubliées – Pourquoi l’Histoire a effacé les femmes, Éditions de l’Iconoclaste, 2021, préface de Michelle Perrot.
- Jennifer Milligan, The Forgotten Generation : French Women Writers of the Interwar Period, New York-Oxford, Berg Publishers, 1996.
- Collectif, « Nous, militantes féministes et juives, accusons aussi Polanski », Mediapart, 12 mars 2020.
- Dominick LaCapra, “Madame Bovary” on Trial, Ithaca, Cornell University Press, 1982.
- Gisèle Sapiro, La responsabilité de l’écrivain. Littérature, droit et morale en France (XIXe-XXIe siècle), Paris, Seuil, 2011.
- Gisèle Sapiro, La Guerre des écrivains, 1940-1953, Paris, Fayard, 1999.
- Anne-Marie Thiesse, La Fabrique de l’écrivain national. Entre littérature et politique, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque des histoires », 2019.
- Voir par exemple l’étude récente de Laurent Joly, Naissance de l’Action française : Maurice Barrès, Charles Maurras et l’extrême droite nationaliste au tournant du xxe siècle, Paris, Grasset, 2015.
- Vanessa Springora, « Par son statut d’écrivain, Gabriel Matzneff redoublait son entreprise de prédation par une exploitation littéraire », France Culture, 3 janvier 2020.
- Laure Murat, « Affaire Matzneff : ‘Je propose le procès de la complicité de l’intelligentsia’ », Le Monde, 8 janvier 2020.
- Ottmar Ette, L’Affaire Jauss : Les chemins de la compréhension. Vers un avenir de la philologie [2016], trad. fr., Presse de l’Université de Rouen et du Havre, 2019.
- Jeffrey Mehlman, « Paul Valéry, entre craniométrie et critique », in Eveline Pinto (Éd.), L’écrivain, le savant et le philosophe. La littérature entre philosophie et sciences sociales, Paris, Publications de la Sorbonne, 2003.
- Pierre Bourdieu, L’ontologie politique de Martin Heidegger, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. « Le sens commun », 1988.

