Les deux géopolitiques de l’énergie, une conversation avec Helen Thompson
« Nous allons vivre dans un monde caractérisé par une géopolitique complexe des énergies vertes, conjuguée à une géopolitique très chaotique liée aux énergies fossiles traditionnelles. Ces deux dynamiques coexisteront. » Après l'invasion de l'Ukraine, Helen Thompson revient sur les lignes de fracture qui marquent cet âge du désordre.
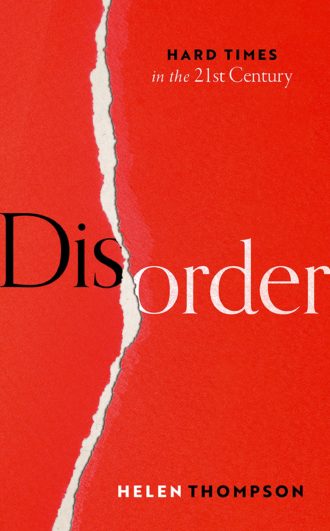
Helen Thompson est professeure d’économie politique au sein du département de sciences politiques et d’études internationales de l’université de Cambridge. Elle signe une chronique bimensuelle dans le New Statesman et a été une collaboratrice régulière du podcast Talking Politics. Nous l’avons rencontré à l’occasion de la publication de son dernier ouvrage, Disorder : Hard Times in the 21st Century, publié par Oxford University Press.
L’objectif de votre livre consiste à démontrer comment les dysfonctionnements actuels – tant au niveau de la politique intérieure des démocraties occidentales que de la politique internationale – trouvent leur origine dans un ensemble de chocs structurels dont les effets se sont propagés entre les sphères géopolitiques, économiques et politiques. Parmi les différents ressorts de ces ruptures, vous estimez que la géopolitique de l’énergie est un facteur déterminant. Pouvez-vous revenir sur l’histoire de cette géopolitique au XXe et début du XXIe siècle ?
Le point de départ de la géopolitique énergétique contemporaine, et par voie de conséquence de mon livre, se situe au début du XXe siècle, lorsqu’il est devenu évident pour les principales puissances européennes qu’un « âge du pétrole » était sur le point de commencer. Très rapidement, les gouvernements européens ont réalisé que ce monde serait assez dangereux en l’absence de réserves de pétrole sur leur sol, au contraire notamment des États-Unis ou de la Russie. Au cours de la Première Guerre mondiale, il est apparu clairement que la puissance militaire au XXe siècle reposerait sur le pétrole en tant que source d’énergie. À ce titre, la contribution la plus importante des États-Unis à la guerre ne concernait pas nécessairement l’engagement de troupes, mais leur capacité à approvisionner la Grande-Bretagne et la France en pétrole, alors que l’Allemagne et ses alliés ne parvenaient pas à s’en procurer.
Après la Première Guerre mondiale, tous les pays européens ont délibérément cherché à s’affranchir de ce qui était devenu une dépendance à l’égard du pétrole importé de l’hémisphère ouest, en particulier des États-Unis. Par conséquent, à la fin de la guerre, les États-Unis se sont paradoxalement retrouvés dans une situation difficile, car leur approvisionnement en pétrole commençait à être limité par leur capacité de production, tandis que la Grande-Bretagne et la France s’étaient établies au Moyen-Orient, la région du monde où se trouvent les plus grandes réserves de pétrole.
Cette situation est à l’origine d’une série complexe de dynamiques géopolitiques qui expliquent une grande partie de la politique européenne de l’entre-deux-guerres, notamment la manière dont les nazis ont réagi au problème de l’exclusion allemande du Moyen-Orient et aux conséquences de l’absence de pétrole sur le territoire national. Dans mon livre, je décris l’émergence, dès la fin des années 1920, d’une dépendance énergétique des pays d’Europe occidentale à l’égard du pétrole soviétique. Pendant la guerre froide, même si cette dépendance était devenue un sujet tabou, les États-Unis n’étaient pas disposés à ce que les pays d’Europe occidentale recommencent à importer du pétrole de l’hémisphère ouest, car les Américains étaient eux-mêmes très préoccupés par la pérennité de leur approvisionnement intérieur. En conséquence, les pays européens n’avaient pas d’autre choix que de concentrer leurs efforts d’approvisionnement sur le Moyen-Orient, ce qui représentait un véritable problème en raison du risque d’instabilité géopolitique dans la région.
La crise de Suez ainsi que les années 1970 ont également marqué des tournants dans la géopolitique mondiale de l’énergie…
Comme je l’explique dans le livre, la crise de Suez a été un moment géopolitique déterminant pour la structuration de la sécurité énergétique d’après-guerre en Europe occidentale. Les actions menées par les Britanniques, les Français et les Israéliens pour garantir cette sécurité ont rendu Eisenhower furieux, car il ne voulait pas donner l’impression que les États-Unis s’opposaient au nationalisme arabe en soutenant les puissances impériales européennes. C’est dans ce contexte que la relation énergétique entre l’Europe de l’Ouest et l’Union soviétique trouve son origine, cette relation étant basée d’abord sur le pétrole dans les années 1950 et 1960, puis le gaz dans les années 1970.
Les années 1970 sont effectivement particulièrement importantes pour comprendre pourquoi l’Occident se trouve dans la position qui est la sienne aujourd’hui. En 1970, la production intérieure américaine de pétrole a atteint un pic qui perdurera jusqu’au boom du schiste des années 2010. Par conséquent, à partir de 1970, les États-Unis sont devenus le plus grand importateur de pétrole au monde, accroissant significativement leur dépendance à l’égard des importations de pétrole du Moyen-Orient. Pour autant, les Américains n’étaient pas en mesure de succéder à la position dominante des Britanniques dans la région, parce qu’un engagement militaire au Moyen-Orient était inconcevable après la guerre du Vietnam, mais aussi parce que le nationalisme énergétique se développait dans bon nombre de pays producteurs de pétrole, en partie sous l’effet de la décolonisation. À la fin de 1973, l’Arabie saoudite avait clairement fait savoir qu’elle était prête à utiliser le pétrole comme une arme géopolitique. En Iran, la révolution de 1979 a débouché sur des relations hostiles avec Washington. Les États-Unis se sont donc mis dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une partie du monde dans laquelle il leur était incroyablement difficile d’exercer une influence durable pour façonner la répartition du pouvoir. La manière dont les Américains ont essayé de gérer ce problème traverse la géopolitique des années 1970 jusqu’aux années 2010.
Les États-Unis se sont mis dans une situation de dépendance vis-à-vis d’une partie du monde dans laquelle il leur était incroyablement difficile d’exercer une influence durable pour façonner la répartition du pouvoir. La manière dont les Américains ont essayé de gérer ce problème traverse la géopolitique des années 1970 jusqu’aux années 2010.
Helen Thompson
Cependant, lorsque les États-Unis sont redevenus un important producteur de pétrole et de gaz grâce au boom du schiste, cela s’est avéré tout aussi déstabilisant pour le Moyen-Orient que lorsque les États-Unis avaient tenté d’utiliser la puissance militaire pour stabiliser la région entre la première et la deuxième guerre d’Irak. En un sens, il y a donc une trame historique structurante autour du positionnement des États-Unis au Moyen-Orient. Les difficultés permanentes liées à ce positionnement constituent un nœud central de tensions qui façonnent les dynamiques géopolitiques actuelles.
Dans quelle mesure estimez-vous que les intérêts énergétiques expliquent les lignes de fracture internes à l’Union européenne et permettent de mieux comprendre la situation actuelle ?
L’énergie est une ligne de fracture fondamentale au sein de l’Union. Si l’on considère les années 1990 et le début des années 2000, les pays de l’Union ont adopté des attitudes très différentes quant à leur volonté de s’affranchir de la dépendance gazière vis-à-vis de la Russie. L’Allemagne, en particulier, n’a jamais adhéré à l’idée que l’Europe devait s’affranchir du gaz russe car, depuis 1970, les gouvernements allemands ont fait de la relation gazière avec l’Union soviétique – puis avec la Russie – la pierre angulaire à bien des égards de l’Ostpolitik. D’autres pays européens ont cherché plus activement des alternatives. Toutefois, le véritable point de tension à ce sujet au sein de l’Europe a été provoqué par le boom du gaz de schiste aux États-Unis dans les années 2010. En effet, le développement par les États-Unis d’une importante capacité d’exportation de gaz naturel liquide à travers les océans leur a permis de se positionner comme un nouveau concurrent de la Russie sur le marché européen du gaz.
Certains pays de l’Union, la Pologne en tête, ont tenu à saisir cette opportunité non seulement car ils voyaient d’un mauvais œil la dépendance globale de l’Union vis-à-vis de la Russie, mais également parce qu’ils étaient très inquiets face aux tentatives de Poutine de contourner l’Ukraine pour faire transiter le gaz russe vers l’Europe. Cela fut particulièrement le cas lors de l’approbation par le gouvernement allemand en 2005 de Nord Stream I qui passe sous la mer Baltique. Cette situation a été exacerbée par une contradiction malheureuse : alors que la Commission n’a pas été très sévère au sujet de Nord Stream, elle l’a été beaucoup plus à propos du gazoduc South Stream qui devait passer sous la mer Noire, de la Russie à la Bulgarie, et qui a été stoppé par une action combinée des autorités européennes et américaines. Ce contexte a donc donné l’impression d’un traitement inéquitable : la dépendance aux pipelines qui contournent l’Ukraine ne semblait pas poser de problème pour approvisionner l’Allemagne, mais était inacceptable pour les États membres du sud de l’Europe.
En ce qui concerne l’Ukraine à proprement parler, je crois évidemment que la ligne de fracture est en grande partie énergétique. Il est vraiment important de comprendre que la dissolution de l’Union soviétique en 1991 a eu de profondes répercussions sur la nature de la dépendance énergétique de l’Union vis-à-vis de la Russie. Les pipelines qui partaient de l’Union soviétique vers la Pologne sont devenus des pipelines entre la Russie et les pays indépendants que sont l’Ukraine et le Belarus. Du point de vue des Russes, cela est apparu comme une vulnérabilité majeure, qui les a mis dans une position défavorable. Même avant l’arrivée au pouvoir de Poutine fin 1999, le gouvernement russe n’était pas à l’aise avec cette dépendance du transit en Ukraine et cherchait des alternatives, initialement sous la mer Noire plutôt que sous la mer Baltique.
Quelle est votre lecture des lignes de fracture qui traversent l’OTAN et l’Union en parallèle ?
Pour ce qui est des lignes de fracture entre l’Union européenne et l’OTAN sur la question de l’Ukraine, le fond du problème réside dans la dépendance de l’Union vis-à-vis de l’OTAN pour garantir sa sécurité. À cet égard, je ne pense pas du tout que ce soit une coïncidence si les pays d’Europe de l’Est ont rejoint l’OTAN plusieurs années avant leur adhésion à l’Union – comme la Pologne, la Hongrie, la République tchèque ou la Slovaquie – ou la même année – comme les républiques baltes en 2004. À l’inverse, ce que l’Union a ensuite tenté de faire avec l’Ukraine – et qui a été un prélude à la crise de 2014 avec l’annexion de la Crimée – c’est d’obtenir une sorte d’adhésion par association alors que non seulement l’Ukraine ne faisait pas partie de l’OTAN, mais que les gouvernements allemand et français avaient en fait opposé leur veto à son adhésion en 2008 et, dans le cas de l’Allemagne, affaibli sa position économique en acceptant Nord Stream. L’idée que l’Ukraine puisse conclure un accord d’adhésion par association en préservant son intégrité territoriale, alors qu’elle était en crise financière et dépourvue d’une perspective claire d’adhésion à l’OTAN, était une approche très incohérente et préjudiciable.
L’idée que l’Ukraine puisse conclure un accord d’adhésion par association en préservant son intégrité territoriale, alors qu’elle était en crise financière et dépourvue d’une perspective claire d’adhésion à l’OTAN, était une approche très incohérente et préjudiciable.
Helen Thompson
Je pense que le défi de demain portera sur la Turquie, notamment car il y a de nombreux parallèles structurels entre l’histoire de la Turquie et de l’Ukraine depuis la fin de la guerre froide. Les dynamiques spécifiques sont évidemment différentes, mais il s’agit de deux pays assez vastes, qui bordent l’Union et la Russie. Dans un sens, ils ont fait l’objet d’une lutte entre ces deux pôles de puissance en termes de relations économiques, et plus particulièrement de transit énergétique. Dans les années 2000 et 2010, il y a notamment eu une tentative, encouragée par les autorités d’Ankara, de considérer la Turquie comme un État de transit stratégique qui pourrait acheminer du gaz en Europe depuis l’Azerbaïdjan et le Moyen-Orient. Certains espéraient que cette approche permette de faire entrer la Turquie dans l’Union, mais les autorités européennes ont aussi rapidement réalisé qu’il y avait des difficultés logistiques et politiques majeures dans le fait d’encourager la Turquie à devenir un hub énergétique pour l’Europe.
Dans le livre, vous consacrez une large section à la Chine et à sa réorientation stratégique de long terme du Pacifique vers l’Eurasie. Pouvez-vous décrire les circonstances et les conséquences de ce glissement géopolitique ?
Pour comprendre ce basculement, il faut revenir au début des années 2000 et à la guerre d’Irak en particulier. Dès 1993, la Chine ne peut plus compter exclusivement sur sa production nationale de pétrole et devient un pays importateur. Dès lors, les dirigeants chinois ont compris de manière assez nette que cela posait quelques problèmes, car ils devaient désormais importer du pétrole du Moyen-Orient et d’Afrique. Cette dépendance mettait la Chine, à long terme, à la merci de la puissance navale américaine. Cela a suscité une forte préoccupation à Pékin, l’invasion de l’Irak en 2003 ayant confirmé que les Américains étaient eux aussi très préoccupés par les problématiques de sécurité énergétique et d’approvisionnement en pétrole.
Dès 1993, la Chine ne peut plus compter exclusivement sur sa production nationale de pétrole et devient un pays importateur. Cette dépendance mettait la Chine, à long terme, à la merci de la puissance navale américaine.
Helen Thompson
À ce moment-là, les dirigeants chinois ont réalisé qu’ils étaient très vulnérables, car les Américains pouvaient couper l’approvisionnement pétrolier de la Chine en bloquant le détroit de Malacca. En mai 2003, le gouvernement chinois et Poutine ont conclu un accord sur la construction d’un oléoduc entre la Russie et la Chine, réduisant ainsi en principe le volume des importations de pétrole passant par Malacca.
Ce choix géopolitique a eu lieu 10 ans avant les nouvelles routes de la soie de Xi Jinping, mais je pense qu’il marque la prise de conscience par la Chine des risques liés au transit énergétique par voie maritime, dans un monde où les États-Unis restent la puissance navale dominante. Il ne fait aucun doute que lorsque Xi Jinping opère son basculement en 2013, il est en partie motivé par la nécessité de se doter le plus rapidement possible d’une sortie directe du golfe Persique, par voie terrestre, afin de ne pas être non plus dépendant de la Russie. Il s’est ainsi tourné vers Gwadar, sur la côte pakistanaise, juste en dessous du golfe Persique, avec l’idée de construire un oléoduc à travers le Pakistan qui amènerait le pétrole vers la province du Xinjiang. Cela explique également pourquoi Xi Jinping considère toute résistance à la domination chinoise dans cette province comme une menace majeure pour la sécurité de la Chine. La géographie joue ici un rôle fondamental.
Comment ce tournant eurasiatique de la Chine a-t-il été une source de perturbations géopolitiques et économiques majeures pour l’Union européenne ?
Ce que nous observons – et qui est antérieur à l’arrivée au pouvoir de Xi – c’est un tournant chinois vers l’Europe en termes de marchés d’exportation et d’investissements étrangers après la crise financière de 2008 et jusqu’au milieu des années 2010. La Chine connaît ensuite également une crise financière en 2015, en grande partie provoquée par les mesures de la Réserve fédérale américaine, visant à restaurer une certaine normalité monétaire en augmentant les taux d’intérêt. Cette crise, assez grave du point de vue de la Chine, conduit la banque centrale chinoise à imposer davantage de contrôles des capitaux, ce qui engendre un repli de l’investissement dans l’Union européenne. Cela est toutefois nettement moins le cas dans les pays d’Europe de l’Est et du Sud que dans les pays d’Europe de l’Ouest. En conséquence, il est apparu en 2016 que la relation avec la Chine était en train de fractionner l’Union européenne. En plus de cela, l’Allemagne avait développé une relation économique particulière avec la Chine à partir des années 2000 grâce à sa capacité d’exportation unique en Europe. Il y avait donc déjà une ligne de fracture chinoise dans l’Union, qui était liée à la singularité de l’économie allemande, à laquelle se sont ajoutées des divisions autour des pays dans lesquels les Chinois continuaient à investir après 2016.
La première ligne de fracture chinoise dans l’Union était liée à la singularité de l’économie allemande, à laquelle se sont ajoutées des divisions autour des pays dans lesquels les Chinois continuaient à investir après 2016.
Helen Thompson
Devant cette situation, Angela Merkel et Emmanuel Macron étaient assez mécontents de la tournure que prenaient les relations entre l’Union et la Chine, et de la capacité des autorités chinoises à diviser l’Europe. Cette tension a vraiment atteint son paroxysme au début de l’année 2019, lorsque l’Italie a décidé de rejoindre les nouvelles routes de la soie. En conséquence, Merkel et Macron se sont fortement impliqués pour faire aboutir l’accord global sur l’investissement. Dans la mesure où cet accord s’est concrétisé en décembre 2020, dans l’intermède entre l’élection présidentielle américaine et l’investiture de Joe Biden en tant que nouveau président, il me semble qu’il s’agissait d’une véritable déclaration d’autonomie stratégique, indiquant que l’Union ne saurait être contrainte par l’état des relations entre les États-Unis et la Chine.
Bien qu’il soit assez difficile pour l’Union d’adopter une position unifiée sur la Chine, et même si l’accord n’a pas été ratifié en raison des agissements subséquents de la Chine, nous avons clairement vu, à l’aune de cette séquence, la manière dont l’aspiration à l’autonomie stratégique européenne, généralement formulée par les Français en matière de défense, s’est conjuguée à l’idée allemande d’autonomie stratégique économique. En ce sens, Emmanuel Macron et Angela Merkel ont fini sur la même longueur d’onde, même s’ils ne partageaient pas la même perspective de départ. Il s’agit d’une évolution importante du positionnement des pays européens dans le contexte de la rivalité sino-américaine.
Dans le même temps, il faut reconnaître qu’il est difficile pour les Américains de pousser les pays de l’Union, et notamment l’Allemagne, à trancher entre leurs intérêts stratégiques vis-à-vis de la Russie et de la Chine. Je pense que si l’administration Biden était prête à lever les sanctions américaines sur Nord Stream 2 en mai 2021, c’est parce que les collaborateurs de Biden estimaient que cette concession pourrait, en retour, convaincre les autorités allemandes de s’aligner davantage sur la position de Washington vis-à-vis de la Chine. Or, les événements ont donné tort à cette stratégie et les concessions ont été exploitées par Poutine pour affaiblir la position de l’Ukraine. Cet épisode montre bien à quel point l’enchevêtrement entre la question chinoise et la question russe ne rend pas seulement les choses difficiles pour l’Union, mais aussi pour les Américains.
Quelles sont les dynamiques énergétiques structurantes que vous anticipez pour l’avenir ? Dans le livre, vous parlez notamment de la coexistence entre une géopolitique « traditionnelle » du pétrole et du gaz et les nouvelles formes de rivalité, autour de la production dans les secteurs des énergies renouvelables par exemple.
Je crois qu’il est foncièrement naïf de penser que la transition vers l’énergie verte pourrait soustraire la géopolitique des questions énergétiques. Il me semble pourtant que cette idée est porteuse de beaucoup d’espoir rhétorique car les gouvernements européens, depuis plus d’un siècle, ont été constamment confrontés à des problèmes de dépendance énergétique vis-à-vis de l’étranger et ont compris que la gestion de ces problèmes avait des conséquences destructrices, voire catastrophiques. L’idée selon laquelle l’énergie verte est un moyen d’échapper à cette situation est évidemment séduisante, car dès lors que l’on ne doit compter que sur le vent qui souffle et le soleil qui brille dans son propre pays, il n’est pas nécessaire de partir à la recherche de pétrole et de gaz dans le monde entier et de se confronter aux tensions géopolitiques liées à leur découverte et à leur exploitation.
Je crois qu’il est foncièrement naïf de penser que la transition vers l’énergie verte pourrait soustraire la géopolitique des questions énergétiques.
Helen Thompson
Toutefois, abstraction faite des problèmes d’intermittence liée à la conversion du soleil et du vent en énergie, toute la question des infrastructures nécessaires pour capter ces sources d’énergie tourne autour de la rareté des terres et minéraux précieux. Il se trouve que cette répartition éparse sur la planète est favorable à la Chine, qui est également en position dominante dans les chaînes de production, d’extraction et d’approvisionnement de ces métaux. Cette situation fait de l’énergie verte une question éminemment géopolitique, en ce qui concerne la relation de l’Europe avec la Chine, mais aussi avec le reste du monde, et bien sûr dans le cadre de la rivalité géopolitique entre les États-Unis et la Chine.
Il faut ajouter à cela que le processus de transition énergétique ne se fera pas dans un délai court, notamment parce que les engagements en faveur du zéro émission reposent sur des technologies qui n’existent pas encore. Nous devons vivre dans le présent, ce qui signifie que la vieille géopolitique de l’énergie fossile va perdurer, et ce alors que les dynamiques qui la sous-tendent sont extrêmement dysfonctionnelles et que les contraintes liées à l’offre sont importantes, notamment pour le pétrole. Le boom du schiste a permis en partie de gérer ces contraintes au cours des années 2010, mais la question se pose aujourd’hui de savoir si les producteurs américains pourront retrouver le même volume que celui atteint à la fin de l’année 2019. En effet, il est important de souligner que la production de pétrole de schiste avait connu son pic juste avant l’arrivée de la pandémie, et non à cause de celle-ci. Nous allons donc vivre dans un monde caractérisé par une géopolitique complexe des énergies vertes, conjuguée à une géopolitique très chaotique liée aux énergies fossiles traditionnelles. Ces deux dynamiques coexisteront.
Nous allons donc vivre dans un monde caractérisé par une géopolitique complexe des énergies vertes, conjuguée à une géopolitique très chaotique liée aux énergies fossiles traditionnelles. Ces deux dynamiques coexisteront.
Helen Thompson
Comment les dynamiques énergétiques et économiques des cinquante dernières années s’entrelacent-elles dans l’histoire des lignes de fracture géopolitiques ? Vous soutenez dans votre livre que le crash financier de 2008 est également un crash pétrolier. Pouvez-vous nous en dire plus et nous expliquer en quoi l’année 2005 a été déterminante à ce sujet ?
Je pense qu’il y a deux façons de comprendre l’interaction entre l’histoire du pétrole et le crash financier de 2008. La première, et d’une certaine manière la plus simple, consiste à rappeler que trois mois avant la faillite de Lehman Brothers, qui est souvent considérée comme l’épicentre du krach financier, le pétrole a atteint 150 dollars le baril, soit le prix le plus élevé jamais atteint en termes absolus et ajustés à l’inflation. Les prix du pétrole se sont effondrés par la suite. Lorsque l’on étudie l’état des économies occidentales à ce moment-là, en juin 2008, on constate que l’économie américaine était en récession depuis le dernier trimestre de 2007 ; les économies de la zone euro et du Royaume-Uni étaient en récession parce qu’elles ne pouvaient pas soutenir des prix du pétrole aussi élevés. Ce constat n’est pas du tout surprenant, car toutes les grandes récessions des économies occidentales depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale ont eu comme préalable des prix du pétrole élevés. Il existe donc une relation assez directe entre les moments où le pétrole devient excessivement cher, détruisant la demande, et les périodes de récession. Le fait que la crise financière soit survenue sous une forme telle que nous l’avons connue en septembre 2008 a faussé la compréhension de l’imbrication entre les crises énergétique et économique, non pas parce que la crise financière n’était pas importante, mais parce que les gens n’ont pas vu qu’une autre crise était également en cours.
Ensuite, lorsque l’on cherche à savoir pourquoi les prix du pétrole ont atteint le niveau de 2008, on observe que 2005 a été une année très importante, car c’est l’année durant laquelle la production de pétrole a connu une stagnation. Les raisons de cette stagnation sont multiples, qu’il s’agisse des retombées de la guerre d’Irak, des troubles intérieurs au Venezuela et au Nigeria ou du fait que le régime iranien était sous le coup de sanctions. Tout bien considéré, il apparaît que seule la Russie était en mesure d’augmenter sensiblement sa production à un moment où la demande asiatique en général, et chinoise en particulier, augmentait considérablement. Nous avons donc atteint un point où la demande de pétrole subissait un choc chinois, mais où la production était insuffisante. Sans surprise, cette situation a fait rapidement augmenter les prix. D’une certaine manière, le point de jonction direct entre ces deux situations se situe au moment où le prix du pétrole a augmenté de manière significative en 2004, au point d’inquiéter la Réserve fédérale et d’autres banques centrales. La Réserve fédérale a commencé à relever les taux d’intérêt en 2004, ce qui a eu des conséquences sur le marché immobilier américain, puis sur les marchés des titres adossés à des créances hypothécaires et, en bout de chaîne, sur les marchés du crédit bancaire, où les titres adossés à des créances hypothécaires étaient utilisés comme garantie. Ainsi, dans une certaine mesure, l’histoire du marché pétrolier et celle de la crise financière ont des causes interconnectées.
De manière tout aussi significative, les banquiers centraux commençaient à s’inquiéter en 2005 du fait que les économies occidentales étaient susceptibles d’entrer dans une période de stagflation comme dans les années 1970. Les niveaux d’inflation n’étaient pas aussi élevés en raison des effets de l’intégration de la Chine dans l’économie mondiale, notamment la baisse des prix dans certains secteurs manufacturiers, qui a agi comme une force anti-inflationniste. Toutefois, je pense qu’il y a eu une prise de conscience considérable en 2005 et au cours des années suivantes qu’un choc énergétique était en cours. Ce choc n’a été pris en compte qu’après 2008 avec le boom du schiste qui a permis de constituer une nouvelle source d’approvisionnement considérable. Même là, entre 2011 et 2014 dans les premières années du boom du schiste, les prix sont restés très élevés, et c’est à cette époque que la BCE a réagi à ce qu’elle pensait être une pression inflationniste en augmentant les taux d’intérêt pour la zone euro à deux reprises en 2011. Cela a eu un impact assez important sur un certain nombre d’économies de la zone euro, qui sont entrées en récession. L’ampleur de cette récession a varié d’un pays à l’autre, mais force est de constater que les perspectives macroéconomiques et la situation pétrolière caractéristiques de cette époque ont interagi de façon délétère.
Que la crise financière soit survenue sous une forme telle que nous l’avons connue en septembre 2008 a faussé la compréhension de l’imbrication entre les crises énergétique et économique, non pas parce que la crise financière n’était pas importante, mais parce que les gens n’ont pas vu qu’une autre crise était également en cours.
Helen Thompson
L’ensemble du positionnement géoéconomique de la Chine semble avoir été fortement impacté par ce contexte. Comment a-t-il influencé la relation économique sino-américaine et son évolution au cours des dernières décennies ?
Une des principales leçons que la Chine a tirées de tout ce qui s’est passé en 2008, notamment la perte de confiance de la banque centrale chinoise dans l’achat de la dette des deux grandes sociétés hypothécaires américaines Fannie Mae et Freddie Mac, est que la Chine est confrontée à un problème de dollar. Face à ce problème, le gouvernement a tenté de faire de la monnaie chinoise, le renminbi, une monnaie internationale. Une des motivations à moyen et long terme était de tendre vers un monde où la Chine n’aurait plus besoin d’acheter du pétrole et du gaz en dollars, y compris à la Russie, mais dans sa propre monnaie. Je dirais que la Chine est modestement parvenue à internationaliser le renminbi pendant un certain temps, jusqu’à ce qu’elle soit obligée de renforcer les contrôles des capitaux pendant la crise financière de 2015-2016. L’idée que les étrangers utilisent le renminbi comme monnaie pour apprendre ensuite que le gouvernement chinois peut les empêcher de le convertir en monnaie étrangère a considérablement limité la viabilité de la stratégie.
Ainsi, les tentatives de la Chine pour échapper à la dollarisation n’ont pas été très efficaces. Je dirais même que la plus grande intégration des banques et des grandes entreprises chinoises aux marchés du crédit en dollars après le krach a rendu la Chine plus vulnérable qu’auparavant face aux États-Unis sur le plan monétaire et financier. Au milieu des années 2000, les États-Unis étaient potentiellement plus vulnérables vis-à-vis de la Chine sur le plan monétaire que l’inverse, car les taux d’intérêt américains auraient augmenté si les Chinois avaient cessé d’acheter de la dette américaine. Mais après 2008, les Américains n’avaient plus autant besoin des Chinois comme créancier structurel, puisque la Réserve fédérale était en mesure de répondre aux besoins d’emprunt du gouvernement grâce à l’assouplissement quantitatif. La Chine n’a pas cessé d’être un créancier américain, mais les programmes d’assouplissement quantitatif ont changé la donne. Dans le même temps, les décisions du Board de la Réserve fédérale ont eu une incidence plus importante sur l’économie chinoise qu’avant 2008, comme en témoigne la crise financière chinoise de 2015-16.
S’il est frappant de constater que la première réponse économique de la Chine après le crash de 2008 se situe du côté financier, en essayant d’échapper au piège du dollar, l’approche chinoise à partir de 2015 est devenue plus axée sur sa transformation en super puissance manufacturière de haute technologie, avec comme ambition d’être dominante dans le domaine de l’énergie verte, des véhicules électriques, etc. Je ne suis pas sûre de la façon dont cela se déroule séquentiellement dans l’esprit de Xi Jinping, mais la Chine est passée de la nécessité de réduire sa dépendance financière à la volonté de dominer l’industrie manufacturière et les chaînes d’approvisionnement qui l’entourent.
Une partie du revirement chinois est ancrée dans sa volonté de réduire la vulnérabilité du pays vis-à-vis des marchés américains après 2008, ce qui signifie également que la Chine doit être un peu plus dépendante du marché européen et des investissements dans l’Union européenne, comme nous l’avons évoqué plus haut. Je pense qu’il est révélateur de constater que la Chine freine ses investissements en Europe en 2016 parce qu’elle ne parvient pas à échapper au problème de la dépendance au dollar. Il s’agit d’un paramètre essentiel pour comprendre les difficultés de la Chine. À cet égard, l’économie mondiale dans les années 2010 est façonnée par la force de la Chine, bien sûr, mais aussi par ses faiblesses, qui sont principalement d’ordre financier et monétaire.
L’économie mondiale dans les années 2010 est façonnée par la force de la Chine, bien sûr, mais aussi par ses faiblesses, qui sont principalement d’ordre financier et monétaire.
Helen Thompson
Au regard du contexte actuel ainsi que de l’ensemble des éléments abordés dans le cadre de cet entretien, quelles sont les lignes de crête auxquelles vous prêteriez une attention particulière dans les mois et années à venir ?
Je pense qu’une grande partie des sujets que nous venons d’évoquer se cristallisent aujourd’hui en Ukraine, en particulier parce qu’il est évident que cette guerre a des conséquences énergétiques et économiques très graves. Cela se traduit non seulement par une augmentation des prix de l’énergie, mais aussi des prix des denrées alimentaires. À cet égard, les deux endroits qui pourraient être particulièrement déstabilisés au cours des prochaines semaines sont l’Irak et le Liban. L’instabilité de ces pays était déjà évidente en 2019, et dans la mesure où les prix élevés du pétrole et des denrées alimentaires ont constitué le facteur économique déterminant du printemps arabe en 2011, je pense qu’il faut s’attendre à d’importantes turbulences dans ces deux pays au cours des prochains mois.
Dans les prochaines années, je serais très attentive à ce qui se passe en Turquie et en Méditerranée orientale sur le plan gazier, car la Méditerranée orientale devient une source majeure et évidente d’approvisionnement en gaz pour les pays européens, à mesure que la production y décolle. Cela soulève des questions complexes, car la Turquie est écartée de ce développement gazier, et le révisionnisme territorial projeté par Erdogan dans ses discours, par exemple à l’égard de Chypre ou de la Grèce, est très préoccupant. Erdogan donne l’impression, du moins sur le plan rhétorique, qu’il est tout aussi enclin à remettre en question les dispositions territoriales européennes issues des lendemains de la Première Guerre mondiale, que Poutine, qui remet en question les dispositions issues de la dissolution de l’Union soviétique à la fin de la guerre froide. La Turquie ne possède peut-être pas la puissance militaire de la Russie et son statut de membre de l’OTAN lui impose évidemment des limites, mais les difficultés énergétiques de la Turquie auront des conséquences importantes. Ces conséquences seront notamment susceptibles d’exercer une pression sur la relation franco-allemande.

