Qu’est-ce qu’être écrivain ? Une conversation avec Robert Darnton
Dans son dernier ouvrage chez Gallimard, l’historien des Lumières brise une idole : le métier d’écrivain.
Du XVIIIe siècle à aujourd'hui, entretien au long cours sur un mythe européen.
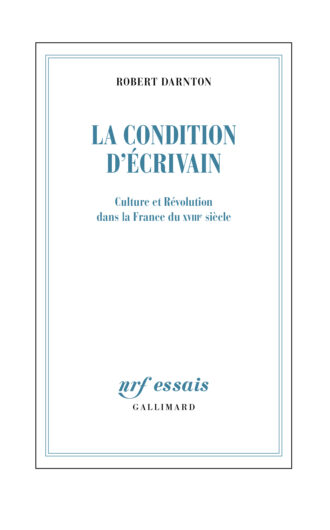
Votre modèle du « circuit de la communication » a permis de repenser l’histoire du livre comme une écologie d’acteurs et de supports. Avec le recul, quel aspect de ce schéma vous semble aujourd’hui devoir être révisé, à la lumière des recherches récentes sur la traduction, le piratage ou les réseaux informels de diffusion ?
C’est une très bonne question, d’autant plus que je reçois constamment des emails, des suggestions, parfois même des critiques à propos de ce modèle. J’ai donc le sentiment qu’il a trouvé sa place dans le champ, qu’il a circulé, été débattu, remis en cause — et c’est tant mieux.
À mes yeux, le principal angle mort du schéma, celui qu’il faut désormais intégrer de manière plus systématique, tient à l’absence d’une véritable dimension temporelle. Dans le modèle initial, je suivais le parcours d’un livre depuis la première ébauche de l’auteur, en passant par la soumission au libraire-éditeur, la composition typographique, l’approvisionnement en papier, le transport vers les librairies, et ainsi de suite — jusqu’à sa rencontre avec les lecteurs. Ce processus me semble toujours pertinent, mais il s’arrête à la première édition, comme si le livre cessait d’exister après cette phase de production et de mise en circulation initiale.
Or, les ouvrages connaissent souvent une vie postérieure : des rééditions, des traductions, des appropriations diverses. Ils entrent dans les bibliothèques, publiques ou privées, où d’autres usages, d’autres formes de réception s’élaborent. Toute une histoire du livre en bibliothèque reste à articuler avec celle de sa production. En ce sens, mon modèle néglige ce que je qualifierais de « vie après la première édition ».
Certaines études récentes ont, de manière très stimulante, suivi les métamorphoses d’un texte au fil du temps — comment un livre change lorsqu’il traverse les langues, les siècles, ou les régimes de censure. Je dirais que c’est là, sans doute, que se situe aujourd’hui le chantier le plus important : penser la durée, les reconfigurations, les usages différés et multiples d’un même objet textuel.
Auriez-vous quelques exemples marquants d’ouvrages dont la trajectoire a particulièrement duré ?
Le Livre du courtisan de Baldassare Castiglione en est un excellent exemple.
Peter Burke lui a consacré une étude remarquable, tout comme Roger Chartier. Ce qui est fascinant, c’est que ces travaux montrent bien combien le livre, à l’origine, se présente comme un manuel de savoir-vivre destiné à qui souhaite s’orienter dans la vie complexe d’une cour de la Renaissance. Mais ce cadre curial évolue : les cours changent, et le texte s’adapte. Lorsque l’on passe à des monarchies de plus grande envergure, comme celle de Versailles, la situation n’a plus rien à voir avec l’Italie du XVIᵉ siècle. Les éditions ultérieures du Livre du courtisan reflètent cette mutation : on y trouve des conseils pour se frayer un chemin dans les intrigues d’une cour désormais très différente. Au XVIIIᵉ siècle, le contexte est encore transformé, et la posture du courtisan évolue en conséquence.
Puis, lorsque l’ouvrage est traduit en anglais et circule au XIXᵉ siècle, il s’adresse à un tout autre public : celui des gentlemen britanniques. L’idée de l’aisance naturelle du gentleman fait son chemin : cette forme de détente maîtrisée, de décontraction apparente que décrit Castiglione, devient ainsi une norme de comportement dans la bonne société londonienne du XIXᵉ siècle.
Vous vous êtes très tôt tourné vers ce que l’on pourrait appeler les « bas-fonds » de la littérature, plutôt que vers les auteurs canoniques qui ont longtemps constitué la matière première de l’histoire littéraire. Qu’est-ce qui vous a attiré vers cette autre face de la production littéraire ?
C’est une question à laquelle il m’est difficile de répondre.
Un de mes livres préférés est Le Neveu de Rameau, qui traite précisément de cette zone trouble entre marginalité sociale et lucidité critique. C’est un texte qui m’émeut profondément, mais, au-delà de mes goûts littéraires, je crois que cette inclination trouve aussi racine dans mon expérience personnelle. Lorsque je travaillais comme journaliste à New York, j’ai côtoyé bon nombre d’écrivaillons (hack writers), souvent relégués dans ce que l’on appelait alors la Police shack, qui se trouvait en face du siège de la police new-yorkaise. Certains d’entre eux étaient des journalistes spécialisés, notamment sur la Mafia, pour des titres comme New York Magazine. J’ai toujours éprouvé de la sympathie pour ces figures de l’ombre et un vif intérêt pour le reportage de terrain, cette pratique du journalisme où l’on est directement en contact avec les réalités dont on parle. Cela m’a peut-être prédisposé à m’intéresser à la littérature dite « mineure » ou marginale.
Un autre tournant majeur a été mon immersion dans les papiers de la Société typographique de Neuchâtel, à l’occasion d’un projet de biographie sur Jacques-Pierre Brissot. Ils conservaient 119 lettres inédites de Brissot, et leur lecture m’a fait reconsidérer l’ensemble de sa trajectoire avant la Révolution française. Ce provincial, originaire de Chartres, fils d’un pâtissier, nourrissait de très hautes ambitions intellectuelles. Il aspirait à devenir philosophe, soumettait ses textes à l’Académie, faisait relier ses ouvrages pour les envoyer à Catherine II de Russie, sollicitait le patronage de Voltaire et des membres de l’Académie française… Mais chaque étape fut un échec. Ruiné, il se mit à rédiger des pamphlets, certains diffamatoires, ce qui attira l’attention de la police.
Les écrivains des bas-fonds littéraires — ces Rousseaux du ruisseau — étaient désespérément pauvres.
Robert Darnton
J’ai pu reconstituer cette trajectoire à travers des documents d’archives saisissants : un inspecteur de police lui conseilla un jour de disparaître quelque temps, faute de quoi il risquait une lettre de cachet. Il y eut donc des négociations, des compromis entre lui et les autorités, avant que, finalement, Brissot ne soit arrêté pour ses liens avec des libellistes opérant depuis Londres. J’ai retrouvé les transcriptions de ses interrogatoires à la Bastille, et il apparaît clairement qu’il était désespéré financièrement, qu’il multipliait les contacts douteux, et — c’est une hypothèse que j’ai explorée — qu’il aurait été libéré parce qu’il accepta de devenir informateur pour la police.
Le futur chef de file des Girondins avait donc d’abord été un écrivaillon. Et il n’était pas seul. J’ai dressé une longue liste de ces figures passées de l’écriture clandestine à la politique révolutionnaire : Fabre d’Églantine, Collot d’Herbois, Billaud-Varenne, Gorsas, Carra, Marat dans une certaine mesure, et bien sûr Hébert. Ce Grub Street français, ce monde des marges littéraires n’avait encore jamais été véritablement étudié — or, il a nourri l’imaginaire révolutionnaire.
En général, on insiste sur l’influence qu’aurait eue la philosophie des Lumières sur la Révolution, mais on a négligé le rôle de ces pamphlets diffamatoires, de cette littérature violente, personnelle, scandaleuse. Ce sont pourtant eux qui, dans bien des cas, ont contribué à délégitimer l’ordre existant plus puissamment que les traités abstraits.
En travaillant sur les archives de Neuchâtel, j’ai également découvert une catégorie particulière dans le commerce du livre : celle des livres philosophiques. Mais cette désignation ne recouvrait pas les œuvres de Voltaire ou de Rousseau. Il s’agissait de textes bien plus radicaux, parfois attribués à d’obscurs auteurs comme Helvétius, mais surtout de pamphlets politiques et de littérature érotique. Dans certains catalogues internes de libraires, on trouvait par exemple Thérèse philosophe — un roman pornographique, certes, mais qui comporte aussi des idées philosophiques — aux côtés du Système de la nature d’Holbach ou de la Vie privée de Louis XV. Ces ouvrages, bien plus subversifs, étaient traités à part, avec des circuits de diffusion discrets, parce qu’ils étaient perçus comme véritablement dangereux.
Ainsi, d’un côté, des écrivains marginaux ; de l’autre, une littérature illicite mais très demandée. À mes yeux, ces deux pôles se rejoignent en ce qu’ils ont constitué un ferment puissant de la Révolution française.
Vous avez montré, dans vos travaux, que nombre de pamphlets hostiles au pouvoir ne répondaient pas seulement à des convictions idéologiques, mais aussi — et peut-être surtout — à des impératifs économiques. Que nous dit cette précarité du travail littéraire au XVIIIᵉ siècle sur la porosité entre critique politique et opportunisme, à la veille de la Révolution française ?
Il y aurait énormément à dire. Bien sûr, certains pamphlets étaient bel et bien rédigés par des ennemis déclarés du gouvernement — dans les milieux parlementaires, par exemple. Mais j’ai la conviction que la majorité d’entre eux furent écrits dans un but avant tout lucratif. Ces écrivains des bas-fonds littéraires — ces Rousseaux du ruisseau — étaient désespérément pauvres. Et il existait une demande soutenue pour une littérature scandaleuse, sulfureuse et subversive.
Quand on lit certains de ces textes, on est frappé à la fois par leur qualité d’écriture et par leur pouvoir de sidération. Prenez par exemple les Anecdotes sur Madame la comtesse du Barry : c’est un texte très bien écrit, mais profondément choquant pour l’époque. L’idée que la maîtresse officielle du roi ait eu une carrière de prostituée, même de haut rang, heurtait profondément les représentations morales de la monarchie. Ce livre, qui selon mes recherches fut un véritable best-seller, regorgeait de détails scabreux sur la cour, les ministres proches de Madame du Barry — Choiseul, Maupeou, Terray — et alimentait autant le voyeurisme que l’indignation politique.
Un autre exemple, encore plus frappant, est la Vie privée de Louis XV. En quatre volumes, ce texte retrace de manière incroyablement précise et documentée l’histoire du règne, de 1715 à 1774. C’est un ouvrage à la fois scandaleux et sérieux. Il connut un succès considérable, fut rapidement traduit et très bien diffusé à l’étranger. À Harvard, nous conservons un exemplaire de la traduction anglaise, qui porte, sur la page de titre, le nom de son propriétaire : George Washington. Celui-ci n’a jamais quitté les États-Unis, donc il l’a probablement acheté sur place, ce qui montre que ce genre de textes circulait bien au-delà de l’Europe, jusque dans les colonies américaines. Ce petit détail m’a toujours paru sidérant : un futur président lisant une chronique scandaleuse sur Louis XV, au même titre que des milliers d’autres lecteurs anonymes.
Ce phénomène illustre l’existence d’un véritable commerce international de la littérature subversive. Bien entendu, cela ne veut pas dire qu’il faille minimiser l’importance des grands penseurs des Lumières — Montesquieu, Diderot, Rousseau, Voltaire — auxquels je consacre d’ailleurs de longs développements dans certains de mes ouvrages. Mais il existe, en parallèle, un autre monde : celui de la littérature clandestine et marginale, qui, elle aussi, a contribué à la délégitimation de l’Ancien Régime. Ce monde-là mérite d’être pris au sérieux. Il est peut-être moins noble, mais il fut, à sa manière, tout aussi révolutionnaire.
Vous avez travaillé comme journaliste, et dans Dernière danse sur le mur, vous reveniez sur cette expérience. Comment comprenez-vous l’évolution de ce métier ?
Je dirais que depuis la chute du mur de Berlin, le monde de la communication a été profondément bouleversé. Et cela, nous le devons en grande partie aux réseaux sociaux. C’est tout à fait remarquable — et en un sens, bouleversant — de constater le déclin de la presse écrite. J’aime profondément les journaux. Mais si vous entrez aujourd’hui dans une grande gare, vous n’y trouverez pratiquement plus de kiosques à journaux. Les gens ne lisent plus la presse : ils consultent leur smartphone, où s’affiche une information filtrée, souvent produite par des individus qui s’imaginent journalistes, alors qu’ils expriment avant tout leurs préférences idéologiques, parfois leurs passions les plus brutes.
Ce que nous perdons, c’est une forme d’information traitée de manière professionnelle — celle qu’offraient les journaux — au profit d’un mode de transmission bien plus biaisé, émotionnel, et orienté. Des politiciens habiles savent parfaitement en tirer parti. On dit souvent que Donald Trump est stupide ; je pense au contraire qu’il est redoutablement intelligent dans sa manière d’exploiter les médias. Il a un langage, une gestuelle, une mise en scène de soi — avec cette coiffure, ce teint artificiel — qui fonctionne pour une large part de l’opinion.
Les médias électroniques ont, de fait, totalement transformé le monde tel qu’il existait encore en 1989. L’Internet tel que nous le connaissons n’a vraiment commencé à se développer qu’à partir de 1991. Et tout ce qui a suivi — le tri algorithmique de l’information, l’émergence des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle — est extraordinairement récent. De ce point de vue, nous vivons une mutation des moyens de communication plus radicale encore que celle provoquée en son temps par Gutenberg.
Au XVIIIe siècle, il existe un véritable commerce international de la littérature subversive.
Robert Darnton
Et diriez-vous que Grub Street s’est transformée ? Peut-on parler aujourd’hui d’un « Grub Street 2.0 » ?
Je dirais que la situation est aujourd’hui très différente, ne serait-ce que parce que chacun peut désormais diffuser des messages en un clic. Il existe bien sûr, si l’on veut, des aventuriers du numérique : des individus qui exploitent ces canaux et parviennent à en tirer profit. Peut-on vraiment les considérer comme les héritiers de Grub Street ? Peut-être… mais j’aurais tendance à penser que la comparaison est un peu forcée.
Ce sont de nouvelles créatures, c’est-à-dire des acteurs très capables dans la manipulation des techniques qui permettent de capter l’intérêt des lecteurs ou des auditeurs. Il existe une certaine analogie, sans doute, mais la condition est fondamentalement différente de celle de ces pauvres diables du XVIIIᵉ siècle, qui survivaient dans des mansardes ou des caves, souvent au bord de la misère. Pendant la Terreur, l’abbé Grégoire, au cours d’un débat, affirmait que « le vrai génie est toujours sans-culotte » et plaidait pour que la République accorde un revenu national aux écrivains du peuple. Le mot sans-culotte lui-même provient d’un obscur écrivain alimentaire, Gilbert, mort avant la Révolution, en 1785 si je me souviens bien, et que l’on surnommait Gilbert le sans-culotte parce qu’il était trop pauvre pour s’acheter une culotte. Il y a donc, de fait, un lien direct entre la figure du misérable écrivain de Grub Street et celle du sans-culotte révolutionnaire.
Dans L’Humeur révolutionnaire, vous développez la notion d’humeur collective (temper) — une disposition diffuse, historiquement située — pour décrire la manière dont les Parisiens réagirent aux événements entre 1748 et 1789. En quoi votre usage de l’humeur se distingue-t-il de notions plus classiques comme la mentalité, la conscience collective ou le Zeitgeist ? Et qu’autorise-t-il à penser que ces catégories ne permettaient pas ?
En réalité, j’ai choisi ce mot sur les conseils de mon ancien tuteur à Oxford, il y a bien longtemps. En anglais britannique, temper désigne non seulement une disposition d’esprit générale, mais renvoie aussi, de manière plus concrète, à un processus de trempe du métal — l’acier que l’on renforce en le chauffant puis en le refroidissant. C’est donc un terme fort, qui évoque à la fois la résistance, la tension et la transformation. Il fonctionne bien en anglais, même s’il se traduit difficilement en français, en italien ou en allemand.
La principale différence, par rapport à la notion d’opinion publique, tient au fait que je cherche à saisir quelque chose de plus large. Nous disposons d’excellentes études sur l’opinion publique, et je m’en inspire volontiers, mais mon propos est autre. L’humeur inclut l’opinion, certes, mais elle renvoie surtout à la formation d’une vision collective du monde. Sous cet angle, il rejoint en partie ce que la tradition française des années 1970 appelait mentalité, ou ce que Durkheim désignait par conscience collective. C’est bien de cela qu’il s’agit : une manière partagée de percevoir le cours des choses, un cadre commun de compréhension du réel.
Naturellement, il pouvait exister plusieurs visions concurrentes. Mais à Paris, entre 1748 et 1789, on assiste à un processus de simplification radicale. Les nuances du débat politique et administratif s’effacent progressivement. À travers les gazettes, les nouvelles, les discussions dans les cafés ou sur les marchés, les prêches, les performances oratoires dans la rue, se diffuse peu à peu une conviction univoque : celle que le gouvernement sombre dans l’arbitraire et le despotisme.
On peut suivre cette évolution sur quatre décennies. Vers 1787-1788, toutes les couches de l’opinion parisienne — y compris les plus éclairées — en viennent à croire que le pouvoir ministériel devient despotique. Condorcet, par exemple, qui avait soutenu au départ le ministère de Loménie de Brienne, finit, après les émeutes et leur répression à l’été 1788, par dénoncer lui aussi le despotisme et appeler à combattre le ministère. C’est là, à mes yeux, le moment crucial : la formation d’une conviction collective selon laquelle le gouvernement a perdu sa légitimité. Cette perception n’impliquait pas une attaque directe contre le roi, ni une rupture avec le principe de loyauté monarchique ; elle visait le « despotisme ministériel ». Mais elle n’en constituait pas moins une remise en cause profonde de l’ordre politique.
On en voit les effets jusque dans la culture pamphlétaire. Prenez par exemple Calonne : son programme de réformes, rejeté par l’Assemblée des notables, était en réalité assez progressiste. Pourtant, au moment de sa disgrâce et de sa fuite en Angleterre, une avalanche de pamphlets déferla, le présentant comme un despote corrompu, abusant de son pouvoir. Autrement dit, la perception publique divergeait radicalement du contenu réel des politiques.
C’est ce processus — cette lente cristallisation d’une sensibilité politique — que j’ai cherché à retracer, épisode après épisode, sur quarante ans. Il aboutit à l’émergence d’un sentiment collectif d’illégitimité du système dans son ensemble. Et je crois que ce basculement fut décisif dans la genèse de la Révolution française.
L’humeur inclut l’opinion, certes, mais elle renvoie surtout à la formation d’une vision collective du monde.
Robert Darnton
Dans Le Goût de l’archive, Arlette Farge explique comment les réponses à une simple question de police sur la capacité à lire révélaient souvent tout un spectre de situations, échappant à la dichotomie lettré/illettré. Dans votre propre usage des archives policières pour reconstruire les lecteurs, les auditeurs et les publics de rue, comment abordez-vous cette ambiguïté ? Comment parvient-on à approcher une humeur collective à partir de ces documents ?
J’aime énormément le travail d’Arlette Farge, et je partage tout à fait sa manière d’envisager les choses. Elle a passé encore plus de temps que moi dans les archives de la police, mais j’y ai moi aussi consacré des années, à lire des dizaines et des dizaines de dossiers. Ces sources sont d’une richesse fascinante, mais elles varient énormément selon les cas.
Par exemple, j’ai étudié en détail le travail d’un inspecteur de la librairie, Joseph d’Hémery, vers 1750. D’Hémery prenait son rôle très au sérieux. Il avait fait imprimer des fiches comportant des rubriques standardisées qu’il remplissait ensuite à la main. Chaque fiche constituait un rapport sur un écrivain actif à Paris, et il en a recensé environ cinq cents — depuis Montesquieu, Diderot, Rousseau ou Voltaire jusqu’aux auteurs les plus obscurs, ces pauvres diables de Grub Street dont nous parlions plus tôt.
J’ai consacré une longue étude à cette véritable enquête policière sur la vie littéraire, une sorte de sociologie policière avant la lettre. J’en ai publié les résultats dans Le Grand Massacre des chats et j’ai également mis en ligne l’ensemble des rapports de d’Hémery. C’est un exemple de documentation policière d’un type très différent de celle qu’analyse Arlette Farge, mais qui éclaire à sa manière les conditions sociales et intellectuelles de la production littéraire.
J’ai aussi passé beaucoup de temps à lire les interrogatoires de prisonniers de la Bastille. Ils obéissent à une forme fixe : question, réponse, question, réponse ; chaque page est ensuite paraphée par le détenu pour en certifier l’exactitude. Lire ces échanges est absolument captivant : on voit les policiers tendre leurs filets, manipuler les réponses ; les prisonniers tentent de s’en sortir, se contredisent, dénoncent parfois des complices. Ces documents, dans leur précision presque théâtrale, sont des microdrames de la surveillance et de la parole contrainte.
Et puis, il y a les découvertes inattendues — ce que Farge appelle si bien le hasard des archives. J’en ai fait l’expérience à la Bibliothèque de l’Arsenal : alors que je cherchais tout autre chose, je suis tombé sur un énorme dossier intitulé L’Affaire des Quatorze. Il s’agissait d’une vaste enquête policière menée vers 1750 sur la circulation de poèmes et de chansons séditieuses. À l’origine, l’ordre venu de Versailles était très simple : retrouver l’auteur d’un poème dont on ne connaissait que le premier vers, Monstre dont la noire furie… — et de là remonter tout le réseau.
L’enquête prit une ampleur considérable. J’en ai finalement tiré un livre entier, car ce dossier ouvrait une perspective totalement nouvelle sur la communication politique au XVIIIe siècle : comment des chansons populaires pouvaient véhiculer, à travers les marchés, les cabarets ou la rue, une vision critique du pouvoir royal. Même les classes populaires, en chantant des couplets satiriques sur la marquise de Pompadour, participaient à la formation d’un regard collectif sur la monarchie.
Ce sont ces voix plurielles, souvent dissonantes, captées par la police presque malgré elle — que j’essaie d’approcher ce que j’appelle une humeur : une manière partagée de sentir, de juger et de comprendre le monde à un moment donné.
Dans La Condition d’écrivain, vous revenez sur votre célèbre thèse de « Grub Street ». Votre prosopographie élargie confirme-t-elle l’idée d’un « prolétariat littéraire » complètement hermétique, ou révèle-t-elle au contraire des trajectoires plus fluides entre écrivains alimentaires, journalistes, dramaturges et philosophes ?
L’ambition du livre est d’embrasser l’ensemble de la population des écrivains, et non plus seulement celle du Grub Street. Mais je commence par un chapitre où je critique mon propre travail antérieur sur le sujet, et où je réponds aussi à mes critiques. L’article que j’avais publié en 1971, il y a très longtemps maintenant, avait suscité un débat assez vif. Certains chercheurs ont écrit des articles contre lui. Plusieurs de ces critiques étaient tout à fait justifiées.
L’Institut d’études avancées de Paris m’a d’ailleurs invité, il y a quelques années, à revenir sur cet article et à en faire une sorte d’auto-critique. J’ai accepté, et j’ai donc relu mon texte de 1971 avec un regard neuf. J’ai admis certains reproches, modifié certains arguments, et intégré ces réflexions dans le nouveau livre, qui tente de considérer la totalité du monde des écrivains.
Cela pose d’emblée une question fondamentale : qu’est-ce qu’un écrivain ? J’ai choisi de retenir la définition contemporaine, celle que l’on trouve dans les dictionnaires du XVIIIᵉ siècle : un écrivain est quelqu’un qui a écrit un livre. C’est une définition simple, peut-être trop, mais elle a le mérite d’être opératoire. J’ai donc pris pour source principale La France littéraire, une sorte de Bottin des auteurs, publiée à plusieurs reprises durant la seconde moitié du siècle. J’en ai suivi attentivement les éditions successives pour mesurer l’évolution numérique et sociale de cette population.
On dispose de biographies innombrables des grands auteurs du XVIIIᵉ siècle, mais on ignore souvent combien d’écrivains existaient réellement, comment ils vivaient, et quelle place ils occupaient dans la société d’Ancien Régime. En m’appuyant sur La France littéraire — que Voltaire qualifiait d’ouvrage « de bibliothèque », c’est-à-dire digne de sérieux —, j’ai pu établir des estimations solides. Fait amusant : Voltaire refusa d’abord de fournir des informations sur lui-même, mais constata ensuite que tout le monde consultait le volume ; il se résigna donc, dans la troisième édition, à y figurer.
Les classes populaires, en chantant des couplets satiriques sur la marquise de Pompadour, participaient à la formation d’un regard collectif sur la monarchie.
Robert Darnton
Les chiffres montrent une croissance spectaculaire : la population des écrivains passe, selon mes estimations, d’environ 1 200 individus au milieu du siècle à près de 3 000 à la veille de 1789. Cette expansion se reflète jusque dans la littérature polémique. J’en donne un exemple particulièrement savoureux à partir du débat que suscita Le Petit Almanach de nos Grands Hommes d’Antoine de Rivarol, texte d’une ironie mordante qui tourne en dérision cette foule d’auteurs médiocres. J’en fais dialoguer la verve satirique avec un contrepoint : Fabre d’Églantine, son adversaire, qui lui répond en 1787—1788, puis à nouveau après 1789, lorsque le contexte révolutionnaire reconfigure totalement les positions. Cette joute littéraire illustre à mes yeux un phénomène plus large : la prise de conscience, à la fin de l’Ancien Régime, de l’explosion numérique et sociale du monde des lettres, et du brouillage des frontières entre les « grands écrivains » et les travailleurs de la plume.
Le cœur du livre est consacré à l’étude des carrières. J’y examine trois figures : l’un a connu la réussite et atteint le sommet du champ littéraire ; un autre s’est maintenu dans la moyenne ; et un troisième est resté au bas de l’échelle. Je les ai choisies à la fois parce qu’elles sont représentatives et parce que les archives permettent de retracer précisément leur trajectoire, avant et après 1789, lorsque les conditions de la vie littéraire se trouvent entièrement bouleversées.
Il s’agit donc d’un projet ambitieux : une véritable sociologie historique des écrivains du XVIIIᵉ siècle. J’y dialogue d’ailleurs avec les travaux de Alain Viala, notamment son remarquable Naissance de l’écrivain, consacré au XVIIᵉ siècle. Nous divergeons sur certains points, mais son approche reste fondamentale, et je crois que mon livre prolonge ce chantier dans le siècle suivant, avec des données beaucoup plus abondantes. En somme, La Condition d’écrivain clôt un cycle de recherche commencé il y a plus d’un demi-siècle : après avoir étudié les éditeurs, les libraires, les censeurs, les contrebandiers et les lecteurs, j’en viens enfin aux auteurs.
Ce livre achève ainsi la série que j’avais rêvé d’écrire il y a cinquante ans : l’exploration complète du circuit de la communication littéraire.
Votre travail met souvent en lumière la dissonance entre les idéaux des Lumières et les réalités rugueuses du quotidien : scandale, censure, pauvreté, calomnie. Parfois, on se demande ce qu’il reste des Lumières lorsque l’on en dépouille les mythes fondateurs.
Je n’ai jamais cru à une histoire culturelle fondée sur la vision héroïque des grands hommes et des grands livres. Mais il y eut bel et bien de grands hommes — Diderot, par exemple, que j’admire profondément — et ils ont écrit de grands livres. Ces ouvrages ont exercé une influence considérable sur leurs contemporains.
J’ai même des données chiffrées sur la diffusion des œuvres de Voltaire. Et, au-delà des chiffres, des anecdotes nombreuses illustrent les luttes acharnées entourant la publication des œuvres complètes de Rousseau après sa mort en 1778. C’est une histoire à la fois drôle et révélatrice : la demande était telle que les éditeurs se disputaient les derniers manuscrits de Voltaire et de Rousseau, morts la même année. Il y eut des espions, des pots-de-vin, des intrigues dignes d’un roman policier pour mettre la main sur ces textes. Beaumarchais y joue d’ailleurs un rôle central.
Tout cela montre à quel point les œuvres des Lumières ont réellement touché leurs lecteurs. Ce n’étaient pas des textes pour cénacle, mais de véritables livres à succès. Il en va de même pour l’Encyclopédie. Dans mon premier grand ouvrage, j’ai tenté de mesurer concrètement sa diffusion : nombre d’éditions, tirages, abonnés, réseaux de distribution. On constate qu’à partir des années 1770, les éditions en format réduit — in-quarto, in-octavo — connaissent une diffusion massive. Ce qui, dans les années 1750, avait provoqué un immense scandale devient alors un produit largement toléré, voire banal, par le gouvernement.
Pourquoi ? Parce que le contexte politique et intellectuel a changé : le pouvoir ne se sent plus menacé. Mais cela prouve bien que la philosophie des Lumières a été une force réelle, concrète, profondément ancrée dans la société. Elle a eu des lecteurs, des effets, une histoire matérielle.
L’étude des pamphlets, des écrits clandestins, du journalisme ou de la littérature des bas-fonds n’est donc pas une mise en cause des Lumières : c’en est le complément. Comprendre les Lumières, c’est comprendre aussi leur envers, leurs marges, et la manière dont ces deux mondes se sont nourris l’un l’autre.
Dans Dernière danse sur le mur, un de vos textes évoquait la censure. Vous y montriez qu’elle prend des formes radicalement différentes selon les contextes culturels, les structures institutionnelles et les objectifs politiques. Pensez-vous que cette approche comparative pourrait aussi aider à comprendre certaines formes contemporaines de pression sur l’édition, la recherche ou l’enseignement aux États-Unis ?
Oui — enfin, en partie. Le propos de ce livre, et de mes recherches sur la censure en général, n’était pas simplement de la condamner ou de plaider pour la liberté de la presse, même si je suis évidemment en faveur de cette liberté. Il s’agissait plutôt de comprendre, de l’intérieur, le fonctionnement concret d’un système de censure : comment il opérait, comment ses acteurs concevaient leur rôle, et comment ils l’articulaient à une culture politique plus large.
Les archives françaises sont, de ce point de vue, d’une richesse extraordinaire. On y trouve des dizaines de mémoires et de lettres échangées entre censeurs, permettant de saisir la manière dont ils définissaient leur mission, souvent avec un mélange de zèle, de prudence et de culture littéraire. Dans le cas de l’Inde britannique du XIXᵉ siècle, j’ai également étudié un corpus considérable de rapports administratifs. Et puis, il y a eu mon expérience en Allemagne de l’Est.
J’y ai passé un an, l’année même de la chute du mur. Des amis écrivains est-allemands m’ont un jour demandé : « Souhaiteriez-vous rencontrer des censeurs ? » J’ai répondu : « Bien sûr que oui. » Peu après, je me retrouvais dans un bureau de la Klara-Zetkin-Strasse, à Berlin-Est, en train d’interviewer deux d’entre eux, juste après la chute du mur. La conversation fut passionnante. Je ne cherchais pas à les accuser, mais à comprendre leur logique, leur perception du travail qu’ils accomplissaient.
Plus tard, au printemps 1990, j’ai pu accéder aux archives du Parti communiste — littéralement en me présentant et en disant : « Je voudrais consulter vos fonds. » Le régime s’était effondré, et personne ne savait vraiment comment gérer ces documents. Cette expérience m’a profondément marqué : elle m’a convaincu qu’il fallait aborder la censure comme un objet anthropologique, en la replaçant dans son environnement institutionnel et symbolique.
Les trois systèmes que j’ai étudiés — la France d’Ancien Régime, l’Inde coloniale et la RDA — pratiquaient indéniablement la censure, mais selon des logiques très différentes. Leurs objectifs, leurs structures et leurs conceptions de la vérité divergeaient radicalement. C’est cela que j’ai voulu montrer : la censure comme pratique sociale située, non comme abstraction morale.
Quant à la situation américaine, c’est à la fois comparable et très différente. Il n’existe pas, au niveau fédéral, de processus officiel de censure des livres. Mais à l’échelle des États, on observe des formes de contrôle inquiétantes. De nombreuses législatures locales ont adopté des lois interdisant non pas la vente des livres, mais leur usage dans les bibliothèques publiques ou dans les écoles. Ces dernières années, la plupart de ces interdictions ont visé des ouvrages traitant d’homosexualité ou de questions transgenres : c’est fascinant, et en même temps consternant. L’objet de la censure n’est plus le communisme ou la subversion politique, comme au temps de la Guerre froide, mais la sexualité et le genre. Cette obsession contemporaine révèle beaucoup sur les angoisses culturelles américaines.
On pourrait aussi mentionner les attaques contre les universités sous l’administration Trump : demandes d’enquêtes sur les politiques d’admission, les recrutements, voire les contenus d’enseignement. Peut-on appeler cela « censure » ? Je crois que oui, au moins en germe : c’est le début d’une tentative pour instaurer un contrôle autoritaire de l’éducation et, au-delà, de la production intellectuelle.
C’est une évolution très inquiétante. Il existe une résistance, vigoureuse et organisée, et j’espère qu’elle l’emportera. Mais je crois que nous assistons à la mise en place progressive d’un appareil plus centralisé de contrôle de la communication, de l’enseignement et des médias.
En ce sens, oui, la censure demeure une menace réelle. Mais non, elle n’a pas encore, aux États-Unis, la cohérence institutionnelle des régimes que j’ai étudiés pour le XVIIIᵉ ou le XXᵉ siècle. C’est plutôt un désordre inquiétant de censures locales, morales, idéologiques — dont il faut néanmoins prendre toute la mesure.

