Une « nouvelle Renaissance » dans l’interrègne européen, conversation avec Giacomo Marramao
Entre la Renaissance et l’Italian Theory, nous revenons avec Giacomo Marramao sur les grandes thématiques qui structurent son travail récent — de Léonard à l’interrègne.
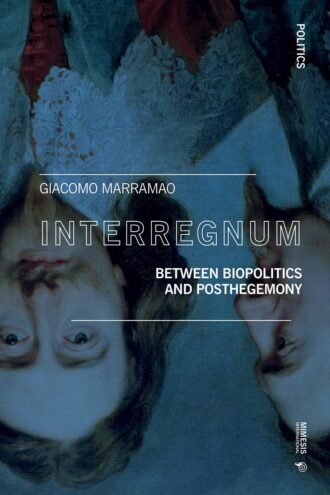
Giacomo Marramao est l’un des plus éminents philosophes politiques italiens contemporains, dont les travaux ont fait avancer des thèmes tels que la genèse de la mondialisation et la crise de la grammaire moderne du politique.
Au cours de quatre décennies de recherche théorique sur l’œuvre de Thomas Hobbes, de Carl Schmitt et de la tradition italienne, Marramao a mis en lumière l’interrègne qui succède à la crise de l’autorité politique dans des ouvrages tels que Dopo il Leviatano. Individuo e comunità (1995), Passaggio a Occidente. Filosofia e globalizzazione (2009), Per un nuovo Rinascimento (2020) ou le collectif Interregnum : Between Biopolitics and Posthegemony (2020).
Dans Per un nuovo Rinascimento, (Castelvecchi, 2020), vous défendez une nouvelle « Renaissance » pour faire face à la stagnation de l’interrègne qui marque notre époque. L’une des figures emblématique de cet essai est celle de Léonard de Vinci en qui se condensent trois domaines pratiques : l’art-imagination, la technique et la philosophie. Dans quelle mesure Léonard peut-il encore nous aider à penser les défis d’un présent dominé par le domaine technique ?
J’adopte une perspective dans laquelle la Renaissance n’est pas seulement conçue comme une période historique mais comme un mouvement — sur ce point, je partage la vision de Carlo Ginzburg —, un mouvement de pensée et un laboratoire qui anticipe les grands défis globaux du présent.
Laissez-moi avancer deux exemples ; d’abord, l’on peut considérer la définition anti-essentialiste du concept d’« humain ». On la retrouve dans la célèbre Oratio de Giovanni Pic de la Mirandole, où il expose aussi une vision de la notion d’« universel » plurielle et anti-uniforme. Par conséquence, l’anti-essentialisme ne comporte pas une forme d’anti-universalisme, mais plutôt anticipe l’idée d’un universalisme de la différence que j’ai cherché à définir — en collision d’abord avec la mode postmoderne, puis avec la nouvelle scolastique poststructuraliste et biopolitique — dans mes livres Passaggio a Occidente (Bollati Boringhieri, 2003) et La passione del presente (Bollati Boringhieri, 2008). Voici la thèse formulée en termes philosophiques : ce n’est pas l’identité mais la différence qui constitue le tracé ontologique de l’universel.
Mon deuxième exemple serait le mélange art-technique-philosophie que l’on retrouve en effet chez Léonard : même s’il avait une vision cosmologique assez traditionnelle, avec son esprit, il a été capable de se projeter au-delà du paradigme mécanique issu de la révolution scientifique de Galilée et Newton, et d’anticiper des formes de savoir rendues actuelles par la science contemporaine : de la dynamique non-linéaire à la spatialité topologique, des transformations géologiques de la Terre à la biodynamique des plantes, jusqu’à la comparaison analogique entre les proportions anatomiques du corps et l’architecture d’un palais de la Renaissance ; une perspective dont les horizons vont au-delà de l’Italie et de l’Europe, impliquant des questions transculturelles qui traversent toutes les civilisations dans un monde global de plus en plus interconnecté.
Le moment de la « Renaissance » est un exemple de ius reformandi ou de révolution intellectuelle décisive. Il n’est pas anodin que nous soyons à l’époque du moment machiavélien et de la consolidation du républicanisme moderne. Cette nouvelle Renaissance vous semble-t-elle devoir être comprise en termes politiques, ou plutôt liée à un mode de vie qui cherche à s’extraire des « grands espaces » impériaux qui reviennent aujourd’hui hanter l’Occident ?
Ce moment de la Renaissance, dans ma perspective, n’occupe pas seulement une signification généalogique, mais aussi une signification provocante dans un présent instable comme le nôtre, marqué par la crise pandémique et par le retour de la guerre dans le cœur du continent européen. En même temps, il s’agit d’un rappel du motif machiavélien de la politique comme lieu de la contingence et de la dimension communautaire comme un « faire » singulier-universel ; comme la liberté de l’événement capable de mettre à nu l’impuissance du pouvoir de ces géants aux pieds d’argile que sont les États-continents impériaux.
Mais une précision est requise ici. Parler d’impuissance du pouvoir ne veut pas dire se tourner vers une position consolatrice : dans le monde instable dans lequel nous vivons, c’est précisément le pouvoir impuissant qui est à l’origine des catastrophes les plus terrifiantes.
La Renaissance a également provoqué une révolution optique en sécularisant les images sensibles issues du cosmos païen. Cette révolution esthétique a donné naissance à cette nouvelle élite culturelle qui a tant fasciné Jacob Buckhardt. Or un autre élément déterminant de l’interrègne semble être l’abdication de l’ethos de l’élite. Cela expliquerait, par exemple, l’angoisse autour d’une nouvelle « colonisation de l’espace », assumée sur un ton apocalyptique par rapport à la Terre. La Renaissance vous semble-t-elle aussi une manière de récupérer la Terre et de prendre en charge la crise de l’extinction du monde de la vie ?
Oui, absolument. L’esprit de la Renaissance, avec son idée de « multiversalité », anticipe la globalisation, en mettant en lumière comment le réchauffement climatique ou les pandémies sont l’effet d’une violence « extractive » exercée par l’Anthropocène sur les ressources énergétiques et sur les formes de vie animales et végétales de la planète. De quoi dépend la « zoonose » qui a généré les différents variants du SARS, sinon d’un débordement, d’un passage à l’homme d’un virus provenant d’animaux expulsés, en raison de la déforestation, de leurs habitats naturels ?
Arrêtons-nous sur la dimension du mythe dans l’horizon de la Renaissance. Il y a quelques années, Massimo Cacciari a défendu la figure de Dante comme un mythe vivant pour une autre configuration de l’Europe : ouverte, errante, porteuse de ses propres forces auto-poétiques, ainsi que d’une grande invention politique. Nous savons pourtant que les mythes ne peuvent pas être instrumentalisés — ils éclatent plutôt dans différentes strates temporelles de l’histoire. Dans votre conception de la Renaissance, l’accent est mis sur la convergence entre la dimension poétique et la dimension technique. Pensez-vous que la dimension technique est plus importante aujourd’hui que l’inflexion du mythe, ou que les deux doivent être pensés ensemble ?
Sur ce sujet, je partage fraternellement l’avis de mon ami Massimo Cacciari : il n’y a aucun doute sur le fait que Dante ait anticipé la modernité en introduisant dans la Divine Comédie, mais surtout dans le De Monarchia, l’idée de l’humana civiltas en la reprenant, depuis Averroès, du grand philosophe andalous Ibn Rushd. Toutefois, il s’agit d’un tournant qui ne concerne pas que l’Europe mais l’universalité — ou, si on veut être plus précis, la « multiversalité » — du genre humain qui s’articule en histoires et civilisations différentes. Une idée dans laquelle, comme l’avait envisagé Léonard de Vinci, l’imaginatio artistique et poétique ne peut pas être séparée de l’inventio scientifique et technique. Celui-ci est un thème que j’ai cherché à développer dans le premier chapitre de Per un nuovo Rinascimento.
Vous avez récemment dirigé le volume Interregnum : Between Biopolitics and Posthegemony (Mimesis, 2020) dans lequel vous abordez la crise de la légitimité et de l’autorité politique dans le présent. La théorie de l’hégémonie est certainement la dernière grande théorie du politique, et pourtant ce cadre apparaît de manière compensatoire à la crise de l’autorité politique, et dans laquelle les exigences et les logiques de reconnaissance sont croissantes. Pourriez-vous en dire un peu plus sur la crise de l’hégémonie, qui est, bien sûr, une supervision de la crise de l’autorité du Léviathan moderne ?
Cette question nous emmène vers un problème crucial du contemporain : le phénomène d’un pouvoir sans autorité ; question paradoxale pour quelqu’un comme moi, ou pour d’autres gens de ma génération, formés intellectuellement et politiquement sous la bannière de l’anti-autoritarisme. Mais comment délier le concept de l’auctoritas de la potestas souveraine ? Est-il possible de concevoir une autorité, entendue comme dimension symbolique non plus verticale-autoritaire mais horizontale-libératoire ?
Pour y arriver, il faut retourner à la racine étymologique indoeuropéenne *aug- : de là même dérivent des termes comme augere, augmentum, augurium, auctor. Ces mots renvoient à l’idée d’une élévation symbolique, « augurale », qui peut se décliner sous une forme diamétralement opposée au symbolisme vertical de la légitimation du pouvoir souverain, pour prendre la forme horizontale d’une énergie symbolique produite « par le bas » : des relations constitutives de l’être-en-commun, de la communauté conçue non pas comme une essence ou une donnée déjà constituée, mais comme un faire dynamique.
La place de l’institution semble être l’un des points aveugles de la théorie populiste et l’un des problèmes centraux de l’autorité moderne depuis Hobbes — ce n’est pas un hasard si la domination économique néolibérale est une logique totalement anti-institutionnelle. Puisque, dans votre introduction à Interregnum vous évoquez la possibilité de repenser la question de l’autorité sous un jour nouveau, quelle place l’institution tient-elle dans votre réflexion ?
Je soutiens depuis de nombreuses années que l’un des problèmes des mouvements sociaux et politiques en Occident — mais pas seulement — depuis les années 1960 est une inconsciente « compulsion de répétition » dans la transition d’une génération à l’autre, qui les conduit à retracer les mêmes étapes, en répétant souvent les mêmes slogans et en réitérant les mêmes objectifs. La raison en est que ces questions et objectifs n’ont trouvé que des réponses partielles dans une prolifération de lois ou de pseudo-réformes qui ont fait des systèmes juridiques occidentaux un labyrinthe indéchiffrable, manipulable à volonté par les grandes puissances et les groupes d’influence.
Ce phénomène de répétition de l’identique est dû au fait que la pléthore de lois a pour contrepartie, dans nos démocraties, un déficit effrayant d’institutions sociales capables de faire converger et de stabiliser en termes opérationnels et non abstraitement normatifs les accomplissements des mouvements. C’est dans ce sens là qu’il faut repenser d’une façon dynamique les institutions et le couple conceptuel mouvement-institution.
Ces dernières années, on a beaucoup parlé de la pensée italienne contemporaine, ou de Italian Theory — qui s’est confrontée à la crise architectonique de la politique. D’une certaine manière, les deux livres dont nous avons discuté ici s’inscrivent dans l’orbite italienne. Que pensez-vous de la Italian Theory contemporaine et de ses effets en matière de transformation des héritages de la politique et de l’imagination ?
Je confesse être en marge des courants philosophiques reconnus, surtout quand ceux-ci assument les traits d’étiquettes médiatiques. C’est à cause de ça que je ne me suis jamais reconnu dans les différents « étiquettes » qui se sont succédées : postmodernisme, déconstructionnisme, biopolitique. Je ne veux pas sous-estimer les importants résultats que ces courants ont produit ; mais dans mon travail, j’ai préféré avancer en autonomie.
Par rapport à l’Italian Theory, je pense qu’il s’agit, en substance, d’une variante de la French Theory. Si ma formation philosophique n’est que partiellement italienne, elle doit beaucoup à la philosophie allemande et à la pensée du monde hispanophone et lusophone, à bien des égards plus complexe et plus originale que celle du monde anglo-saxon.
Pour ce qui est des paradigmes : ceux qui sont dignes de ce nom sont toujours, il me semble, « transnationaux ».

