Traverser les frontières fantômes, une conversation avec Béatrice von Hirschhausen
Certaines frontières continuent à vivre après leur mort. Dans son dernier ouvrage, Les Provinces du temps, Béatrice von Hirchhausen piste les traces qu’elles laissent dans nos imaginaires géographiques et qui structurent l’expérience politique — présente et future.
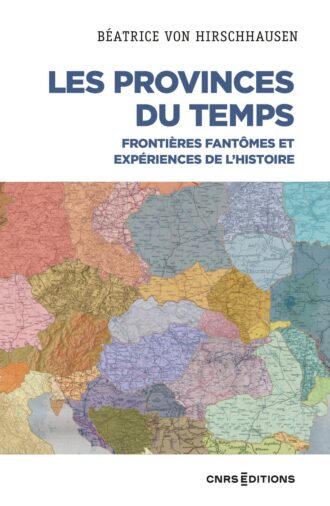
Comment en êtes-vous venue à théoriser l’existence de « frontières fantômes » et qu’entendez-vous par là ?
L’intuition de ce concept vient d’une question qui m’obsède depuis longtemps, celle des longues durées, des traces du passé et des rémanences que j’observais dans les paysages et sur les cartes de l’Europe centrale et orientale. Le concept s’est ensuite forgé au sein d’un projet de recherche interdisciplinaire conduit en Allemagne entre 2009 et 2017 puis de ma propre réflexion. L’allemand Phantomgrenzen résonne avec les Phantomschmerzen, les douleurs fantômes que ressent une personne qui a été amputée dans le membre perdu. Cela fait écho à des nostalgies qu’on rencontre souvent dans l’espace centre et est européen qui sont liées aux multiples découpages et changements frontaliers propres à cet espace. La Hongrie en offre un bon exemple puisque certains secteurs de la société hongroise expriment encore aujourd’hui des formes de nostalgie et de douleur de la perte territoriale consécutive à la Première Guerre mondiale. Il s’agit donc d’aborder les traces laissées par des territorialités défuntes dans les territoires et les sociétés contemporaines.
Au fur et à mesure de vos travaux sur le sujet, vous en êtes venue à distinguer plusieurs types de frontières fantômes. Le premier est la frontière relique. Qu’entendez-vous par là ?
Les frontières reliques sont un concept que je reprends au géographe américain de l’entre-deux-guerres Richard Hartshorne qui parle de « relict boundaries » dans deux articles de 1933 et 1936 sur la Haute-Silésie. Il s’intéresse notamment aux réseaux viaires et ferroviaires mais aussi à l’habitat ou aux niveaux de scolarisation et montre qu’on peut retrouver les traces laissées par les empires allemand, russe et austro-hongrois dans cette région qui vient d’être redécoupée entre l’empire allemand, la Pologne et la Tchécoslovaquie. Je propose de réduire la notion aux traces matérielles laissées par les déplacements de frontières. Par exemple en Pologne, on voit le contraste entre la grande densité du réseau ferroviaire de l’espace anciennement situé dans l’empire allemand et le réseau beaucoup plus lâche dans l’espace qui faisait anciennement partie de l’empire russe. Dans l’entre-deux-guerres, la Pologne a eu vingt ans d’existence qui lui ont permis d’uniformiser la largeur des voies, mais pas de rééquilibrer son réseau et la frontière relique persiste sur les cartes ferroviaires des années 1950.
L’allemand Phantomgrenzen résonne avec les Phantomschmerzen, les douleurs fantômes que ressent une personne qui a été amputée dans le membre perdu.
Béatrice von Hirschhausen
Un deuxième type de frontière fantôme est la frontière survivante.
Les frontières survivantes renvoient à la reconduction dans la durée de différences, d’asymétries, de discontinuités spatiales, par-delà l’espace physique, dans les morphologies sociales. Par exemple, le niveau de vieillissement de la population en Pologne demeure très contrasté. Encore aujourd’hui, les populations des campagnes de l’ancien empire russe sont plus âgées que celles des campagnes de l’ancien empire austro-hongrois et encore plus que celles de l’ancien empire allemand et a fortiori que celles des régions regagnées sur l’Allemagne après 1945. L’inertie démographique ne suffit pas à expliquer la persistance de ces décalages. On est en présence de phénomènes de résilience liés à des trames urbaines différentes, des taux de ruralités variés, des systèmes productifs contrastés qui se sont reconduits dans la durée.
La frontière fantôme, dans un sens étroit, renvoie à un troisième et dernier type.
J’en suis effectivement venue à réserver le terme « fantôme » aux traces que l’on observe dans les cartes qui engagent les choix des acteurs locaux. Ce sont par exemple les cartes électorales. Quand on prend les cartes électorales depuis les élections libres de Pologne de 1989, on voit apparaître une géographie structurée entre les trois anciens empires qui se partageaient ce territoire. On voit même apparaître quatre blocs car la partie de l’ancien empire allemand qui n’a été intégrée au territoire polonais qu’après 1945 présente un visage singulier. Ces cartes électorales sont compliquées à expliquer. On les interprète classiquement comme le fruit d’une perpétuation dans la longue durée de mentalités qui expliquerait qu’on vote de manière plus conservatrice ou libérale selon qu’on a été dans l’empire russe, austro-hongrois ou allemand. Mais cela ne résiste pas à l’analyse : certes, les discontinuités sont régulières mais elles changent de contenu.
Les territoires occidentaux votant actuellement pour la Plateforme civique, pro-européenne et libérale sur le plan culturel, se distinguent des territoires autrefois russes ou austro-hongrois où on vote majoritairement pour le parti Droit et justice (Pis), anti-européen et très conservateur sur le plan culturel et social. Or cette partie occidentale du pays qui vote aujourd’hui libéral votait au début des années 2000 pour des candidats socialistes. On ne peut donc pas dire que les électeurs des anciens territoires allemands seraient prédestinés à avoir un vote libéral. La frontière fantôme désigne donc les traces laissées par des frontières défuntes dans les sociétés contemporaines et dont on repère l’actualisation fluctuante dans des cartes exprimant des choix sociétaux.
La frontière fantôme désigne les traces laissées par des frontières défuntes dans les sociétés contemporaines et dont on repère l’actualisation fluctuante dans des cartes exprimant des choix sociétaux.
Béatrice von Hirschhausen
Vous avez développé ce concept de « frontière fantôme » à partir de votre terrain qu’est l’Europe centrale et orientale. En quoi cette région offre-t-elle un laboratoire pertinent pour le mettre à l’épreuve ? Et le concept est-il selon vous universalisable ?
Le concept vient effectivement d’une volonté de saisir des phénomènes qui sont particulièrement observables dans cet espace entre mers Adriatique, Noire et Baltique marqué par le passage d’une Europe des empires — ottoman, russe, allemand et austro-hongrois — à une Europe des États-nations avec les grandes césures que constituent les deux guerres mondiales et la dislocation du bloc soviétique. Il s’agit d’espaces dont les sociétés ont une expérience historique très fortement marquée par le déplacement des frontières et qui constituent donc un laboratoire extraordinaire pour questionner le rapport entre espace, histoire et différences culturelles.
Le cartographe Philippe Rekacewicz donnait l’exemple de ses grands-parents, nés au début du XXe siècle à Oujgorod, dans ce qu’on appelle aujourd’hui l’Ukraine subcarpatique. Au moment de leur naissance, la ville était dans l’empire austro-hongrois, dont la capitale était à Vienne. À partir des années 1920, ils se retrouvent dans la Tchécoslovaquie, dont la capitale est Prague. À partir de 1945, ils se retrouvent dans l’empire soviétique, dont la capitale est Moscou. Après 1991, ils se retrouvent dans les frontières de l’Ukraine, dont la capitale est à Kiev. À chaque fois, il y a donc changement de nationalité, de capitale, de monnaie, d’hymne et de récit nationaux. On retrouve ce type d’expérience pour les habitants de Vilinius, de Chişinău/Kichinev, de Lviv, etc. Cela crée une expérience historique très différente de celle des populations d’Europe occidentale où il y a une plus grande stabilité des frontières des États au XXe siècle.
Quant à savoir si le concept est applicable à d’autres espaces, c’est précisément l’un des objectifs de l’ouvrage : j’y déploie les concepts que j’élabore à partir de cette situation particulière pour les proposer à l’usage des chercheurs spécialistes d’autres espaces, par exemple postcoloniaux.
Pouvez-vous nous donner un exemple concret de frontière fantôme et de ses manifestations ?
J’ai particulièrement travaillé, sur le terrain, de part et d’autre d’une frontière fantôme qui traverse la carte de l’équipement domestique et de la modernisation des maisons en Roumanie. Ces frontières fantômes disent avant tout quelque chose sur l’espace rural, c’est là qu’on repère le mieux les discontinuités. Les campagnes roumaines sont structurellement sous-équipées : en 2000, elles n’avaient encore pratiquement pas accès à l’eau courante, alors qu’elles abritaient tout de même près de 9 millions d’habitants. L’État roumain s’en est désintéressé et aucune politique publique n’a été mise en œuvre pour y remédier. Les familles ont donc entrepris de se doter d’installations privées qui pompent l’eau dans des puits pour l’acheminer jusque dans les maisons, où elles aménagent des salles d’eau. Quand on regarde la carte de l’équipement en eau courante dans les maisons rurales au recensement de 2002, on observe une différence entre les ville et les campagnes, les premières étant équipées et pas les secondes. Mais on voit surtout que certaines régions rurales commencent à s’équiper, à savoir la Transylvanie et le Banat. Deux régions qui ont en commun d’avoir été dans l’empire austro-hongrois tandis que cet équipement ne progresse que très peu dans les régions dites du « vieux royaume », qui constitue le premier État roumain composé de la Moldavie et de la Valachie sur les versants est et sud des Carpates. Depuis, cette différence n’a cessé de s’accroître et au recensement de 2011, la dissymétrie est très visible sur la carte.
J’ai particulièrement travaillé, sur le terrain, de part et d’autre d’une frontière fantôme qui traverse la carte de l’équipement domestique et de la modernisation des maisons en Roumanie.
Béatrice von Hirschhausen
Comment l’expliquer ?
Je suis allée voir les choses sur place, en me rendant dans deux villages de taille similaire et au niveau de vie assez comparable, situés de part et d’autre de cette frontière fantôme. Du côté ruthénien, sur le versant sud-est des Carpates, seules 4,7 % des familles s’étaient équipées en eau courante. De l’autre côté, dans le Banat, sur le versant ouest de cette frontière fantôme, 75 % des familles s’étaient équipées en l’espace d’une dizaine d’années. Du côté du Banat, on a des villages qui correspondent à une colonisation de cet espace au XVIIIe siècle au moment de sa reconquête sur les Ottomans. Les maisons sont assez grandes et souvent en briques. De l’autre côté, les maisons sont plus petites et moins souvent en dur.
Quand on interroge les gens sur cette différence, ils l’expliquent par des enjeux de représentations, considérant que c’est une affaire de mentalités. Dans les Banat, les gens disent volontiers : « nous ici, sommes plus modernes, entreprenants, ambitieux et c’est la raison pour laquelle nous sommes mieux équipés ». De l’autre côté, les gens vous disent : « dans le Banat, les gens sont plus modernes », ils formulent même les choses d’une façon un peu étrange pour nous, disant que les gens du Banat sont « plus civilisés ». J’ai cherché à dépasser cette explication par les mentalités qui me semblait peu pertinente dans la mesure où j’observais des deux côtés le même appétit pour la modernisation, le même désir de conditions de vie plus confortables, qui se traduit notamment par une même tendance à l’émigration de travail à l’étranger. Cette frontière fantôme engage un choix : pourquoi une famille décide ou non d’installer l’eau courante dans sa maison ? Quel sens elle donne à ce choix et comment comprendre qu’en dépit d’un niveau de vie très comparable, on arrive à des niveaux d’équipement si différents ?
La frontière fantôme engage un choix : pourquoi une famille décide ou non d’installer l’eau courante dans sa maison ? Quel sens elle donne à ce choix et comment comprendre qu’en dépit d’un niveau de vie très comparable, on arrive à des niveaux d’équipement si différents ?
Béatrice von Hirschhausen
Il vous fallait donc interroger ces gens sur la motivation et le sens qu’ils donnent à leurs choix ?
Mes entretiens avec les villageois font ressortir l’importance de la catégorie de la « normalité » : qu’est-ce que l’on tient pour normal ? Du côté du Banat, les gens considèrent, au moment où je les interroge en 2012, qu’il est normal d’avoir l’eau courante et une salle d’eau. Ceux qui ne l’ont pas fait ne l’ont pas fait par choix mais parce qu’ils n’en avaient pas les moyens financiers. Toutefois, cette normalité est récente puisque dix ans plus tôt, aucun de ces habitants n’avait accès à l’eau courante. De l’autre côté, les gens trouvent normal de ne pas avoir l’eau courante. Si bien que lorsque j’interroge la minorité qui a fait le choix de s’en doter, les gens éprouvent le besoin de se justifier. On considère qu’il est normal de ne pas avoir l’eau quand on vit à la campagne. On est en présence de constructions qui n’ont que partiellement à voir avec des données spatiales mais qui engagent d’abord les imaginaires. Du côté du Banat, les gens se souviennent qu’ils appartiennent à l’espace centre-est européen et se considèrent en retard en son sein. Et ils attribuent ce retard à l’expérience communiste qui les aurait empêchés de se moderniser à la même vitesse que l’Autriche par exemple. Nombreux sont ceux qui me disent que, sans le communisme, ils seraient au niveau de l’Allemagne, pays considéré comme le standard de modernité le plus élevé.
C’est donc tout un rapport au temps et à l’espace qui est en jeu ?
Effectivement, ils sont dans un régime d’historicité moderniste, en quête de modernisation, mais il s’agit d’une modernité de rattrapage. Ils pensent avoir toujours été modernes, et simplement retardés par la parenthèse soviétique. De l’autre côté, ils veulent aussi se moderniser et y consacrent de gros efforts, mais ils considèrent que ce dont ils héritent ne leur donne pas accès à cette modernité et que pour y accéder, il leur faut importer des modèles venus d’ailleurs. Notamment des modèles de maisons qu’ils tiennent pour modernes. Ils considèrent que les maisons dont ils ont hérité sont médiévales et incompatibles avec cette modernité. Pourtant, ce n’est techniquement pas impossible de raccorder ces vieilles maisons à l’eau courante. Mais pour ces villageois, l’espace dont ils héritent n’appartient pas à la modernité. Et donc pour construire une salle d’eau, il faut commencer par construire une maison moderne. La différence de choix résulte donc de la manière dont on interprète ce dont on hérite : d’un côté on a les héritiers d’une histoire de la modernité, de l’autre on est dans l’idée qu’il faut rompre avec la culture dont on a hérité pour importer un modèle de l’extérieur, ce qui est beaucoup plus coûteux. C’est cette différence d’interprétation de leur histoire qui explique ces choix différents.
Mes entretiens avec les villageois font ressortir l’importance de la catégorie de la « normalité ».
Béatrice von Hirschhausen
Cette importance de la manière dont les populations que vous étudiez s’inscrivent dans l’histoire explique la mobilisation dans votre analyse des concepts d’« espace d’expérience » et d’« horizon d’attente » forgés par Reinhart Koselleck pour penser l’historicité. Pouvez-vous nous expliquer l’usage que vous en faites ?
Chez Koselleck, l’espace d’expérience désigne le passé actuel, tel qu’il est présent, remémoré et intégré par les sociétés ou les personnes, et qui est intégré dans les habitus. L’horizon d’attente est, en symétrie, le futur actualisé. Dans le cas du passé, il parle d’espace car il veut mettre l’accent sur la simultanéité du passé : c’est tout le passé, quelle que soit sa profondeur historique, qui est susceptible de s’exprimer. Dans le cas du futur, il parle d’horizon car c’est un point de fuite — c’est le futur tel qu’il est imaginé, projeté, planifié ou espéré par les sociétés. Son usage du terme d’espace est donc métaphorique et je pense qu’il n’a pas à l’esprit l’espace géographique. Je crois toutefois qu’on peut considérer que l’espace géographique est partie prenante de cette expérience. Ce binôme « espace d’expérience » / « horizon d’attente » permet de défiger l’espace, de dépasser l’idée braudélienne que l’espace est ce qui est immobile, qui ne bouge pas. Koselleck montre très bien que l’horizon d’attente est bien sûr dépendant de l’espace d’expérience — ce que l’on espère, ce que l’on attend, est lié à notre expérience — mais que ce dernier est aussi une clé de réinterprétation du premier. Quand l’horizon d’attente se modifie, il transforme le sens qu’on donne à l’expérience.
Si, comme l’écrit Michel Foucher, la frontière est « du temps inscrit dans l’espace », il ne s’agit donc pas seulement du temps passé. Selon vous, la frontière a autant à voir avec le futur qu’avec le passé.
Les frontières en général, je ne sais pas ; les frontières fantômes, indubitablement. Elles ne sont pas des résultats figés mais sont actualisées par les choix des sociétés locales à un moment particulier. Des choix qui tiennent à l’histoire de l’espace en question mais cette expérience historique s’inscrit dans un récit dépendant d’un futur. C’est ce qui explique qu’on puisse assister à des inversions du contenu des frontières fantômes telles que celle que je décrivais à propos de la Pologne. Ces inversions s’expliquent par le fait que le sens donné au vote varie selon les contextes politiques du moment. Dans le cas polonais, l’évolution du contenu des frontières fantômes observée sur les cartes électorales est liée à l’intégration européenne qui constitue un moment de recomposition de l’espace politique polonais. On ne vote plus comme auparavant en fonction de l’attitude à adopter à l’égard de l’héritage soviétique mais sur la place à donner à des modèles et des normes ouest-européens. L’horizon d’attente ne tourne plus autour du fait de savoir jusqu’à quel point on se dégage de l’expérience soviétique mais jusqu’à quel point on s’engage dans l’expérience ouest-européenne. Cette transformation de l’horizon modifie l’expérience des électeurs. Dans les campagnes roumaines c’est lorsque l’horizon socialiste devient totalement illégitime qu’on voit apparaître en substitution l’idée d’Europe centrale. Si l’espace frontalier a donc effectivement une dimension temporelle, j’ajouterai que le temps historique, comme vécu et comme récit, a aussi une dimension spatiale que les frontières fantômes permettent de percevoir.
Quand l’horizon d’attente se modifie, il transforme le sens qu’on donne à l’expérience.
Béatrice von Hirschhausen
D’où l’importance de ce que vous appelez les « géorécits » ?
Je propose ce concept de géorécit afin de capter la dimension géographique du temps historique tel que nous le vivons, à la fois comme récit et comme expérience. Je cherchais initialement à saisir comment les villageois et villageoises que j’ai interrogés finissent par endosser et par actualiser dans leurs pratiques des récits qui promettent le progrès et la modernité à l’Europe centrale et inversement le retard à l’Europe balkanique. Par-delà ce cas d’étude, et en m’appuyant sur l’analyse d’autres situations régionales, je montre que les configurations spatialisées des sociétés sont dotées de significations. Elles suggèrent en permanence des « récits », des mises en intrigues tacites, des formes de mise en ordre de l’histoire, et avec elles, des attentes et des promesses pour le futur. Nos imaginaires géographiques ne confèrent pas les mêmes valeurs aux lieux, ils ne leur accordent pas les mêmes chances de réussite ou de développement. Ils découpent le monde en aires culturelles ou en aires de développement et, dans un même mouvement, ils les inscrivent dans une géographie de l’histoire qui délivre des oracles.
Il est important ici de comprendre que ces imaginaires ne sont pas suspendus hors sol, sur le seul registre des discours : Ils se construisent à travers des expériences situées, incarnée dans les morphologies sociales ou dans des paysages. Or c’est ce qui permet leur grande performativité. La croyance dans une promesse d’avenir pour un territoire se nourrit de l’expérience qui accrédite et naturalise de manière itérative les différences entre les sociétés et entre les régions. C’est ce lien entre croyances et expérience géographique, entre récit et espace que le concept de géorécit veut saisir. Il est important de l’expliciter parce qu’il formate en grande partie les choix ordinaires et le devenir des sociétés.
Nos imaginaires géographiques ne confèrent pas les mêmes valeurs aux lieux, ils ne leur accordent pas les mêmes chances de réussite ou de développement.
Béatrice von Hirschhausen
L’existence de frontières fantômes constitue-t-elle un symptôme d’une imperfection des frontières « réelles » ? Serait-il dans l’absolu souhaitable de faire coïncider frontières fantômes et frontières politiques ? Ou bien faut-il au contraire œuvrer à effacer les frontières fantômes pour faire gagner en efficacité les frontières politiques ?
Les frontières fantômes ne sont pas plus légitimes que les frontières politiques, et elles ne renvoient pas de toute façon à une même réalité. Leur dimension fantomatique tient au fait qu’elles apparaissent sur certains phénomènes et pas sur d’autres, et également au fait qu’elles peuvent disparaître pendant un certain temps, puis resurgir ou non plus tard. Elles n’ont rien d’induré dans l’espace. Il s’agit de discontinuités instables, fluides. La question n’est donc pas de faire coïncider frontières fantômes et frontières politiques, mais de savoir comment les sociétés et les acteurs politiques peuvent s’en saisir en certaines circonstances historiques. En Tchécoslovaquie ou en Yougoslavie, des acteurs politiques ont pu s’en emparer jusqu’à faire éclater les États qu’elles traversaient. De tels scénarios peuvent se reproduire, mais il n’y a aucun déterminisme. Ils sont l’effet des stratégies d’acteurs politiques qui instrumentalisent la perception naturalisée et essentialisée que les sociétés peuvent avoir à un moment donné de différences héritées du passé. Ceci, alors que ces sont des « fantômes », c’est-à-dire des « réalités » situées à l’articulation des pratiques et des récits, à la jonction de l’expérience et de la construction du sens.

