« Une histoire inquiète », une conversation avec Sabina Loriga et Jacques Revel
Comment le tournant linguistique de l'histoire a-t-il été reçu, vécu, absorbé ou rejeté ? Dans cet entretien fleuve, Florian Louis revient avec Jacques Revel et Sabina Loriga sur l'histoire d'une manière de faire de l'histoire qui résonne aujourd'hui encore en choquant les frontières de la discipline et du métier d'historien.
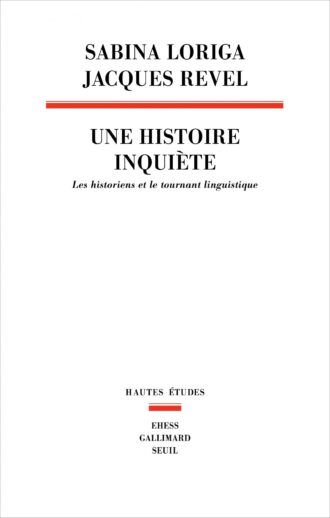
L’un des mérites de votre ouvrage est de souligner le caractère nébuleux, composite et pluriel du « tournant linguistique ». Pourriez-vous tout de même essayer de nous en donner une définition ?
Jacques Revel
Le tournant linguistique est un des nombreux tournants qui ont affecté l’historiographie et plus généralement une partie des sciences humaines et sociales depuis la fin des années 1960 et dont on peut penser qu’ils traduisent une instabilité nouvelle de la réflexion historiographique. Ce fut le premier de ces turns et probablement celui qui a créé le plus de remous dans nos professions. On s’est beaucoup mobilisé contre, et parfois farouchement pour le tournant linguistique. Pourtant, en dépit de ces engagements forts, la nature et le périmètre du linguistic turn ne se laissent pas aisément définir. Partons du cadrage le plus assuré. Le problème du langage, on le sait, a été au centre de la réflexion philosophique et de celle de toute une part des sciences sociales tout au long du XXe siècle. Il l’a été sous des formes très diverses et éventuellement contradictoires, tout à la fois à travers le questionnement herméneutique mais aussi du côté de la philosophie analytique, dans ses commencement viennois puis dans ses développements anglo-américains, tandis que les sciences du langage proprement dites connaissaient elles aussi une croissance et une diversification spectaculaires, jusqu’à être promues en modèle pour les sciences humaines et sociales aux beaux temps du structuralisme. Ce sont autant de sources, pas toujours convergentes, du tournant linguistique. Tout ou presque a pu être considéré comme « langage ». Le tournant linguistique repose sur l’affirmation, qui peut de prime abord sembler triviale, que notre rapport au monde, à la réalité du monde, est entièrement médiatisé par le langage.

Cela, les historiens le savent puisqu’ils scrutent depuis longtemps des documents qui sont souvent écrits et qu’ils les commentent avec des mots. Il n’y a donc rien que de très normal à s’interroger sur les mots de l’histoire. Mais le tournant linguistique va plus loin en ce qu’il considère que si le langage est une ressource, il est aussi un piège, en ce qu’il s’interpose entre nous et la réalité. Cela aussi, les historiens ne sont pas les plus mal placés pour y être attentifs. Mais dans les formulations les plus extrêmes du linguistic turn, on en est arrivé à affirmer que le langage est tout ce que nous pouvons appréhender de la réalité, qu’il n’y a pas d’accès à cette réalité en tant que telle car nous vivrions dans un monde de mots qui ne renvoient jamais qu’à d’autres mots. Chez certains, l’habitude s’est même prise de parler de la « réalité » en la plaçant entre des guillemets. Pour les historiens, comme pour toute corporation ayant des ambitions cognitives, prétendant donc dire quelque chose de vrai sur un état du monde, une telle proposition est bien évidemment problématique.
Ce caractère problématique explique que le lingustic turn ait pris des formes très variées en histoire ?
Oui, et c’est ce qui rend l’appréhension de ce moment très complexe Dans les premiers temps du linguistic turn, certains de ceux qui ont eu l’initiative de cette réflexion, le britannique Gareth Stedman Jones, l’américaine Joan Scott, ont eu une lecture fortement inspirée par la lecture de Saussure et reposant sur la conviction que le langage n’est pas de nature symbolique — les mots ne renvoient pas à des choses — mais qu’il est un système de différences dans lequel les mots prennent leur valeur par différence par rapport à d’autres mots. De cette conception sémiotique du langage, on a pu tirer la conclusion extrême qu’il ne fallait plus prétendre appréhender la réalité, mais seulement les constructions langagières qui nous la font connaître : ce que les historiens appellent des « sources », mais aussi la masse des commentaires qui ont été produits et qui continuent de l’être à propos de ces sources. C’est, si l’on veut, la version la plus radicale du linguistic turn. Elle n’a pas été majoritaire, mais elle n’a cessé d’être présente et elle a pu aboutir, à la faveur de polémiques, à des positions extrêmes, qui déniaient à l’histoire, réduite à sa seule dimension langagière — les historiens ne peuvent que raconter des histoires — toute prétention à connaître et à dire le vrai. Mais il a aussi existé une version que l’on peut qualifier de « discursive » ou de « textuelle », qui posait que le réel sur lequel les historiens – mais aussi les sociologues, les anthropologues, etc. – travaillent, peut être appréhendé comme un texte. C’est la position d’un philosophe comme Paul Ricoeur ou celle qu’a théorisée et mise en œuvre un anthropologue dont l’influence a été considérable comme l’américain Clifford Geerz. Cette approche est celle qui a eu le plus de succès car elle est la plus manœuvrable. Elle présente en effet l’avantage de ne pas même exiger d’engagement pour, contre ou à propos de la réalité. Elle propose une manière de travailler sur les traces dont l’historien peut disposer. Elle a été particulièrement bienvenue dans un moment où l’histoire « culturelle » — quel que soit ce que l’on met sous ce pavillon — prenait le relais de l’« histoire économique et sociale » qui avait massivement dominé les décennies d’après-guerre. Ce que l’on appelle alors les cultural studies — l’histoire et une bonne part des sciences sociales, mais aussi les études littéraires et artistiques et plus largement les grandes thématiques sociétales — connaissaient alors un essor spectaculaire, souvent accompagné de forts investissements idéologiques, et dont témoigne une énorme production de livres, d’articles, d’échanges, accords et désaccords confondus.
La nature et le périmètre du linguistic turn ne se laissent pas aisément définir.
Jacques Revel
Pourquoi avoir décidé de revenir aujourd’hui sur un débat déjà ancien et qui peut paraître dépassé ? En arrivant « après la bataille », avez-vous l’intention — ou la crainte ? — de la ranimer ?
Sabina Loriga

À l’origine, nous avions l’idée de proposer une anthologie rendant accessible au lectorat francophone les principales pièces du débat. En effet, la plupart des textes qui ont constitué le corpus du tournant linguistique n’ont pas été traduits en français et cette absence de traduction n’est pas un hasard. Elle exprime une méfiance généralisée vis-à-vis de cette expérience, voire une attitude défensive à son égard. La France a été sans doute le pays le moins réceptif au linguistic turn. Au début, on l’a considéré avec une certaine suffisance et un sentiment de supériorité et l’on en a souvent donné une vision caricaturale l’assimilant avec le nihilisme voire le négationnisme, avant de chercher finalement à l’oublier en se félicitant de la relative imperméabilité française à cette expérience dont on s’est empressé de dire qu’elle était close et qu’il s’était agi d’un emballement, d’une mode superficielle voire absurde. Avec Jacques, nous pensons au contraire qu’il s’agit d’une expérience-clef sur laquelle on ne saurait fermer les yeux. Il s’agit d’une crise majeure dans la manière de penser le rapport entre passé et histoire et in fine de concevoir la notion de vérité historique. De ce point de vue, nous pensons que le tournant linguistique nous offre une opportunité pour réfléchir sur l’historiographie et sur la tâche de l’historien dans l’espace public. En rédigeant cet essai, il ne s’agissait donc pas pour nous de ranimer le débat sur le tournant linguistique mais de prendre au sérieux cette expérience, de l’examiner dans toute son ampleur mais aussi dans ses évolutions. Ce n’est en effet pas seulement une expérience large mais aussi une stratification, un débat qui n’a pas cessé de se transformer et d’être reformulé.
Il s’agissait aussi de revenir sur votre propre parcours d’historiens en proie à ce tournant ?
Jacques Revel
Ne serait-ce que pour des raisons d’âge, Sabina et moi n’avons pas la même expérience de ce mouvement ou, mieux, de ce moment historiographique. Pour Sabina, c’est d’abord une expérience de lectrice attentive. Dans mon cas, il se trouve que j’ai été, non pas un acteur, mais quelque chose comme un « accompagnateur », en tout cas un observateur des développements du linguistic turn dont l’émergence a coïncidé avec une fréquentation régulière des universités américaines où j’allais enseigner. J’ai donc été confronté plus directement à ce phénomène. Je l’ai d’abord reçu de façon très critique parce qu’il allait à l’encontre de toutes mes convictions d’historien, puis il m’a fallu faire l’effort de comprendre ce qui se passait. De façon répétée, j’ai eu l’occasion de débattre avec plusieurs des historiennes et des historiens qui sont présents dans notre livre, et avec certains d’entre eux j’ai noué des amitiés durables. Pour moi, il s’agissait donc aussi de faire le point sur une expérience d’une vingtaine d’années qui avait été assez tumultueuse : le débat nord-américain tranchait avec la relative sérénité du cadre intellectuel français. Mais au-delà de ce qui relève de l’expérience personnelle, nous avons eu l’une et l’autre, Sabina et moi, la conviction que quelque soit le jugement que l’on pouvait porter sur lui (et ces jugements n’ont pas manqué), le tournant linguistique était le symptôme d’un malaise plus général dans l’historiographie.
La France a été sans doute le pays le moins réceptif au linguistic turn.
Sabina Loriga
Sabina Loriga
Nous avons articulé nos deux expériences personnelles qui sont différentes. Jacques connaît, il est vrai, mieux que moi le monde universitaire états-unien. Toutefois, en tant qu’historienne formée en Italie, un pays où les travaux du linguistic turn ont été beaucoup plus traduits et donc lus qu’en France, j’ai été très exposée non seulement aux livres mais à l’ambiance postmoderne dans laquelle s’inscrivait le tournant linguistique. Le rapport italien au linguistic turn diffère du rapport français non seulement en raison du différentiel de traduction mais aussi pour des raisons contextuelles d’ordre plus général. Ma génération, celle qui vient après la longue saison de 1968, a été très marquée par la crise postmoderne : il suffit de penser au volume édité en 1979 par Aldo Gargani, Crisi della ragione (dans lequel Carlo Ginzburg a publié la première version de « Spie », son essai sur la démarche indiciaire) ou encore à un écrivain comme Pier Vittorio Tondelli. Et ceci est d’autant plus vrai pour les femmes. Par ailleurs, la vie politique de la péninsule des années 1970-1980 a été scandée par une série de « mystères » qui rappelle la situation états-unienne à la même époque. En France, il n’y a pas eu de mystères aussi lourds et donc capables de déstabiliser la notion de vérité historique en profondeur dans la société que l’ont été aux États-Unis les affaires Rosenberg ou Kennedy, ou en Italie, notamment, le terrorisme néo-fasciste, en liaison avec les services secrets de l’État pendant les « années de plomb ». Dans notre livre, nous cherchons précisément à traiter du linguistic turn du point de vue historiographique mais aussi de mieux comprendre quel a été le terrain politique et social qui l’a nourri.
On considère généralement que c’est la publication de Metahistory d’Hayden White en 1973 qui fait entrer, avec fracas, le tournant linguistique dans le champ historiographique. Pouvez-vous nous résumer la teneur de ce livre et nous expliquer pourquoi il suscita de vives réactions dans la communauté historienne ?
Metahistory est un ouvrage très complexe dans lequel White renverse la question posée par Erich Auerbach dans Mimesis. Là où Auerbach se demande « qu’est-ce qui est proprement historique dans l’art réaliste », White s’interroge sur « ce qui est artistique au sein de l’historiographie ». À partir de la lecture de grands historiens (Michelet, Ranke, Tocqueville, Burckhardt) et de philosophes (Hegel, Marx, Nietzsche, Croce, etc.) du XIXe siècle, White propose une approche formaliste centrée sur le rôle du langage et la structure narrative de l’historiographie avec la conviction que le contenu historique ne peut pas être détaché de sa forme discursive. De là, toute une réflexion sur l’idée que la forme narrative joue un rôle cognitif décisif. Toutefois, dans Metahistory, White ne suggère pas que tout n’est que langage, discours ou texte. Il ne nie pas l’existence de la réalité externe au langage. Mais il privilégie la fonction métalinguistique à la fonction référentielle et, qualifiant l’historiographie de « fiction-making operation », il considère qu’elle est une formalisation d’intuitions poétiques ou de conceptions idéologiques. Ces questions commencent à être abordées par White dans Metahistory, mais ce n’est sans doute pas cet ouvrage qui a le plus marqué la réception de sa pensée. Les très vives réactions à Hayden White dans la communauté historienne sont plutôt liées aux articles qu’il a publiés dans les années qui suivent Metahistory, à savoir les textes réunis dans une série de recueils, Tropics of Discourse : Essays in Cultural Criticism (1978) et dans The Content of the Form : Narrative Discourse and Historical Representation (1987). C’est là que l’assimilation de la fiction à l’histoire devient plus sensible, particulièrement dans « The Historical Text as Literary Artifact », un article publié en 1974, juste après la publication de Metahistory et qui en est un peu le prolongement théorique. Je pense que la réception de Metahistory est beaucoup passée à travers la lecture de cet article dans lequel White met en discussion la capacité mimétique de l’histoire et la traite comme un artefact littéraire dans le sillage d’un autre texte célèbre, « Le discours de l’histoire » de Roland Barthes (1967). Un autre essai important de Hayden White est « The politics of historical interepretation ». Paru plus tard, au début des années 1980, c’est un article complexe dans lequel White déplace son regard sur la dimension politique plutôt que rhétorique et stylistique et affirme que la narration est fondée sur des choix épistémiques qui ont toujours des implications idéologiques.
Il n’y aurait donc pas d’historiographie politiquement innocente et toute connaissance historique serait nourrie d’idéologie même si elle ne participe pas d’un programme politique explicite. Se plaçant ici dans le sillage de Michel Foucault, White renverse l’image habituelle du processus de professionnalisation de l’histoire en affirmant que le « noble rêve » de l’objectivité n’est pas seulement une illusion mais un dispositif politique. Ce sont ces deux articles qui ont suscité des préoccupations profondes de nombre d’historiens, à commencer par Arnaldo Momigliano. Ces préoccupations étaient d’autant plus justifiées qu’elles intervenaient dans les années du déferlement négationniste qui donnait à la question de la preuve une acuité politique et sociale fondamentale, et cela d’autant plus que les négationnistes les plus médiatiques, tels Robert Faurisson ou David Irving, se présentaient comme des chercheurs et des défenseurs de la vérité historique. Malheureusement, il y a eu dans les années 1980 une association entre postmodernisme et négationnisme qui a figé les positions. Elle a donné à la discussion un tour polémique qui a empêché de saisir la complexité de l’expérience du tournant linguistique, ses tensions internes et ses contradictions.
Dans notre livre, nous cherchons précisément à traiter du linguistic turn du point de vue historiographique mais aussi de mieux comprendre quel a été le terrain politique et social qui l’a nourri.
Sabina Loriga
Comment expliquer l’exception française dans la traduction des textes de White ? Alors que ceux-ci ont été rapidement rendus accessibles aux lectorats italophone, hispanophone ou germanophone, il a fallu attendre 2009 pour qu’une petite partie de Metahistory (l’introduction) soit traduite en français, puis 2017 pour que paraisse un recueil en langue française d’une sélection de ses articles ?
Jacques Revel
Le fait que l’anthologie à laquelle vous faites référence ait été réalisée par Philippe Carrard, un historien d’origine suisse enseignant aux États-Unis, est à lui seul significatif. L’historiographie française, y compris celle des Annales, a sans doute eu trop longtemps le sentiment d’être au centre du monde savant. Après que les États-Unis ont — tardivement, il faut bien le dire — découvert les Annales au début des années 1970, les historiens français ont pu être confortés dans cette certitude, d’où peut être leur manque de curiosité pour ce qui se passait ailleurs. Il existe par ailleurs un très solide socle positiviste dans l’historiographie française. L’héritage durkheimien, qui a lui-même produit une critique du positivisme en son temps, a, jusqu’à un certain point, instauré un nouveau positivisme. Depuis la fin du XIXe siècle, on a effet toujours eu un positivisme à critiquer sans s’interroger sur son propre « positivisme », au point que le mot s’est largement vidé d’un sens précis. L’histoire « économique et sociale » qu’ont illustrée de très grands noms, ceux d’Ernest Labrousse et de Fernand Braudel en premier lieu, reposait en tout cas sur une conviction qu’il vaudrait mieux qualifier de scientiste et qui était inséparable d’une confiance dans le caractère cumulatif de nos connaissances. Nous participions tous à la construction d’un mur de savoir au sein duquel chaque brique individuelle trouverait sa place et avec la conviction qu’à terme, il y aurait bien un mur qui aurait une forme. C’est un rêve qui a duré jusqu’aux années 1970, puis l’historiographie, dans tous nos pays ou presque, est entrée dans une forte zone de turbulence. Cela a aussi été le cas en France, mais sans considération pour le tournant linguistique. Le vieux rejet de la philosophie par l’historiographie française a aussi joué son rôle : on sait qu’au XIXe siècle, l’histoire savante s’est construite, en France en particulier, contre les philosophies de l’histoire et le pli est resté très durable. Il s’est accompagné d’une réticence de longue durée à l’encontre de la réflexion historiographique. Celle-ci n’a commencé à prendre consistance chez nous — à la différence de ce qui se passait en Allemagne, en Italie ou en Grande-Bretagne — qu’à la faveur de ce que l’on a commencé à appeler d’un terme bien trop général, la « crise de l’histoire », dans les années 1980.
Deux ans avant la parution de Metahistory, Paul Veyne avait toutefois publié un retentissant essai d’historiographie qui, déjà, s’interrogeait de manière critique à la manière dont on écrit l’histoire. Il y réfutait les prétentions à la scientificité de la discipline et mettait l’accent sur sa dimension narrative. N’y avait-il pas là une préfiguration des thèses de White ? D’autant que Veyne était l’un des historiens les plus proches de Foucault, dont les écrits ont largement nourri outre-Atlantique le linguistic turn. Finalement, la non-traduction française de White vient peut-être du fait qu’il faisait double emploi avec Veyne dont les thèses furent toutefois mieux acceptées que les siennes par les historiens français ?
Je n’en suis pas certain. Le livre de Veyne, qui était une sorte de pavé dans la mare des historiens, n’a pas été trop bien reçu. La note critique qui lui a été consacrée dans les Annales avait été confiée à Michel de Certeau, qui n’était pas précisément un positiviste. Il s’y livrait à une critique assez sévère de l’ouvrage. Cette critique a déplu à Raymond Aron qui, après la publication de Comment on écrit l’histoire (1971), considérait Veyne comme son continuateur dans la critique de la raison historique et était occupé à le faire élire au Collège de France. Tant et si bien que — et je crois que c’est un cas unique dans l’histoire de la revue — il y eut une deuxième note critique dans les Annales, signée d’Aron, disant tout le bien qu’il pensait du livre. Il reste que l’ouvrage a plutôt été mal reçu par les historiens, je me souviens d’en avoir parlé avec Veyne après coup, parce qu’il arrivait à contre-temps : nous étions encore dans les hautes eaux de la confiance scientiste, ce qui n’invitait pas spécialement à revoir les ambitions de la discipline à la baisse, comme il nous le proposait. Veyne était proche de Foucault, mais il s’était aussi plongé dans ce que les philosophes analytiques anglo-américains avaient écrit sur l’histoire. Il était proche aussi du sociologue Jean-Claude Passeron, et tous s’intéressaient, à des titres divers, aux opérations logiques et discursives impliquées dans le processus de connaissance propre aux sciences sociales. Par ailleurs, je ne pense pas que le livre de Veyne ait joué un rôle important aux origines du linguistic turn, à la différence d’un certain nombre d’auteurs français qui ont été beaucoup sollicités — Foucault, Derrida, Barthes, Lacan, mais aussi Bourdieu et quelques autres — et plus encore cités, sans qu’on se soucie toujours de la compatibilité de leurs propositions respectives. Ce que l’on a appelé la French Theory, référence obligée pendant quinze ou vingt ans, avant d’être vouée aux gémonies, a été, pour l’essentiel une construction d’outre-Atlantique, qui faisait écho à certaines tendances de fond de la culture américaine. C’est au fond ce que résumait Derrida en déclarant : « l’Amérique, mais c’est la déconstruction » !
Ce que l’on a appelé la French Theory, référence obligée pendant quinze ou vingt ans, avant d’être vouée aux gémonies, a été, pour l’essentiel une construction d’outre-Atlantique, qui faisait écho à certaines tendances de fond de la culture américaine.
Comme nous l’avons déjà souligné, on a beaucoup reproché à Hayden White, notamment lors d’un colloque devenu fameux organisé en avril 1990 à l’Université de Californie à Los Angeles, de décrédibiliser la parole historienne en mettant l’accent sur sa discursivité. Avec le risque d’aboutir à un relativisme pouvant aller jusqu’à faire le lit du négationnisme. Dans un article publié en 2004, il prétend au contraire démontrer comment l’œuvre de Primo Levi, « constitue un modèle de la façon dont un mode d’écriture spécifiquement littéraire peut rehausser les valences référentielles et sémantiques d’un discours de fait ». Autrement dit, l’écriture littéraire, loin d’altérer la factualité historique de la Shoah en la déréalisant ou en l’esthétisant, permettrait de la faire ressortir et ressentir mieux que n’importe quelle prose historiographique : « Se questo è un uomo, généralement reconnu comme un classique du témoignage sur l’Holocauste, tire son pouvoir testimonial moins de l’enregistrement scientifique et positiviste des « faits » d’Auschwitz que de l’expression poétique de ce que l’on a ressenti en endurant ces « faits » » écrit-il.
Sabina Loriga
Pour moi, le livre de Levi, Se questo è un uomo, n’est pas de la littérature. C’est un témoignage qui a une forme littéraire, mais ce n’est pas de la fiction. L’article auquel vous faites référence appartient à la dernière phase du travail de White dont la pensée a changé avec le temps. Les années 1970 étaient centrées sur les tropes et les intrigues, les années 1980 l’ont été sur la question politique et idéologique et enfin, à partir des années 1990, White s’éloigne de cette lecture politique de l’histoire pour revenir à la question du récit, mais dans une perspective différente de sa première phase. Ce changement résulte sans doute du colloque organisé par Saul Friedländer à Los Angeles auquel vous faites référence et au cours duquel White s’est probablement aperçu des dangers dont étaient porteuses certaines de ses déclarations. À partir de ce moment, il a en tout cas commencé à privilégier la littérature par rapport l’histoire, au motif que les traumas historiques propres au XXe siècle, d’une part, et les nouvelles technologies, de l’autre, avaient dissous l’événement dans un nombre infini de détails et qu’il fallait inventer de nouvelles formes de récit. C’est cette crise de l’événement qui avait, selon lui, détruit la distinction entre discours réaliste et discours fictionnel. C’est un point très intéressant car White s’éloigne ici de la proposition poststructuraliste qui était celle de Metahistory et qui exaltait la dimension rhétorique du discours historique pour adopter une position historiciste, en affirmant que pour raconter les événements traumatiques du XXe siècle, il y a des formes de narration qui fonctionnent mieux que d’autres. Il en revient donc à une conception mimétique du récit historique.
Les travaux du dernier White soulèvent la question complexe du rapport de l’histoire à la littérature. Qu’est-ce que la littérature peut selon vous apporter de plus ou d’autre que l’historiographie à l’intelligence du passé ? Ces deux modes d’écriture sont-ils concurrents, complémentaires ou encore incommensurables ?
Ces dernières années, de nombreux romanciers se sont lancés en quête du passé et certains se voient comme les véritables médiateurs entre le passé et le présent voire comme les défenseurs d’une mémoire bafouée à l’instar d’un Édouard Glissant qui se pose en gardien de la mémoire contre l’histoire « officielle ». Il est évident que la forme du récit n’est plus celle du roman historique à la Walter Scott mais plutôt celle de l’œuvre-témoignage ou la métafiction historiographique. C’est un phénomène majeur qui mérite d’être compris en profondeur. Ce retour à l’histoire a produit des chefs-d’œuvre incontestables comme l’Austerlitz de W. G. Sebald. C’est donc un mouvement qui peut être très positif, mais qui soulève une série de questions. La première concerne le statut de l’histoire dans la mesure où très souvent les romanciers ont cherché à délégitimer l’histoire à l’image d’Edgar L. Doctorow qui revendique la supériorité de la fiction sur l’histoire. Il me semble que cette revendication n’est pas le propre de la littérature mais que cette dernière exhale un état d’esprit soupçonneux de plus en plus répandu dans la société et qui voit dans l’histoire un instrument du pouvoir. On retrouve les traces de ce sentiment soupçonneux dans les médias où il est fréquemment question d’« histoire manipulée », d’« histoire occulte » ou encore de « tabous de l’histoire ».
Il est évident que la forme du récit n’est plus celle du roman historique à la Walter Scott mais plutôt celle de l’œuvre-témoignage ou la métafiction historiographique. C’est un phénomène majeur qui mérite d’être compris en profondeur.
Sabina Loriga
Que faire face à cette vague d’incrédulité à l’encontre du discours historique sur laquelle surfe la fictionnalisation du passé ?
Nous devons chercher à mieux comprendre la signification de cette vague de la fictionnalisation. Il me semble d’abord qu’elle exprime une demande de dramatisation du récit historique. Il est vrai que l’histoire positiviste a souvent produit une double désertification du récit historique : on a occulté les individus qui peuplaient le passé et, d’autre part, pour souligner la dimension scientifique, l’historien s’est caché derrière la troisième personne. Or je pense que de ce point de vue la confrontation avec la littérature peut jouer un rôle extrêmement positif et aider les historiens à redonner au passé sa dimension dramatique, à mieux méditer sur les stratégies narratives à mettre en œuvre pour restituer le drame de la liberté du passé. En revanche, il y a dans cette vague de fictionnalisation une tendance à l’effacement de la distance entre passé et présent qui me préoccupe, non pas bien sûr dans le cadre de la fiction, mais si on l’applique à l’historiographie. L’idée que le passé devient présent par intuition, qu’on peut le mettre à jour par un geste prophétique plutôt qu’analytique, me semble dangereuse. La tâche de l’histoire est au contraire de travailler à restituer l’altérité et l’étrangeté du passé et elle doit donc éviter d’en donner des images faussement familières à travers l’usage d’« effets spéciaux ».
Georges Duby a récemment rejoint Jules Michelet au catalogue de la Bibliothèque de la Pléiade. Dans la préface du volume recueillant ses œuvres, Pierre Nora écrit que ce qui vaut au grand médiéviste cet honneur n’est pas « son interprétation de la féodalité, souvent discutée », mais bien plutôt son « style tendu, ténu, légèrement solennel, plein de chair et de vie, chaleureux et sonore ». De fait, quand nous lisons Michelet aujourd’hui, n’est-ce pas la forme plus que le fond qui nous intéresse ? Et n’en sera-t-il pas bientôt de même pour Duby, Braudel ou Hobsbawm ? L’écriture historique serait-elle par nature sujette à péremption sur le fond ? Est-elle condamnée à perdre en validité avec le temps et les inéluctables progrès de la discipline ? Autrement dit, notre intérêt pour elle aurait-il vocation au pire à s’estomper ou, au mieux, à glisser avec le temps du registre du véridique à celui de l’esthétique ?
Jacques Revel
L’hommage de Nora auquel vous faites référence peut sans doute être compris comme celui d’un académicien — et d’un éditeur — à un autre académicien. Que Duby ait été un grand écrivain d’histoire, nul n’en doute, comme Braudel l’avait été avant lui. Devrait-on oublier pour autant que Duby été un grand savant, un homme qui n’a pas seulement écrit de beaux livres mais qui a joué un rôle majeur dans le renouvellement de notre connaissance du Moyen Âge, en même temps qu’un artisan rigoureux, exigeant, toujours soucieux d’étayer et d’argumenter son propos ? Jouer l’un contre l’autre, le beau style contre le savoir, me semble mal venu. Je ne pense pas que l’on puisse penser la relation entre le fond et la forme dans les termes d’un choix alternatif. Pour prendre un autre exemple, on sait que Carlo Ginzburg a été un des plus rudes critiques de Hayden White et de ses thèses formalistes. Pourtant il est lui-même, tout à la fois un historien érudit, toujours soucieux de la preuve, et un auteur qui a su mobiliser de brillantes ressources rhétoriques avec une efficacité extrême à travers son œuvre depuis plus d’un demi-siècle. Cela dit, la connaissance historique est révisionniste, au meilleur sens du terme, elle l’est dans son principe. L’œuvre de Duby a renouvelé en son temps ce que nous savons de la société féodale. Elle a commencé à être révisée et complétée par les travaux de ceux-là même qu’elle avait inspirés et qui ont poursuivi et, pour une part, renouvelé ses enquêtes. Il n’y a rien là que de très normal. Il se peut que dans un avenir plus ou moins lointain, il reste surtout de Georges Duby une pensée forte et une grande écriture, comme c’est le cas pour Gibbon, pour Michelet, pour Fustel de Coulanges, que nous continuons de lire. On ne saurait pour autant oublier que son ambition ne s’est pas bornée au grand style, quand bien même il aura su, par son talent d’écrivain, faire exister, faire comprendre aussi, la profondeur des temps passés.
L’œuvre de Duby a renouvelé en son temps ce que nous savons de la société féodale. Elle a commencé à être révisée et complétée par les travaux de ceux-là même qu’elle avait inspirés et qui ont poursuivi et, pour une part, renouvelé ses enquêtes. Il n’y a rien là que de très normal.
Jacques Revel
En écho aux écrivains qui viennent « braconner » en terres historiennes, ces dernières années, un certain nombre d’historiens ont publié des ouvrages échappant aux formes classiques de l’écriture savante, notamment en assumant un prisme subjectif voire littéraire. Je pense par exemple à ces livres dans lesquels des historiens se penchent, à la première personne du singulier, sur leur « roman familial », à l’image de ceux de Stéphane Audoin-Rouzeau, Chiara Frugoni, Mark Mazower ou de Camille Lefebvre. Quel regard portez-vous sur cette tendance historiographique qui tend à brouiller ou en tout cas à redéfinir les distinctions classiques entre histoire et littérature ?
Sabina Loriga
Dans cette vague d’histoire à la première personne, on trouve des ouvrages de nature très différente. Certains sont des mémoires dans la lignée initiée par Saül Friedländer, d’autres des ego-histoires souvent issues de mémoires d’habilitation à diriger des recherches, d’autres encore sont des romans de famille. La nature et la qualité de ces ouvrages sont inégales et il est donc difficile de généraliser. Ces historiens articulent de manière nouvelle et plus vivante expérience personnelle et processus historique. Dans la plupart des cas, ils expriment le désir de sortir d’une vision surplombante de l’histoire et de reconnaître le fait qu’ils parlent à partir d’une histoire particulière, d’une position. Tout ceci me semble être extrêmement intéressant. Il peut toutefois y avoir dans cet exercice de l’histoire à la première personne une dérive identitaire. J’entends par là que la question historique est remplacée par une interrogation sur soi-même ou sur son groupe d’appartenance et que l’auteur devient le centre de la réflexion. Ce choix est peut-être dicté par la volonté d’assumer le fait que ce n’est qu’un point de vue et le refus du surplomb que j’évoquais. Mais le résultat risque parfois d’être le contraire de ce qui était recherché, à savoir une exposition excessive de l’historien omniscient.
Ivan Jablonka est sans doute celui qui pousse le plus loin ce rapprochement entre l’histoire et la littérature en théorisant le fait que « l’histoire est une littérature contemporaine ». Qu’en pensez-vous ?
Le plaidoyer d’Ivan Jablonka en faveur d’une nouvelle rencontre entre histoire et littérature me semble trop optimiste. Lorsqu’il parle de l’histoire comme d’un militantisme de la vérité s’exerçant toujours en milieu hostile contre la tromperie, le déni et le mensonge, j’ai l’impression qu’il présente une vision glorieuse de la discipline. Je pense pour ma part que le rapport de l’historien au passé a toujours une dimension mélancolique dans la mesure où il est fondé sur le décalage entre l’histoire et le passé et que l’historien sait qu’il ne peut pas adhérer complètement au passé. On pourrait dire pour reprendre une phrase célèbre que le passé demeure toujours un lieu étranger. Cette inquiétude mélancolique me semble être une qualité éthique et esthétique de l’histoire.
Tout n’est donc pas stylistiquement et rhétoriquement permis à l’historien ?
Dans un livre qui a eu en son temps un grand succès, Certitudes meurtrières (1991), l’historien Simon Schama n’hésite pas à inventer des monologues intérieurs ou des dialogues imaginaires. Il y a là un saut que je trouve dangereux. Il revendique de pouvoir entrer dans les pensées d’autrui, ce qui me semble être le propre de la fiction. Cette prétention omnisciente au psychisme de l’autre me paraît très problématique. Que l’imagination joue un rôle important en histoire est incontestable, et Georges Duby dont nous parlions a d’ailleurs écrit un beau texte à ce sujet. Toutefois, je pense que l’imagination historienne n’est pas la même que l’imagination qui est à l’œuvre dans la fiction. Elle ne cherche pas à s’élever au-dessus de la réalité et doit respecter certaines limitations, à commencer par le fait que nous écrivons des choses qui peuvent être contrôlées par d’autres. Si nous renonçons à cette possibilité, il me semble qu’on sort du cadre historiographique. Je prône une forte confrontation avec la littérature, mais je plaide aussi pour une auto-limitation volontaire des historiens.
Au terme de votre enquête, quel bilan tirez-vous de la « querelle linguistique » qui a secoué l’historiographie dans le dernier quart du XXe siècle ? Votre livre montre que l’histoire en est ressortie inquiétée : n’est-ce pas finalement une bonne chose ? Le doute n’est-il pas au fondement de toute démarche savante ?
Jacques Revel
La première chose qui nous importait était de reconnaître et de faire reconnaître que le tournant linguistique a eu lieu. Il faut ensuite, et c’est ce que nous avons tenté de faire, essayer de le comprendre, comme un ensemble de propositions que nous ne sommes pas tenus d’accepter, et comme le symptôme d’un état de l’historiographie à un moment donné. Ce moment est derrière nous, ce qui ne signifie pas que les questions qui ont alors été posées ont tout perdu de leur pertinence, ni même de leur acuité. La production historique a vécu pendant les décennies d’après-guerre dans un régime de certitudes positives, dans l’idée qu’elle était capable de produire des connaissances qui seraient cumulatives à terme plus ou moins proche. Il importe de reconnaître qu’elle l’a fait, et de manière impressionnante. Des avancées dans le « territoire de l’historien », pour reprendre le titre célèbre d’un livre d’Emmanuel Le Roy Ladurie (1973), on attendait qu’elles promettent la découverte et la maîtrise d’un territoire unifié. Cette confiance s’est ébranlée au cours des années 1970 et ce n’est certainement pas un hasard.
Alors, nos sociétés, celles dans lesquelles nous vivons, sont elles-mêmes entrées dans un temps de fortes incertitudes : dans un ensemble de crises que nous n’étions pas capable de comprendre, ni même, pendant longtemps, de décrire. C’est le moment où l’on a commencé à prendre conscience de la limitation des ressources de la planète, suivi du premier choc pétrolier qui nous a confronté à notre dépendance à l’égard des ressources énergétiques, puis d’une massive montée du chômage. En quelques années, cette rupture avec les perspectives d’une croissance qui avait semblé devoir être sans limites depuis les années d’après guerre n’a pas seulement affecté les mondes sociaux, en attendant la prise en compte de la crise climatique. L’avenir, dans lequel nos sociétés se projetaient si volontiers auparavant et dont la perspective commandait nos anticipations, est devenu incertain, opaque. Cette « crise de l’avenir » a altéré plus largement notre rapport au temps historique. Mis à distance, le passé ne nous enseigne plus grand chose. Il nous offre au mieux un refuge nostalgique. La dimension du présent, dans laquelle nous nous enfermons depuis un demi-siècle, ce que François Hartog a appelé le « présentisme », ne peut qu’affecter notre rapport à l’histoire et la confiance qui lui était auparavant associée. C’est sur ce terreau que le tournant linguistique s’est enraciné. Il est lui aussi l’expression du régime d’incertitude qui a affecté l’histoire, cette vieille discipline, familière, dont nous attendions qu’elle nous rassure sur ce que nous étions et sur ce que nous étions promis à être. Elle a commencé à s’interroger sur ses démarches, sur son statut, sur la fonction qui pouvait être la sienne et qui était en train de perdre de son évidence. L’histoire, et en particulier l’histoire sociale au sens très large qu’elle avait pris pendant les dernières décennies, avait profondément renouvelé nos connaissances et nos approches du passé. Puis est venu le moment où l’on a commencé à se demander ce qu’on ferait de cette masse de résultats en tous sens. L’invention méthodique qui avait tant marqué les années 1950-1970, à quoi nous menait-elle à la fin ? Est-ce qu’une histoire serait possible à partir de toutes les histoires que nous étions en train de produire ? Ont émergé toute une série de questions sur le métier, sur notre manière de le pratiquer, sur nos habitudes de penser, qui n’ont pas seulement engendré le tournant linguistique mais aussi, par exemple, la microstoria italienne ou l’Alltagsgeschichte en Allemagne : elles aussi sont nées de cet ébranlement des convictions positives. Il faut se rappeler ce contexte pour comprendre que les questions que le linguistic turn a posées au métier d’historien relevaient d’abord d’une interrogation réflexive. Dans certains cas, celle-ci a pu déboucher sur des formulations extrêmes, parfois jusqu’à l’absurde. Mais nombre de ces questions ont été pertinentes et le restent aujourd’hui. Comme il arrive souvent, les questions posées sont plus importantes que les réponses qu’on y a apportées. Du linguistic turn, nous avons moins l’idée qu’il a proposé des solutions que la conviction qu’il a été l’occasion de poser des interrogations qui demeurent valides. Le cycle du linguistic turn appartient désormais au passé, mais le retour réflexif de la discipline sur elle-même, sur ses certitudes provisoires, demeure à l’ordre du jour. Et c’est très bien ainsi.
L’avenir, dans lequel nos sociétés se projetaient si volontiers auparavant et dont la perspective commandait nos anticipations, est devenu incertain, opaque. Cette « crise de l’avenir » a altéré plus largement notre rapport au temps historique. Mis à distance, le passé ne nous enseigne plus grand chose. Il nous offre au mieux un refuge nostalgique.
Jacques Revel
Pour terminer, j’aimerai demander à chacun d’entre vous de me donner sa définition de l’histoire et de sa fonction dans le monde du XXIe siècle. Pourquoi et comment faire encore de l’histoire aujourd’hui ?
Sabina Loriga
L’histoire est une recherche. Cela peut sembler banal mais c’est très important car c’est une recherche qui implique un décentrement à l’égard de soi-même, un transfert dans une autre époque, un autre présent. Cela implique que l’historien ne connaît pas la fin de sa recherche. Nous avons avec Jacques une passion commune pour Siegfried Kracauer qui disait que le voyage dans le passé n’est pas un simple aller-retour. Lorsqu’on revient du passé, on n’est plus le même que quand on y est parti, on a changé sa forma mentis. C’est selon moi la valeur la plus belle de la recherche historique. En outre, l’histoire vit sous la férule de la vérité. L’historien s’engage à fournir des informations sur une réalité et à soumettre cette interprétation à une vérification. Cependant la vérité de l’histoire n’est pas une posture comme le pensait Ranke, ni un résultat, mais une inspiration, une tension. En d’autres termes, précisément parce que l’histoire poursuit un projet de vérité, elle est confrontée à la question des limites de la vérité historique. Ce qui me semble avoir été remis en discussion par le linguistic turn, c’est le projet d’une résurrection du passé. Je pense qu’on ne peut plus nourrir un tel projet aujourd’hui. Cette forme d’hybris n’a au demeurant pas toujours existé et de ce point de vue, le tournant linguistique récupère des réflexions plus anciennes. Il suffit de lire le texte de Wilhelm von Humboldt sur la tâche de l’historien (1821) ou l’Historik de Johann Gustav Droysen pour s’apercevoir qu’il y avait là des questions qui sont les mêmes que celles soulevées par le tournant linguistique. Je pense que cette inquiétude est une prise de conscience positive. Voilà pour la dimension « interne », vue du point de vue de l’historienne que je suis.
Il y a aussi dans votre question une facette « externe » qui concerne le rôle de l’histoire dans la société dans un moment complexe et difficile en général mais aussi plus particulièrement marqué par une perte de confiance dans le récit historique. Nous avons dit que cette perte de confiance vient d’une part de certains événements historiques qui l’ont brisée. Mais elle vient aussi de certains mouvements politiques. Dans le cas nord-américain, les mouvements afro, féministe, gay ont, dans les dernières décennies, remis en question l’idée qu’il puisse y avoir une histoire unifiée, qu’elle soit nationale ou universelle. Ce changement qui avait été diagnostiqué de manière prophétique par Lyotard ouvre une nouvelle manière de penser l’histoire dans la société. La réponse ne peut en conséquence pas être donnée par les seuls historiens mais d’un point de vue politique plus large : notre société peut-elle renoncer à une histoire unique et consensuelle ? Comment répondre à la demande de pluralité portée par ces mouvements ? Peut-on vivre avec des passés, des histoires, des mémoires différentes ? Comment peut-on former des désaccords qui respectent l’autre et portent une responsabilité partagée au présent ? Je ne pense pas que les historiens seuls pourront répondre à ces questions. C’est un travail qui engage l’ensemble de la société pour apprendre à vivre en désaccords. Mais cela implique des responsabilités déontologiques plus importantes pour les historiens qui doivent être d’autant plus rigoureux dans leur manière de s’exprimer dans l’espace public.
Ce qui me semble avoir été remis en discussion par le linguistic turn, c’est le projet d’une résurrection du passé. Je pense qu’on ne peut plus nourrir un tel projet aujourd’hui.
Sabina Loriga
Jacques Revel
Du point de vue interne, pour reprendre la distinction qu’a proposée Sabina, je définirai l’histoire comme un exercice de connaissance réalisé sous contraintes : contrainte des traces sur lesquelles nous travaillons, contrainte des règles de la preuve, contrainte de l’intention véritative qui est inséparable de toute ambition de connaissance. Je crois qu’il est très important de rappeler ce dernier point à un moment où, sur les marges du linguistic turn, ces contraintes ont pu être remises en question. Je vois aussi l’intérêt d’un exercice sous contrainte. Après tout, nous travaillons tous avec des jeux d’hypothèses qui sont autant de clefs que nous essayons, mais c’est parfois la serrure que nous recherchons avant de pouvoir y essayer une clef. Je suis très attaché à cette dimension expérimentaliste de l’histoire. Il y a là un jeu sous contrôle dont il est essentiel d’expliciter les règles. Cela vaut pour les gens du métier, mais aussi, bien sûr, pour ceux qui nous lisent. Cet effort de dépaysement, d’estrangement, que nous nous imposons, car il est inséparable de toute connaissance historique, il est nécessaire de le faire partager aux gens qui ont la patience de nous lire. Non pas pour produire des coups de théâtre mais pour rendre sensible ce décentrement, ce pas de côté qui nous permet de sortir des évidences du sens commun. Ce qui est vrai des historiens l’est aussi d’un certain nombre d’écrivains. Les Disparus de Daniel Mendelsohn est un livre qui repose tout entier sur ce phénomène d’estrangement : comment, au fil d’une enquête, réussir à faire comprendre un monde qui ne nous est pas, ne nous est plus compréhensible, qui ne l’a probablement pas été pour ceux qui en ont été les protagonistes ? Comment trouver le bon angle, la bonne focale, pour faire comprendre ce qui s’est passé à partir de traces discontinues ?
S’agissant de la dimension externe, cette fois, je partage le souci de Sabina d’un dialogue entre les historiens et la société dans laquelle ils vivent. Il y a soixante-dix ans, on pouvait encore faire apprendre aux enfants d’Afrique ou d’Indochine que leurs ancêtres étaient des Gaulois qui vivaient dans des huttes de paille. Aujourd’hui, il est devenu difficile d’enseigner l’histoire de France dans nombre de collèges ou de lycées de l’Hexagone. Depuis une génération, on rappelle utilement que l’histoire du monde n’est pas seulement celle de l’Europe mais qu’elle est faite de plusieurs histoires : des histoires dont les rythmes, les formes et les enjeux ont pu être très différents, qui se sont ignorées mais aussi croisées plus ou moins durablement, qui se sont combattues ou dominées ou émancipées, etc. Le constat s’impose aujourd’hui mais il laisse bien des questions ouvertes. Et d’abord : comment rendre compte d’une histoire polyédrique, qui rendrait à chacune de ces histoires la place qui lui revient ? C’est un problème posé et qui, pour l’heure, n’a pas trouvé de solution satisfaisante. C’est une des questions qui se posent aujourd’hui, tout à la fois en termes de connaissances et d’écriture de l’histoire. Elle s’adresse en premier lieu aux historiens, mais elle met en cause aussi ce que pourrait être le statut de l’histoire dans les sociétés de demain.

