Michael Mann, Fascists, Cambridge, Cambridge University Press, 2004

Ce livre est une tentative ambitieuse de définir le fascisme dans un contexte européen. En se concentrant principalement sur le fascisme en tant que mouvement, Michael Mann cherche notamment à le comparer aux autres formes d’autoritarisme de droite qui émergèrent en Europe pendant l’entre-deux guerres. Pour ce faire, il considère trois grands critères : la composition sociologiques des différents partis et mouvements autoritaires ; les conditions économiques des pays dans lesquels ils ont émergé ; la vision de l’État qui était portée par ces mouvements. Cette approche est déclinée dans plusieurs chapitres qui étudient des mouvements particuliers, examinant tour à tour les fascistes italiens, allemands, autrichiens, hongrois, roumains et espagnols. Au terme de son tour d’horizon, il semble conclure que la capacité d’un parti fasciste à s’imposer dépend de plusieurs facteurs : l’unité interne du mouvement ; sa capacité à trouver du soutien aussi bien du côté du patronat que des classes moyennes et ouvrières ; à contrôler l’appareil d’État en s’imposant notamment à l’armée ; à s’affranchir, enfin, des alliés de circonstance (conservateurs, nationalistes, traditionalistes) qui l’ont accompagné dans la conquête du pouvoir.
Rien de surprenant à ce que Michael Mann prête si peu d’attention aux motivations individuelles des fascistes (ce que l’on peut regretter) puisque dès son premier chapitre, il explique que pour comprendre les fascistes, il faut comprendre les mouvements fascistes. Il aboutit donc à un portrait important, mais quelque peu schématique du militant fasciste (pendant la phase de conquête) : de jeunes hommes, dans leur majorité anciens combattants, insatisfaits de leur place dans la société de l’après-guerre, et souvent idéalistes — une dimension qu’il creuse assez peu. Quelques études de cas auraient peut-être enrichi ce livre important dans la compréhension européenne du fascisme et des mouvements d’extrême droite qui ont interagi avec lui.
Emilio Gentile, E fu subito regime. Il fascismo e la marcia su Roma, Roma-Bari, Laterza, 2012 (Gallimard, 2015 pour la traduction française)

Ce livre fait le choix de proposer une interprétation du phénomène fasciste en étudiant minutieusement un moment clef de son histoire : son arrivée au pouvoir. D’emblée, Gentile fait remarquer que l’historiographie disponible a peu pris au sérieux cette autre « révolution d’octobre » (le sous-titre français). Souvent ramené à une pantalonnade un peu grotesque, l’arrivée au pouvoir de Mussolini est ici remise en perspective : elle permet à la fois d’éclairer les débuts du parti fasciste, tant du point de vue de sa formation idéologique que de son action violente au service des patrons et des propriétaires terriens. L’historien cherche aussi à comprendre comment Mussolini devenu Président du Conseil a immédiatement entrepris de démanteler la démocratie parlementaire pour imposer sa dictature tout en renforçant toujours plus le rôle du parti au sein de l’appareil d’État et dans la société. Le récit des premières années du fascisme permet de voir combien le chef du mouvement réussit à imposer le programme qui était le sien avant la prise du pouvoir : le prisme du moment charnière de la prise du pouvoir s’avère ainsi être une boussole extrêmement pertinente pour comprendre le phénomène politique et social qu’a représenté le fascisme.
Robert Paxton, The Anatomy of Fascism, New York, Alfred A. Knopf, 2004 (Seuil, 2004 pour la traduction française)
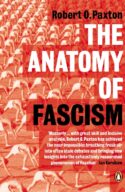
Ce livre marque l’aboutissement de décennies de recherches sur les droites radicales et l’Europe de l’entre-deux guerres et il embrasse des questions très diverses. Robert Paxton fait d’abord le choix de ne répondre qu’à la fin du livre à l’éternelle question de la définition du fascisme. Il souligne notamment l’importance des passions mobilisatrices dans l’avènement des régimes tombant dans cette catégorie.
Mais avant de se risquer à une tentative de définition, l’historien américain cherche d’abord à identifier les causes structurelles de l’arrivée des fascistes au pouvoir : l’avènement des masses en politique ; la force mobilisatrice du nationalisme ; les échecs des différentes alternatives politiques, qu’elles soient communistes, socialistes ou libérales. Ce dernier est point est particulièrement riche sur l’incapacité des concurrents du fascisme à proposer une offre politique qui séduisent les classes populaires et moyennes : trop radicaux, les communistes de l’entre-deux guerres se sont aliénés des pans entiers de la population ; malgré leur modération, les socialistes pâtirent de leur proximité supposée avec le frère ennemi communiste (sans parler de la violence des campagnes de l’extrême droite qu’ils suscitèrent) ; les libéraux, enfin, ne surent pas proposer une alternative aux défis économiques de l’immédiat après-guerre et surtout des années 1930. La rénovation doctrinale entamée au colloque Lippmann ne devait effectivement porter ses fruits qu’après la guerre. À ces explications structurelles s’ajoute une évaluation des stratégies politiques utilisées par les mouvements fascistes et de l’aveuglement des partis conservateurs qui crurent qu’il était possible de les instrumentaliser dans leur lutte contre tous les projets de réforme sociale. En creux Paxton réfléchit à la capacité de mouvements politiques d’abord très minoritaires à se saisir du pouvoir en quelques années en tirant efficacement profit de l’agitation sociale et politique de l’Europe de l’entre-deux guerres. Une question de kairos, en somme ?
D’autres questions sont finement traitées : celle de la prise et de l’exercice du pouvoir et celle de l’évolution des régimes fascistes. Ce dernier chapitre, qui oppose le régime franquiste — caractérisé par son « entropie » — au fascisme italien et au nazisme — marqués par leur « radicalisation », c’est-à-dire la violence de masse —, laisse un peu sur sa faim, quoiqu’il demeure très stimulant. Enfin l’avant-dernier chapitre est d’une grande utilité aujourd’hui, puisqu’il réfléchit à l’évolution du fascisme dans le temps long. Il fait une utile analyse des différents mouvements qui, en Europe de l’Ouest, ont participé à la reconstruction des extrêmes droites en évaluant notamment ce qu’il reste du fascisme classique dans les programmes politiques des partis de droites radicales (qui sont pour la plupart issus ou ont amalgamé à l’origine des groupuscules explicitement fascistes dans les années 1950 et 1960).
Quant à la question de savoir si le fascisme, c’est-à-dire son retour au pouvoir, est toujours possible, il apportait, en 2004, rappelons-le, une réponse pleine de pessimisme : l’Europe étant le continent où l’héritage du fascisme demeure le plus vivace, les nouveaux habits des chemises brunes et noires — c’est-à-dire la normalisation observée dans de nombreux partis d’extrême droite — lui paraissent plein d’un triste potentiel dans un monde qui ne parviendrait plus à garantir une croissance continue du niveau de vie.
Arno Mayer, Les furies : violence, vengeance, terreur aux temps de la Révolution française et de la Révolution russe, traduit par Odile Demange, Paris, Fayard, 2002 et Zeev Sternhell, Les anti-Lumières : une tradition du XVIIIe siècle à la guerre froide, édition revue et augmentée, Paris, Gallimard, 2010 (2006)

Ces deux livres posent, chacun à leur manière, la question de l’inscription du fascisme dans un phénomène intellectuel séculaire en Europe puis aux États-Unis : le rejet de la pensée des Lumières — dont les contours sont parfois trop imprécis — et de la Révolution française comme événement fondateur d’une forme de modernité politique.
Mayer examine les processus de radicalisation violente qu’entraîne les révolutions, expliquant les politiques d’exception décidées par les gouvernements révolutionnaires en France et en Russie, par la résistance brutale des défenseurs de l’ordre ancien. Si l’analogie paraît parfois bancale, elle a le mérite d’ancrer l’irrationalisme revendiqué par le fascisme et le nazisme, et la violence qu’elle induit, dans le rejet de la Révolution française et de son héritage.

Sternhell se positionne quant à lui du côté d’une histoire purement intellectuelle : du XVIIIe au XXe siècle, il a l’ambition de décrire toutes les incarnations d’une pensée qui récuserait la modernité politique et sociale issue des Lumières. S’il donne parfois l’impression de peiner à sortir du cadre des bibliothèques, il parvient tout de même à dénouer le fil des différentes branches de la pensée contre-révolutionnaires qui ont été amalgamées par Mussolini dans la constitution d’une idéologie qui doit décidément se lire dans le temps long.
La compréhension du fascisme qui émerge de ses deux ouvrages paraît faire écho à une réplique de Blas, l’un des personnages les plus inquiétants du Flagellant de Séville de Paul Morand — cet étrange roman qui rend notamment compte du cheminement intellectuel d’un collaborateur (en l’occurrence, un Espagnol qui choisit de soutenir Napoléon en 1808) — : « La seule révolution vraie, c’est la contre-révolution, celle que nous faisons. »
Sergio Luzzatto, Il corpo del duce. Un cadavere tra immaginazione, storia e memoria, Einaudi, 1998 (Gallimard, 2014 pour la traduction française)

Le 28 avril 1945, au lendemain de son arrestation pendant sa tentative de fuite, Mussolini est fusillé, transféré à Milan où son corps, battu au point de le rendre méconnaissable, est pendu par les pieds, aux côtés de celui de Clara Petacci. Le Comité de libération de l’Italie du Nord publie un communiqué expliquant la violence de l’épisode en écrivant que c’était la « conclusion nécessaire d’une phase historique qui laisse notre pays dévasté matériellement et moralement ». L’exposition du cadavre de Mussolini devait permettre une « coupure nette avec le passé ».
Tout le travail de Sergio Luzzatto consiste à montrer qu’il n’en fut rien. De la conquête du pouvoir jusqu’à sa chute, le corps du duce avait sans cesse été instrumentalisé par le mouvement puis par le régime fasciste. Avant la prise de pouvoir, il était convalescent, signalant le comportement héroïque du chef au combat. Une fois arrivé à la tête du pays, on donne à voir un corps glorieux et charismatique, dont l’image est démultipliée : pendant près de deux décennies, les Italiens ne cessent de voir leur dictateur. Cette empreinte ne s’efface donc pas en deux jours et cette réalité n’échappe pas aux nouvelles autorités. Après l’exhibition du cadavre de Mussolini, celui-ci est d’abord jeté dans une fosse commune avant d’être caché dans un placard fermé à clef du monastère capucin de Cerro Maggiore (Lombardie). Il n’est rendu à sa famille qu’en 1957.
Ces douze années sont au cœur du livre de Luzzatto. Le corps occulté du dictateur permet de saisir les tensions qui traversent la société italienne de l’immédiat après-guerre. Les lois d’amnistie n’ont pas permis de faire le procès du fascisme, au-delà de certaines figures de la République de Salò, et même s’ils étaient exclus de l’arc constitutionnel, les post-fascistes du Movimento Sociale Italiano étaient présents dans la vie politique. À cela s’ajoute le fait qu’une partie de la population conserve une forme de déférence pour la figure de Mussolini. En parallèle, la mémoire de la résistance au fascisme — de Matteoti, massacré en 1924, jusqu’aux partisans — peine à émerger, ne suscitant pas de vrai consensus. Dans ces conditions, il est difficile pour la jeune République de rendre le corps du duce : sa mise au secret témoigne de l’ombre que jette la dictature sur la société italienne.
Depuis que le corps du duce a été enterré à Predappio, il est effectivement devenu un lieu de pèlerinage où se pressent des dizaines de milliers de personnes chaque année…
Pauline Picco, Liaisons dangereuses. Les extrêmes droites en France et en Italie (1960-1984), Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2016

Il y a quelques années disparaissait la flamme tricolore — bleue, blanche et rouge — qui ornait les affiches et les tracts du Front national depuis sa fondation. Marine Le Pen voulait se débarrasser d’un logo qui renvoyait aux décennies de présidence paternelle. De son côté, Giorgia Meloni refuse de se débarrasser de sa propre flamme tricolore — verte, blanche et rouge — qui est pourtant le symbole des post-fascistes italiens depuis 1947 (l’une des scissions les plus radicales du Movimento Sociale avait même pris le nom de “Fiamma tricolore” dans les années 1990 !).
Avant cette divergence iconographique, les deux partis qui en France et en Italie ont occupé, pendant des décennies, l’extrême droite du champ politique ont longtemps partagé une image — et plus encore. En partant des liens forts entre l’OAS et les néofascistes italiens jusqu’à la manière dont le jeune Front national voulu émuler dans les années 1970 le Mouvement Social Italien, ce dont Jean-Marie Le Pen, toujours prompt à effacer tout ce qui ne le mettait pas au centre du jeu, s’est souvent défendu, Pauline Picco revient sur près de trois décennies d’histoire violente de l’extrême droite française et italienne : à côté de l’institutionnalisation partisane, elle raconte aussi la manière dont le terrorisme, de l’Algérie française aux années de plomb italienne, s’est organisé de part et d’autres des Alpes. Comprendre cette période de co-construction, faite d’inspirations mutuelles, de circulations intellectuelles et, parfois, de tensions, offre un éclairage précieux sur une période clef dans la reconstitution en Europe de l’Ouest de partis d’extrême droite capables de s’engager efficacement sur le terrain de la compétition électorale.
Aujourd’hui, flamme ou pas flamme, Giorgia Meloni est en passe de devenir Présidente du Conseil, tandis que Marine Le Pen est devenue une habituée du second tour des élections présidentielles françaises.
Marie-Anne Matard-Bonucci,Totalitarisme fasciste, Paris, CNRS Éditions, 2018

On a longuement hésité entre ce livre et, de la même autrice, L’Italie fasciste et la persécution des juifs (2012). L’un comme l’autre incarnent toute l’originalité du travail de Marie-Anne Matard-Bonucci. Celle-ci a profondément transformé nos conceptions du régime fasciste en insistant sur trois de ses caractéristiques, étroitement liées : la centralité de la violence, du racisme et de l’antisémitisme dans la formation de la doctrine et de l’État fasciste. Alors qu’une part importante de l’historiographie a longtemps sous-estimé l’ampleur des violences racistes commises par l’État italien. Son livre permet de faire le point sur la politique fasciste en la matière. Bien que largement séparés dans leurs conceptions et leur réalisation, l’Italie est le seul pays à avoir expérimenté au même moment une politique raciste coloniale, fonctionnant parfois sur un mode génocidaire, et un véritable antisémitisme d’État. Le cynisme des dirigeants et des intellectuels fascistes éclatent à chaque page dans la conception et l’application des lois raciales qui, à partir du mois de septembre 1938, vont précipiter l’exclusion des juifs italiens de la société, préparant la déportation de communautés entières à la fin de la guerre. : l’antisémitisme était conçu comme un « mythe pour l’action » permettant d’accélérer l’invention de l’homme nouveau que Mussolini ambitionnait de créer puisque l’exclusion d’une partie de la population permettait de renforcer le sens d’une communauté italienne dotée d’un rôle à part dans l’histoire.
Dès avant la prise du pouvoir, la violence joue un rôle similaire dans l’invention de la doctrine fasciste. Si elle est profondément politique, organisation la persistance de l’expérience du front, elle a aussi une fonction sociale : la brutalité des squadristes est déterminante dans la restauration d’un ordre profondément ébranlé par le biennio Rosso (1919-1920) qui a tant paniqué le patronat italien.
Les livres de Marie-Anne Matard Bonucci sont importants parce qu’ils rendent le fascisme à la vérité de son ambition totalitaire. Il n’est pas question en la lisant de ne pas prendre au sérieux un régime qui a duré plus de vingt ans en se maintenant par la violence et en organisant dans son empire des politiques d’extermination des populations d’une rare férocité.
Christopher Duggan, Fascist Voices : An Intimate History of Mussolini’s Italy, Oxford, Oxford University Press, 2012 (Flammarion, 2014, pour la traduction française)
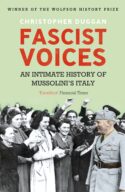
Quelles sont les motivations de l’engagement politique dans un État totalitaire. Dans ce livre important, Christopher Duggan s’efforce de trouver une réponse à une question ouverte dans les années 1970 par Renzo de Felice dans sa biographie de Mussolini : quelle fut l’ampleur exacte de l’adhésion populaire au fascisme en Italie ? L’historien italien avait soulevé un tollé en arguant, au regard de la faiblesse des oppositions jusqu’en 1943, que le soutien avait été important. Pour Duggan, depuis cette époque, les débats politiques contemporains avaient sans cesse brouillé le débat, compliquant toute investigation sérieuse en la matière. Se posait par ailleurs la question des sources. L’histoire n’a pas encore trouvé la méthode pour sonder les âmes et, dans un régime, où la parole publique était sans cesse soumise à la censure et aux déformations de l’État, il est encore plus difficile de trouver des éléments solides pour s’assurer que les gens pensent ce qu’ils disent ou écrivent. Cette contrainte a obligé l’historien a considéré un riche matériau documentaire composé de journaux intimes, publiés ou non, et de correspondances privées. Si la majorité de ces textes datent de la fin des années 1930, à un moment où le régime paraît stabilisé, Duggan peut néanmoins tirer des conclusions sur le sentiment politique dans l’Italie fasciste. Reprenant à son compte le concept d’Emilio Gentile sur la « religion politique » du fascisme, il analyse plusieurs aspects clefs de la politique menée par le régime analysés au prisme de leurs réceptions dans les écrits intimes. S’il est difficile de tirer des conclusions générales sur l’ampleur de l’adhésion au régime tant les sources utilisées sont complexes à utiliser, ce livre n’en demeure pas moins une plongée fascinante dans l’Italie fasciste qui permet de saisir, à hauteur d’hommes et de femmes, la multiplicité des raisons d’adhérer au régime. Par bribes, c’est une plongée dans le kaléidoscope des intimités fascistes.
[Si vous trouvez notre travail utile et souhaitez contribuer à ce que le Grand Continent reste une publication ouverte, vous pouvez vous abonner par ici.]
Paul Corner, Mussolini in Myth and Memory. The First Totalitarian Dictator, Oxford University Press, 2022
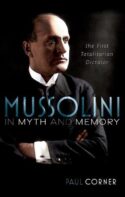
Paul Corner montre en quoi les comparaisons entre fascisme, nazisme et stalinisme, sont aussi éclairantes qu’aveuglantes. Éclairantes en ce que le régime politique forgé par Mussolini en Italie dans les années 1920 présente bien des similarités avec ceux mis en place par Staline et Hitler en URSS et en Allemagne. Aveuglantes en ce que cette comparaison tend à en minimiser les singularités et l’importance, comme s’il ne s’était agi que d’un « totalitarisme soft », incomparablement moins important que ses épigones allemand et soviétique. L’ombre portée du nazisme et du stalinisme complique ainsi l’appréhension de la dure réalité du fascisme. Surtout, elle tend à en faire relativiser la nocivité et fait donc le lit de sa réhabilitation. Tout autant qu’un livre sur l’histoire du fascisme, c’est donc un essai sur ses après-vie et les conditions de possibilité de son actualité que livre Paul Corner.
Giuseppe Parlato, Fascisti senza Mussolini. Le origini del neofascismo in Italia, 1943-1948, il Mulino, 2012

Le Mouvement social italien (MSI), héritier direct du fascisme, a été fondé à Rome en décembre 1946, à peine un an et demi après l’effondrement du régime mussolinien. Comment expliquer cette résurgence si précoce d’un courant politique dont on aurait pu penser qu’il était ressorti discrédité voire banni de la guerre ? Selon Giuseppe Parlato, la précoce renaissance du fascisme dans l’Italie de l’après-Seconde Guerre mondiale s’explique par sa capacité à se positionner dans le nouveau contexte qui est celui de la guerre froide. Plutôt que de jouer de la nostalgie du Duce, les néofascistes ont mis en avant la peur du rouge. Une stratégie qui s’est avérée d’autant plus payante qu’elle avait déjà été expérimentée au début des années 1920.


